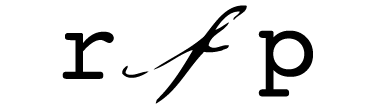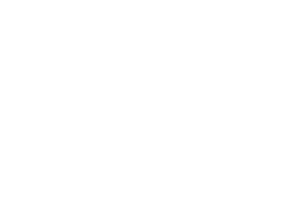Pulsion de vie
Présentation du numéro
Pulsion de vie, mais quelle vie, quand le vivant se caractérise plus par la cessation de ses fonctions – la mort – que par leur existence (Canguilhem) et qu’un vitalisme triomphant a pu recouvrir ce paradoxe ?
Aux commencements, il n’y avait que faim et amour (Liebe) (Freud, 1910i/1993, p. 182). La faim méritait à peine le nom de pulsion au regard de l’émergence conceptuelle de la notion : cette force constante qui pousse au-delà de l’objet du besoin et lie la naissance du psychique aux intermittences de l’excitation somatique. Et le scandale de la sexualité infantile ouvrait à la logique de l’après-coup : la pulsion sexuelle vient s’encastrer dans l’immaturité de l’ordre vital qu’il sera impossible de saisir psychanalytiquement en deçà du sexuel venu le recouvrir (Laplanche, 1982). Asymétrie entre pulsions sexuelles et pulsions d’autoconservation ou du moi, parfois appelées alors confidentiellement pulsions de vie dans les Minutes de la Société psychanalytique de Vienne.
Mais pourquoi le tournant des années 1920 restera-t-il celui de l’avènement de la pulsion de mort comme réponse aux impasses de la compulsion de répétition, alors qu’il est aussi celui de l’avènement officiel de la pulsion de vie par regroupement des pulsions sexuelles et des pulsions d’autoconservation (ou de l’une de leurs composantes) ? Dans pulsion de vie, aussi, il y a d’abord pulsion – l’un des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Pour Udo Hock, c’est bien la poussée furieuse de la pulsion qui est en jeu dans ce tournant. « À la pulsion sexuelle essentiellement perverse et polymorphe des Trois essais, s’oppose donc une pulsion de vie effrénée, der alles erhaltende Eros, à laquelle s’ajoutent désormais les pulsions d’autoconservation » (2007, p. 75).
En 1920, Éros est donc élevé au rang de concept et, si nous suivons Dominique Bourdin, apparaît avant tout comme une force témoignant de la tension inhérente à la vie, dynamique processuelle continue entre deux polarités aux multiples visages : individuel et supra-individuel, somatique et culturel, rassemblement unifiant du principe de liaison et individualisation disruptive du principe de plaisir ; tension philosophique enfin entre solipsisme et pensée du cosmos (2008). Tension déjà chez Paul Ricœur lecteur de Freud entre persévération de l’individu y compris monocellulaire dans son être et ouverture à l’altérité (1995), que nous retrouvons dans la pensée philosophique et scientifique sur le vivant par opposition à l’inerte propre à l’inorganique ou à la mort.
Chez les philosophes, avec en particulier la tension entre le besoin et la création, le clos et l’ouvert chez Bergson, mais aussi entre la vie et la mort, telle que Canguilhem propose de comprendre la fonction normative du vivant dans La Connaissance de la vie : « Entre le vivant et le milieu, le rapport s’établit comme un débat où le vivant apporte ses normes propres d’appréciation des situations, où il domine le milieu, et se l’accommode » (cité par Worms, 2009, p. 369).
Mais en 1920 il s’agit pour Freud d’autre chose que de penser le vivant. Et l’une de ses grandes hésitations – à la fois condensée dans ce texte et déployée de façon diachronique – concernera le statut des pulsions d’autoconservation : depuis la possible « opposition entre pulsions du moi (de mort) et pulsions sexuelles (de vie) » (1920g/1996, p. 316) au fait qu’avec l’introduction du narcissisme le moi lui-même est investi de libido et « qu’il en est même le berceau originel » (1930a/1994, p. 304).
Dès lors, il maintiendra l’axe épistémologique du matérialisme et de la conflictualité « entre l’inlassable tendance expansive de l’Éros et la nature en général conservatrice des pulsions » (ibid.) visant à restaurer un état antérieur de non-vie. Contre le danger d’une force de vie indifférenciée et univoque, nommément contre Jung, mais aussi contre la tentation de l’héritage romantique d’une philosophie exaltant la puissance démiurgique de la Natur. Monisme vers lequel s’était acheminée la synthèse nietzschéenne de l’affirmation de la Volonté de puissance (Assoun, 2008a, p. 176).
Pour Paul Denis, la théorie des pulsions « de vie » découlerait des « postulats biologiques » du tournant de 1920 : de forces psychiques elles deviendraient forces de la nature « dans une démarche métabiologique et non métapsychologique » (2002, p. 1805). Mais ce tournant n’est-il pas avant tout affirmation d’un logos que s’emploiera à liquider « la déferlante du bios » de l’idéologie nazie pervertissant les termes de « pulsion » et de « pulsion d’autoconservation » au service d’une naturalité pulsionnelle de la race et de la sauvegarde de son « espace vital » (Kahn, 2018) ?
Ainsi, à l’encontre de la romantisation manichéenne d’une pulsion « de vie » qui tendrait à la vie, vie n’est « qu’un déterminant différentiel nécessaire pour penser » le conflit pulsionnel fondamental à travers l’intrication et la désintrication, et « la psychanalyse ne saurait accréditer le moindre nouveau discours de la vie » (Assoun, 2008b, p. 306).
Mais Freud aurait-il déplacé sur l’opposition pulsion de vie/pulsion de mort les conflits de but entre autoconservation et sexualité, désir d’enfant et désir sexuel, survie de l’individu et de l’espèce (Guillaumin, 2002) ? C’est ici que Nathalie Zalztman postule une « pulsion anarchiste », ce mouvement qui tire sa force de la pulsion de mort et la retourne contre elle, force ultime de résistance, lorsque toute forme de vie possible s’écroule (1999) ; et que Vassilis Kapsambelis soutient, à partir de la clinique des désorganisations, qu’une part des pulsions du moi reste irrémédiablement rattachée à la pulsion de mort (2018).
Reste enfin que la force liante demeure l’exclusive des pulsions sexuelles, « pulsions de vie proprement dites » (Freud, 1920g/1996, p. 312), que Freud n’a jamais postulé d’autre énergie que la libido, et que de nombreux auteurs s’accordent, au-delà des principes de plaisir et de réalité, sur un principe de liaison passant avant la recherche de plaisir et articulant pulsion de vie et fonction objectalisante (Green, 2007) ; avec au fondement de la vie psychique le noyau masochique érogène primaire, de vie (Rosenberg, 1997).
Éros, agent de liaison dans le conflit pulsionnel fondamental entre pulsion de vie et pulsion de mort ? Autant de considérations dont nous n’avons pas épuisé la complexité et ouvrant à nombre de questions actuelles posées aux psychanalystes :
- Le soin : il a pu faire l’objet de débats serrés chez les psychanalystes. Mais comment rester vivant sans parler trop vite de mort psychique face à l’enfouissement défensif d’un noyau de survie derrière une vertigineuse immuabilité ? Degré zéro du soin entre réanimation qui ne soit pas activisme et effacement attentif qui ne soit pas indifférence, maintien des conditions de surgissement d’un signe de vie ;
- La clinique analytique : nous aurions à déployer toutes les figures des désintrications délétères et des impasses d’Éros dans son lien au moi et à l’objet ; l’enjeu est alors pour nos patients qu’ils puissent en premier lieu retrouver une cohérence, une unité interne, des limites, voire des défenses suffisantes (Letarte, 2018), qui leur permettent de renouer un commerce avec l’objet jusque-là trop menaçant. Cela passe réciproquement par une réceptivité suffisante de l’analyste (Roussillon, 2012), qui leur redonne confiance dans l’adéquation du monde à leurs besoins, la possibilité d’un équilibre narcissico-objectal si souvent en souffrance, à l’adolescence en particulier (Jeammet, 2002), condition d’une expression plus libre de la pulsion de vie. La nécessité vitale d’un accordage mieux tempéré entre le moi et son objet, y compris soignant ou analyste, n’est-elle pas ce qui fonde toute ambition thérapeutique ?
- L’amour, autre nom d’Éros, devrait avoir toute sa place ici. C’est de l’amour que naissent (théoriquement) les enfants, et donc que se perpétue (ou se perpétuait jusqu’à récemment) l’espèce. Et pourtant, il est aussi associé à la sexualité la plus crue, et aux menaces de la maladie et de la domination, sinon de l’agression. Mais la part d’une intersubjectivité inconciliable avec la sauvagerie de la pulsion à l’égard de son « objet » n’est jamais bien loin, et l’embrasement amoureux quasi cosmique de ceux qui sont seuls au monde voisine avec la violence passionnelle et le crime du même nom. Sous son nom d’agapè, ou de philia, il a pu paraître un temps suspect, comme tous les « bons sentiments », y compris aux psychanalystes. N’est-il pas la manifestation la plus éclatante de la pulsion de vie, quand l’ouverture la plus grande à l’altérité vient féconder l’épanouissement le plus complet de l’individu, erôs, agapè et philia ?
- La sublimation, comme l’amour, dans ses formes accomplies, ne réalise-t-elle pas au mieux une autre destinée de la pulsion de vie quand le souffle de l’inspiration et de la créativité la plus personnelle se donne irrémédiablement à l’épreuve de l’altérité ? L’art contemporain tient-il ces promesses ? Et le progrès scientifique ne suscite-t-il pas la crainte d’échapper à ses créateurs ? Mais au croisement d’un traumatisme collectif et intime Philippe Lançon ne vient-il pas avec Le Lambeau (2018) de nous offrir œuvre de vie ? Et en deçà de toute œuvre, la créativité n’est rien de plus pour Winnicott qu’un regard neuf sur le monde, « un mode créatif de perception qui donne le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue », même au bébé (1975, p. 91).
Le risque de « dévoiement » de la pulsion de vie ne tient-il pas à chaque fois à ce qu’elle perdrait cette réceptivité à l’altérité qui en fait l’essence ? Expression univoque d’un « principe de plaisir » égocentrique, sans contrepartie et désobjectalisant, qui prétend aller jusqu’au bout de sa « satisfaction » et semble gouverner la vie économique mondialisée, sans considération pour la destruction de la planète qui l’accompagne ?
Mais inversement, ne sommes-nous pas redevables à Freud d’avoir, après Hegel, réhabilité le négatif, gage de vie par la tension qu’il autorise, et en tout premier lieu par l’altérité nourricière et vivifiante de l’inconscient ?
Martine Girard et Benoît Servant
Références bibliographiques
Assoun P.-L. (2008a). Freud et Nietzsche. Paris, Puf.
Assoun P.L. (2008b). Métapsychologie. Dans A. de Mijolla, S. de Mijolla (dir.). Psychanalyse : 235-309. Paris, Puf.
Bourdin D. (2008). Éros et les pulsions de vie. Dans C. Le Guen. Dictionnaire freudien : 480-508. Paris, Puf.
Canguilhem G. http://www.universalis.fr/encyclopedie/vie/
Denis P. (2002). Un principe d’organisation-désorganisation. Rev Fr Psychanal 66(5) : 1799-1808.
Freud S. (1910i/1993). Le trouble de vision psychogène dans la conception psychanalytique. OCF.P, X : 179-186. Paris, Puf.
Freud S. (1920g/1996). Au-delà du principe de plaisir. OCF.P, XV : 273-338. Paris, Puf.
Freud S. (1930a [1929]/1994). Le malaise dans la culture. OCF.P, XVIII : 243-333. Paris, Puf.
Guillaumin J. (2002). Intrication et désintrication au sein des pulsions de vie entre pulsions du moi et pulsions sexuelles. Rev Fr Psychanal 66(5) : 1809-1823.
Green A. (2007). Pourquoi les pulsions de destruction ou de mort ? Paris, Éditions du Panama.
Hock U. (2007). Laplanches Trieb. Libres Cah Psychanal 1(15) : 73-84.
Jeammet P. (2002). Spécificités de la psychothérapie psychanalytique à l’adolescence. Psychothérapies 2 : 77- 87.
Kahn L. (2018). Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Paris, Puf ; https://www.rfpsy.fr/entretien-laurence-kahn/
Letarte P. (2018). Entendre la folie. Paris, Puf.
Kapsambelis V. (2018). Désorganisations et destructivité Rev Fr Psychosom 54(2) : 95-112.
Laplanche J. (1982). Vie et mort en psychanalyse. Paris, Flammarion.
Ricœur P. (1995). De l’interprétation. Essai sur Freud. Paris, Seuil.
Rosenberg B. (1999). Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie. Paris, Puf, « Monographies de psychanalyse ».
Roussillon R. (2012). Manuel de pratique clinique. Paris, Elsevier-Masson.
Winnicott D.W. (1975). Jeu et réalité. Paris, Gallimard.
Worms F. (2009). La Philosophie en France au XXe siècle. Paris, Gallimard, « Moments ».
Zaltzman N. (1999). De la guérison psychanalytique. Paris, Puf.
Éditorial
Cent ans après Au-delà du principe de plaisir
Ce numéro de la Rfp a été « bouclé » en mai 2020, au terme du confinement imposé par la pandémie de Covid19. Bien que son thème, « Pulsion de vie », résonne particulièrement avec les temps troublés que nous vivions, son élaboration était en cours depuis plus de dix-huit mois.
Ce thème interroge les rapports entre pulsions sexuelles et autoconservation ; il nous renvoie autant à notre interdépendance qu’à la dépendance vitale des premiers jours ou à celle de la maladie. On le verra dans les textes proposés : entre soins de survie somatique et psychique, créativité et « violations », l’autoconservation – qui apparaît moins « auto » que jamais – est souvent à la merci de l’autre, de son indifférence ou de son bon plaisir. Ces dimensions sont par ailleurs inséparables d’une remise en débat de l’articulation entre pulsions de vie et pulsions de mort initiée par le « tournant » de 1920 et, in fine,de la réaffirmation de la formidable puissance créatrice d’Éros.
De cette puissance créatrice témoignent notamment, dans le champ de la psychanalyse et à ses marges, quelques brèves réflexions de Paulette Letarte aux frontières de la mort, ou le prodigieux travail de Ziva Postec, monteuse du film Shoah de Claude Lanzmann. D’autres textes présentés dans les rubriques « Histoire de la psychanalyse » et en « Recherches » explorent quelques-unes des multiples dimensions de la vie, entre biologie et métapsychologie, depuis l’étude des anguilles (Rodrigo Alberto Cornejo Portilla) jusqu’aux manifestations de l’amour et de la mélancolie analysées par Rosine Perelberg et Catherine Chabert.
Sommaire
Éditorial – Cent ans après Au-delà du principe de plaisir
THÈME : PULSION DE VIE
Rédacteurs : Martine Girard, Benoît Servant
Coordination : Danielle Kaswin-Bonnefond
Martine Girard et Benoît Servant – Argument
La pulsion de vie, entre métaphysique, métapsychologie et métabiologie ?
Vassilis Kapsambelis – Freud et les sciences de la vie
Paul Denis – La pulsion de vie ou Éros sans sexe
Jessica Tran The – L’émergence de la pulsion de vie dans le corpus freudien : de la biologie helmholtzienne à la métapsychologie
La pulsion de vie dans la cure
Dominique Bourdin – Travailler avec les pulsions de vie ?
Guy Lavallée – Pulsion de vie : Lier coûte que coûte, investir sans fin, espérer toujours, aimer encore…
Yoann Loisel – De la pulsion de vie : l’adolescence et le soin institutionnel, ou la nécessaire cheville du tendre et du temps dans la thérapie des fonctionnements limites à l’adolescence
Jean-Baptiste Dethieux – Une pulsion de mort… pour aider à vivre
Pulsion de vie, créativité, création
Anne Brun – Le couple pulsion de vie/pulsion de mort à l’œuvre. Genèse du processus créateur et formes sensorimotrices
Frédéric Worms – Violation et création. Une autre lecture des pulsions de vie et de mort
Ziva Postec et Évelyne Chauvet – Rencontre avec Ziva Postec : « Comment j’ai monté le film Shoah », par Ziva Postec, suivi d’un entretien avec Évelyne Chauvet
Vivre aux frontières de la mort
Sabine Sportouch – Pulsion de survie en médecine-intensive réanimation. Le travail de l’affirmatif
Paulette Letarte – Considérations sur la vie et sur la mort
HISTOIRE DE LA PSYCHANALYSE
Rodrigo Alberto Cornejo Portilla – Temporalité psychique et théorie de l’évolution aux origines de la pensée de Freud : l’étude des anguilles et l’influence de Carl Claus
RECHERCHES
Rosine Jozef Perelberg – Amour et mélancolie dans les analyses de femmes par des femmes
Catherine Chabert – À propos du texte de Rosine Jozef Perelberg : « Amour et mélancolie dans les analyses de femmes par des femmes »
Anne-Valérie Mazoyer, Vincent Estellon, Marjorie Roques – Sexualité limite et processus mélancolique
Jacques Robion – Lacan et le péché du savoir
REVUES
Revue des livres
Julie Augoyard – The analyst’s reveries. Explorations in Bion’s enigmatic concept, de Fred Busch
Nicolas Gougoulis – Éclairs et ombres d’une rencontre. À propos du livre d’Henri Vermorel, Sigmund Freud et Romain Rolland. Un dialogue
Marie-Laure Léandri – Benno Rosenberg, une passion pour les pulsions, sous la direction d’Évelyne Chauvet
Michèle Pollak-Cornillot – Nul droit, nulle part. Journal de Breslau, 1933-1941, de Willy Cohn
Revue des revues
Hede Menke-Adler – Jahrbuch der Psychoanalyse 78, 2019 (« Annales de la psychanalyse »)
Michel Sanchez-Cardenas – Lu dans l’International Journal of Psychoanalysis 5 et 6, 2019
Revue des scènes
Anne Ber-Schiavetta – Les labadens en scène !
Visuel d’ouverture : Tempa del Prete. Tombe du plongeur (470 avant J.-C.). Paestum © Wikimédia-commons.