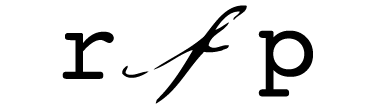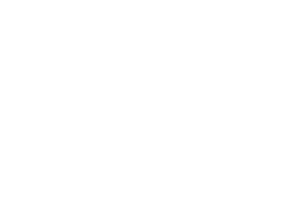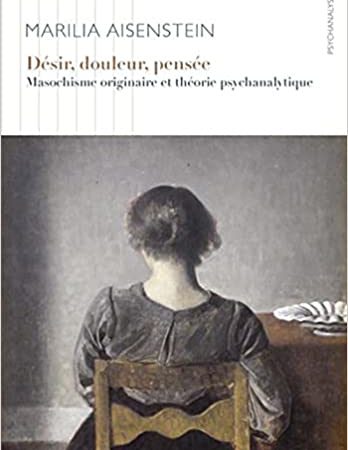
Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique
Marilia Aisenstein, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, Paris, Éditions d’Ithaque, 2020.
 Une grande partie du plaisir que procure la lecture du nouveau livre de Marilia Aisenstein, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, provient de ce qu’elle fait alterner des récits cliniques toujours saisissants avec des résumés de textes romanesques. Littérature et clinique s’éclairent mutuellement, et donnent facilement à voir les idées nouvelles que l’auteur apporte à la théorie psychanalytique.
Une grande partie du plaisir que procure la lecture du nouveau livre de Marilia Aisenstein, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, provient de ce qu’elle fait alterner des récits cliniques toujours saisissants avec des résumés de textes romanesques. Littérature et clinique s’éclairent mutuellement, et donnent facilement à voir les idées nouvelles que l’auteur apporte à la théorie psychanalytique.
Marilia Aisenstein fait partie des psychanalystes psychosomaticiens qui ont entrepris d’utiliser les idées de Benno Rosenberg pour mieux comprendre leurs patients. Comme le rappelle Michel Fain, dans une annexe au livre de M. Aisenstein, et intérêt des psychosomaticiens pour l’œuvre de Rosenberg est ancien, mais n’a pas été partagé par tous. Il remonte à un colloque de 1963-1964 à l’Institut de psychosomatique (Fain, 2000, p. 95). Rosenberg nous avait étonnés en soutenant que le masochisme est « gardien de la vie » : Freud n’avait-il pas introduit la notion de pulsion de mort à propos des phénomènes cliniques de la résistance, et du besoin de souffrir ? (Rosenberg, 1991, p. 20). Le masochisme n’était-il pas la cause principale des échecs des patients dans leurs vies, et une résistance majeure à l’analyse ? (Nacht, 1938, 1948). Mais il ne s’agissait là que du masochisme moral et du masochisme pervers. Rosenberg avait en vue la troisième variété de masochisme décrite par Freud dans Le problème économique du masochisme, le « masochisme primaire érogène ». Le masochisme primaire érogène résulte de la liaison de la pulsion de mort par la libido à l’intérieur de l’organisme. Il est en effet « gardien de la vie » parce qu’il empêche la pulsion de mort de détruire l’organisme de l’intérieur (Freud, 1924c/1973, p. 290-291). Rosenberg avait appliqué cette idée du « masochisme gardien de la vie » aux états psychotiques qu’il attribuait à « un dysfonctionnement important du masochisme primaire, du noyau masochique du moi » (op. cit., p. 87-90). Il avait aussi proposé une explication très intéressante du « travail de mélancolie » que Freud décrit brièvement dans Deuil et mélancolie (Freud, 1917e [1915]/1968, p. 169), par la « détachabilité de l’objet » (p. 99-120). À côté du masochisme gardien de la vie, Rosenberg a aussi décrit un « masochisme mortifère », dans lequel l’excitation devient impossible à décharger. L’objet est alors progressivement abandonné. L’absence de relation objectale bloque la pulsion de vie, et la vie fantasmatique du sujet s’en trouve entravée. Le sadisme est alors introjecté de façon massive et retourné contre le sujet. Le prototype de ce masochisme mortifère est la « psychose froide » décrite par Évelyne et Jean Kestemberg et Simone Decobert (Kestemberg É., Kestemberg J. et Decobert S., 1972) à propos de l’anorexie mentale, ou le mérycisme, étudié par Fain, Léon Kreisler et Michel Soulé (Kreisler L., Fain M. et Soulé M., 1974).
M. Aisenstein prolonge l’œuvre de Rosenberg dans deux directions : d’une part, elle l’étend à la compréhension des patients psychosomatiques ; d’autre part, elle fait un pas de plus vers les origines. Alors que Rosenberg pose le masochisme comme originaire, M. Aisenstein place la douleur encore en amont de ce masochisme primaire.
Dans le titre du livre, la douleur s’intercale entre le désir et la pensée. Mais quand elle en vient à sa conclusion, elle se demande si elle ne met pas plutôt la douleur à l’origine du désir comme de la pensée (p. 93). En effet, selon elle, les premières représentations psychiques naissent de la nécessité de représenter la douleur, « devenue souffrance » (p. 32). Cette première représentation prend nécessairement la forme d’un fantasme inconscient masochiste. Le désir naît donc de la douleur. « La structure du désir est d’essence masochique » (p. 37, p. 43). Le désir, l’attente de la satisfaction, serait impensable sans « un investissement masochique du déplaisir, une dimension masochique de l’existence, qui permette l’investissement de l’hallucination du plaisir » (p. 23).
Mais par ailleurs, la psychanalyse ne fait pas de séparation nette entre le corps et l’esprit. Elle est fondamentalement « moniste » (quand on parle du « dualisme » freudien, on n’a en vue que le dualisme des pulsions) (p. 66). Pour Freud, « la pensée n’est qu’un substitut du désir hallucinatoire… » (Freud, 1900a/2003, p. 482). Il faut donc désirer pour pouvoir penser, de même qu’il faut vivre sa douleur pour pouvoir désirer (p. 94).
En est-il nécessairement ainsi ? Le désir est non seulement supportable, mais plaisant, parce qu’il se déplace sur de nouveaux objets substitutifs, et s’assigne de nouveaux buts, pas tous masochistes. Le premier de ces déplacements est la satisfaction hallucinatoire du désir, décrite par Freud. Certes, répond M. Aisenstein, mais cette capacité de déplacement et de condensation du désir dépend de la qualité des soins maternels. Et sans le masochisme primaire, les mots et les gestes de la mère suffisamment bonne ne suffiraient pas. Il faut que l’attente soit investie masochiquement pour que l’enfant prenne plaisir à attendre (p. 36). C’est ce noyau masochiste primaire qui fait défaut dans la clinique psychosomatique (p. 52).
Contrairement aux patients névrosés, les malades somatiques graves, que M. Aisenstein traite psychanalytiquement, ne se plaignent pas de l’impossibilité de réaliser leurs désirs. Ils se contentent d’éviter de désirer, en se protégeant contre les objets qui pourraient les exciter. À 32 ans, Carla a déjà été opérée d’un cancer du sein et a fait deux accidents vasculaires cérébraux. C’est une sportive professionnelle, qui n’a pas de vie sentimentale, et qui est tombée malade quand elle a dû arrêter son entraînement physique intensif à la suite d’une fracture. Au bout d’un an de psychothérapie, elle rapporte un premier rêve : « un paysage de neige, ni froid ni chaud ». Elle révèle alors qu’elle a perdu le sens du froid et du chaud depuis ses premières règles à l’âge de 12 ans. Son analyste lui fait remarquer qu’elle a été anesthésiée. Carla parle alors pour la première fois de la mort de son père, survenue au même moment, ainsi que des mauvais traitements qu’elle a subis de sa mère, qui la battait, et recevait ses amants en sa présence. Il faut lire le livre d’Aisenstein pour suivre le processus analytique passionnant qui commence à partir de cette séance. Il a fallu que la douleur anesthésiée de Carla se transforme en souffrance, et en représentations masochistes pour que le processus démarre (p. 37-41).
Dans certains cas, les douleurs anesthésiées d’une patiente accèdent à la représentation par le biais de la « perception inconsciente » des affects de l’analyste par la patiente. Une des patientes de M. Aisenstein, psychotique et diabétique insulinodépendante, accède à des sentiments de tristesse liés à la longue maladie de son grand-père, dont elle n’avait jamais parlé jusque-là, lorsque, le même jour, l’analyste est inquiète pour l’un de ses proches. La patiente a eu la perception inconsciente de l’inquiétude vitale de son analyste (p. 41-42). Cette notion de « perception inconsciente » a souvent été soulignée par Pierre Marty. Il disait des patients opératoires que leur inconscient n’émet pas, mais que cela ne l’empêche pas de recevoir (p. 42).
Sans doute M. Aisenstein a-t-elle aussi pensé que la patiente avait eu la perception interne d’avoir le feu au derrière.
Marilia Aisenstein ne croit pas que Freud ait eu raison de nommer « féminin » le masochisme pervers. Ce dernier se rencontre chez des sujets qui ne parviennent à la jouissance qu’en s’identifiant à des femmes maltraitées (Freud, 1924, p. 289). Mais si elle ne croit pas au « masochisme féminin », elle pense qu’il existe tout de même un « masochisme au féminin », qui serait responsable de l’endurance des femmes et de leur meilleure résilience. La raison en serait que chez les femmes la tension d’excitation serait plus souvent plaisante érotiquement, alors que les hommes investissent davantage la décharge. Les femmes s’identifieraient plus souvent à leur père en même temps qu’à leur mère, elles seraient davantage bisexuelles que les hommes (p. 44-46).
Cette endurance des femmes, qui font souvent en effet deux journées de travail, l’une au bureau et l’autre à la maison, fait bien l’affaire des hommes. Elle disparaîtra peut-être dans une société où les hommes auront partagé leur pouvoir avec les femmes.
Mais dans le monde où nous vivons, il semble que seules les femmes souffrent de fibromyalgie, une maladie nouvelle, faite de tensions musculaires douloureuses, avec un abaissement du seuil à partir duquel une sensation proprioceptive est perçue comme douloureuse. La fibromyalgie survient souvent après un traumatisme psychique : deuil, rupture affective, échec professionnel. Elle frappe toujours des femmes très actives, qui cherchent sans cesse à en faire davantage. Cette hyperactivité évoque les processus autocalmants. M. Aisenstein donne une observation remarquable d’une de ces patientes et de son entrée dans le processus analytique (p. 49-50).
Très différents des patients somatiques sont les patients qu’une intervention chirurgicale mineure fait basculer au seuil de l’hypocondrie délirante, comme l’Homme aux loups après qu’un chirurgien a eu porté atteinte à son précieux nez « typiquement russe » – et si différent du nez juif de Freud (Brunswick, 1928, p. 274). De même, M. Aisenstein découvre le colossal investissement narcissique et objectal dont était porteur le grain de beauté sur la joue de sa patiente O., dont l’ablation avait provoqué chez elle une désorganisation complète.
Elle compare ce trouble à celui qui atteint le héros du roman d’Emmanuel Carrère, La moustache. Après s’être coupé la moustache, le héros de Carrère se heurte à l’incrédulité de sa femme et de ses amis qui lui affirment qu’il ne s’est rien coupé parce qu’il n’avait jamais eu de moustache. Il finit par s’amputer la lèvre supérieure puis par se trancher la gorge (p. 53-60).
M. Aisenstein retrouve le masochisme mortifère décrit par Rosenberg dans les divers aspects de la destruction de la pensée chez l’individu et dans la civilisation. Sa lecture du roman de Jonathan Littell, Les bienveillantes, a remis en question ce qu’elle avait pensé jusque-là de la démentalisation. Comment concilier le haut niveau culturel du héros des Bienveillantes, Maximilian Aue, et sa participation aux crimes collectifs commis par les nazis sur le front de l’Est ? Littell décrit Aue et son ami Voss comme « psychiquement vivants », et non comme démentalisés (p. 82-83). Le roman de Littell illustre le paradoxe de la « modernité » du IIIe Reich : débarrassé des juifs et des autres races inférieures, le Reich du IIIe millénaire devait voir l’avènement de la Civilisation.
Comment comprendre ces « sublimations de mort » dans lesquelles l’art et la pensée se mettent au service de la destructivité ? Certes, toutes les sublimations s’accompagnent d’une désintrication pulsionnelle, parce qu’elles ne portent que sur les pulsions sexuelles. La pulsion de mort ainsi libérée peut se porter contre l’artiste ou contre son œuvre (Freud, 1923b/1981, p. 259). Mais cette explication est trop générale. L’hypothèse de M. Aisenstein est « qu’il s’agit d’une déliaison qui agit à l’encontre de tout élément humain, opérant ainsi un malentendu ou un mésusage de la notion de ‟civilisationˮ ». Ainsi, « la notion de civilisation est coupée de l’être humain » (p. 83). Un tel mésusage de la notion de civilisation peut s’observer partout, y compris dans les cures psychanalytiques, quand les analystes font passer l’idéal de la cure avant le souci de leur patient (p. 84, et p. 92-93).
Comment peut-on en venir à une telle soumission à des idéaux barbares ? M. Aisenstein compare la soumission aux ordres des responsables de crimes collectifs et la phobie du fonctionnement mental propre à la pensée opératoire. Dans les deux cas, une soumission démentalisante avec dilution du surmoi se met en place. Comme J-B. Pontalis, elle voit dans le personnage de Herman Melville, Bartleby le scribe, un résistant radical, le héros de l’affirmation négative, celui qui « préfère ne pas ».
Je crains que la question de la soumission aux idées reçues ne dépasse de beaucoup le champ de la psychanalyse. Freud nous rappelle à la modestie quand il écrit :
« Chaque individu pris isolément participe donc de plusieurs âmes des foules, âme de sa race, de sa classe, de sa communauté de foi, de son État, etc., et peut par surcroît accéder à une parcelle d’autonomie et d’originalité » (Freud, 1921c/1981, p. 198).
Marilia Aisenstein a la générosité de partager avec nous la parcelle d’originalité particulièrement étendue que sa culture psychanalytique et littéraire lui a fait acquérir.
Références bibliographiques
Aisenstein M. (2020). Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique. Paris, Éditions d’Ithaque.
Kreisler L., Fain M. et Soulé M. (1974). L’enfant et son corps. Paris, Puf.
Fain M. (2000) À propos du masochisme érogène primaire. Dialogue imaginaire avec Benno Rosenberg. Dans Aisenstein M. (2020) : Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique. Paris, Éditions d’Ithaque.
Freud (1900a/2003) L’interprétation du rêve. OCF.P, IV. Paris, Puf.
Freud S. (1917e [1915]1968) Deuil et mélancolie. Métapsychologie. Paris, Gallimard.
Freud S. (1921c/1981). Psychologie des foules et analyse du moi. Essais de psychanalyse. Paris, Payot.
Freud S. (1923b/1981) Le moi et le ça. Essais de Psychanalyse. Paris, Payot.
Freud S. (1924c/1973). Le problème économique du masochisme. Névrose, psychose et perversion. Paris, Puf.
Kestemberg E., Kestemberg J. et Decobert S. (1972). La faim et le corps. Une étude psychanalytique de l’anorexie. Paris, Puf.
Mack Brunswick R. (1928/1981). En supplément à « L’histoire d’une névrose infantile » de Freud. Traduit par M. Bonaparte. L’homme aux loups par ses psychanalystes et par lui-même. Paris, Gallimard, Paris.
Nacht S. (1938). Le masochisme. Paris, Le François.
Nacht S. (1948). Les manifestations cliniques de l’agressivité et leur rôle dans le traitement psychanalytique. Rapport présenté à la XIe Conférence des Psychanalystes de Langue Française. Rev Fr Psychanal 12(3) : 313-365.
Rosenberg B. (1991) ? Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie. Paris, Puf, « Monographie de la Revue française de Psychanalyse ».
Gilbert Diatkine est psychiatre, psychanalyste, membre Titulaire Formateur de la SPP.