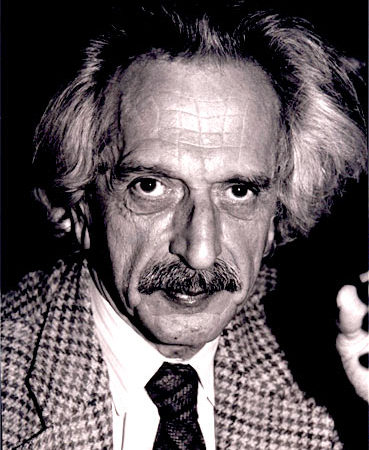
La grande énigme du deuil
dépression et mélancolie
le beau objet
Article de Pierre Fedida, paru dans la RFP 40 (5-6) : 1111-1118, 1976.
Dans un texte intitulé Vergiinglichkeit, écrit en vue d’un volume commémoratif à la demande de la Société Goethe deBerlin, Freud accueille l’évidence commune du deuil pour s’en étonner. « Le deuil à la perte de quelque chose que nous avons aimé et admiré apparaît si naturel au profane qu’il le tient pour évident par soi-même. Pour le psychologue au contraire, le deuil est une grande énigme, un de ces phénomènes qu’on n’élucide pas eux-mêmes, mais auxquels on ramène d’autres choses obscures[1]. »
S’étonner d’une évidence tenue par l’existence quotidienne pour naturelle, l’accueillir et la laisser parler sans chercher, d’aucune façon, à la réduire : telle est la démarche à laquelle Freud nous invite lorsqu’il rappelle comment le propre de l’évidence commune est de cacher l’énigme. L’évident, n’est-ce point ce à quoi on ne s’attendait pas, et ce qui ainsi vient toujours à étonner ?
Commune est, en effet, l’évidence qui représente comme normales les réactions suscitées par la perte de « quelque chose que nous avons aimé et admiré » : la parole quotidienne l’exprime en des mots qui s’entendent à marquer le rejet dans une solitude où le ne plus semble, tout à coup, rendre vaine et désœuvrée la vie et ses actes. Et le deuil est ce que porte l’humain en signe d’un secret, lorsque la mort soustrait à la parole et à sa geste corporelle l’autre qui, d’une réalité, en fondait la reconnaissance et en assurait ainsi l’intime identité. La relique – qui n’est pas sans ressemblance ni rapport avec le fétiche – rappellerait que le deuil, avant de se concevoir en un travail, protège l’endeuillé contre sa propre destruction[2]. L’effondrement narcissique qui survient dans le processus mélancolique constitue la véritable menace que porte la violence de la mort et – ainsi que l’ont si bien cliniquement éclairé Maria Torok et Nicolas Abraham – l’endeuillé n’a pas encore perdu son partenaire et il « mène le deuil pour ainsi dire par anticipation ». J’ajouterais pour ma part que le deuil assure au vivant la garantie de son impossibilité à se représenter sa propre mort et que c’est même ainsi que se peut concevoir l’économie d’une défense dépressive du travail du deuil. J’entends bien souligner de la sorte que ce qu’on appelle dépression se définit par une position économique qui concerne une organisation narcissique du vide (selon une détermination propre à l’inaltérabilité topique de la psyché) qui ressemble à une « simulation » de la mort pour se protéger de la mort. Et finalement la psyché – qui n’est autre, peut-être, que la métaphore dépressive du vide – loin de se concevoir comme souffle vital ne se désignerait-elle pas ici comme immobilité du corps ou même comme corps entièrement devenu lieu de l’absence. La dépression ne serait-elle pas l’expérience vitale de la mort impossible[3] ?
Agnès – jeune femme de 31 ans – engage une cure quelques mois après une rupture sentimentale avec un homme marié dont elle était la maîtresse depuis cinq ans. Cette rupture avait été consécutive à une interruption de grossesse qui, dès notre premier entretien, avait été présentée comme la condition nécessaire pour ne pas perdre l’homme aimé. Mais immédiatement après l’avortement (auquel l’homme semblait refuser de souscrire), Agnès se découvrit tout à fait « vidée », n’ayant pour pensées que de rompre à tout jamais avec son amant, d’abandonner sa vie professionnelle (hôtesse de l’air) qui lui donnait jusque-là toute satisfaction et de « faire une cure de sommeil aussi longue que possible ». Un bref séjour en clinique psychiatrique (au cours duquel elle fut sous traitement d’antidépresseurs) ne lui apporta aucun mieux-être et, pendant quatre mois, elle se confina chez elle, n’acceptant de voir que sa sœur cadette qui assura alors une véritable prise en charge.
Agnès parle de son (« désir de mourir » : pour elle rien n’a plus aucun intérêt, sa vie est « perdue », c’est « l’échec d’un bout à l’autre », Elle pleure en me parlant de sa vie, à ses yeux, ratée et elle se considère coupable d’avoir détruit la vie des autres, de les avoir rendus malheureux et elle « sait » qu’ayant « tout perdu », elle ne pourra jamais rien ni « réparer » ni « racheter ». Elle a accepté le conseil de sa sœur et est venue « voir un psychanalyste », mais elle « sait » encore que « ça ne servira à rien » et que seule la mort est son unique solution. Chez cette jeune femme – fort belle et habillée avec goût et distinction– la plainte mélancolique venue avec les larmes en me parlant crée une sorte d’effet de contraste tout à fait surprenant. Cette constatation, pendant quelques instants, me soustrait à une écoute de sa plainte pour livrer ma pensée à une sorte de révolte faite d’objections en série qu’évidemment je n’exprime pas mais dont je me dis qu’elles me placent dans la répétition qu’elle connaît – à savoir : « Alors quoi ? Vous avez tout pour réussir et vous n’avez que le désir de mourir ! » C’est précisément ce qu’elle reproche aux autres de lui dire, vivant cette interpellation fréquente comme le signe de l’incompréhension et de l’abandon. Et elle se demande pourquoi sa souffrance suscite chez les autres tant de « méchanceté ». Si ce n’est auprès de sa sœur, elle ne trouve nulle part·ce qui pourrait « la protéger » ; et si elle éprouve autant le besoin de s’enfermer chez elle et de dormir, c’est qu’elle ne connaît pas de meilleur « moyen d’être à l’abri et protégée ». La rupture avec l’amant – le seul homme qu’elle dit « pouvoir aimer » – fut, selon elle, le seul moyen d’espérer le garder en le rendant absent. Et si elle avait gardé l’enfant, elle n’aurait pu éviter de perdre son amant.
Nous convenons d’engager la cure à raison de quatre séances par semaine. Je pense alors qu’il est éminemment souhaitable que cette cure se modèle, dans son installation, sur le « désir de dormir » et qu’ainsi sa fonction de holding soit très soigneusement et très ponctuellement aménagée. De fait, Agnès vient régulièrement à ses séances dont elle dit éprouver la « chaleur » : lors de la première séance, elle parle d’un conte de son enfance où une « belle jeune fille ayant, une nuit, rêvé qu’un chevalier s’introduisait chez elle pour la ravir, perdit son image dans le miroir et fut ainsi condamnée, chaque fois qu’elle cherchait de nouveau à se voir pour se regarder et se parer, à trouver à la· place de son image celle d’une vieille et horrible femme ricanante, le visage pustuleux et meurtri », Ce conte – dont Agnès ne sait d’où il lui vient – livre associativement, à la suite d’un rêve intervenu après la première séance (dans ce rêve le tableau de la Joconde se transformait en un horrible dessin de Topor – peut-être une peinture surréaliste– où le visage s’ouvrait verticalement comme les « lèvres d’un sexe féminin boursouflé »), l’« aveu » d’une mise en scène masturbatoire où,allongée, elle·avait laissé venir entre ses jambes le miroir où elle se contemplait et avait été, à ce moment précis, surprise par l’arrivée impromptue de son frère jumeau dans sa chambre. Ce conte du miroir – inaugurant la cure et en désignanttout à la fois l’angoisse et l’espoir – fut, pour ainsi dire, la parole de notre secret, et c’est lui qui assura la fonctiond’entreprendre et de mettre en œuvre, comme à l’intérieur des limites du sommeil, le matériel fantasmatique et onirique dutravail de la cure. Mes interventions ont participé, pendant des mois, à cette œuvre tissée du conte, car ma parole ne pouvait être que celle d’un conte dans son pouvoir intrinsèque de faire vivre la métaphore dans l’interprétation. Peu de temps après que la cure fut commencée, Agnès s’endormait au début de chaque séance – elle dormit, une fois, pendant toute la séance –et c’est alors seulement que, dans le récit poursuivi et toujours transformé du conte, elle parlait.
Le récit du conte organisait donc la séance en une zone d’endormissement qui présentait cette particularité – dans les séances où Agnès commençait par dormir– de se transposer en un espace de transaction entre le sommeil et la veille, soit donc en une sorte d’aire de réveil. J’étais ainsi porté à penser que la séance aménagée par le conte en zone transitionnelle de préendormissement (plutôt que d’endormissement) recevait chez Agnès un fonctionnement économique de telle sorte que s’y opérait un travail de transaction préparatoire au réveil. Et je fus frappé par ce qu’elle me dit plus tard sur ma « place » et sa mobilité imaginaire dans le déroulement de la séance : au moment de s’endormir elle me représentait parfois me pencher légèrement sur elle ; puis, un instant avant de s’éveiller, désirer que je sois juste à côté d’elle et se retrouver satisfaite que je sois présent « sans visage » derrière elle. Je tins ces remarques ainsi que d’autres relatives à ces positions spatiales comme techniquement très importantes : ce qui s’en trouvait l’enjeu était la reconstitution – par la disposition de l’espace en la parole et son silence – d’un miroir dont la culpabilité auto-érotique avait énoncé la première figure (la femme est « ratée » par la mère dont le sexe-visage horrible fait de la scène primitive un stigmate), mais qui portait la potentialité d’un double dissymétrique – le contraire du jumeau voleur persécuteur– grâce auquel pourrait se re-construire l’identité du soi[4]. L’amant avait été rejeté comme fausse actualité de ce double : il était une allégorie amante dont l’échec était d’avoir voulu rendre Agnès « heureuse » – entendons qu’il avait représenté une illusion actualisée de la complétude amoureuse, de la réunion imaginaire de l’identité des semblables (c’est de la sorte qu’il était devenu pour elle le « bouc émissaire », c’est-à-dire le double adverse de la culpabilité retournée en persécution). Et le rejet de l’amantsupposait dans la logique inconsciente d’un processus mélancolique mis en mouvement depuis cinq ans – à la fois la grossesse (ayant duré trois mois) et son interruption « volontaire» dont on ne saurait trop souligner la signification traumatique (au regard du narcissisme et de la mélancolie) s’entendant notamment comme l’épreuve mélancolique littérale de la mise à mort et de l’exhumation interminable d’un enfant. L’avortement avait ainsi fait le vide. Mais il vaudrait mieux dire qu’il était venu ouvrir une interminable perte (de nature mélancolique) et qu’il attribuait dans le corps un vide à la mort. L’enfant une fois rejeté, la mort devient le contenu du vide qui protège Agnès contre sa propre mort. Et l’immobilité fait du corps la sépulture de l’amant désormais voué à l’absence. C’est donc selon une telle organisation topique subjective – ainsi brièvement résumée – que l’on peut concevoir non seulement la fonction défensive mais surtout le pouvoir thérapeutique de la dépression d’Agnès et principalement à partir du moment où la cure est engagée. Le holding de la cure est la prise en charge – c’est-à-dire en soin – de ce corps du vide (définition, peut-être, de la psyché !) qui s’apparente au sommeil et qui contient la mort de même que le sommeil contient le rêve. Et on pourrait ajouter que le sommeil est la dépression thérapeutique. Et seul le conte pouvait être la parole qui convient à ce que le sommeil peut entendre !
Lorsque j’ai engagé la cure d’Agnès j’ai pressenti – en raison même de cette mort contenue par le vide et en lui – que pouvait se rouvrir ce qu’elle appelait « l’horrible hémorragie de l’avortement ». Les larmes de la parole, lors du premier entretien, en indiquaient la menace. Je pensais alors que si cette « hémorragie » ne pouvait point être artificiellement empêchée par l’analyse, elle ne devait pas pour autant trouver en celle-ci sa condition facilitante sous la forme d’une « entreprise » mélancolique ! C’est pourquoi il m’apparaissait si important, du point de vue technique, que la précise et ponctuelle rigueur du protocole de la cure assure les limites du cadre thérapeutique à l’intérieur duquel tout devait se jouer entre elle et moi comme sur l’extrême sensibilité d’une « membrane » dont la rigidité aurait signifié tout à coup la rupture, La technique consistant – sous forme d’une sorte de squiggle game– à parler moi-même le conte, de moi-même venu et en écho de sa propre parole dans le conte en travail, instituait ainsi la séance comme un temps pour un espace d’échange et ainsi d’élaboration. Le jeu n’est-il pas ce par quoi – au travers de l’illusion – s’élabore symboliquement l’absence d’un double hors de toute représentation.
Au cours des deux premières années de sa cure, Agnès fit plusieurs « tentatives de suicide ». Je désigne ainsi ce qui se présenta, chaque fois, sous forme d’un coma généralement de très courte durée, dû à une absorption excessive d’un hypnotique. Par trois fois, ces comas la conduisirent en service de réanimation. Or, lors de chacune de ces « tentatives suicidaires », je n’ai jamais pensé que la vie d’Agnès se trouvait réellement en danger. Il m’apparaissait, en effet, que ces mises en acte de la mort, toujours, bien que différemment, associées à une « prise de conscience » de réveil (provoquée notamment par la survenue trop brutale d’une injonction de la réalité : les parents, voulaient la « secouer » et lui « remettre les pieds sur terre »), participaient à un travail d’interprétation et d’élaboration réglé sur un signal de danger. Ces passages par la mort-sommeil (désir de mourir-désir de dormir) venaient à s’entendre dans les séances où il en était abondamment parlé, comme une interprétation par le rêve (la mort) depuis l’intérieur du sommeil de la mort contenu du vide en elle. Sa propre mise à mort imaginaire engageait, dans la cure, le pouvoir d’une effectuation symbolique redonnant à sa vie le temps et le corps d’un projet ; c’est ainsi que, chaque fois, non seulement un matériel important venait à se parler en séance mais une nouvelle ouverture favorable se produisait dans sa vie (par exemple sa remise en activité professionnelle ou encore – à la suite de la tentative la plus grave– sa réinstallation dans un nouvel appartement qu’elle décora elle-même). Je souligne donc ici comment ce qu’on appelle tentative suicidaire chez le dépressif peut – sous la condition de l’existence et de la poursuite d’une cure – faire agir un travail de la mort sur le mode d’un travail du rêve. (L’expression « travail de la mort » est de J.-B. Pontalis) et vise comme à évacuer la mort du vide dès lors que levide – prototype dépressif de l’espace psychique – reçoit capacité d’un espace de rêve et peut ainsi être pour la pensée un lieu propre à habiter (cf. l’installation et la décoration de l’appartement). C’est le rêve – et non plus le conte– qui se trouve ici l’entrepreneur thérapeutique de ce retour à une activité de pensée. Mais le conte – orte de parole paradigmatique et préinterprétative des rêves – a peut-être partie liée avec Psyché endormie !
Cette observation[5] nous donnera ici l’occasion de formuler, en première approximation, quelques hypothèses métapsychologiques relatives à dépression-deuil-mélancolie :
1° Ainsi que je l’ai à plusieurs reprises évoqué[6], il m’apparaît souhaitable de préciser les rapports entre rêve et hypocondrie d’une part et hypocondrie et mélancolie d’autre part : les textes de la Métapsychologie de Freud invitent à poursuivre – dans le cadre d’une problématique de la régression et du narcissisme – la recherche d’une compréhension de ce que j’appellerai ici la mélancolie du rêve. Serait-ce alors le rapport du rêve à la mélancolie – plutôt que celui du deuil et de la mélancolie – qui se révélerait métapsychologiquement plus pertinent ? Il ne m’apparaît, en tout cas, pas certain que ce soit le deuil qui ait le pouvoir d’éclairer le processus mélancolique et inversement. L’étude des insomnies mélancoliques serait ici le préalable de cette réévaluation rêve-mélancolie[7] ;
2° Cette première hypothèse que je me contente de formuler ici sommairement[8] est étayée par l’hypothèse complémentaire du rapport sommeil soma-dépression. Freud indique lui-même que le rêve donne accès à une compréhension du somatique dont la seule métapsychologie possible – grâce précisément au rêve – est celle du sommeil.« L’état psychique des dormeurs se caractérise, dit Freud, par un retrait presque total du monde environnant et par la suspension de tout intérêt pour lui » : c’est en des termes identiques que, dans le texte sur Le narcissisme, il parle de la maladie organique avant d’en revenir à l’hypocondrie. Or il apparaît que – distinguée de la mélancolie – la dépression pourrait se définir comme essentiellement dépression somatique : cette expression est appelée à prendre ici le statut d’une compréhension métapsychologique à la fois par rapport à la mort (distincte de la pulsion de mort), au rêve et à la mélancolie et d’autre part, par rapport au narcissisme primitif ainsi qu’à l’égoïsme du sommeil[9].
3° Certes le deuil concerne-t-il, dans le sens commun et populaire du mot, principalement la perte d’un être proche aimé et admiré. Ou plus exactement ce serait une réaction du sujet tout entier à la mort de l’être aimé. Mais est-il même juste de dire que c’est une « réaction » ? – Parler de réaction n’est-ce pas traiter le deuil comme un phénomène psychologique dont l’évidence naturelle se satisferait d’une simple explication ? La mort de l’autre est loin, comme on le sait, de susciter quelque chose d’univoque et Freud a bien raison de tenir le deuil pour une énigme qu’aucune explication psychologique ne saurait comprendre. Il en va du deuil comme de la pudeur et de la honte. On ne les nomme « réactions »que pour mieux en normaliser la valeur défensive et éviter ainsi l’étonnement que ne manquerait de susciter la question de leur énigme. Abandonner le deuil à une morale, à une éthique, voire même à une sociologie de la solitude, c’est le meilleur moyen, sans doute, de confirmer la fonction normale de la réaction qu’il engage. Et pourtant l’endeuillé est brusquement rappelé à l’existence conservée de soi par la présence des pensées et des souvenirs qui, au nom de ce qui a été perdu, donnent poids à l’histoire personnelle et approfondissent la subjectivité. Le deuil est d’abord un rapport au temps : l’éphémère rassure le temps. Mais aussi comme si la mémoire avait besoin du deuil pour faire l’épreuve du souvenir et découvrir momentanément l’impuissance de l’oubli. Comme la pudeur et la honte, le deuil est l’événement – pour ainsi dire : transcendantal – de la subjectivité. La mort de l’autre, tout de même que sa nudité, assigne à l’existence subjective une histoire. Ces thèmes sont ici rappelés dans la pensée de désigner le deuil sur de nouvelles articulations métapsychologiques. Soit par exemple : le deuil est à l’œuvre dans le travail du rêve ; ou encore : le problème de la mélancolie n’est point tant celui du deuil que celui de la honte et nous savons bien peu de chose du deuil mélancolique etdu deuil maniaque; enfin : l’exhibitionnisme et, par extension peut-être, la perversion posent conjointement le problème du deuil et celui de la pudeur.
4° Le texte de la Verganglichkeit évoque le rapport deuil-mélancolie en se référant à ce qui est éphémère et – par là même – en se concevant d’un temps du beau objet, de sa capacité de disparaître dans le charme fragile de son apparaître. En dehors de K. Abraham, il est remarquable que la psychanalyse ait si peu consacré son œuvre à la compréhension de la fonction prévalente du beau-objet (je l’exprime ainsi par rapport à cette sur-évaluation culturelle du bon objet). Le charmede l’objet est pourtant à la source des formes mélancoliques ainsi que d’une position persécutive. Tout de même que la beauté se trouve ici étroitement associée à la mort. La beauté – que la sublimation dépressive protège – est pourtant uneviolence qui ne manque d’apparaître dans le processus mélancolique. Et le deuil mélancolique ne concerne pas tant la destruction du bon objet que la mise à mort de la beauté même !
5° Je l’ai dit : la dépression est une mort impossible. Parler du deuil dans la dépression c’est précisément l’appeler – fût-ce chez le patient dans l’essai de sa propre mise à mort – comme ce par quoi on s’en sort ! La dépression fait de l’absence la gardienne de la mort et du vide ce qui la contient. « Seul un deuil pourrait me sortir de mon vide », dit quelqu’un.
Et c’est finalement à une question du temps dans la psychanalyse que nous ramènent ces hypothèses sur dépression-deuil-mélancolie.
La grande énigme du deuil est peut-être dans le pouvoir d’un temps laissant aux vivants le sommeil pour rêver la mort et les protégeant ainsi d’une violence que seul le mélancolique connaît.
[1] Ce texte fut rédigé en novembre 1915 et publié en 1916 (G.W., vol. X, p. 358-361 ; Standard Edition, vol. XIV, p. 305-307). Bien que publié quelque temps auparavant, ce texte a été écrit un peu après Deuil et mélancolie. Ainsi que le note Strachey, son inspiration témoigne de la façon dont Freud engageait sa propre sensibilité littéraire dans un thème de préoccupation métapsychologique.
Je me contenterai d’en rappeler ici l’idée. Une promenade dans les Dolomites « l’été précédant la guerre » – en compagnie d’un « ami taciturne » et d’un jeune poète – donne à Freud l’occasion d’une sorte de méditation sur l’éphémère (Vergiinglichkeit; en anglais : transience). Le paysage laisse une impression de charme et de beauté et on pourrait penser qu’il invite à l’espoir dans l’éternel renouvellement de la vie. « Le poète admirait la beauté de la nature autour de nous mais il n’en éprouvait aucune joie. Il était troublé par la pensée que toute cette beauté était vouée à passer, que l’hiver la ferait disparaître et qu’il la rendait vaine ; et qu’il en était ainsi de toute beauté humaine et de toute beauté et splendeur que les hommes avaient créées ou peuvent créer. » La pensée de l’éphémère suscite alors deux mouvements distincts : l’un de lassitude et de dégoût universels (Weltüberdruss) et l’autre de révolte contre une telle disposition. Il serait, certes, vain de croire que perte, vieillissement, destruction n’existent pas ! L’immortalité en laquelle l’homme se rêve, le continuel renouvellement auquel il croit pour lui-même et pour les choses, sont comme démentis par les faits. .La menace de destruction des formes fait-elle de la mort une rêverie de l’éternité là où l’impensable concerne une horreur – la castration ? C’est de la sorte que se trouve ainsi appelé le triple rapport du deuil au narcissisme, du temps à la castration et aussi du narcissisme au fétiche.
Comment trouver alors le motif d’une joie créative – le pouvoir d’un temps de la création – alors que le renouvellement de la vie fait l’effet d’une dénégation : la beauté d’un paysage de même que le charme d’un visage ou d’un corps ne sont-ils point les expressions affirmées – en leur propre fragilité – de leur négation.
Freud cherche à convaincre l’ami et le poète du renouvellement de toute chose : la vie ne revient-elle pas toujours au travers de ce qui semble se détruire et disparaître ? Fliess est-il alors si loin dans l’oubli de Freud ? La conception des périodes et des rythmes dans le cours de la vie s’inspirait, chez Fliess, d’une pensée de l’éternel renouvellement de la nature (cf. Der Ablauf des Lebens et Vom Leben und vom Tod) : l’observation des plantes pouvait en attester. Et c’est au prix d’un véritable déni de la castration que s’est développée la théorie de Fliess jusque dans un délire.
Dans le texte sur l’éphémère, Freud s’exprime alors ainsi : « Je remarquai que je n’avais fait aucune impression ni sur le poète ni sur son ami. Monéchec me porta à conclure que quelque facteur puissamment émotionnel était à l’œuvre et qu’il troublait leur jugement et je crus plus tard que j’ai découvert ce que c’était. Ce qui gâte leur jouissance de ce qui est beau doit avoir été une révolte, dans leur pensée, contre le deuil… » Survenue peu après et manifestant une gigantesque force des pulsions de destruction, la guerre donnait-elle alors raison au poète ?
Ce texte de Freud a le mérite d’évoquer, notamment, la beauté du « corps humain et du visage » – tout de même que celle d’un paysage – dans la valeur d’un charme qui tient à l’éphémère fragilité de ce qui apparaît et est aussitôt menacé de disparaître. La fonction de sublimation – dans son rapport à une idéalité de la conservation – ne trouve-t-elle pas ainsi ici une signification précise qui éclaire le rapport du fétichisme et de la création artistique ?
[2] Je renvoie à mon article sur « La relique et le travail du deuil » (Nouvelle Revue de psychanalyse, automne 1970, n° 2). Freud écrivait dans Totem et tabou : « … Le deuil se doit de remplir une mission psychique définie qui consiste à établir une séparation entre les morts d’un côté, les souvenirs et les espérances des survivants de l’autre. »
[3] Cf. mes contributions à ce problème dans « L’organe psychique » (Nouvelle Revue de psychanalyse, 1975, n° 12) et « Le conte et la zone de l’endormissement » (Psychanalyse à l’université, déc 1975, n° 1).
[4] J’ai abordé ce thème dans mon article sur » D’une essentielle dissymétrie dans la psychanalyse » (Nouvelle Retvue de psychanalyse, printemps 1973, n° 7) ainsi que dans Le conte t la zone de l’endormissement. C’est, de même, un axe poursuivi au cours de mon séminaire 1974-1975, dans le cadre du C.E.S. de Psychiatrie (C.H.U. Saint-Antoine) sur Dépression, perversion et mélancolie.
[5] Que je publierai in extenso ultérieurement.
[6] (2) Cf. notamment « L’hypocondrie du rêve » (Nouvelle Revue de psychanalyse, printemps 1972, n° 5) et « D’une métapsychologie du somatique » (Bulletin de psychologie).
[7] Ludwig Binswanger citant Freud avait produit le lapsus : Traum (au lieu de Trauer) und Melancholie !
[8] Je l’ai développée dans le cadre d’un séminaire qui fera l’objet de publication.
[9] Cf. L’hypocondrie du rêve, op. cit.

