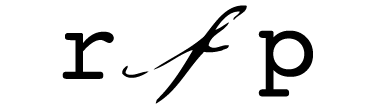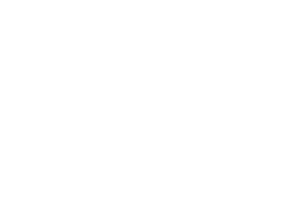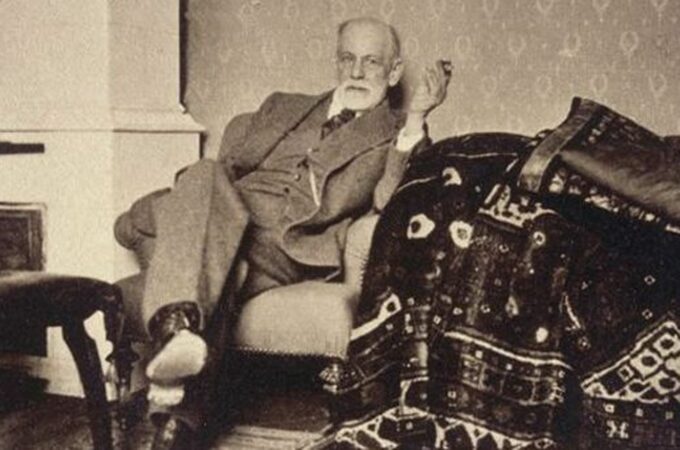
Freud dans le texte
FREUD DANS LES TEXTES | Numéro 2025-1
La résistance
Sigmund Freud, La question de l’analyse profane, OCF.P, XVIII, Paris, Puf, 1994, p. 49-50.
Nous appelons toutes les forces qui s’opposent au travail de guérison : les « résistances » du malade. Le bénéfice de la maladie est la source d’une telle résistance, le « sentiment de culpabilité inconscient » représente la résistance du sur-moi, c’est le facteur le plus puissant et le plus redouté de nous. Nous rencontrons dans la cure bien d’autres résistances encore. Quand le moi, dans la période précoce, a, par angoisse, procédé à un refoulement, cette angoisse subsiste encore et se manifeste maintenant en tant que résistance quand le moi doit s’approcher du refoulé. Finalement, on peut se représenter que ce n’est pas sans difficulté qu’un processus pulsionnel, qui pendant des décennies a suivi une voie déterminée, doit soudain suivre la nouvelle voie qu’on lui a ouverte. C’est ce qu’on pourrait appeler la résistance du ça. Le combat contre toutes ces résistances est, pendant la cure analytique, notre travail principal, en regard de quoi s’efface la tâche des interprétations. De plus, par ce combat et par le surmontement des résistances, le moi du malade se voit modifié et renforcé au point qu’il nous est permis d’envisager en toute tranquillité son comportement futur après la terminaison de la cure. D’autre part, vous comprenez maintenant à quelles fins nous avons besoin de cette longue durée de traitement. La longueur de la voie de développement et la richesse du matériel ne sont pas l’élément décisif. Il importe davantage de savoir si la voie est libre. Sur un parcours qu’en temps de paix on accomplit à toute allure en quelques heures de chemin de fer, une armée peut être arrêtée des semaines si elle doit y surmonter la résistance de l’ennemi. Dans la vie animique aussi de tels combats prennent du temps. Il me faut malheureusement constater que tous les efforts pour accélérer notablement la cure analytique ont jusqu’ici échoué. La meilleure voie pour la raccourcir semble être de la conduire correctement.
« Si j’avais jamais ressenti l’envie d’aller faire le charlatan dans votre métier et de tenter moi-même une analyse sur quelqu’un d’autre, ce que vous m’avez communiqué sur les résistances m’en aurait guéri. Mais qu’en est-il de cette influence personnelle particulière, que pourtant vous avez reconnue ? Ne prévaut-elle pas contre les résistances ? »
Il est bon que vous posiez maintenant cette question, Cette influence personnelle est notre arme dynamique la plus forte, elle est ce que nous introduisons de neuf dans la situation et ce par quoi nous la rendons fluente. À cela, le contenu intellectuel de nos éclaircissements ne peut arriver, car le malade qui partage tous les préjugés du monde environnant serait tout aussi peu tenu de nous croire que les hommes de science qui nous critiquent. Le névrosé se met au travail parce qu’il accorde croyance à l’analyste et il le croit parce qu’il acquiert, à l’égard de la personne de l’analyste, une position de sentiment particulière. L’enfant, lui aussi, ne croit que les êtres humains auxquels il est attaché. Je vous ai déjà dit à quelles fins nous utilisons cette influence « suggestive » particulièrement grande. Non pour la répression des symptômes – ce qui différencie la méthode analytique des autres procédés de psychothérapie –, mais comme force de pulsion pour amener le moi du malade au surmontement de ses résistances.