
CRITIQUES DE LIVRES
Une recension de livres parue dans la Revue des livres du numéro « Résister » à redécouvrir sur le site.
Bonnes (re)lectures !
Alexandra Bouchard, Césariennes sur demandes maternelles. Le féminin à l’épreuve de l’accouchement, Toulouse, Érès, 2023
 L’accouchement, expérience singulière et toujours extraordinaire, sollicite de manière unique et intense la sexualité et le sexe de toute parturiente. Si cette expérience constitue chez chaque femme une opportunité de réactualisation et de ré-élaboration de problématiques inconscientes propres à son histoire psycho-sexuelle, seul l’accouchement par voie basse a cette particularité d’engager de manière aussi complète le sexe féminin dans son entièreté, interne et externe, cachée et visible, par le passage du bébé dans la filière génitale.
L’accouchement, expérience singulière et toujours extraordinaire, sollicite de manière unique et intense la sexualité et le sexe de toute parturiente. Si cette expérience constitue chez chaque femme une opportunité de réactualisation et de ré-élaboration de problématiques inconscientes propres à son histoire psycho-sexuelle, seul l’accouchement par voie basse a cette particularité d’engager de manière aussi complète le sexe féminin dans son entièreté, interne et externe, cachée et visible, par le passage du bébé dans la filière génitale.
Voici quelques considérations initiales proposées par Alexandra Bouchard, psychologue clinicienne exerçant en maternité, enseignante-chercheuse et psychanalyste inscrite à l’Institut de Psychanalyse de Paris, dans son livre (Bouchard, 2023) écrit dans le prolongement d’une thèse réalisée sous la direction d’Aline Cohen de Lara. Dans cet ouvrage, l’auteure s’interroge : quelles sont les motivations et les représentations, conscientes et inconscientes, des femmes demandant à accoucher de leur premier enfant par césarienne, en dehors de toute indication médicale ? À côté de cette question centrale, ce sont en fait deux autres questions plus larges encore, celle des spécificités du développement psycho-sexuel chez la femme et celle de l’expérience de l’accouchement étudiée d’un point de vue psychanalytique, qui sont abordées. L’ensemble forme un tout comme les trois fils d’un même ouvrage, remis ensemble sur le métier.
Trois types de matériaux sont utilisés : une synthèse bibliographique des apports de Freud et de ses successeurs sur ces sujets, les résultats d’une recherche menée pendant trois ans dans un service de maternité, et des exemples cliniques issus de cette recherche. Alexandra Bouchard s’est en effet entretenue à trois temps différents – au troisième trimestre de grossesse, à deux jours puis à deux mois du post-partum – avec deux groupes de femmes accouchant de leur premier enfant : les unes, dans le groupe « tout-venant » ayant accepté le mode d’accouchement préconisé par l’équipe médicale et les autres, dans le groupe « césarienne », ayant demandé un accouchement par césarienne en dehors de toute indication médicale. Les résultats ont été analysés à l’aide d’une méthode qualitative s’appuyant sur un référentiel psychanalytique.
Le texte, particulièrement riche, suit le cheminement théorico-clinique de l’auteure. Après une première partie introductive se référant à des éléments d’évolution anthropologique, sociale, médicale et juridique, l’expérience de l’accouchement est abordée au travers de quatre dimensions principales : l’ancrage somatique et le rapport à la douleur, la dimension d’effraction psychique, la réactualisation de la problématique œdipienne et la remise au travail du féminin.
Le développement psycho-sexuel chez la femme
Alexandra Bouchard nous rappelle que chez la fille, le développement et la résolution du complexe d’Œdipe sont des phénomènes plus complexes, plus longs et plus incertains que chez le garçon. Alors que chez ce dernier, le complexe de castration vient inaugurer la résolution du complexe d’Œdipe, la menace de castration le conduisant à renoncer à l’accomplissement de ses désirs œdipiens, chez la fille, c’est le complexe d’Œdipe lui-même qui est inauguré par le complexe de castration. En effet, imaginant que sa mère est responsable de l’avoir faite fille, et constatant que celle-ci n’en a pas et que son père en est pourvu, la fille cherche à séduire son père pour obtenir de lui, un phallus ou son équivalent : un enfant. Ce faisant, la fille déplace l’investissement qu’elle avait pour l’objet primaire maternel vers un second objet, le père œdipien. Plus tard, en suivant les perspectives de Jacqueline Schaeffer, il s’agira pour elle de se tourner vers un troisième objet, l’amant de jouissance. Dans ce contexte, le dégagement de la relation à la mère peut être considéré comme un enjeu particulièrement important et complexe dans le développement psycho-sexuel de la fille, se rejouant particulièrement à l’occasion d’un accouchement.
Une autre question sur laquelle Alexandra Bouchard s’arrête est celle de la reconnaissance du vagin. Si, pour Freud, le vagin n’était découvert par la fille qu’au moment de la puberté, pour Hélène Deutsch, Melanie Klein et d’autres, il serait découvert puis refoulé. Pour ces auteurs, le refoulement du vagin pourrait s’expliquer par la nécessité de maintenir à distance d’une part, la relation à la mère avec toute sa dimension de rivalité et d’attaques envieuses, et d’autre part, la représentation érotique d’un vagin maternel plein de la tête du bébé. Ces représentations sont directement sollicitées par l’expérience d’un accouchement par voie basse.
Une troisième notion importante présentée par l’auteure est celle du féminin. Après avoir désigné chez Freud les caractéristiques sexuelles de la femme, autrement dit, ce qu’on entendrait aujourd’hui sous le terme de féminité, Alexandra Bouchard nous rappelle que le féminin a indiqué par la suite, chez la femme comme chez l’homme, une situation de passivité comme modalité de satisfaction de la pulsion. Les théories de Jacqueline Schaeffer à ce sujet ont particulièrement retenu l’attention de l’auteure. Pour Schaeffer (1997), si la dimension positive de l’Œdipe féminin permet à la fille d’investir le pénis du père et l’enfant qu’il lui donnera, le registre en jeu reste alors phallique-anal, ces objets ayant valeur d’objets de substitution ou de cadeaux. Un travail psychique important reste encore à accomplir tout au long de la vie : symboliser l’intérieur et tout ce qui y entre. Dans ce travail du féminin, il s’agit, après que les angoisses d’intrusion prégénitales auront été élaborées en angoisses de pénétration génitale, que la pénétration elle-même puisse être érotisée. En effet, pour Schaeffer, « plus le moi admet de pulsion sexuelle en son sein, plus il a accès à la jouissance sexuelle, et plus il est riche, mieux il vit, mieux il aime, moins il est malade et mieux il pense » (1997, p. 22). Les situations où de grandes quantités d’excitation non liées sont admises dans le moi sans effraction traumatique et sans sidération du moi sont désignées sous le terme d’effractions nourricières. C’est notamment le cas lorsque le moi est confronté à la poussée constante de la libido, à la différence des sexes, et à la rencontre avec l’amant de jouissance. Dans ces situations, le moi aurait le choix entre : se refermer à l’invasion pulsionnelle (solution répressive), accepter une partie et négocier (solution névrotique), ou s’ouvrir et se soumettre (solution pulsionnelle). Le féminin de la femme résiderait ainsi dans « le dépassement toujours à reconquérir, de ce conflit constitutif, qu’elle le dénie ou non, de la sexualité féminine : son sexe exige la défaite, son moi la hait » (1997, p. 26).
L’expérience de l’accouchement
Pour Alexandra Bouchard, l’expérience de l’accouchement constitue une double mise à l’épreuve pour la femme : mise à l’épreuve des limites du corps, par l’ouverture du sexe et la traversée du sexe par le corps de l’enfant, et mise à l’épreuve du moi. Du fait d’une part, de l’intensité des sensations éprouvées, qu’elles soient du côté de la douleur, du plaisir ou du déplaisir et d’autre part, de la nature des fantasmes mobilisés par cette expérience, le moi de la femme est ici confronté à un risque de débordement économique et donc de rupture du sentiment continu d’exister, au sens de Winnicott. De ce point de vue, l’un des enjeux principaux de l’accouchement est alors pour la femme d’éprouver cette expérience, tout en maintenant un sentiment continu d’être soi.
Sur le plan sensoriel, deux caractéristiques de l’accouchement sont plus particulièrement mises en exergue et discutées : son rapport à la passivité, et son association à la douleur. Par son déroulement même, l’accouchement implique pour la parturiente d’accepter une position passive vis-à-vis d’un phénomène qui à la fois engage son corps d’une manière entière et intense et en même temps lui échappe. L’accouchement a sa temporalité propre, indépendante et imprévisible. Durant la phase de travail, le bébé progresse dans la filière génitale de manière autonome et inéluctable. À juste titre, Alexandra Bouchard relève que la douleur constitue, dans les représentations individuelles et collectives, un éprouvé indissociablement lié à l’accouchement. Pourtant, l’accouchement sans douleur semble difficile à envisager socialement, comme s’il faisait l’objet de résistances, et qu’il s’agissait, en préservant la douleur de l’accouchement, de préserver sa fonction. Selon les auteurs, il pourrait s’agir : d’une tentative pour juguler l’angoisse (Claude Revault d’Allonnes), d’un moyen de mettre à distance les représentations sexuelles infantiles (Monique Bydlowski), ou d’un contre-investissement des désirs et plaisirs interdits ressentis au cours de l’accouchement.
Sur le plan fantasmatique, l’accouchement est susceptible de favoriser l’émergence de représentations variées notamment en lien avec la confrontation à la mort, la dimension de perte, la question de la dépendance, la confrontation au sexuel et à l’incestuel, et la résurgence des fantasmes œdipiens. Ces représentations pourraient participer à une effraction traumatique lors de l’accouchement, que ce soit par afflux massif et débordement pulsionnel du ça favorisé par la levée du refoulement caractéristique de la fin de grossesse, ou par effet d’après-coup d’un premier temps qui pourrait être constitué par la scène fantasmatique de la réalisation des désirs œdipiens, mais aussi par la scène originaire de la naissance de la parturiente elle-même.
Au total, on peut donc considérer que face à l’afflux d’excitations sexuelles internes et externes associées à l’expérience de l’accouchement, le moi est confronté à un envahissement pulsionnel qui risque de dépasser et d’ébranler ses moyens de défense habituels.
Toutefois, Alexandra Bouchard montre aussi comment, à partir notamment de l’angoisse de différence anatomique des sexes, de la différence des générations réactualisée par l’accès à la maternité, et plus spécifiquement encore de la dialectique activité-passivité convoquée par la situation de désaide et de dépendance vécue en présence d’une autre femme, l’expérience de l’accouchement vient réactualiser certaines dimensions de la problématique œdipienne et constituer ainsi une nouvelle opportunité pour son élaboration. Rivalité et besoin de mise à distance de la figure maternelle, besoin d’étayage, d’identification à la mère et d’inscription dans la filiation maternelle, sont ainsi réactualisés et mis en conflit avec l’expérience de l’accouchement. Par ailleurs, l’auteure propose l’idée que les éprouvés sensoriels de la parturiente lors de l’accouchement par voie basse puissent avoir, à côté de leur potentiel effractant, un effet bénéfique dans le vécu de devenir mère et le lien entre la mère et l’enfant : « L’éprouvé vaginal de la naissance, en tant qu’éprouvé d’une première séparation et d’une première rencontre en même temps, et dans un même lieu, favoriserait l’ancrage corporel, charnel, des premiers liens » (Bouchard, 2023, p. 105). Enfin, dans les suites des travaux de Schaeffer, Alexandra Bouchard propose de concevoir l’expérience de l’accouchement comme une mise à l’épreuve du féminin au sens de la capacité du moi à accepter une grande quantité d’excitation non liée et à en être nourri. Dans certaines conditions, l’expérience de l’accouchement pourrait ainsi jouer le rôle d’un effracteur nourricier. L’ouverture du moi à l’envahissement pulsionnel représenterait alors une alternative à d’autres défenses du moi, retrouvées préférentiellement dans le cadre de la recherche menée par l’auteure.
Césariennes sur demandes maternelles
En effet, l’un des résultats principaux de cette recherche concerne le type de stratégie de pare-excitation utilisée par le moi en réponse à l’envahissement pulsionnel suscité par l’expérience de l’accouchement. Alors qu’elle retrouve, chez les femmes du groupe « tout-venant », un recours préférentiel à un contre-investissement des représentations sexuelles par le biais de la douleur, chez les femmes du groupe « césarienne », c’est l’évitement de la voie vaginale par le choix de la modalité d’accouchement qui remplirait cette fonction pare-excitante. Le recours à la césarienne traduirait ainsi chez ces femmes une tentative de disjoindre sexualité et accouchement, vagin de femme et vagin de mère, érotique féminin et érotique maternel.
Plus largement, l’auteure retrouve dans l’histoire de ces femmes un vécu d’effraction plus fréquent lors des premières règles, ainsi qu’un vécu plus souvent négatif des transformations non contrôlables en lien avec la grossesse. L’accouchement par voie basse est souvent perçu comme un événement indésirable du fait de son imprévisibilité, de son caractère douloureux, et du nécessaire recours à une tierce personne secourable. Les angoisses projetées sur l’accouchement portent plus souvent sur l’intégrité physique tout entière, au travers de celle du sexe féminin, avec de possibles représentations terrifiantes de mutilation, voire des angoisses identitaires. Alors qu’une position active lors de l’accouchement est plus souvent revendiquée en prénatal, ces femmes décrivent plus souvent en post-natal un vécu de traversée passive de cette expérience, contrairement aux femmes du groupe « tout-venant », lesquelles, après avoir décrit en prénatal davantage d’appréhensions concernant le risque de passivité lors de l’accouchement, témoignent souvent à postériori d’une expérience d’allure mutative, et d’un vécu inédit de leur corps comme animé d’une force intérieure indépendante à laquelle il n’y aurait pas d’autre choix que de s’abandonner activement.
Conclusion
Dans son ouvrage, Alexandra Bouchard nous montre comment le recours à la césarienne, au-delà de différents motifs manifestes avancés par les parturientes et déjà répertoriés dans d’autres études, représente une tentative de réponse parmi d’autres, au risque de débordement du moi auquel expose l’envahissement pulsionnel associé à l’expérience de l’accouchement chez chaque femme. Plus largement, l’auteure vient nous rappeler ici comment l’expérience de l’accouchement, quels qu’en soient les modalités et le déroulement, constitue toujours une expérience singulière et extraordinaire, une opportunité de rencontre avec soi-même et de transformation psychique. Ce livre est une invitation à ouvrir notre écoute aux récits d’accouchements de nos patientes et à la pluralité des histoires qu’ils racontent. En cela, il pourra intéresser tous les psychanalystes, ainsi que nombre de cliniciens engagés dans le champ de la périnatalité.
Germain Dillenseger est psychiatre et pédopsychiatre en activité mixte : cabinet libéral et unité de soins conjoints parents-bébé ; psychanalyste inscrit à l’Institut de Psychanalyse de Paris.
Références bibliographiques
Schaeffer J. (1997). Le refus du féminin. Paris, Puf.
Catherine Chabert, Se retrouver. Rencontres avec…[1], Paris, Puf, 2023
On s’est connu, on s’est reconnu
On s’est perdu de vue, on s’est r’perdu de vue
On s’est retrouvé, on s’est séparé
Puis on s’est réchauffé.
Le tourbillon, chanté par Jeanne. Moreau, paroles de Serge Rezvani.
 Se retrouver reprend les contributions d’un colloque tenu en 2021 autour des travaux de Catherine Chabert. L’ouvrage nous fait participer à ces retrouvailles et au goût du débat qui les anime. « Se retrouver » soi-même, « se retrouver » l’un l’autre, en dépit des différences ou grâce à elles : les retrouvailles engagent la possibilité d’être deux toujours articulée à l’unité narcissique et au trio œdipien. Pour se retrouver, encore faut-il supporter de se perdre. Cette possibilité est au cœur du livre.
Se retrouver reprend les contributions d’un colloque tenu en 2021 autour des travaux de Catherine Chabert. L’ouvrage nous fait participer à ces retrouvailles et au goût du débat qui les anime. « Se retrouver » soi-même, « se retrouver » l’un l’autre, en dépit des différences ou grâce à elles : les retrouvailles engagent la possibilité d’être deux toujours articulée à l’unité narcissique et au trio œdipien. Pour se retrouver, encore faut-il supporter de se perdre. Cette possibilité est au cœur du livre.
Le livre comporte quatre parties, précédées d’introductions concises permettant de ressaisir les enjeux centraux du travail de Catherine Chabert ; leur clarté permet d’en envisager une lecture séparée comme introduction à son œuvre. Elles engagent à la (re)lire et à retrouver sa façon d’articuler théorie et clinique. Chaque chapitre invite des auteurs très divers à débattre d’un thème qui lui est cher et Catherine Chabert le conclut par une discussion fouillée. Ces développements donnent à l’ouvrage un fil rouge et font vivre le débat autour de l’intrication des enjeux narcissique et œdipien, la séparation, la douleur, la pulsion de mort, le transfert et l’écriture.
La première partie, « Incertitudes d’Œdipe », introduite par Françoise Neau et Aline Cohen de Lara, contient les contributions de Vincent Vivès et Paul Denis ; la deuxième, « L’un et l’autre », introduite par Catherine Matha et Benoît Verdon, reprend celles de Leopoldo Bleger, Évelyne Chauvet et Bernard de La Gorce. Le chapitre « Meurtre, mort et pulsion de mort », introduit par Françoise Neau et Aline Cohen de Lara, invite Jacques André, Sylvain Missonnier et Laurence Kahn, et « Aimer la psychanalyse », introduit par Françoise Neau et Estelle Louët, contient les textes de Jean-François Chiantaretto et André Beetschen. L’ensemble s’achève par un poème de Patrick Autréaux. Ces contributions seront citées sous la forme (nom d’auteur SR, numéro de page).
L’impossibilité de rendre justice à ces contributions me pousse à choisir quelques points qui traversent ces rencontres.
Narcisse et Œdipe
La différence
Catherine Chabert affirme la « consubstancialité de la sexualité et de la perte, de l’angoisse de castration et de l’angoisse de perte d’amour de la part de l’objet » rendant impossible d’isoler le motif narcissique de l’idéalisation-déception-perte de la reconnaissance de la différence des sexes. Elle dégage une version du fantasme de séduction « féminin mélancolique » (Chabert, 2003) marqué par l’impossibilité à « renoncer aux premiers objets d’amour et de haine », l’identification à l’objet d’amour perdu, la conviction d’exciter le père et une culpabilité massive (Neau et Cohen de Lara SR, p. 17). Le surmoi est tyrannique et la menace prend la forme de l’enfant mort, figure de la perte absolue, version mélancolique du fantasme masochique « un enfant est battu ».
Le lien entre la pulsion, le moi et l’objet se pose de façon aigüe à la charnière des théories de Winnicott et de Freud ; Leopoldo Bleger y consacre un texte qui tisse les fils de la notion de soi et de la douleur. Catherine Chabert récuse une conception développementale du soi représentant un narcissisme non libidinal qui précéderait la conflictualité alors que le moi serait construit en identification aux objets perdus : « Comment séparer investissements narcissiques et investissements objectaux? » (Chabert SR, p. 130). L’espace transitionnel et la crainte de l’effondrement de Winnicott sont pertinents pour elle à condition d’associer l’événement non reconnu et l’espace intermédiaire à la scène primitive. Sylvain Missonnier voit de même le fantasme infanticide comme envers de la confusion mère/bébé de la préoccupation maternelle primaire. Catherine Chabert insiste sur le caractère toujours sexuel de l’infantile, qui ne peut se tenir dans l’indifférenciation, et « affronte inévitablement la différence des sexes et des générations ». La différence des sexes est « le paradigme de la différence » (Chabert, SR, p. 141) – ce qui ancre la différence dans le corps. Elle évoque moins souvent la différence des générations, mais précise qu’il s’agit de cures d’adultes ; la différence des générations est-elle paradigmatique dans les cures d’enfants et d’adolescents ? On ne peut envisager d’état narcissique antérieur au conflit, ce que montre le mythe de Pandore travaillé par Bernard de La Gorce autour du thème de l’indifférence (des sexes, des affects, de l’analyste) : Pandore, la première femme, pourrait semer le trouble de la différence des sexes, mais elle est conforme à un idéal et ne peut donc incarner une vraie différence ; Catherine Chabert souligne qu’elle n’amène pas le conflit, mais est née d’un conflit inaugural, de même que l’analyste ne sème pas le trouble dans un monde paradisiaque, le conflit lui préexiste. Quel est le risque d’une analyse « à la Pandore », séduisante et empathique, mais réduite à une surface privée de contenu pulsionnel ?
Catherine Chabert montre la fécondité d’interroger les multiples implications de la différence des sexes et du narcissisme : l’analogue féminin du désir de sauver la femme de petite vertu, la castration féminine, la spécificité masculine de l’angoisse de castration, l’universalité de l’angoisse de perte d’amour, l’impact de l’enfant mort sur le féminin mélancolique du père. Paul Denis reprend les méandres du complexe d’Œdipe et le clivage des figures de la mère et de la prostituée comme effet sur les hommes du féminin mélancolique et du féminin maniaque, tous deux à la fois excitants et inhibants, l’un par la culpabilité et le désir de la soulager, l’autre, par l’excitation insatiable. Il propose que l’angoisse de castration du garçon ne serait pas suscitée par la vue de l’absence de pénis de la fille, mais par « la perception […] de la culpabilité maternelle, du féminin mélancolique chez la mère » (Denis SR, p. 54).
Même la mort se noue aux différences entre sexes, générations, réalité et fantasme, conscient et inconscient. Catherine Chabert souligne le poids de la réalité : « de l’expérience du deuil, peut-on dire qu’elle n’est qu’une séparation ? » (Chabert SR, p. 139) et ajoute l’identification au mort comme indissociable du deuil. Jacques André et Sylvain Missonnier déplient cliniquement l’impact des différences : « La mort d’un père présente le meurtre, la mort d’une mère présente la mort » (André SR, p 167) ; La réalité du pouvoir d’une mère sur son bébé déborde le refoulement d’un fantasme infanticide ; pour un enfant de remplacement, le mort désigne la mélancolie parentale et le déploiement de fantasmes meurtriers inconscients peut traiter la rivalité et engager un mouvement vers le sexuel : « derrière le mort, le tué » (André SR, p. 160). L’enfant mort, comme fantasme, se situe pour Catherine Chabert à la croisée de l’inceste, du meurtre, de la passivité, du besoin de punition, de l’idéal perdu, de la castration féminine, du traitement de la perte, du sexuel et ses déformations manifestent l’enchevêtrement des pulsions.
La déception
La déception, indissociable de l’idéalisation, peut entraîner un retournement narcissique sur un moi déçu et décevant, jusqu’à engager un mouvement mélancolique d’auto-accusation et d’effacement des différences. Elle a un sens fort qui condense la blessure narcissique, l’insatisfaction, la trahison que constitue la découverte de la sexualité maternelle et le refus de donner le pénis à la fille. Catherine Chabert lui attribue un « rôle décisif » (Chabert SR, p. 305). Elle développe l’évolution de la conception de la déception chez Freud : œdipienne sous le primat du principe de plaisir, puis liée à l’idéal et au narcissisme, enfin en lien avec la pulsion de mort et le besoin de punition. « On pourrait admettre que l’idéal et la déception ont en commun de s’attacher aussi bien aux destins du moi qu’à ceux de l’objet » (Chabert SR, p. 303).
Idéalisation et déception participent à toute la cure, selon Catherine Chabert. Elle reprend avec Évelyne Chauvet l’écart entre objet trouvé, objet perdu et objet retrouvé, pour évoquer l’incarnation transférentielle de la déception à partir de la différence. Pour Évelyne Chauvet, l’espoir transférentiel d’annuler cet écart impose de travailler la différence entre l’analyste en personne et l’analyste en fonction. Ce travail de séparation peut amener à investir la vie psychique, la trace, le rêve et érotiser les différences. La dédifférenciation moi/objet risque de « nier la séparation au prix de la destruction » (Chabert SR, p. 140) en retournant la haine en auto-accusation ; elle se rapproche alors du triomphe maniaque montrant le « soubassement maniaque de la mélancolie » (Chabert SR, p. 66).
Entre idéalisation, déception et désir, la place de l’objet est au cœur des développements d’André Beetschen. Il note le poids que Catherine Chabert donne à l’idéalisation de l’amour maternel absolu, ce qu’elle reconnaît tout en insistant sur la place du père et de son amour, comme refuge et frein à la dérive mélancolique ; le titre « la jeune fille et le psychanalyste » (Chabert, 2015b) fait espérer que rencontrer « la » psychanalyste ouvre au lien avec « le » psychanalyste. La déception peut engager un mouvement mélancolique, parfois requis dans la cure, mais aussi le détournement des filles vers le père. André Beetschen pose la question de l’écart entre le renoncement aux objets et le renoncement à la satisfaction : dans « l’amour maniaque », le renoncement pulsionnel échoue, la culpabilité est refusée, la multiplication des objets triomphe de la perte. L’impossible renoncement est l’échec d’un surmoi protecteur (présent dans la phrase « maintenant il faut se quitter », Chabert 2017) ; le tyrannique « surmoi au féminin » fait équivaloir renoncement et auto-destruction et interroge sur les destins différents des vœux de mort des filles adressés à un objet narcissiquement investi, et de ceux des garçons. Catherine Chabert poursuit ces réflexions sur le surmoi par le rôle de la pulsion de mort dans sa genèse, qu’il soit héritier des déceptions œdipiennes ou de la culpabilité tyrannique du féminin mélancolique (qui peut aussi concerner les hommes).
La douleur et l’attente
Catherine Chabert fait de la possibilité de se séparer un but de l’analyse. La perte et la douleur qui l’accompagne provoquent une excitation massive qui peut chercher à se calmer par la douleur physique ou l’investissement masochique du manque. La séparation, la douleur et leur place dans la cure traversent l’ouvrage, spécialement les textes de Leopoldo Bleger, d’Évelyne Chauvet, et de Catherine Chabert.
L’analyse se finit quand « l’analyste et le patient ne se rencontrent plus » (Freud 1937c/2010) : il s’agit de se quitter. Se séparer, en revanche, est un travail et suppose une capacité à quitter et à être quitté, voie active et voie passive, à laquelle s’intéresse Évelyne Chauvet ; dans le jeu du fort-da, l’absence passivement subie est retournée en activité. Toute séparation, toute analyse dans ses moments mélancoliques, confronte à la nécessité d’un travail de deuil avec une dimension narcissique de la perte. Entre se quitter et se séparer : la douleur.
La douleur est pour Catherine Chabert aussi fondatrice de la vie psychique que la satisfaction et peut avoir une valeur positive. Ce caractère fondateur la place au cœur du Soi, comme représentant du vivant : « souffrir, c’est vivre » (Chabert SR, p. 135). La réflexion sur la douleur est indissociable de celle sur le transfert et le contre-transfert. Dans la cure, la douleur ne s’interprète pas, elle se vit, en présence de l’analyste. La capacité de l’analyste à souffrir, sa présence « en chair et en psyché », est essentielle, comme celle de Freud dans le jeu du fort-da. Même si elle répète « une non-rencontre » (Chabert SR, p. 147), la douleur en présence peut être à la source du sentiment de la continuité d’exister, de l’espace transitionnel et de l’objet, « un objet à faire souffrir » (Chabert SR, p. 135-136). Faire souffrir est en deçà du sadisme et du plaisir, comme la douleur est en deçà du masochisme. Il s’agit de l’utilisation de l’objet au sens de Winnicott, d’un objet détruit qui est toujours là. La douleur de transfert peut alors devenir souffrance, expérience impliquant un objet : « La douleur concerne prioritairement le narcissisme et la souffrance, la prise en compte de l’objet » (Chabert SR, p. 136), le masochisme concerne sa prise en compte impliquant un plaisir. Bernard de La Gorce souligne que l’indifférence tout comme la cruauté, certaines passions et la douleur n’impliquent ni objet ni plaisir à souffrir ou à faire souffrir au contraire de la haine et du sadisme. Le masochisme, souligne André Beetschen, constitue en la sexualisant une « érotique de la mélancolie » (Beetschen SR, p. 278).
« Croire au transfert » (Chabert 2015), à son déploiement, à sa fécondité, permet d’éviter la précipitation. L’importance de l’attente, le risque de l’urgence, en particulier face à la douleur du patient, traversent le livre. Évelyne Chauvet souligne qu’il faut accepter la temporalité pour dire « maintenant il faut se quitter » (Chabert, 2017), donc pouvoir différer ; pour attendre, tolérer la passivité et la séparation, il faut disposer d’un noyau de masochisme érogène bien constitué. La capacité de l’analyste à laisser se déployer les moments mélancoliques et la douleur de transfert est indissociable de son propre masochisme, en appui sur son investissement de la méthode. L’attente et le transfert, même s’il semble neutralisé l’engagent profondément.
La pulsion de mort et le collectif
Jacques André remarque que les premières sépultures sont concomitantes de l’apparition du langage : aux plans collectif et individuel, faut-il investir de libido la trace de l’absence pour parler et enterrer ? Si la douleur déborde la capacité d’élaboration, la destructivité brute peut s’attaquer au moi ou à l’objet.
Si, comme Catherine Chabert, on définit la pulsion de mort comme force de déliaison, elle n’est pas assimilable à la destructivité et peut « s’avérer utile, voire bénéfique » (Chabert SR, p. 212), pour tempérer la tendance à l’unification totalisante d’Éros, œuvrer pour la reconnaissance des différences et s’opposer à l’idéalisation sur le plan individuel transférentiel ou collectif.
Dans le prolongement de ses travaux sur le nazisme, Laurence Kahn interroge l’analogue collectif du traitement de la perte, de la manie, de l’identification. Elle met immédiatement en garde contre une recherche trop claire, totalisante, des causes qui serait du côté (maniaque ?) de « l’excitation de la pensée » (Kahn SR, p. 190) cherchant à maîtriser la réalité (historique) qui suscite l’effroi… Cette causalité totalitaire caractérise le nazisme. Comment distinguer des instances analogues à celles de la topique individuelle permettant d’imaginer la perte et ses destins ? Cela suppose un sujet divisé. Or le peuple nazi est absolument Un, exactement identifié à son histoire, sa biologie et étant à lui-même son propre idéal. Cela fait écho au caractère bénéfique de la pulsion de mort quand elle met un frein à l’excitation massive ou à l’emprise extrême. La haine individuelle qui d’ordinaire menace le groupe devient haine de l’étranger et consolide une masse indifférenciée qui partage des crimes et des idéaux dans la promesse d’une solidarité absolue entre auto-conservation (espace vital), corps ou biologie, haine et idéal. Cela permet d’interroger les notions de sublimation et d’idéalisation, le statut de l’incarnation et la conception de l’art noué, voire identique à la politique. Catherine Chabert répond en évoquant le collectif d’abord par le biais de l’intime : la littérature ou le transfert. Face à l’effroi et à l’impuissance, elle retient le sentiment d’imposture, le risque de « donner du sens trop tôt, trop vite, aux événements traumatiques […] pour fermer la plaie » (Chabert SR, p. 233), de succomber aux attraits narcissiques de son propre fonctionnement dans une exaltation maniaque, faisant écho à la pensée excitée. L’horreur collective crée une urgence à répondre qui met à mal l’attente. Catherine Chabert souligne dans le nazisme l’idéalisation de la haine et distingue soigneusement l’instance Idéale, le contenu des idéaux et le processus d’idéalisation. Le lien de l’Idéal aux pulsions de mort est complexe : en clivant un Bien d’un Mal il en dépend, mais s’il prend en masse, il lui manque le côté « anarchiste » de la pulsion de mort. Cela peut renvoyer à la discussion de l’identification maniaque comme forme de totalitarisme.
Lire relire écrire et ré-écrire
L’écriture de Catherine Chabert, son charme, sa place dans le métier d’analyste ont retenu plusieurs auteurs. « Écrire l’analyse est une forme de duplication du transfert », elle manifeste le « rapport de l’analyste à l’analyse », le transfert sur l’analyse (Neau et Louët SR, p. 246-247).
Vincent Vivès et Paul Denis s’appuient sur Flaubert et la passion de Catherine Chabert pour la littérature. Paul Denis et Catherine Chabert travaillent à partir de ce que suscite le héros, un « mouvement d’humeur » pour l’un, un « faible » pour l’autre, faisant du roman une expérience clinique partageable (Denis SR, p. 40 ; Chabert SR, p. 59). Par opposition à un transfert trop présent, la littérature est une expérience « transitionnelle » (Neau et Cohen de Lara SR, p. 16). Lire, c’est aussi relire, et débattre avec ses auteurs favoris, Freud, bien sûr, mais aussi Winnicott, Anzieu, Wildöcher et Pontalis que Bernard de La Gorce, André Beetschen et Leopoldo Bleger font intervenir dans leur texte.
L’écriture, voire la ré-écriture du même cas, est un effet de la force d’attraction du transfert et du contre-transfert dans les cures qui mobilisent chez l’analyste sa propre auto-destructivité et sa haine « jusqu’à le priver d’une solution masochiste ». Il s’agit de « retrouver sa voix et le plaisir à penser le patient avec et sans lui, contre lui » (Chiantaretto SR, p. 257-258). Catherine Chabert (SR, p. 127) se penche sur cette répétition : est-ce « répéter ou revenir vers » ? Comme dans le jeu et le transfert, la répétition porte l’espoir d’un recommencement, vers le plaisir à répéter plutôt que vers la compulsion de répétition. Le désir d’écrire s’inscrit pour Catherine Chabert dans le transfert pour se dégager du huis clos, du risque de dérive mortifère de l’analyse et de l’analyste, et trouver une relance libidinale par la curiosité. Il s’agit de se garder de croire en une causalité unique (qu’elle se trouve dans le traumatisme externe ou dans le lien à la mère des premiers temps comme origine de l’idéal et de la déception). La nécessité d’écrire va donc de pair avec « la bataille pour le père […] pour le havre qu’il peut offrir, pour l’idéal qu’il peut incarner, un idéal davantage marqué d’ambivalence » (Chabert SR, p. 304). C’est ce que suggère André Beetschen en évoquant l’idéalisation maternelle immédiatement après l’écriture analytique. La complexité métapsychologique est cet appui essentiel ; c’est un objet d’amour et de transfert, profondément impliqué dans le contre-transfert, source d’un intense plaisir et d’un espoir de redécouverte de certains aspects du transfert ; c’est l’outil du dégagement, et son but. Nouvel objet et nouveau but, l’écriture engage-t-elle la sublimation d’une part de l’énergie pulsionnelle du transfert ?
Comme le transfert, l’écriture est indissociable d’une adresse : « j’écris aux autres » (Chabert SR, p. 296). En reprenant l’utilisation de l’objet, Catherine Chabert, articule l’écriture de cas à la destruction de l’objet (et la haine de contre-transfert ?) et sa rencontre. Écrire creuse après-coup un espace entre la réalité trop réelle du transfert et la sorcière métapsychologie, entre le fantasme du patient ou de l’analyste et la rigueur métapsychologique, entre confiance envers le transfert et angoisse, entre patient, lecture et lecteur, entre plaisir et déplaisir, entre amour de la psychanalyse et haine.
Conclusion
Les multiples échos entre les discussions et les contributions montrent si c’était nécessaire la cohérence des travaux de Catherine Chabert, mais aussi leur fécondité dont chaque auteur se saisit à sa façon. Chaque lecteur est amené à penser à ses propres références théoriques et à ses propres patients, et ainsi à renouveler le fait de « croire au transfert » (Chabert, 2015), et à l’attente de l’analyste, entre espérances et déceptions. Lire et relire ce livre permet de se rencontrer soi-même comme analyste et d’écouter les patients autrement.
Dinah Rosenberg est psychanalyste, membre de la SPP.
Références bibliographiques
Chabert C (2003). Féminin mélancolique. Paris, Puf.
Chabert C. (2015). Croire au transfert. Annuel de l’APF : 15-32.
Chabert C. (2015b). La jeune fille et le psychanalyste. Paris, Puf.
Chabert C (2017). Maintenant, il faut se quitter…. Paris, Puf.
Chabert C. (2023). Se retrouver, Rencontres avec Jacques André, Patrick Autréaux, André Beetschen, Leopoldo Bleger, Évelyne Chauvet, Jean-François Chiantaretto, Bernard de La Gorce, Paul Denis, Laurence Kahn, Sylvain Missonnier et Vincent Vivès. Coordonné par F. Neau, avec A. Cohen de Lara, E. Louët, C. Matha et B. Verdon. Paris, Puf.
Freud S. (1937c/2010). Analyse finie et analyse infinie. OCF.P, XX : 13-55. Paris, Puf.
[1] Catherine Chabert (coordonné par Françoise Neau, avec Aline Cohen de Lara, Estelle Louët, Catherine Matha et Benoît Verdon). Se retrouver. Rencontres avec Jacques André, Patrick Autréaux, André Beetschen, Leopoldo Bleger, Évelyne Chauvet, Jean-François Chiantaretto, Bernard de La Gorce, Paul Denis, Laurence Kahn, Sylvain Missonnier et Vincent Vivès, Paris, Puf, 2023.
Laurent Danon-Boileau, Dans les plis du langage. Raisons et déraisons de la parole, Paris, Odile Jacob, 2022
 La lecture du nouvel ouvrage de Laurent Danon-Boileau offre un double plaisir. D’abord épistémophilique, car le linguiste nous fait ici profiter de l’étendue de son savoir ; il nous montre comment le langage, loin de servir à de seules fins d’information et de communication, se trouve intimement lié, dès ses origines, à l’expression des mouvements affectifs et émotionnels, et parle autant à l’autre qu’à soi-même, et de soi-même. Plaisir aussi de pratique clinique qu’il nous propose de partager, car le linguiste est en l’occurrence tout aussi psychanalyste expérimenté – et qui plus est, psychanalyste d’enfants, et spécialiste de l’autisme –, et peut magistralement nous montrer de quelle façon le mot et même l’onomatopée du très jeune enfant s’associent dès l’origine à une valence émotionnelle, qui va combiner plusieurs éléments de la réalité perceptive pour les agréger dans un ensemble personnel, propre au sujet, constitué de représentations inconscientes dont le mot devient à la fois le représentant symbolique et le rempart face à l’angoisse liée à ces représentations. La double fonction du mot, en fait, et sa capacité de liaison : « le mot peut être ce qui fait lien avec les représentations inconscientes qu’un fragment du monde évoque. Mais ce peut être aussi une manière de tenir à distance les inquiétudes qu’il peut provoquer » (p. 30).
La lecture du nouvel ouvrage de Laurent Danon-Boileau offre un double plaisir. D’abord épistémophilique, car le linguiste nous fait ici profiter de l’étendue de son savoir ; il nous montre comment le langage, loin de servir à de seules fins d’information et de communication, se trouve intimement lié, dès ses origines, à l’expression des mouvements affectifs et émotionnels, et parle autant à l’autre qu’à soi-même, et de soi-même. Plaisir aussi de pratique clinique qu’il nous propose de partager, car le linguiste est en l’occurrence tout aussi psychanalyste expérimenté – et qui plus est, psychanalyste d’enfants, et spécialiste de l’autisme –, et peut magistralement nous montrer de quelle façon le mot et même l’onomatopée du très jeune enfant s’associent dès l’origine à une valence émotionnelle, qui va combiner plusieurs éléments de la réalité perceptive pour les agréger dans un ensemble personnel, propre au sujet, constitué de représentations inconscientes dont le mot devient à la fois le représentant symbolique et le rempart face à l’angoisse liée à ces représentations. La double fonction du mot, en fait, et sa capacité de liaison : « le mot peut être ce qui fait lien avec les représentations inconscientes qu’un fragment du monde évoque. Mais ce peut être aussi une manière de tenir à distance les inquiétudes qu’il peut provoquer » (p. 30).
Toutefois, le linguiste ne peut pas se contenter de cette analyse. Pourquoi ? Parce que, justement, il est sensible au fait que le mot est avant tout une expérience auditive et une émission de sons, et cette émission nécessite une action motrice (les cordes vocales sont des muscles, tout comme la zone péribuccale). On se souvient ici que, Freud neurologue, connaissait très bien ce domaine des « fonctions supérieures » dont la pathologie commence à être précisée au cours du troisième tiers du 19e siècle : les aphasies, les agnosies et les apraxies. Leur dissociation permettra des avancées dans la connaissance des localisations cérébrales (qui seront d’ailleurs aussi leur piège) : une aphasie ne s’accompagne pas nécessairement d’une agnosie, et vice versa, donc l’espace cortical qui reçoit les représentations visuelles (l’image des choses vues) n’est pas le même que celui qui reçoit les représentations verbales (l’énoncé auditif du nom des choses vues), et ils peuvent présenter des lésions distinctes. Freud saura tirer de cette dissociation la distinction entre représentations de chose et représentations de mot, et l’utiliser pour bâtir une première topique – il était d’ailleurs lui-même un spécialiste des aphasies. Mais ce faisant, il portera moins d’attention aux apraxies ou à l’aphasie motrice, à savoir aux troubles liés à la mise en forme et à l’exécution d’une série d’actions motrices coordonnées, dont fait partie aussi le langage, ou plus précisément la parole.
Laurent Danon-Boileau ne s’intéresse pas seulement à la pensée et aux mots, mais aussi à l’« enfance du dire » (p. 10), à l’ « image verbale » (p. 35). Il en étudie les répétitions compulsives, ces mots-actions qui ne renvoient qu’à une séquence motrice, toujours la même, avec donc cette part de fixité et de répétition plus ou moins compulsive qui rend le mot inutilisable hors de son association à l’action à laquelle il renvoie. Ce qui conduit le linguiste au psychanalyste, car la répétition est constitutive de l’expérience du transfert, elle en est même la condition. Qu’en est-il alors de la parole répétitive ? Parfois, elle peut apparaître comme « expulsive », « axée sur l’image verbale motrice au détriment de l’image verbale acoustique, sur l’exercice répété de la motricité au détriment du plaisir de l’écoute » (p. 126). Mais l’auteur est étranger à une logique binaire du « ou bien ceci » et « ou bien cela ». Cette même parole expulsive, dont la part de force ne nous échappe pas, peut inclure le sens, mais comme noyé dans le caractère impérieux de la force. Or « le langage est tout ensemble force et sens » (p. 126) – la force des besoins, des pulsions, de l’excitation, et le sens compris dans la représentation que médiatise le langage – et la dynamique de la cure peut onduler, selon la période traversée par le patient, voire même selon les moments d’une même séance, du pôle de la force au pôle du sens.
On retrouve ici l’importance de ce que Jean-Luc Donnet a nommé « agir de parole ». Cet agir qui a trop souvent mauvaise presse en psychanalyse, alors que, du fait même de sa répétition – et grâce à elle – il connote le mouvement transférentiel, et il n’est pas rare qu’il l’inaugure, notamment avec les patients qui s’écartent des organisations névrotiques ordinaires. Danon-Boileau nous propose une véritable séméiologie de l’agir de parole : de ces locutions fréquentes du français oral (« Bon », « Enfin », « Disons », « Notez »…) dont l’action sur l’analyste consiste à tenter de le transformer en un interlocuteur ordinaire, jusqu’aux questions les plus directes, touchant à la vie même de l’analyste hors séance, qui ne sont pas moins porteuses d’un important potentiel interprétatif dans l’après-coup. Sans oublier ce qu’est la parole en mettant de côté le sens des mots, à savoir l’intonation et les variations mélodiques de la voix, ou sur un autre registre, cette parole qui, bien qu’en apparence fluide – trop fluide, probablement – semble dépourvue de toute qualité transitive ou injonctive : le discours opératoire que l’auteur discute parmi les formes de parole compulsive, tout en récusant le terme de récit factuel, car il considère que sa platitude peut être indice d’un trop-plein d’intensité émotionnelle et de fantasmatique envahissante, comme il le montre avec le cas de Marie, exposé et commenté de façon détaillée (p. 139-148).
Ces aller-retour entre le linguiste et le psychanalyste font toute la richesse du livre. L’investigation de Danon-Boileau se poursuit sur l’origine des mots chez chacun de nous. Les mots, pensons-nous, sont particulièrement indiqués pour exprimer l’intime ; certes, mais ils sont aussi, et en même temps, anonymes, car ils sont ceux de nos parents, de nos proches, de tous les autres : « telle est la nature paradoxale du mot » (p. 41). S’adresser à quelqu’un présuppose que « tous nos mots sont déjà en lui, et tous les siens en nous » (p. 42). Les écholalies de certaines situations autistiques montrent un langage qui, non seulement ne s’adresse à personne, mais aussi n’est pas pris par le sujet à son propre compte. Ainsi, la parole prononcée, en incluant cris et onomatopées, est indissociable d’une « écoute ». On est d’ailleurs ici en présence de ce que Freud avait repéré dès l’Esquisse, à savoir cette « situation anthropologique fondamentale » où le cri de décharge lié à la faim ou à la douleur fait sens pour la « personne secourable » ; c’est à cette condition qu’il devient, secondairement, « signifiant d’un affect de déplaisir » (p. 51). Nous sommes donc en présence d’un mouvement civilisateur, au sens où le langage devient l’une des sources de la sublimation. C’est cette situation fondamentale qui se répète lorsque, dans une séance analytique, une parole apparaît comme n’appartenant ni à l’un ni à l’autre des protagonistes, mais aux deux simultanément et conjointement. Dans ces conditions, l’affect peut être considéré, non pas comme primaire, mais comme l’effet de la rencontre entre un mouvement émotionnel (cris pour le nourrisson, intonation de la voix ou mélopée pour le locuteur ordinaire) et l’écoute qu’il rencontre.
À partir de ces considérations, l’auteur propose une véritable clinique de la parole en séance, de cette « cure de parole », selon l’expression utilisée en anglais (talking cure) par Anna O. dans la préhistoire de la découverte psychanalytique. Il s’agit avant tout d’un acte de parole, le terme d’« acte » véhiculant ce que la parole comporte de manifestation corporelle, aussi bien dans sa prononciation que dans les expressions émotionnelles dont elle se charge, sans oublier sa capacité à toucher l’interlocuteur, ce terme de « toucher » incluant à lui seul le fait que la parole adressée concerne aussi le corps de celui qui écoute. Ainsi, notre conception de la parole en séance évolue avec l’évolution de notre conception du cadre. De véhicule de la remémoration cathartique du traumatisme, elle devient révélatrice de l’inconscient, puis moyen privilégié de perlaboration des mises en acte répétitives qui organisent la résistance, elle-même étant un acte. Avec l’introduction de la deuxième théorie des pulsions, la notion même de représentation inconsciente perd sa centralité (au profit du ça, chaudron pulsionnel), mais la parole, elle, reste centrale dans la cure : elle vient ralentir la décharge des motions pulsionnelles en proposant des associations temporaires qui ne sont plus considérées comme exprimant une représentation de chose ou de mot, établie par avance et immuable dans le signifiant qui la fixe, mais exprimant des identifications inconscientes dont le sens émerge dans l’après-coup de l’expérience « faite d’un agir dont le sujet prend la mesure en venant à l’écoute des paroles d’un autre ou de lui-même entendu alors comme un autre » (p. 81). Enfin, l’auteur considère que, avec Winnicott, la parole connaît une nouvelle évolution de ses fonctions dans la cure, devenant ce qui émerge dans l’espace intermédiaire entre les deux protagonistes.
En même temps, une clinique de la parole en séance peut être décrite dans le rythme, dans l’allure de sa façon de se prononcer. Ici l’indexation se fait sur les quantités d’excitation. Danon-Boileau oppose parole compulsive et parole associative. La première est porteuse de répétition, mais cette répétition inclut aussi le transfert : c’est en elle, dans son caractère impérieux, et même dans sa véhémence, que vient se loger la réactualisation transférentielle. Elle représente donc la dimension intersubjective du « dire ». L’autre, associative, est plus proche d’un déploiement de pensée mise en mots, d’un « se parler à soi-même », même si un autre écoute toujours. Mais son déroulement n’est pas toujours fluide et harmonieux, car elle peut se heurter à des restes perceptifs qui n’ont pas été symbolisés (qui peut-être ne sont pas symbolisables), entraînant chez l’analyste des sensations quasi corporelles, une « émotion » au sens strict du terme. Une troisième modalité se met alors en place, que l’auteur appelle « parole interpsychique ». Elle est « inter », car c’est de l’élaboration de ces sensations de la part de l’analyste dans ses propres mouvements régressifs, et de leur restitution à l’analysant sous forme de parole (l’interprétation), que dépend la transformation des motions pulsionnelles en représentations inconscientes, ces dernières ne constituant pas, partout et dans tous les cas, une donnée d’emblée existante. « De mon passé de linguiste, écrit l’auteur, j’ai conservé un certain goût pour la matérialité du langage et la manière dont il porte trace des mouvements de l’âme » (p. 92-93).
Dans la troisième et dernière partie de son ouvrage, Danon-Boileau décrira diverses formes de « Paroles en séance ». Nous en avons eu un aperçu en évoquant plus haut le propos sur l’agir de parole, ou encore le récit du cas de Marie (le « discours opératoire »). C’est que « chaque représentation de mot est composée de deux parties : le souvenir du mot tel qu’on a pu l’entendre (son image verbale sonore) et les souvenirs des mouvements articulatoires nécessaires à sa profération (son image verbale motrice) » (p. 110). Ainsi, si la règle du travail analytique indique qu’on peut tout dire, mais ne pas « faire », il n’est reste pas moins vrai que, parler, c’est « faire », c’est « agir », et la parole est aussi une décharge de la poussée pulsionnelle. Ce « faire » a des effets sur celui qui écoute la parole prononcée – c’est même à l’aune de ces effets que l’on apprécie sa qualité. Inversement, la parole du côté de l’analyste, l’interprétation, le fait sortir du silence d’un objet primaire infiniment bienveillant et présent, met en tension et conflictualise les objets auxquels s’adresse le discours du patient. Mais il ne s’agit pas d’un effet d’écho : le décalage, et même parfois la douloureuse expérience, de la part du patient, de ne pas être « compris », font partie d’une prise de conscience de l’irréductible altérité de l’objet. L’analyste doit savoir que « l’intuition de l’altérité adéquate dans la perturbation [induite par sa parole] est une exigence du travail thérapeutique » (p. 150).
D’autres « paroles en séance » peuvent encore être décrites, telle la « parole nostalgique », qui semble se situer à l’opposé de la parole opératoire. Elle exerce une séduction particulière sur celui qui l’écoute, car elle constitue une invitation permanente à l’interpsychique, par ailleurs nécessaire à toute rencontre entre analyste et patient. Mais ici, elle implique une impossibilité, ou un désinvestissement, du plaisir à penser seul. Tel le discours d’Ada en séance (p. 160-172), d’une grande puissance évocatrice, qui masque une dépendance tout aussi grande : la parole nostalgique reproduit indéfiniment l’exigence d’un objet « externe », réel, pour l’accueillir ; et ce faisant, rend l’analyse « sans fin ». Pourtant, elle pense, elle fantasme, elle élabore. La nostalgie n’est pas dans les propos tenus, mais dans la qualité qu’a cette parole de ne pouvoir exister qu’à la condition d’être adressée à quelqu’un d’extérieur à elle : « elle contourne », dit joliment Danon-Boileau, « le deuil de l’hallucinatoire » (p. 171).
Les séances passent et se succèdent. Qu’en reste-t-il ? Tel dans le « bloc magique » de l’article de Freud, le perçu des paroles prononcées s’efface lorsqu’une feuille de séance est tournée pour laisser place à la feuille de la séance suivante. Le perçu demeure néanmoins sur l’ardoise, comme une mémoire qui accumule une matière première à partir de laquelle la séance va laisser chez l’analyste qui écoute l’impression d’une thématique générale, et surtout d’un mouvement, d’une sensation. De ces mouvements successifs, il reste néanmoins des mots, des phrases, des formulations courtes qui résistent à l’oubli. Ils ne se sont pas fondus dans le mouvement d’ensemble, ils semblent constituer des condensés (des signifiants) qui n’ont pas trouvé leur affect. L’interprétation saura les utiliser, parfois tels quels ; mais son émergence, associative dans le cas optimal, tiendra aussi compte d’un autre facteur : celui du moment, du « temps voulu », du kairos. Ni combinatoire de signifiants ni explication raisonnée, l’interprétation qui fonctionne est aussi une parole telle que décrite dans ce livre : un acte qui se produit à un moment où il peut trouver son sens.
En écrivant ce livre, Laurent Danon-Boileau nous parle : de linguistique, de pratique analytique, de nos patients, de l’enfance, de nous-mêmes… Et dans l’essentiel de son propos, non seulement il nous apprend des choses, beaucoup de choses, mais aussi, nous parlant, nous touche.
Vassilis Kapsambelis est psychanalyste, directeur de la Revue française de psychanalyse.
Gilbert Diatkine, Le surmoi culturel, Paris, Fario, 2023.
 Paru en février 2023, ce livre construit en neuf chapitres, reprend et repense certaines idées déjà défendues par l’auteur dès 1993 avec « La cravate croate, narcissisme des petites différences et processus de civilisation », « Le surmoi culturel » (Diatkine, 2005), « Racisme, homosexualité, paranoïa » (Diatkine, 2011), « L’énigme du sadisme » (Diatkine, 2016) et plusieurs autres textes tous passionnants et incisifs.
Paru en février 2023, ce livre construit en neuf chapitres, reprend et repense certaines idées déjà défendues par l’auteur dès 1993 avec « La cravate croate, narcissisme des petites différences et processus de civilisation », « Le surmoi culturel » (Diatkine, 2005), « Racisme, homosexualité, paranoïa » (Diatkine, 2011), « L’énigme du sadisme » (Diatkine, 2016) et plusieurs autres textes tous passionnants et incisifs.
« Ce livre est né d’une stupéfaction : malgré le retour perpétuel de la barbarie, nous maintenons fermement notre croyance dans le progrès de la civilisation » (p. 7), écrit Gilbert Diatkine. Et en effet il y a là un paradoxe, l’homme civilisé, cultivé, devient soudain le plus violent, cruel et inhumain des animaux.
Dès son début, le livre se penche sur les débats entre Freud et Adler à propos de « la pulsion primaire d’agression » défendue par ce dernier. Le contexte de la guerre meurtrière de 1914-1918, au cours de laquelle Freud avait deux fils au front, semble le faire vaciller et accepter l’idée d’une pulsion d’agression qu’il abandonnera en 1920 avec sa seconde théorie des pulsions.
Avec celle-ci, Freud réunit sexualité et autoconservation pour opposer la libido à une pulsion de mort. Pourtant, malgré son nom, la pulsion de mort est encore décrite en 1938 dans L’Abrégé de psychanalyse (Freud, 1940a/1998) comme une poussée séparatrice qui vise à « briser les rapports » (p. 8). La destructivité provient donc de la désunion ou désintrication de deux pulsions. Freud écrit : « Toute modification dans la proportion des pulsions unies l’une à l’autre a les retentissements les plus évidents. Un excédent d’agressivité sexuelle fait d’un amoureux un meurtrier sadique… » (p. 9). La désunion des deux pulsions est responsable de divers tableaux cliniques mais aussi de sublimations.
En 1923, dans Le moi et le ça, Freud (1923b/1991) va décrire la construction du surmoi constitué par des identifications aux deux objets parentaux et aux idéaux de ces derniers. Un an plus tard, en 1924, dans « Le problème économique du masochisme » (Freud, 1924c/1992), il développe une idée selon laquelle désintriquée de la libido cette destructivité joue un rôle dans les phénomènes de foule. Ce qu’il étudie magistralement en 1921 dans « Psychologie des masses et analyse du moi » (Freud, 1921c/1991). Ce second chapitre se termine sur la présence de pulsion de mort déliée, silencieuse au sein même de la cure.
Toujours à propos de cette destructivité issue de la désintrication de la pulsion de mort et retournée vers le monde extérieur, Gilbert Diatkine fait un détour par Malaise dans la culture (Freud, 1930a /1994), il soutient, et a, je crois, raison, que culture et civilisation ne sont pas véritablement synonymes. Le terme de culture est à conserver pour les arts et les lettres, alors que civilisation s’applique aux progrès du socius lorsque sont imposées des interdits aux pulsions de destruction humaine. Il en prend pour exemple l’abolition de l’esclavage ou l’abandon de la peine de mort.
L’auteur nous fait partager sa vaste culture historique, politique, psychanalytique comme littéraire. C’est dans ce contexte qu’il reprend sa conception d’un surmoi culturel, terme déjà utilisé par Freud dans Malaise et qui, comme le surmoi individuel, est fondé sur les deuils et les identifications aux deux parents.
À la page 57 de son livre, Gilbert Diatkine va proposer une construction que je trouve intéressante, mais osée. Il écrit : « Les périodes de troubles et guerre civile seraient l’équivalent du conflit œdipien. La période de calme qui suit la victoire d’un camp serait comme la période de latence et l’interdit de penser aux évènements passés serait l’homologue du refoulement post-œdipien » (p. 57). Connaissant l’auteur je pense que c’est non sans humour qu’il s’est lancé dans cette comparaison.
Il enchaîne sur des cas cliniques très vivants où les patients ont subi des traumatismes de guerre sur une ou plusieurs générations, et il montre avec subtilité combien patients et analystes risquent d’instaurer une « communauté du déni », selon le terme de Michel Fain, lorsqu’ils ont vécu les mêmes évènements traumatiques dans de mêmes moments de l’histoire.
Ceci pose à mon sens une question majeure à laquelle il nous faudra réfléchir en ce qui concerne les indications d’analystes.
Dans le quatrième chapitre intitulé « Surmoi culturel ou inconscient collectif » (p. 43), l’auteur se penche sur la question de la phylogenèse dans l’œuvre de Freud : elle apparaît dès les Trois essais sur la théorie de la sexualité (Freud, 1905d/2006), puis dans Le moi et le ça (Freud, 1923b/1991) enfin dans « Inhibition, symptôme et angoisse » (Freud, 1926d/1992), où Freud ira jusqu’à attribuer la « période de latence » à un facteur phylogénétique. Dans « L’Homme aux loups » (Freud,1918b/1988), il se pose la question des schémas phylogénétiques que l’enfant apporte en naissant. Des schémas dont on ne sait s’ils concernent l’évolution de l’espèce ou celle de la société. Il faut rappeler ici Haeckel, biologiste contemporain de Freud, qui avait développé une théorie selon laquelle l’ontogenèse récapitule la phylogenèse. Freud comme Jung en sont convaincus.
Leurs échanges prouvent leur accord, mais en décembre 1909 ils s’éloignent en raison d’une dissension sur la conception de la libido. En effet, si Freud pense que la mythologie est explicable à partir des pulsions, Jung dit l’inverse. Le fossé entre les deux hommes se creuse jusqu’à leur rupture définitive en janvier 1913. Plus loin, il sera question de l’antisémitisme de Jung qui a certes dû jouer son rôle dans cette rupture.
Gilbert Diatkine m’a appris, je l’ignorais, que « Totem et tabou » (Freud, 1912-1913a/11981) que je considère comme un chef-d’œuvre serait issu de cette longue polémique entre Freud et Jung.
La lecture de ce livre est très agréable, car il donne au lecteur l’impression d’une lecture fluide, associative comme s’il avait été écrit au fil de la plume.
S’attardant sur « Totem et tabou[1] », l’auteur nous apprend que l’hypothèse d’une horde primitive a été empruntée à Darwin. Une seconde hypothèse, celle du repas totémique avait déjà été évoquée par William Robertson Smith, physicien et archéologue. Freud y ajoute l’idée de ce que ce repas totémique, « peut-être la première fête de l’humanité, serait la répétition et la commémoration de ce geste criminel mémorable qui a été au commencement de tant de choses, organisations sociales, restrictions morales et religion » (Freud, 1912-1913a/1981, p. 107).
C’est dans le sixième chapitre, intitulé « Fiction et vérité en psychanalyse », que Gilbert Diatkine va entrer dans le vif de la question du surmoi, surmoi de la deuxième topique évidemment. Il en rappelle la construction, héritier du complexe d’Œdipe et fondé sur les identifications au surmoi des parents ; il discute de la culpabilité que Freud rattachait « en partie » à la phylogenèse, ce serait donc, entre autres, le meurtre du père de la horde qui engendrerait chez l’enfant un sentiment de faute.
On peut lire sous la plume de l’auteur qu’il voit deux parties dans la théorie freudienne du surmoi culturel « D’une part la civilisation progresse en utilisant, contre la satisfaction des pulsions destructrices, l’énergie libérée par le deuil des objets perdus. D’autre part le meurtre du père de la horde primitive est effectivement une histoire, un roman » (p. 118). Fiction certes, mais qui fut indispensable à Freud pour défendre sa vision phylogénétique comme sa théorie d’un surmoi culturel.
Pour défendre sa thèse, soit « le meurtre du père de la horde primitive est un roman » (p. 118), Gilbert Diatkine va s’appuyer sur les travaux de paléologues et de spécialistes en histoire et anthropologie. Il se demande si les hommes du paléolithique supérieur ou du néolithique vivaient en hordes dominées par un seul mâle. Il se réfère au livre de Flannery et Marcus[2] (2012) qui ont étudié les Esquimaux, tels que décrits par les premiers explorateurs. Selon ces deux auteurs, il serait possible de comparer ces derniers aux Gravettiens qui vivaient eux au paléolithique supérieur.
Ce sont des pages très vivantes qui dévoilent une vaste culture transdisciplinaire et posent avec humour des questions profondes.
J’avais l’impression de suivre un dialogue contradictoire ente l’auteur et Freud, ce dernier soutenant jusqu’au bout l’hypothèse d’un meurtre du père de la horde primitive et Gilbert Diatkine cherchant à le convaincre de l’abandonner.
Pour ce faire, Diatkine nous promène de l’Homme de Néandertal à des tribus australiennes et aux Chewong de Malaisie puis en Amérique du Sud, dans les villages Tupi-Guarani, en affirmant qu’en aucun de ces lieux il n’a existé de horde isolée. Il suppose que Freud avait pu lire chez des anthropologues de l’époque des descriptions du rôle des rois de sociétés primitives parfois mis à mort par leurs sujets.
Il se réfère beaucoup à James George Frazer, anthropologue écossais fondateur de l’anthropologie religieuse, connu pour avoir dressé un inventaire mondial des rites et des mythes. Il avait publié en 1910 Le Rameau d’Or, Étude comparative des Religions, en douze volumes. Frazer parle, lui, de totémisme, ce qui avait été immédiatement contesté par d’autres anthropologues de l’époque et encore plus violemment par Claude Lévi-Strauss en 1962.
Je suis personnellement très critique de l’œuvre de ce dernier et par conséquent je doute de la validité de ses affirmations.
J’estime que la position de Philippe Descola[3] (2021) selon laquelle on peut voir le totémisme comme un des modes d’identification est bien plus nuancée et intéressante. Et en effet on ne peut que penser à l’identification par incorporation. Gilbert Diatkine évoque ensuite Moïse et le monothéisme, et rappelle la distinction faite par Freud entre deux formes de vérité : « la vérité matérielle et la vérité historique ».
Pour lui, la vérité matérielle équivaut à des évènements historiques dont les historiens peuvent apporter la preuve alors que la vérité historique serait « une histoire que l’on se raconte, par exemple dans un fantasme ou dans un rêve » (p. 131). Gilbert Diatkine écrit que pour Freud la religion monothéiste contiendrait un noyau de vérité historique qui est en lien avec le meurtre du père de la horde primitive. Il enchaîne en disant que l’on peut envisager le meurtre du père de la horde primitive comme un roman raconté par Freud où nous pouvons trouver un noyau de vérité historique. Ce serait en effet le travail de deuil « des massacres collectifs qui fait progresser la civilisation » (p. 131).
Je serai personnellement moins optimiste que l’auteur, car j’estime que nous assistons à de tels retours à la barbarie que je m’interroge sur les « progrès de la civilisation ». Suivant la distinction entre culture et civilisation proposée au premier chapitre, je dirai aujourd’hui que l’humanité progresse dans la culture, mais non dans la civilisation.
Toujours à propos du meurtre de la horde primitive, Gilbert Diatkine cite longuement Bernard Chervet pour qui le « Au commencement était l’acte », cette phrase conclusive de « Totem et tabou » serait une tentative de décrire « un acte interne au psychisme, en fait l’acte fondateur du psychisme » (Chervet, 2014, p. 3, in Diatkine, 2023, note p. 133).
Partisan d’une paix perpétuelle, Emmanuel Kant (1796/1994) écrit qu’aucun progrès dans la civilisation n’est établi une fois pour toutes. Si l’on en prend pour exemple l’abolition de la peine de mort, il est des États des États-Unis qui ont exigé son rétablissement. En France, il a fallu attendre jusque 1981.
Les chapitres VIII et IX qui vont clore le livre se penchent sur le meurtre, les meurtres de masse ordonnés par la religion ou l’idéologie, enfin le racisme et l’antisémitisme, soit les retours à la barbarie sous toutes ses formes.
En dépit du commandement du Coran « Tu ne tueras pas », un grand nombre d’attentats ont été commis ces vingt dernières années au nom de la religion musulmane. Commanditée par le pape, la croisade contre les Albigeois mit à feu et à sang la ville de Béziers.
Lorsque Moïse descend du Mont Sinaï avec Les tables de la Loi pour s’apercevoir que des Juifs se sont mis à adorer le veau d’or, il brise les Tables sacrées et tient le premier discours meurtrier aux Juifs Lévites qui étaient demeurés fidèles, il dit : « Ainsi parla Yahvé, le Dieu d’Israël, ceignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez… et tuez… »
Gilbert Diatkine revient sur tous ces exemples pour proposer que le discours religieux meurtrier serait la forme matricielle d’où dériveraient tous les discours meurtriers (p. 145). Hypothèse qu’il appuie sur l’examen des conditions du discours meurtrier. Dans les trois exemples évoqués plus haut, celui qui le tient parle avec Dieu et transmet la parole de Dieu. Il doit donc être obéi.
Dans l’enthousiasme que porte une foule soulevée par celui qui parle au nom de Dieu, ou d’une idéologie déifiée, on assiste à une régression de la libido objectale en libido narcissique et du surmoi au profit d’un idéal du moi collectif.
« Une foule enthousiaste est prête à massacrer ceux qu’une différence sépare d’elle » (p. 161), écrit l’auteur qui tout naturellement se penche sur le narcissisme des petites différences et examine le racisme « ordinaire ».
Ce dernier peut rester « ordinaire » ou bien être délirant. Ici il étudie le délire de Schreber. En 1893, hospitalisé dans la clinique du professeur Fleschsig, Schreber entre dans le délire lors d’une absence de sa femme. Gilbert Diatkine avait déjà écrit en 2001(Diatkine, 2001) que la séparation d’avec son épouse aurait privé le patient d’une image en miroir qui lui assurait la cohésion de son moi. Hypothèse intéressante et convaincante qu’il reprend aujourd’hui.
Comme exemple de ce qu’il nomme « antisémitisme ordinaire », l’auteur brosse un portrait d’Edmond de Goncourt, écrivain médiocre qu’il oppose à l’antisémitisme délirant de Céline.
Or ce dernier n’avait pas toujours été d’extrême droite. Diatkine cite ici une lettre de Céline à Cilly Ambor : « Je suis bien content de vous savoir pour le moment en sécurité mais la folie d’Hitler va finir par dominer l’Europe. M. Freud n’y peut rien » (Céline, 1933/2009, in Diatkine, 2023, note p. 179). J’avoue avoir été surprise de ces mots mais aussi par le portrait nuancé et subtil de Céline que dresse l’auteur.
Je dirai du livre qu’il est passionnant, profond, érudit et se lit avec plaisir grâce à un récit associatif qui dévoile les questionnements de son auteur.
Marilia Aisenstein est psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société Psychanalytique de Paris et de la Société Hellénique de Psychanalyse. Ancienne Présidente de la SPP.
[1] Sur « Totem et Tabou », je signale ici un livre remarquable sur cet article : The Vicissitudes of Totemism. One Hundred Years after Totem and Taboo, Karnac, 2015, où Gérard Lucas analyse le texte en profondeur, comme le contexte culturel de sa réception par les anthropologues de l’époque.
[2] Flannery K. et Marcus J. (2012). The creation of Inequality. How our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery and Empire. Harvard University Press, Massachussetts.
[3] Descola Ph. (2021), Les formes du visible, une anthropologie de la figuration, Paris, Seuil.
Une recension de livre parue dans la Revue des livres du numéro « Voyages et frontières »
Michel Gribinski, Le psychanalyste amoureux, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse ».
 Le psychanalyste, « amoureux » ? Le titre semble s’exclamer « le roi est nu ! », comme s’exclamerait l’enfant des Habits neufs de l’empereur. Cet enfant qui, depuis les Trois essais, est pour toujours sexuel (pensée) avant d’être moral (culture) et qui, devenu psychanalyste, ausculte sa propre société tout autant que lui-même quand il rappelle la réalité « inouïe » (Gribinski, 1987, p. 13) que Freud dévoila : les fondements sexuels, les fondements limites, de nos théories. Dès lors, il rouvre la question : par où commence l’éthique du psychanalyste, qu’en est-il de son amour ? Corollaire : de sa pensée ? Imaginons que nous soyons en 1926 et l’interlocuteur du Psychanalyste amoureux pourrait être l’analyste sauvage autant que l’analyste vertueux. Le psychanalyste profane, lui, l’enfant véritablement « hors du temple » (Pontalis, 1985/1988, p. 233), remet ainsi au présent la question du lien entre pensée et amour, celle de l’éprouvé, de ce qu’elle fait de nous et de ce qu’on en fait, au cœur du royaume pour toujours interrogatif, et laïque, qui relie et sépare le fauteuil du divan : le transfert, et son métier. Question d’éthique. Question de technique.
Le psychanalyste, « amoureux » ? Le titre semble s’exclamer « le roi est nu ! », comme s’exclamerait l’enfant des Habits neufs de l’empereur. Cet enfant qui, depuis les Trois essais, est pour toujours sexuel (pensée) avant d’être moral (culture) et qui, devenu psychanalyste, ausculte sa propre société tout autant que lui-même quand il rappelle la réalité « inouïe » (Gribinski, 1987, p. 13) que Freud dévoila : les fondements sexuels, les fondements limites, de nos théories. Dès lors, il rouvre la question : par où commence l’éthique du psychanalyste, qu’en est-il de son amour ? Corollaire : de sa pensée ? Imaginons que nous soyons en 1926 et l’interlocuteur du Psychanalyste amoureux pourrait être l’analyste sauvage autant que l’analyste vertueux. Le psychanalyste profane, lui, l’enfant véritablement « hors du temple » (Pontalis, 1985/1988, p. 233), remet ainsi au présent la question du lien entre pensée et amour, celle de l’éprouvé, de ce qu’elle fait de nous et de ce qu’on en fait, au cœur du royaume pour toujours interrogatif, et laïque, qui relie et sépare le fauteuil du divan : le transfert, et son métier. Question d’éthique. Question de technique.
(Interdit de ne pas) Penser
Voici le geste très freudien que ravive Michel Gribinski dans ce livre court, libre, magnifiquement écrit. Un livre pur, comme un traité de chimie (aux solutions impures), comme un traité d’éthique (more geometrico), comme un Abrégé (écrit avant l’exil). Un livre du reste quasi sociologique, à la façon dont Stendhal ou Balzac animaient, sous les traits d’un seul homme, un portait de la morale sexuelle civilisée et de la nervosité moderne de leur temps. Portrait et autoportrait se réverbèrent, l’autoportrait de la question éthique devenant portrait de la société analytique tout entière – « en un mot, c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi », écrivait Courbet. Dans cet atelier de psychanalyse, on retrouve et réinvente une réflexion sur les sources de notre pensée comme aux « débuts de la découverte freudienne – quand toutes les questions se posaient et qu’il était légitime de s’interroger sur tout ce qui se présentait » (p. 93).
Il faut dire que Michel Gribinski, qui fut membre de l’Association Psychanalytique de France, de la rédaction de la Nouvelle Revue de Psychanalyse, créateur des revues Le fait de l’analyse et Penser/rêver, traducteur d’Aaron Appelfeld, de Winnicott, d’Adam Phillips, de James Strachey, de Leonard Woolf, auteur de la « Préface » aux Trois essais sur la théorie sexuelle, d’articles majeurs et de nombreux ouvrages, est aussi peintre. Et Le Psychanalyste amoureux a été publié cette année en même temps qu’une exposition : « Amoureux à en mourir » – titre emprunté au Temps zéro, d’Italo Calvino (1967/1970). Ils (le peintre, le psychanalyste) invitent donc doublement à nous réinterroger sur notre cadre et ses « objets mobiles », comme les appelait Giacometti : que reste-t-il de nos amours, dans notre pensée analytique ? Que sont notre pensée et interdits de penser devenus ? Et puis « amoureux », qu’est-ce à dire ?
Gambade
Vers ce centre incommode qu’ils se sont donné d’approcher, les six chapitres de l’ouvrage progressent par rapprochements centripètes. L’Avant-propos ne saurait être plus clair : des réflexions sur l’éthique, et « c’est plutôt d’un cheminement qu’il s’agit » (p. 11). Des essais, si tant il est vrai que la vie de l’esprit de l’analyse suit la vie de la cure où la notion d’expérience est sans doute l’un des cœurs les plus battants avec les outils que l’on s’est forgés en en devenant soi-même l’artisan puis l’auteur. Le remarquable numéro « Portraits d’un psychanalyste ordinaire » de Penser/rêver du reste l’annonçait : l’analyse « porte en elle la nécessité de reprendre et de retracer une route comme si c’était la première fois – et la possibilité d’un déplacement » (2012, p. 12). Retracer/déplacer : un mouvement semble-t-il propre à l’œuvre de Michel Gribinski dont ce livre s’offre comme une sorte d’exemple princeps, qui saisit et poursuit, enté sur des intuitions profondes et personnelles, des notions qui traversent le travail de l’analyste autant que l’œuvre de Freud et offrent la perspective d’un renouveau : concordance, ersatz et construction, deviner, dédaigner – l’amour est-il de ceux-là ? Disons plutôt l’expérience de l’amour, centre de gravité à la fois absolument privé et d’abord insaisissable (de la vie, du transfert, de ce livre), du fait même de sa centralité et de son traitement, qui est la matière même, ramène à elle autant qu’elle déploie les notions analytiques qui concordent alors ou plutôt : coïncident.
Post-éducation
Dès lors, on éduque un analyste : car si « post-éducation » est l’expression employée par Freud qui désigne l’œuvre de correction par l’analyste du travail du refoulement (« orthopédie »… disait Lacan) et se trouve déjà forte de son débat (de ses résistances), que cela se passe par le fait de « deviner » – l’erraten freudien dont Gribinski fut le premier en France à saisir l’importance (2004, p. 897-915) et qui se produit quand, à travers les mailles du filet autocritique du patient, l’analyste capture (autoperçoit) l’inconscient, condition pour qu’une éducation après-coup du refoulement puisse avoir lieu, condition pour que le moi connaisse mieux – en lance un autre : deviner implique, du même geste, et le territoire de l’éthique se trouve là, une post-éducation de l’analyste. Car deviner le refoulé du patient est une « technique impure » (p. 15), non scientifique, non mesurable : il y a là le cran de l’analyse, le fait de son « paradigme à part » du savoir (Gribinski et Ludin, 2005/2022) – la psychanalyse se produit et produit, à chaque cure de novo, ce qu’elle est, et cela « fait de la technique analytique quelque chose d’aussi inapproprié que l’amour » (p. 16). Une absence de maîtrise, qui ouvre ainsi sur une chance (sa créativité) autant que sur un problème (éthique) : où commence et finit-elle ? Réponse : à l’endroit d’une responsabilité « choisie » et « on est reconnaissant à Freud d’avoir simplement dit qu’il fallait, ce contre-transfert, le tenir de court » (p. 19). Se tenir et tenir de court, c’est ce qui ouvre la voie à l’aiguisement de l’outil articulé à cette éthique : le « dédain » (Verschmähung) par quoi « on permettra au patient une post-éducation » (p. 20) et sans quoi tous les mélanges deviennent, en puissance ou en acte, des abus transférentiels. « Un homme, ça s’empêche », la fameuse phrase du Premier homme de Camus indique bien ce minimum maximal, sa « capacité négative » (Phillips, 2009). Dès lors, le choix est « permanent » (p. 24) : on dédaigne ce qu’on devine de l’amour du patient, sa morphologie première et secrète, son mouvement sous-terrain, et on post-éduque à chaque moment nos amours – dédain, derechef, pour le couple n’étant que reflet du passé et qui s’invite dès toujours sur la scène : « Sans dédain technique, on confond passé et présent et on prend le risque de créer dans l’analyse une sexualité positive actuelle » (p. 25).
L’enfant de l’analyse
L’autre couple choisit ainsi la voi(x)e d’un autre langage inouï : l’association libre. Et depuis son invention, il s’est « produit un déplacement » (p. 30), sans doute « du même ordre que celui qui a suivi l’invention du langage parlé ». Rien moins : Freud, avance l’auteur, en découvrant cette loi, a désorganisé puis renouvelé le rapport intime du langage dans son rapport au monde (p. 31) : création d’un désordre pour défaire une éducation puis la refaire, une « guérison par la récupération du contact avec l’enfance et sa pensée d’enfant » (p. 36). Le psychanalyste, amoureux ? Lorsque son dédain pour la répétition de l’amour (du) passé permettra qu’on « adopte ce qu’on avait oublié de soi-même » (p. 37), via l’association libre, comme une langue de l’infans alors parlée – une cure qui prend ainsi l’allure d’une aventure (amoureuse) que l’esprit entretient avec lui-même, ou plutôt avec ses départs. « Post-éducation, éducation d’après : Nacherziehung fait partie des concepts discrets qui circulent discrètement entre les pages de Freud » (p. 39) et il fallait ici rendre un hommage discret quoiqu’explicite à J.-B. Pontalis : à son amour de la pensée qui naît, du « laboratoire central » de l’infans (2012) qui aura permis que l’on saisisse une concordance nouvelle entre le créateur, le visionnaire, l’halluciné et le rêveur. Car ce « muet dans la langue » (E. Gomez Mango) les dispose à « la vérité des images » (p. 41). Notre part de mutité, le non parlant voyant en nous, a peut-être ainsi « conservé le secret » comme l’écrivait Freud à Abraham (Freud, 1907/1969, p. 11), celui du premier dire portant les mouvements contradictoires du vivant, celui de la coïncidence par images de l’esprit avec le monde avant que le langage ne l’en sépare et… permette de le rejoindre ? Notre part de mutité, précisément ce dont s’empare la répétition, est aussi le lieu où se rend possible une post-éducation : une rééducation du secret de l’aphasie. Une façon, en se tenant, en « heurtant » (p. 41), de tenir la répétition en échec.
L’aller du refoulé (un superviseur en formation) – Un petit fait vrai – Mots-clés : divagation, vache, oie, fiancée, queue, empereur
Le naturel d’une question de Judith Dupont qui naguère embarrassa son auditoire (pourquoi faut-il être analysé pour devenir analyste ?) invite les trois chapitres centraux sur le virage de la surprise, de la déformation et de la (construction de la) vérité. Le psychanalyste amoureux est surpris, aime le dérangement contre la formation de la masse et nos réflexes sociaux qui sont autant de prête-noms au refoulé – quand on tente, par exemple, de parler objectivement d’un patient. Amoureux, c’est l’expérience des premières unions de la pensée avec elle-même, redisons-le, et la tentation d’un discours objectivant « passe à côté » : objectiver la déformation, celle dont nous procédons, c’est passer à côté de « la matière de l’analyse » (p. 56), de ce qui en analyse veut dire « plusieurs sens » et mettre « plusieurs sens en mouvement est aussi l’esprit de la formation du psychanalyste » (p. 57). Du reste en séance, « on a affaire à des sortes de sous-pensées » (p. 59) qui « vivent sous le niveau de la pensée consciente », des mécanismes déformants, anamorphogènes, au service de la résistance. La déformation nous constitue, nous y sommes assujettis et comme « inscrits avec notre perception même sur ce que Einstein appelle « un mollusque de référence […] nous suivons ces étirements, ces déformations, sans même nous en rendre compte puisque leurs mouvements, c’est nous » (p. 61). Une belle définition qui rappelle que l’analyste ne peut qu’habiter la rupture en lui que le langage (la résistance) a instituée, à l’endroit où sa pensée « a appris à s’anamorphoser et se donner des raisons autant qu’elle y trouve sa source vive ». Ces trois chapitres poursuivent ce sentier de traverse : n’en va-t-il pas de même avec la construction, la théorie, et le récit (des faits vrais) ? On croisera à nouveau Lacan, le temps d’un matin à Baltimore, pour illustrer « la relation d’inconnu » que le sujet pensant entretient avec le monde quand les « confins sont à l’intérieur (l’étranger est dans la maison) » (p. 70) et que la construction est toujours guettée par le même défaut de vouloir démontrer, de vouloir bâtir, oubliant qu’elle ne peut que créer, à partir de la relation de transfert, la relation du patient à son passé. Dernier virage animal, quelques images sur la route : « On a vu une vache divaguer »/ « De quoi rêve l’oie ? De maïs. Et de quoi rêve la fiancée ? De queue. » / « Chacun n’ensuit pas Charlemaine Qui va là où sa chair le maine »… façons de nous rappeler que chaque fois le moi a beau jeu de nier qu’il serait le cavalier du ça, « de croire que l’on sait où l’on va puisque “ça” le sait » (p. 79). Et pourtant, quand « on cesse de croire que l’on sait où l’on va », on devient le passager clandestin d’un divan, et le psychanalyste amoureux sait que sa mémoire est sexuelle autant que ses représentations-buts inévitables, que ses constructions proviennent de ce qu’il souhaite obtenir, et que la divagation qui a pris corps dans les mots se déplace toujours plus vite en courant au-devant, source de notre liberté associative, de notre risque, autant que de notre choix éthique.
Le psychanalyste amoureux
Dès lors, arrêtons-nous avec le dernier chapitre au seuil de nos certitudes : un amour « fondé en réalité » (p. 87) entre analyste et patient, hors transfert, serait-il « viable » comme le disait Freud de l’amitié ? Le récit d’une histoire d’amour entre un ami de l’auteur et sa patiente longtemps analysée permettra de le soutenir, en s’adossant à une réflexion lumineuse sur l’expérience du souvenir, si tant il est vrai qu’on « a négligé le lieu intermédiaire et étrange de l’expérience du souvenir considéré à l’instar de l’expérience du rêve faite par le rêveur » (p. 92) autant que celle de l’expérience de l’amour : ayant été éprouvée et simultanément arrêtée (et pas inhibée – distinction éthique fondamentale), une part de cette expérience amoureuse peut s’aventurer ailleurs, vivre sa vie parallèle et privée y compris de nous, sur son propre chemin. La vie des « projets arrêtés » (p. 94) de l’expérience amoureuse soutient dès lors la distinction possible entre l’amour de transfert et l’amour réel lequel, à l’instar de la vie sous-venue du souvenir, peut poursuivre sa vie et mourir « dans un domaine à part » (p. 94). Ainsi ne nous guette-t-elle peut-être pas tout à fait de la même façon que les réminiscences, « ombres latentes » qui un jour « s’avancent au premier plan comme un fantôme et s’emparent du corps » (p. 95), mais vit à sa façon librement fantomatique où l’on retrouvera la source renouvelée de notre activité éthique – puisque les « noces » du « reflet du passé et du corps actuel » sont chaque fois le terrain de « renaissance perpétuelle » de la pensée de l’analys(t)e.
Inconclusion
En 1926, l’interlocuteur de la Question de l’analyse profane demandait à Freud : « le malade vous croit-il si aisément quand vous dites qu’il n’est pas amoureux mais seulement contraint de jouer une vieille pièce ? » (Freud, 1926/1985, p. 100). À quelle condition un reflet du passé perd-il sa force d’attraction et laisse-t-il s’ouvrir la voie de dégagement par laquelle ce qui ne se remémore pas en possédant les corps laisse place à une danse nouvelle de la pensée ? Corollaire : quand sommes-nous convaincants ? Réponse de Freud : quand dans le maniement du transfert nous sommes « habiles ». Il m’a semblé que ce livre de Michel Gribinski la poursuivait, mais pas seulement : il parle d’après moi d’un moment, de cet espace-temps si singulier et qui est aussi chaque fois unique dans une cure, qui se produit avec l’expérience princeps de l’amour et produit dès lors sa pensée. Un moment d’éclosion qui est le propre de l’analyste. Son bien.
Puis en refermant l’ouvrage une image me surprend, celle de la morphologie de cette expérience proprement analytique de l’amour conjointe à la naissance de la pensée : une sorte de forme, de cellule, d’unité élastique mouvante, de corps premier, comme le corps archaïque en Grèce quand, avant la philosophie, on ignorait encore la distinction soma-psuche et que le mot Karo désignait le socle fondamental des êtres et des choses. Un mollusque qui voit. Le dépaysement est radical et remonte le temps : la forme élastique nous apparaît quand elle se découvre naissante, amoureuse d’elle-même, qui s’échappera bientôt car la fin d’un livre ou une résistance reviennent toujours, mais qui parle en nous, nous qui également allongés sur un divan, dédaigneusement à l’écoute ou contemporains de la pensée freudienne réapprenons aussi à être cette phase antécédente, cet état de désir et de mouvement – un soi-même de Calvino « qui parfois risque de vivre, un soi-même pluri-cellulaire et unique qui conserve parmi ses cellules celle qui se répétant répète les mots secrets du lexique que nous sommes » (Calvino, 1967/1970, p. 75).
En chemin une émotion de la pensée nous a étreint. Le Psychanalyste amoureux est une déclaration d’amour, discrètement bouleversante, dédiée à la découverte, son expérience et le présent continué des départs de la pensée analytique en nous. L’éthique commence là.
Références bibliographiques
Calvino I. (1967/1970). Temps zéro. Paris, Éditions du Seuil.
Freud S., Abraham K. (1969). Correspondance 1907-1926, Lettre du 05 juillet 1907. Paris, Gallimard.
Freud S. (1926/1985). La question de l’analyse profane. Paris, Gallimard.
Gribinski M. (1987). « Préface » à S. Freud (1905/1987). Trois essais sur la théorie sexuelle. Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient ».
Gribinski M. (2004). Deviner à peu près. Rev Fr Psychanal 68(3)
Gribinski M. (2022). Les choses vagues. Paris, Fario, « Le silence des sirènes ».
Gribinski M. (2023). Le psychanalyste amoureux. Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse ».
Gribinski M., Ludin J. (2005). Dialogue sur la nature du transfert. Paris, Puf, « Petite Bibliothèque de Psychanalyse ».
Gribinski M., Ludin J. (2022). La technique analytique. Une archéologie. Paris, Puf, « Petite Bibliothèque de Psychanalyse ».
Penser/rêver, Automne 2012, n° 22, « Portraits d’un psychanalyste ordinaire », Paris, Éditions de l’Olivier.
Phillips A. (2009). Trois capacités négatives. Paris, Éditions de l’Olivier, « Penser/rêver ».
Pontalis J.-B. (1985/1988). Hors du temple. Perdre de vue. Paris, Gallimard.
Pontalis J.-B. (2012). Le laboratoire central. Entretiens 1970-2012, « Penser/rêver », Paris, Éditions de l’Olivier.
Sarah Contou-Terquem est psychanalyste, membre du comité de rédaction de la revue Le Présent de la psychanalyse
ARCHIVES
Jacqueline Schaeffer, Le féminin. Un sexe autre, Paris, In Press, 2022
 Le féminin est un sexe autre. Telle est la thèse de Jacqueline Schaeffer, affichée dès le titre de son dernier ouvrage.
Le féminin est un sexe autre. Telle est la thèse de Jacqueline Schaeffer, affichée dès le titre de son dernier ouvrage.
Elle ouvre ainsi le débat avec Freud et Simone de Beauvoir, sur un sujet qu’elle élabore et précise depuis 1987, et la parution dans la Rfp de son article princeps, « Le Rubis a horreur du rouge. Relation et contre-investissement hystériques ». Le succès du Refus du féminin (Schaeffer 1997/2008/2013), régulièrement réimprimé depuis sa troisième édition, témoigne de l’actualité et de la force d’une pensée ramenant aux fondements de la psychanalyse : la sexualité humaine (Schaeffer, 2019).
Freud envisage le féminin, « roc d’origine » sur lequel bute toute analyse, comme une altérité menaçante. Celle-ci est rapportée à la différence des sexes et pensée à partir du masculin : c’est pour être « autre que l’homme qu’elle [la femme] paraît incompréhensible, pleine de secrets, étrangère et pour cela ennemie ». En 1949, dans Le deuxième sexe, de Beauvoir dénonce une définition millénaire de la femme comme l’Autre de l’homme, cet Absolu. Ce rapport crée une situation de domination qu’il contribue à maintenir : l’infériorité et le mystère féminin sont des mythes également résistants. La femme a à se défaire de cette identité aliénante pour revendiquer l’égalité et l’assumer. L’égalité n’exclut ni la différence ni la passion, mais celles-ci sont secondaires. Schaeffer conçoit en revanche le féminin comme altérité pour la femme comme pour l’homme. Relativement à Simone de Beauvoir, elle réintroduit l’interdépendance du masculin et du féminin. Au-delà de Freud, elle poursuit l’élaboration du féminin comme l’autre, l’étranger, le haï. Le féminin devient le représentant de la pulsion envisagée à partir de son accueil. Il apparaît alors comme une menace, une violence et une contrainte. Il est aussi ce qui pousse à l’élaboration de la bisexualité psychique, c’est-à-dire à ce que le masculin se dégage du phallique, le féminin du maternel, afin que la psyché s’ouvre à de nouveaux antagonismes.
Avec cette seconde monographie, Schaeffer renverse la perspective qui était la sienne dans Le Refus du féminin : il s’agit de repenser la psycho-sexualité à partir du féminin, et non plus de son refus, ce dernier étant vu comme le rejeton d’une position phallique ; un féminin qui certes se différencie de la femme comme individu, mais s’ancre dans les expériences de la vie d’une femme. Schaeffer y ressaisit en formules claires et concises chacun des aspects de sa recherche, et propose aussi des avancées. À repenser toute la métapsychologie « au-delà du phallique », c’est à une révolution du point de vue freudien qu’elle invite. Du côté de la philosophe existentialiste, si Le deuxième sexe envisage toute l’anthropologie du point de vue des femmes, Un sexe autre conduit à reconsidérer la psychanalyse à partir du féminin.
Le livre de Schaeffer se présente comme une reprise condensée des différents volets d’une conception originale, développée par ailleurs dans différents articles. Il décrit un « processus d’altérité » obligeant le psychisme à des réorganisations narcissiques et objectales au travers de rencontres chocs avec la série des figures de l’autre, dont l’enjeu est une intégration du « féminin » pour les deux sexes. Classiquement envisagées sur le modèle du traumatisme comme une exigence de travail, ces « déliaisons dangereuses » sont autant de menaces de désintégration mobilisant les défenses, mais aussi les forces d’élargissement du moi, de changement et d’épanouissement libidinal.
Au tout début, l’autre n’a pas de « figure ». Le Nebenmensch, l’être humain proche des premiers soins, se différencie selon la variable amour/haine au travers de vécus de détresse, dans l’alternance plaisir/déplaisir. La sexualité est déjà là : éprouvée dans le corps à corps avec la mère, première séductrice (Laplanche), elle est médiatisée par l’investissement des parents (fille ou garçon ?). La première expérience d’altérité est celle que la mère fait éprouver à son bébé lorsqu’elle retourne à sa nuit sexuelle (Quignard, 2007). Elle lui désigne l’autre de son désir dans un premier antagonisme entre féminin et maternel, moment décisif de la première pulsionnalisation de l’excitation.
La seconde figure de l’autre surgit dans une perception anatomique en tout ou rien, qui donne lieu au refoulement originaire. Le moi se construit en se dégageant de la mère primitive par l’érotisation des zones érogènes tandis que les théories sexuelles infantiles prennent le relais de l’hallucination. Une originalité de la pensée de Schaeffer est de concevoir le clivage comme la coexistence de solutions contraires développées par le moi, pris dans le conflit entre refus et intégration de l’altérité. Ainsi le déni de la perception du manque produit la théorie du monisme phallique. Mais dans le même temps, la solution identificatoire aux parents tient compte de la différence des sexes et ouvre une autre voie. Elle donne accès à la réflexivité, à l’intériorisation, et à l’objectalisation ; pourvu cependant que soit trouvée, à l’extérieur, la personne étrangère répondant, comme sujet, à ces transformations. La troisième figure de l’autre, à la puberté, est un nouvel organe féminin, le vagin. Elle brise le déni de la différence des sexes et appelle à la reconfiguration du complexe de castration.
La quatrième figure de l’autre est celle de la rencontre amoureuse et sexuelle. Ultime élaboration du féminin, elle transforme l’autre en objet total, maintenant son caractère d’altérité. Chacun de ces moments implique le double retournement qui donne accès à l’intériorisation, à la réflexivité et au processus d’identification soutenant l’élaboration de la bisexualité psychique. Mais à chaque étape aussi, la transformation de l’autre en objet peut se trouver mise en échec : fétichisation, domination, destructivité, désobjectalisation, désinvestissement en seraient les figures négatives, déclinables sur les versants narcissique et objectal.
Le premier chapitre propose donc une conception originale du développement psycho-sexuel. Les huit chapitres qui suivent développent plus en détail un aspect de la psycho-sexualité féminine. Si cette dernière est envisagée pour les deux sexes, l’altérité se négocie différemment selon que l’on naît fille ou garçon. Au plan clinique, l’ouvrage de Schaeffer se présente d’abord comme une anthropologie du féminin appréhendée à partir d’expériences de femmes telles qu’elles se livrent, se figurent et s’élaborent dans les cures ; elle laisse aussi parfois la parole à des hommes. Ainsi de cette vignette clinique présentant un jeune père à la virilité menacée qui retrouve après un rêve éjaculatoire grandiose humoristiquement associée à la peinture de la cage d’escalier de son analyste, la capacité de réconcilier en son épouse l’amante et la mère.
Le livre aborde aussi des questions propres à la société contemporaine : en lien avec la différence des sexes (chapitre 2), les « théories du genre » ; en lien avec la mère, les destins de la transmission du féminin à la fille (chapitre 3) ou le conflit entre féminin et maternel (chapitre 6) ; en lien avec la sexualité féminine (chapitre 4), la différenciation du féminin et de la féminité ou du masculin et du phallique pour les deux sexes ; en lien avec la relation sexuelle et amoureuse (chapitre 5), les homosexualités féminines, l’emprise du maternel sauvage, le père amant (chapitre 7) ; en lien avec la clinique des états limites, les angoisses du féminin (chapitre 8) ou ses folies privées (chapitre 9).
Féminin et transitionnalité
Schaeffer est une psychanalyste engagée, de celles qui n’ont de cesse de mettre en garde contre les dérives de la trans-identité, le déni du sexuel et de la différence des sexes, le danger des traitements médicaux et chirurgicaux pratiqués sur de jeunes mineurs, les dérives d’une idéologie abolissant, au travers de la bisexualité, toutes les belles différences. Il s’agit pour elle des formes actuelles d’attaques ou de répression du féminin. En déplier la nature défensive et en dévoiler la réalité symptômale lui permet d’exposer ses idées, d’inviter à la discussion et au débat, mais aussi de lancer l’alerte sur une dérive sociale qui fragilise la psychanalyse et, au-delà, voudrait imposer sa conception anthropologique révisionniste.
Schaeffer rapproche les Gender Studies des théories sexuelles des enfants, qui perdureraient jusqu’à vouloir nier ce qui s’offre à la perception. Le but est d’évacuer le traumatique et d’abolir le conflit, fondateur du psychisme. Elle évoque la lutte qui se joue sur le terrain social, dénonçant dans la réponse immédiate aux demandes de « transition sexuelle » de la part des adolescents des deux sexes – quand on sait que cet âge est celui du questionnement de l’identité sexuelle, du choix d’objet et des identifications – un acte flattant les fantasmes de toute-puissance. La finesse clinique de la psychanalyste apparaît lorsqu’elle détaille les différentes figures de ces fantasmes, issues de l’interprétation du transfert et du contre-transfert, dans les conjectures anciennes ou des plus actuelles. Ainsi elle met en garde contre le risque de confondre la demande touchant à l’identité avec le recul effaré devant un choix d’objet vécu comme inacceptable. Une telle simplification revient à priver un adolescent de l’élaboration de son homosexualité.
Schaeffer fait aussi le lien entre la transitionnalité et les illusions portées par les technologies informatiques. J’ajouterais que l’« asexualité » de la sexualité à distance a encore progressé. De l’éviter du toucher, on semble bien passé à une course à l’évitement fantasmatique de la différence des sexes via l’effacement du perceptif. Ainsi, dans le plus ambitieux des métavers, Meta – propriétaire de Facebook, Instagram, Wattsapp –, les avatars sont représentés sous forme de troncs.
Ce qui fait violence, c’est la différence. Les fantasmes de bisexualité sont une défense contre l’investissement de l’altérité, mais maintiennent la possibilité de son élaboration. La tendance actuelle à l’exaltation de la bisexualité a même valeur, mais elle est une forme agie de refus du féminin flattant notre besoin d’illusion. Celui-ci est aisément exploitable par des idéologies privilégiant la solution pragmatique à la réflexivité, ainsi qu’à l’investissement du temps long de l’histoire du sujet et du monde.
Un autre masochisme
Au plan métapsychologique, l’auteur propose d’interroger la tendance actuelle à ne plus voir dans la violence pulsionnelle que la dimension destructrice, aux dépens des potentialités nourricières de l’effraction sexuelle. Le « scandale » serait désormais moins celui de la sexualité infantile que celui du « masochisme érotique féminin » (chapitre 5). Ce dernier se distingue du « masochisme érogène » de Freud, qualifié de primaire, renvoyant à une première liaison dans l’organisme de la douleur et du plaisir. Le « masochisme féminin », décrit également par Catherine Parat, ne se confond pas non plus avec l’érotisation fantasmatique des douleurs et humiliations sexuelles. Pour Schaeffer, la coexcitation libidinale ne prend sa valeur de cran d’arrêt à la destructivité qu’associée à un mouvement de retournement de l’activité en une passivité active. Mais relier la vie psychique à une capacité d’ouverture et d’abandon à de fortes quantités libidinales, comme à la possession par l’objet sexuel, soulève aujourd’hui de nouvelles résistances.
La pensée de Schaeffer s’enrichit de la discussion avec René Roussillon, auteur de la postface ajoutée au Refus du féminin dès sa seconde édition (2008/2013), lorsqu’elle précise que ce masochisme psychique nécessite un objet fiable, « objet “autre sujet” », désignant aussi bien la mère du narcissisme primaire que « l’amant de jouissance » de la rencontre amoureuse, ou que l’analyste. Elle va jusqu’à faire du masochisme féminin « l’inventeur de la culpabilité, dans le secret de son plus grand plaisir » : le garant de la jouissance sexuelle, le gardien du narcissisme féminin, le promoteur des investissements en intériorité, l’indispensable auxiliaire de la cure entendue comme élargissement du moi.
Clinique du féminin
Détaillants enfin quelques aspects d’une clinique psychanalytique différenciée – la transmission mère-fille, l’accouchement, la ménopause – Schaeffer décrit et promeut, pour la vie psychique et ses effets dans la cité, un « travail du féminin » tel qu’il se découvre dans les relations amoureuses et sexuelles, les grandes crises de la vie, le déroulement d’une cure. Ce trajet est retracé par l’auteur pour les deux sexes. Néanmoins il me semble possible de lui retourner, en le renversant, le reproche fait à Freud au sujet de l’Œdipe, réputé universel mais abordé du point de vue de la psycho-sexualité du garçon. Car non seulement le vagin, mais également le pénis génital est l’objet d’un refoulement jusqu’à la puberté ; quant à l’identification primaire, elle est au père de la préhistoire maternelle ou aux deux parents ; enfin par le jeu de la bisexualité et des identifications, comme Tiresias, il arrive à la femme d’être psychiquement homme dans l’amour.
Si Schaeffer décrit l’intégration du féminin chez un homme comme la capacité à relâcher le contrôle de son moi et à abandonner ses défenses anales et phalliques, si elle évoque lors de la rencontre avec celui qu’elle appelle « l’amant de jouissance », une « co-création du féminin et du masculin », elle réserve au féminin la primauté de l’autre, et décline trop peu à mon sens les figures complémentaires du masculin… dans les deux sexes. Le scandale aujourd’hui, au-delà du féminin, n’est-il pas celui de la différence des sexes ? Celle-ci ouvre aux jeux des psycho-sexualités homosexuelles et hétérosexuelles, quel que soit le sexe des partenaires ou des parents.
Audacieux, ce petit livre très dense permet au clinicien de s’inventer les formes incarnées d’une intériorité contenante active, pour vivre et penser les expériences de transfert et de contre-transfert comme des rencontres sexuées. On peut regretter une densité rendant le propos parfois elliptique, ainsi que la parcimonie des vignettes cliniques. Celle-ci est contrebalancée par des références culturelles concises et parlant juste. Ainsi deux répliques d’opéras célèbres mettent en lumière la dissymétrie du désir de l’homme et de la femme dans la rupture : « Si tu me quittes, je te tue ! », crie Don José à Carmen. Tandis que Madame Butterfly menace : « Si tu me quittes, je me tue ! » Finalement, plus qu’à Freud ou de Beauvoir, c’est à Marguerite Duras qu’est confié le dire difficilement avouable d’un désir de femme : « Il y a une sorte de gloire du subissement chez la femme, mais que beaucoup de femmes nient. C’est le règne du subissement. Je regrette que beaucoup de femmes ignorent tout de ça… Je crois que s’il n’y a pas ça, il y a une sexualité infirme chez les femmes, incomplète. C’est comme si on portait en soi sa barbarie première, intacte, qui s’était ensablée avec le temps, depuis des siècles. »
Laurence Aubry est psychanalyste (SPP)
Références bibliographiques
Quignard P. (2007). La nuit sexuelle. Paris, Flammarion.
Schaeffer J. (1997/2008/2013). Le refus du féminin. La Sphinge et son âme en peine. Paris, Puf.
Schaeffer J. (dir.). (2019). Qu’est la sexualité devenue ? De Freud à aujourd’hui. Paris, In Press.
Aux origines du Je. L’œuvre de Piera Aulagnier. Actes du Colloque de Cerisy la Salle – 15 au 22 juillet 2021, Jean-François Chiantaretto, Aline Cohen de Lara, Florian Houssier et Catherine Matha (dir.), Paris, Ithaque, 2022.
 Comment parler de cet ouvrage sans évoquer Piera Aulagnier, bien sûr, mais aussi l’ambiance, la vigueur, le dynamisme et les ressorts vivifiants du colloque organisé par nos mousquetaires au Centre Culturel International de Cerisy la Salle. Comme il est rappelé dans l’introduction, ce colloque sur l’œuvre de Piera Aulagnier s’est tenu à Cerisy du 15 au 22 juillet 2021. Il fait suite, dans une continuité évidente, aux précédentes rencontres cerisyennes, impulsées par Jean-François Chiantaretto, avec différents collègues, qui ont toutes donné lieu à publication. Le fil rouge est toujours celui de mettre en avant une des spécificités de la psychanalyse francophone, à savoir, la place accordée à la culture dans la pratique clinique et la théorie des analystes, et dans le même temps, la place de la psychanalyse dans la culture. Qu’il s’agisse des travaux autour de l’écriture de soi, du corps, du psychanalyste, ou de l’œuvre, de Nathalie Zaltzman et enfin de celle de Piera Aulagnier, la fidélité aux textes de Freud et à son questionnement essentiel sur l’articulation de l’individuel et du collectif, résonne et se manifeste de plus en plus vivement. Cet ouvrage présente les principaux concepts proposés par Aulagnier au travers de dix-huit chapitres qui font suite aux interventions du colloque de 2021. Ces articles sont regroupés en cinq parties : Passé(s) à construire ; Le désir, la douleur, la mort ; La culture, le Je ; Les origines, la psychose ; Penser.
Comment parler de cet ouvrage sans évoquer Piera Aulagnier, bien sûr, mais aussi l’ambiance, la vigueur, le dynamisme et les ressorts vivifiants du colloque organisé par nos mousquetaires au Centre Culturel International de Cerisy la Salle. Comme il est rappelé dans l’introduction, ce colloque sur l’œuvre de Piera Aulagnier s’est tenu à Cerisy du 15 au 22 juillet 2021. Il fait suite, dans une continuité évidente, aux précédentes rencontres cerisyennes, impulsées par Jean-François Chiantaretto, avec différents collègues, qui ont toutes donné lieu à publication. Le fil rouge est toujours celui de mettre en avant une des spécificités de la psychanalyse francophone, à savoir, la place accordée à la culture dans la pratique clinique et la théorie des analystes, et dans le même temps, la place de la psychanalyse dans la culture. Qu’il s’agisse des travaux autour de l’écriture de soi, du corps, du psychanalyste, ou de l’œuvre, de Nathalie Zaltzman et enfin de celle de Piera Aulagnier, la fidélité aux textes de Freud et à son questionnement essentiel sur l’articulation de l’individuel et du collectif, résonne et se manifeste de plus en plus vivement. Cet ouvrage présente les principaux concepts proposés par Aulagnier au travers de dix-huit chapitres qui font suite aux interventions du colloque de 2021. Ces articles sont regroupés en cinq parties : Passé(s) à construire ; Le désir, la douleur, la mort ; La culture, le Je ; Les origines, la psychose ; Penser.
Les directeurs de l’ouvrage, de même que les auteurs, appartiennent à des institutions psychanalytiques différentes : Quatrième Groupe, Société Psychanalytique de Paris, Association Psychanalytique de France, Société de Psychanalyse Freudienne, Société Belge de Psychanalyse, Société Psychanalytique de Montréal. Le parti pris a consisté non pas à réunir des spécialistes des écrits et concepts d’Aulagnier, mais à solliciter des auteurs pour témoigner de son influence sur leur pratique et leurs travaux. Il s’agit donc de montrer à l’œuvre une diversité de manières de penser, d’être analyste ou de styles d’écriture. Cette diversité est source et preuve de discussions et d’échanges entre analystes et entre institutions analytiques, animés et toujours enrichissants. Les colloques de Cerisy sont ainsi d’une confiance, d’une vitalité et d’une émulation toujours renouvelées et stimulantes, qui donnent toute sa qualité à l’après-coup de l’écriture. La liberté de penser, de mettre en relation, d’exposer une clinique singulière et sensible est une prise de risques, car penser suppose toujours de perdre, de prendre le risque de perdre. Une prise de risques salutaire.
Piera Aulagnier (1923-1990), liée à Jacques Lacan, son analyste pendant quelques années, puis à François Perrier et Jean-Paul Valabrega, fonda avec ces deux derniers, le Quatrième Groupe. Elle créa en 1967 la revue L’inconscient et en 1969, en même temps que la création du Quatrième Groupe, la revue Topique. Son œuvre prolonge et renouvelle la métapsychologie freudienne, tout en élargissant le champ de la clinique psychanalytique. Son séminaire, créé en 1962, sera le lieu d’élaboration de ses principaux concepts et ouvrages, faisant d’elle une grande figure de la psychanalyse. Elle fut reconnue internationalement pour son renouvellement de la métapsychologie et ses apports novateurs dans l’approche théorico-clinique de la psychose, mais aussi, des addictions et plus largement des différents types d’attaque du corps et de la pensée. Elle se situe au croisement des deux courants majeurs ayant animé la psychanalyse après Freud : entre le retour à Freud prôné par Jacques Lacan, mettant l’accent sur le langage, et l’héritage de Sándor Ferenczi, prolongé et renouvelé par Donald Woods Winnicott, axé sur l’infans. Elle propose une conception inédite de la construction psychique qui intègre à la métapsychologie freudienne, une nouvelle instance – le Je – et un nouveau processus, précédant les processus primaire (mise en scène) et secondaire (mise en sens) : le processus originaire (mise en forme). Cette approche novatrice des origines de la vie psychique et de l’articulation psyché/soma constitue un apport conceptuel considérable : pictogramme, porte-parole, fond de mémoire, contrat narcissique, etc.
La première partie se construit autour du « fonds de mémoire » et de la construction du Je. Ce fonds de mémoire, impératif pour garantir la certitude d’une parenté, d’un ordre temporel et assurer un capital fantasmatique, permet une permanence identificatoire et des possibles relationnels accessibles. La tâche du Je, comme le dit Aulagnier citée par Catherine Chabert, est de devenir capable de penser sa propre temporalité : « […] pendant une première phase de l’existence du Je, l’enfant continue à laisser au porte-parole la charge de formuler des souhaits identificatoires qui concernent son futur » (p. 23). Un enfant sait très vite que son histoire ne peut s’écrire qu’avec un autre. Le fonds de mémoire est la toile de fond sur laquelle peut se construire le travail autobiographique. Le défaut de refoulement conduit à la psychose, l’excès de refoulement à un désintérêt de l’enfance, à un passé désaffecté. Aline Cohen de Lara poursuit ce travail autour de la question des identifications. Selon Aulagnier, le processus identificatoire se fait en trois temps : identification primaire, identification spéculaire et identification au projet. L’enfant n’a pas le pouvoir de ne pas investir la mère ni de partager son investissement sur d’autres objets. « Le premier objet investi répond à un choix obligé, il est un objet non substituable, un objet qui ne peut pas manquer et un objet qui accapare à son profit la totalité de la libido […] » (p. 25). L’enfant est donc condamné à investir la mère. C’est à l’adolescence que le sujet peut sortir de ce passé et des identifications premières pour entrer dans le présent. Mais cela ne peut se faire qu’avec des repères solides, des ancrages temporel et spatial suffisants, un objet premier imparfait et manquant. Florian Houssier et Ghyslain Lévy s’attachent par leurs textes à montrer comment un projet identificatoire peut être empêché.
La deuxième partie se poursuit par le thème de la contrainte du désir. C’est par sa théorisation de l’originaire, comme système représentatif hors fantasme, dans un avant de l’usage des mots, par l’usage exclusif de la chose corporelle à jamais forclos de la pensée consciente, que Aulagnier avance l’idée du « désir de plaisir » et du « désir de non-désir », rapprochant ces termes de la question du masochisme. Au temps premier, il y a l’originaire, au temps deuxième, la mère dit au bébé qui il est, au temps troisième, le bébé donne son accord ou pas. Ainsi le Je peut se créer. Mais l’enfant est contraint de désirer. Le sujet est contraint par ses désirs. L’enfant étant condamné à investir, à désirer, Catherine Matha rappelle l’étymologie commune de désir et de désastre : desiderare, dérivé de sidus, sidéris (constellation, étoile, astre) cesser de voir l’astre, regretter l’absence de… Ainsi, plus le sujet investit l’objet pour le plaisir, plus il souffre, car il existe toujours un écart entre le désir et la réalité. Dominique Tabone-Weil travaille ainsi autour du désir maternel de non-vie. De même, Dominique Bourdin part de ce processus originaire et du pictogramme pour penser le prototype identificatoire. Le pictogramme est la représentation que forge l’originaire des sentiments reliant le Je à ses objets. Au moment où l’altérité se construit, le pictogramme se décolle, la psyché ne peut plus fonctionner en spécularisation et le fantasme intervient. Ce que fait l’autre est repris pas les fantasmes.
La troisième partie place la culture au centre des articles. René Kaës met en discussion ses concepts, l’intersubjectivité, les alliances inconscientes et l’appareil psychique groupal, avec le contrat narcissique et la fonction de porte-parole d’Aulagnier. Le contrat narcissique est cet espace psychique d’articulation entre anticipation parentale et anticipation sociale, comme préinvestissement au sein duquel va venir s’inscrire le sujet. Le contrat narcissique concerne le père et la mère. C’est le lieu du symbolique, il est donc articulé d’emblée à l’originaire, ce qu’il rapproche de l’intersubjectivité. René Kaës reprend ensuite les fonctions du porte-parole. La mère porte l’infans à la parole, dans la parole et par la parole, et lui porte la parole de l’autre en tant que référent tiers. Ellen Corin éclaire ces propos par une approche anthropologique et psychanalytique. Elle rappelle les mises en garde d’Aulagnier sur le fait que ses découvertes ne tiennent compte que d’un seul modèle culturel. Comment penser alors universalité et relativisme culturel dans notre manière d’appréhender la psyché ? À partir d’une clinique chez les Mongo et les Yansi, en se servant de ce concept de porte-parole, elle montre que l’ordre symbolique et l’ordre social s’inscrivent d’emblée dans la vie psychique. Et de rappeler, à l’instar de Catherine Chabert, la nécessité de penser la bigarrure de la psyché. Mireille Fognini poursuit une discussion posthume, conceptuellement riche de ces échanges singuliers, cliniques et théoriques avec Aulagnier.
La quatrième partie évoque davantage la question des origines. Yves Lugrin trouve une troublante proximité analytique et une communauté potentielle entre l’œuvre d’Aulagnier et celle de Sándor Ferenczi. Isabelle Lasvergnas rappelle que le fondement des recherches et des travaux d’Aulagnier s’appuie sur sa clinique avec des patients psychotiques. C’est à partir de la psychose que se construit le stade primaire de la psyché humaine et le sensoriel-graphique qu’elle nomme pictogrammes. Claire de Vriendt-Goldman poursuit cette réflexion sur la primo-proto-représentation, qui est le lieu, trace ou endogramme psycho-corporel, d’un investissement énergétique premier qui perdure tout au long de la vie, remanié ou non par les processus de psychisation successifs. Pierrette Laurent évoque ainsi une métapsychologie de la rencontre, celle de l’infans et de sa psyché avec le monde, transitant par le corps, dont les éprouvés viennent éveiller la psyché, créant ainsi un lien indéfectible psyché-corps.
La cinquième partie discute l’articulation penser le plaisir/plaisir à penser. Le lien sans conteste entre la théorie de la pensée et la théorie de la cure, au centre de l’œuvre d’Aulagnier, retravaillé par Jean-François Chiantaretto, montre que la cure vient révéler ce qu’il en est de la pensée, non seulement la dimension secrète de l’activité de penser, la question des secrets à penser, mais aussi la pensée (le penser) comme lieu du secret de fabrication de l’être. Le désir de savoir est une transgression du « su toujours » à la recherche du « non-su jamais » épuisable. De même, le mensonge est nécessaire au déploiement du Je par son écart entre parler et penser. Emmanuelle Chervet évoque le plaisir de penser dans l’interprétation. Elle rapproche la pensée d’Aulagnier de celle de nombreux auteurs en lien avec le pictogramme, les inscriptions présymboliques et la quête identificatoire du Je. C’est une ouverture à une définition très large du transfert et donc de l’interprétation. Évelyne Tysebaert fait un travail approfondi sur la question du Je. Le Je est condamné à investir et l’investissement dominant est celui de la rencontre. La rencontre psyché-monde présuppose que le Je, sans qu’il puisse en avoir connaissance, soit accompagné en permanence, tout au long de la vie, par l’originaire et le primaire qui se donnent leurs propres représentations des mouvements affectifs suscités par cette rencontre. Sans oublier la question bien actuelle de l’aliénation qui est pour Aulagnier un destin possible du Je. Jean-Claude Rolland rappelle sa rencontre avec cette théoricienne, rencontre qu’il nomme « coup de foudre », tant il se sentait converti à la pensée métapsychologique d’Aulagnier. Malheureusement, elle décède peu après cette unique rencontre. D’après-coup en après-coup, de textes fondateurs en textes fondateurs, Rolland montre combien la métapsychologie est « une science mal aimée » mais aussi comment Aulagnier a été la première qui, après Freud, a montré le statut de méthode qu’a la métapsychologie. Malgré une sécheresse de sa pensée, selon Rolland, elle montre que cette méthode consiste pour la pensée en une dissection infinie de ce qu’elle expérimente.
Le style des colloques de Cerisy, leur organisation, le fait d’être à l’extérieur de « chez soi » et en résidence, sont propices à une pensée de et sur la différence. L’œuvre d’Aulagnier s’accorde parfaitement à ce type de rencontres et le passage à l’écriture semble prolonger et amplifier comme naturellement le colloque. Lire l’ouvrage permet de découvrir, redécouvrir, confirmer, tous les apports conceptuels que Aulagnier a développés tout au long de sa vie et de son travail clinique. Il ne m’a bien sûr pas été possible, en si peu de lignes, d’expliquer et de rapporter la richesse des récits cliniques que chaque auteur a mis en avant pour étayer son propos, qu’il s’agisse de cures singulières, d’évocations anthropologiques ou d’un appui sur des figures artistiques connues. Comme le disent ces auteurs, l’œuvre d’Aulagnier est une reconfiguration d’ensemble de la métapsychologie. Elle part de la psychose pour repenser la métapsychologie. Cet ouvrage montre combien ces rencontres et ces écrits sont la conquête d’une aptitude à la confiance mutuelle : parler ensemble, penser ensemble, écrire ensemble, sans oublier la potentielle conflictualité contenue dans cet ensemble. Cependant, comme dans la cure analytique, une langue commune se crée. La question de l’humanité et du vivant de cette humanité est au cœur de ces échanges et de ce travail de pensée.
Catherine Herbert est psychanalyste, analyste en formation homologuée APF.
Narciss(is)me, de Martin Joubert, Paris, Stilus, « Nouages », 2022
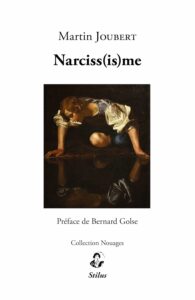 Dans cet ouvrage, Martin Joubert, psychanalyste, membre titulaire de la SPP, bien connu pour ses travaux sur l’autisme (L’enfant autiste et le psychanalyste, 2009 ; À quoi pensent les autistes ?, 2018) explore les fonctionnements et les impasses du narcissisme. Ou plutôt du « Narcisme » si l’on transpose en français le choix de Freud d’abréger, pour des raisons d’euphonie, disait-il, Narcizissmus en Narzissmus. L’auteur interroge cette transformation qui rappelle et répète l’abréviation de son prénom par Freud adolescent – Sigismund devenant Sigmund – avec élision des mêmes phonèmes « is »…
Dans cet ouvrage, Martin Joubert, psychanalyste, membre titulaire de la SPP, bien connu pour ses travaux sur l’autisme (L’enfant autiste et le psychanalyste, 2009 ; À quoi pensent les autistes ?, 2018) explore les fonctionnements et les impasses du narcissisme. Ou plutôt du « Narcisme » si l’on transpose en français le choix de Freud d’abréger, pour des raisons d’euphonie, disait-il, Narcizissmus en Narzissmus. L’auteur interroge cette transformation qui rappelle et répète l’abréviation de son prénom par Freud adolescent – Sigismund devenant Sigmund – avec élision des mêmes phonèmes « is »…
Pour Martin Joubert, le narcissisme est garant de la cohésion et de l’unité du moi malgré ses insupportables défaillances ; dans son ambiguïté même, il reste l’ultime rempart de la vie psychique et son point de résistance. Comme le souligne Bernard Golse dans sa préface, parmi les innombrables écrits portant sur le narcissisme, Martin Joubert apporte un regard nouveau, une perspective spécifique : il n’envisage pas tant l’élaboration du narcissisme dans la structuration et l’économie du psychisme ni ses rapports avec la formation d’idéal et les premières formes de l’instance critique interne, source d’une division dans la subjectivation, que le suivi attentif des perturbations du narcissisme dans les grandes pathologies que Freud nommait névroses narcissiques. Il envisage ainsi successivement les problématiques d’auto-engendrement, les pathologies narcissiques identitaires (paranoïa et mélancolie notamment chez la femme), et la question d’une faille narcissique. Tout ceci en relation avec la détresse originaire du nourrisson, l’Hilflogiskeit, source ultérieure de culpabilité, soutenant l’insatiable revendication narcissique.
Ce faisant, Martin Joubert conjugue de façon particulièrement heureuse la relecture rigoureuse des textes freudiens écrits dans cette perspective avec des vignettes tirées de sa propre clinique et des réflexions multiples ancrées dans les réflexions psychanalytiques contemporaines. On peut seulement regretter que le choix de la perspective ne soit pas indiqué plus clairement au début de l’ouvrage, ce qui peut surprendre et décontenancer le lecteur habitué aux formes les plus courantes de l’abord du narcissisme en psychanalyse, notamment à partir du texte de 1914, Pour introduire le narcissisme.
Le Caravage a choisi un dispositif circulaire pour peindre (vers 1597) Narcisse se mirant dans son reflet, continuité de lui-même. C’est autour de son genou plié que s’organise la scène circulaire, espace clos et dense, isolé du monde qui l’entoure. L’image, d’une consistance pleine autour de son axe, illustre le rêve narcissique du moi, celui d’une unité dense et homogène, un moi-tout-seul, entier, sans besoins, ne laissant aucune place au vide. La visée secrète de Narcisse serait ainsi de s’éviter la souffrance de la honte qu’inflige la détresse humaine primordiale, la dépendance vitale et prolongée du petit d’homme.
La puissance de la forme sphérique est soulignée par Lacan dans son séminaire sur le transfert (Le Séminaire. Livre VIII). Mais la pulsionnalité du sujet apporte à son rêve de complétude un démenti irréductible. Le fantasme de plénitude tire sa force du rejet de la castration hors du champ de la représentation. L’aspiration à un narcissisme sans tache est en fait un projet de mort, ce qu’expriment les verts et les marrons sombres du tableau du Caravage. L’immobilité du reflet est un puits qui attire vers la mort, tandis que la dynamique pulsionnelle suscite une conflictualité, ainsi que l’auto-observation – permettant ainsi une relation au double, structurelle et dynamique, dont on voit l’importance dans certains traitements d’enfants autistes. Il faut ainsi distinguer la défense narcissique (et son idéal de complétude) de l’appui narcissique dont se soutient le moi dans sa conquête du monde.
La première partie de l’ouvrage, au titre éloquent : « Je me suis fait tout seul !», envisage à la fois « l’invention » du narcissisme et sa visée entre auto-engendrement et création. La notion de narcissisme apparaît dans l’étude consacrée à Léonard de Vinci (1910), comme choix amoureux de l’enfant mâle par identification à lui-même, objet d’amour de sa mère. Les jeux de miroir et de fascination sont présents. Mais c’est après la publication du mémoire de Schreber (1910) que le narcissisme est désormais au cœur de la réflexion de Freud sur les psychoses, qui choisit, le reprenant de P. Näcke, le terme de Narzissmus. Martin Joubert retrace alors la genèse de l’écrit freudien, qui réveille la rupture avec Fliess et les thèmes du double et du vol des idées. La dénonciation du vol des idées (comme le fit Fliess contre Freud à propos de la bisexualité psychique) témoigne d’une révolte narcissique contre une pénétration vécue comme un viol, portant atteinte à la fois à la pureté interne de l’inventeur, et à l’action fécondante de ses idées. Sans nier ce qu’il devait à Fliess, Freud préférait voir dans son emprunt une cryptomnésie involontaire. Or c’est aussi de cela qu’il s’agit chez Schreber : de la postérité. À la fin de son texte, Freud en appelle au témoignage de ses collègues en faveur de sa théorie de la libido et de l’inconscient, face à l’auto-théorisation par Schreber des « rayons de Dieu » et de la « langue fondamentale ».
Freud semble fasciné et déconcerté par la familiarité étrange de la paranoïa. Dès 1895, il note le lien avec une dimension narcissique avant la lettre : les malades aiment leur délire comme ils s’aiment eux-mêmes. Cette lutte narcissique contre l’insuffisance fondamentale du sujet est à relier à son rejet de la scène primitive, à laquelle il substitue un fantasme d’auto-engendrement. La paranoïa combine ainsi la mégalomanie avec des mythes relatifs à l’origine.
Avec Schreber, Freud pense encore la paranoïa sur le modèle de la névrose, comme lutte contre une homosexualité inconsciente inacceptable. Léonard choisit ses objets d’amour selon une identification inconsciente à lui-même, tel que sa mère l’aurait aimé. Narcissisme, idéalisation et identification forment l’ensemble structural sous-jacent. Au risque du délire, afin qu’il n’y ait ni perte, ni renoncement, ni deuil. Le délire de jalousie de Don Francisco, dans le film El de Buñuel, s’alimente de la question des origines et de la perpétuation de la lignée. Pour Schreber, le délire rencontre aussi la fonction du père dans la génération : le fantasme de la transformation en femme est à relier à l’idée délirante d’enfants humains engendrés par la seule pensée. Le fantasme d’un engendrement/auto-engendrement par l’action des rayons divins manifeste l’absence de toute symbolisation de la fonction de la femme dans la procréation.
Du fantasme d’auto-engendrement, Martin Joubert rapproche la suppression de la syllabe « is » par Freud dans son propre prénom comme dans le terme choisi pour désigner le narcissisme. « L’autonomisation vis-à-vis de la filiation anticipe la revendication de la paternité exclusive de ses œuvres » (p. 39). Ce sacrifice d’un petit bout à valeur symbolique rappelle d’ailleurs la circoncision, rite que Freud attribue au Moïse égyptien, et qui manifeste l’appartenance communautaire et le rattachement du sujet à la Loi. Freud reste dans la logique névrotique – avoir un fils qui soit comme le père – qui reste l’issue au fantasme du roman familial comme à celui du sauvetage des parents, écartant la folle logique circulaire : avoir le père comme fils en échappant ainsi à toute dette…
Les chapitres qui suivent poursuivent cette réflexion sur l’auto-engendrement dans la paranoïa masculine. C’est Yaël, qui couve ses enfants comme s’il était une vieille femme maltraitée par eux. C’est ainsi qu’il s’approprie la puissance procréatrice maternelle, calmant quelque peu l’angoisse de l’exil et l’exigence d’être un homme. La femme aurait-elle quelque chose de plus ? Zoltan cherche un support identificatoire, mais se sent traqué par des paparazzi qui pourraient dévoiler que, jeune, il a fréquenté des prostituées. Un sentiment d’anéantissement du moi accompagne ses bouffées délirantes, mais elles le protègent de la mélancolie. Il y aurait ainsi un malentendu dans la compréhension du désir de féminisation dans la paranoïa masculine : au-delà des désirs passifs vis-à-vis du père, la visée pulsionnelle est l’accès à la puissance féminine de la procréation. Dans l’impossibilité où se trouve le paranoïaque d’accepter la séparation avec l’objet maternel incestueux et donc de lâcher les identifications primaires pour investir celles de la lignée paternelle (« Tu n’es plus un enfant ! », « Sois un homme ! » l’auto-engendrement d’une lignée ne provenant que de lui-même l’affranchit de la génération sans l’obliger à renoncer au lien incestueux.
En dehors de la pathologie, ces logiques paranoïaques peuvent d’ailleurs soutenir la création artistique. Un chapitre passionnant est ainsi consacré à la façon dont Romain Gary s’est construit un double opposé à lui, Émile Ajar (Gros-Câlin, La vie devant soi), sans dévoiler la supercherie de son vivant, ce qui lui a valu deux prix Goncourt et l’inimitié posthume du jury. Multiplicité des références symboliques, fantaisies dans les textes d’apparence autobiographique, paternité de substitution (l’acteur Mosjoukine), et personnalité troublante de sa mère, tout est réuni pour soutenir cette pluralité des identités offerte au public, dont Martin Joubert suit pas à pas les méandres (en appui sur Racamier, Aulagnier et Chiantaretto). Dans La promesse de l’aube, le cri « j’étais né ! » ne vise pas le nouveau-né, mais la publication d’Une éducation européenne. Et la publication posthume Vie et mort d’Émile Ajar, après son suicide, dévoile le plaisir immense pris par Romain Gary à cette mystification, vécue comme un défi.
L’assise narcissique de chacun repose sur la confiance dans sa capacité à transformer le monde et à susciter une réponse de ses objets. Il faut donc oser une mise narcissique qui, si elle tombe dans le vide d’une non-réponse ou ne reçoit qu’une réponse insensée, ouvre la voie aux pathologies infantiles les plus sévères. Le bébé cherche déjà à prévoir ce qui va arriver, il soutient un pari, et révise au fur et à mesure ses modèles de compréhension et d’anticipation. La vie psychique se déploie dans une situation paradoxale : tout en maintenant le fantasme d’un monde autoengendré par le seul désir de l’enfant, elle doit prendre en compte son imprévisibilité et ses récurrences. L’erreur de prédiction expose non seulement à la déception, mais à une honte qui entrave le développement des capacités cognitives. La prétention narcissique du nourrisson a prévalu sur le pari, suscitant une blessure qui amène à maintenir un collage à la psyché maternelle à qui l’enfant délègue son autonomie psychique. Il en résulte un sentiment d’infériorité et une honte, et le conflit narcissique non dit se solde par l’abandon de l’outil intellectuel, en un tableau de déficience mentale ; ainsi Fabien – qui ne peut jouer qu’à coup sûr – dans le non-jeu qu’il instaure avec son analyste. Buster Keaton, comme Pascal dans son pari sur Dieu, perçoivent l’enjeu radical du pari : veux-tu que je vive ? Inversement, Pascale, une patiente qui ne peut écrire que dans l’urgence, ressent avec force la vanité des choses, l’idée que ça ne sert à rien. Elle renonce à parier sur elle-même, active un fantasme masochique mais persiste dans sa demande à l’analyste, dans l’espoir qu’un jour on puisse parier sur elle. Interpréter c’est d’ailleurs aussi parier, renoncer à l’ensemble des possibles pour en réaliser un. Parier expose au deuil originaire, mais ouvre à l’échange symbolique ; c’est un défi adressé au surmoi.
La deuxième partie de l’ouvrage envisage les névroses narcissiques. Elle s’ouvre par un chapitre sur les spécificités de la paranoïa chez la femme, en référence au cas présenté par Freud d’un cas en contradiction apparente avec la théorie psychanalytique. Le lien passionnel à un objet infantile jamais perdu porte l’élément homosexuel inconscient, et la construction délirante prend la place de l’angoisse de castration. « La patiente s’est libérée de l’allégeance homosexuelle vis-à-vis de la mère par un petit bout de régression […] elle s’est identifiée à elle, elle est devenue elle-même la mère », précise Freud (1920a/1996, p. 314). La disposition à l’affection paranoïaque est donc d’origine narcissique.
La logique du raisonnement reste celle de la première topique. Mais ce qui fonde le narcissisme s’organise par des voies différentes selon les sexes. La continuité de l’attachement mère-fille demeure et le lien adhésif n’est jamais totalement lâché. Il faut y ajouter la continuité et l’ondulatoire du plaisir dans la jouissance féminine. Par ailleurs, l’entente secrète des persécuteurs est une figure récurrente de la paranoïa. L’exclusivité idéalisée des « meilleures amies », comme la raconte Virginia Woolf dans Mrs Dalloway, implique un pacte qui ne se dévoile que lorsqu’il se rompt dans une explosion passionnelle. Une désidéalisation tempérée permet par la suite la complicité en miroir avec d’autres femmes.
La maternité et l’allaitement (promesse de fusion affolante) exposent aussi les femmes au risque d’une décompensation paranoïaque. Martin Joubert revient sur Aimée, la patiente de Lacan, qui manifeste des angoisses infanticides projetées sur l’entourage. Un premier épisode délirant avait eu lieu lors d’une première grossesse ; l’enfant est mort-né. Elle investit passionnément l’enfant suivant qu’elle allaite jusqu’à quatorze mois ; anxieuse, elle craint qu’on ne l’enlève. Et l’actrice qu’elle agresse aurait menacé son enfant. La chute du délire, lors de l’hospitalisation, révèle une profonde dépression mais aussi un attachement passionné à sa mère… S’il faut protéger l’enfant contre la malveillance du monde, c’est aussi parce que la mère perçoit inconsciemment les mouvements d’individuation et d’autonomie du bébé, ce qui suscite un conflit d’ambivalence oral. Une vignette clinique montre chez Sylvie des mouvements psychiques analogues à ceux d’Aimée.
Le chapitre suivant s’attache à différencier la mélancolie de ces réactions paranoïaques où la projection protège contre la désorganisation. Le Procès de Kafka, commenté par un patient lui-même mélancolique, apparaît comme le roman par excellence de la mélancolie, caractérisé par l’errance dans des lieux en enfilade, resserrés ou étendus, sorte de caverne labyrinthique. Des vignettes cliniques répondent ici à Kafka, mais aussi aux peintures de Dürer, Cranach et Carpaccio, pour figurer la continuité et la confusion des espaces, la porosité des topiques et des instances propres à la mélancolie. Conséquence de l’adhésivité de la libido, l’identification narcissique fige le lien à l’objet incorporé en maintenant la continuité fantasmatique des corps. Le propos est illustré par La promenade au phare de Virginia Woolf : l’excursion ne parvient à s’effectuer qu’après la mort de la mère, et la continuité de l’espace manifeste une circularité fondamentale. L’identification narcissique joue selon les logiques ambivalentes de l’incorporation cannibalique. D’où parfois l’accrochage de survie à un sado-masochisme pour éviter le désinvestissement et la désagrégation. L’auteur déploie ainsi une réflexion, presque une méditation, sur la cruauté, la haine et la honte dans le transfert et dans le contre-transfert.
Cette seconde partie s’achève par un chapitre sur l’hypocondrie d’Argan, le personnage du Malade imaginaire de Molière, entre mélancolie et paranoïa. La contradiction chez cet homme mûr entre la figure paternelle autocratique et la régression infantile fonde la puissance comique du personnage. Tandis que le carnaval bat son plein et assure l’unité entre les éléments du récit, Molière donne à voir la lente désorganisation psychique d’Argan, jusqu’à la folie. La reprise du synopsis amène Martin Joubert à souligner l’érotique anale de la pièce, sous une autre forme que dans Le roi des Aulnes de Michel Tournier. C’est le triomphe de Dionysos. Le désordre mental dans lequel bascule Argan rappelle la mère du roi Penthée qui, dans Les Bacchantes d’Euripide, dans sa transe hallucinatoire, dépèce et dévore son fils, répétant le destin de Dionysos lui-même.
La dernière partie de l’ouvrage lui sert de conclusion : « Il y avait un trou… ». Évoquant un patient, Yann, Martin Joubert y reprend l’analyse du fantasme d’usurpation dans les rêves typiques d’examen, naguère mis en évidence par Janine Chasseguet-Smirgel. S’il « n’a pas mérité ça », pas plus que sa mère, la quête de légitimité du patient doit en passer par ce détour de l’examen réussi qu’il faut repasser. Le psychisme bute sur un traumatique qu’il ne parvient pas à élaborer. Le thème de l’usurpation traduirait la persistance d’une sexualité autoérotique attachée aux fantasmes incestueux de l’enfance. Conformément à Au-delà du principe de plaisir, la répétition tente de donner forme à un insensé situé hors représentation. Y compris chez des patients d’aujourd’hui, plus de cent ans après ceux de Freud, suscitant chez l’analyste un sentiment d’étrangeté.
À l’infini, la forme ronde se répète et les nœuds mathématiques de Jean Michel Othoniel (exposition au Petit Palais à Paris) – faits de ficelles attachées à des boules réfléchissantes en verre de Murano – viennent figurer ces jeux de reflet des boules les unes dans les autres. Elles-mêmes et tout l’environnement qui s’y reflète et l’observateur lui-même sont en même temps déformés par leur sphéricité, et s’y retrouvent à l’infini de plus en plus petits…
Narcisse tente de s’incarner dans un moi qui se voudrait complet et autonome, maître de son monde et de ses désirs. Il préfère la symétrie du miroir et l’abolition de la différence des sexes, laissant la castration en suspens, arrêtant le temps et demeurant sans faille ni tension avec son idéal ou son surmoi. Mais le rêve d’examen qui tente de façon renouvelée de recouvrir une faille symbolique la révèle. Il y a nécessité d’un manque. La fêlure d’où sourd l’inconscient est au cœur du travail analytique et confère au contre-transfert sa dimension inquiétante, suscitant un vacillement identitaire chez l’analyste. L’expérience analytique est celle d’une béance, c’est un manifeste de l’incomplétude. Sinon, à l’expérience de la honte primaire contre laquelle le moi s’insurge, reste attachée la menace d’une désorganisation corporéo-psychique.
Dominique Bourdin est psychanalyste (SPP).
Le défi des états limites. Regard clinique et théorique, de Bérengère de Senarclens, Paris, Campagne Première, 2022
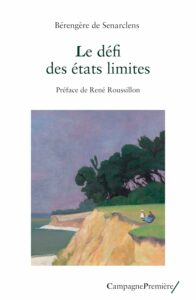 Ce livre de 246 pages reprend le parcours personnel de Bérengère de Senarclens à travers des articles déjà publiés et remaniés pour cette édition, comme elle l’indique dans son introduction. Cet ouvrage peut constituer une référence en ce qui concerne la réalité clinique avec des patients états limites et s’inscrit dans le courant de la psychanalyse contemporaine qui s’intéresse à l’irreprésentable ainsi qu’aux liens corps-psyché. Le riche matériel clinique est au premier plan et s’articule d’une manière fine autour de la théorie. Les enjeux théoriques ont pour but d’éclaircir l’expérience clinique en évitant de l’obscurcir.
Ce livre de 246 pages reprend le parcours personnel de Bérengère de Senarclens à travers des articles déjà publiés et remaniés pour cette édition, comme elle l’indique dans son introduction. Cet ouvrage peut constituer une référence en ce qui concerne la réalité clinique avec des patients états limites et s’inscrit dans le courant de la psychanalyse contemporaine qui s’intéresse à l’irreprésentable ainsi qu’aux liens corps-psyché. Le riche matériel clinique est au premier plan et s’articule d’une manière fine autour de la théorie. Les enjeux théoriques ont pour but d’éclaircir l’expérience clinique en évitant de l’obscurcir.
J’ai eu plaisir à lire les quinze chapitres du livre de Bérengère de Senarclens qui traite avec profondeur et subtilité des difficultés qu’on rencontre dans le travail analytique avec des patients états limites. Dès le premier chapitre, les thèmes principaux autour des changements induits par l’analyse de certains états limites sont ébauchés. Dans chapitres suivants, les mêmes thèmes s’amplifient, faisant l’objet de réélaboration et deviennent plus complexes au niveau du contre-transfert, illustré par des vignettes cliniques.
Quant au titre du livre, Le défi des états limites, l’auteur propose sa définition : « Le défi pour l’analyste consiste à transformer une partie de cette zone en mal de représentations en quelque chose qui soit accessible, interprétable, et à lever les effets paralysants du lien à l’objet pour récupérer la force pulsionnelle et sa qualité transformatrice » (p. 35). Il me semble que plus encore que de défi, l’auteur démontre qu’il s’agit de l’appel profondément émotionnel adressé à l’analyste par des patients limites.
René Roussillon qui nomme ces pathologies narcissiques-identitaires, dans la préface du livre, propose le travail analytique des processus qui obéissent à la logique primaire du « tout », au profit des processus symbolisant et symboliques, des processus de la pensée.
L’auteur puise ses idées tout d’abord dans son dialogue avec la clinique, puis dans l’œuvre de Freud de la seconde topique. Le ça prend la place majeure d’inconscient au lieu du refoulé et les « […] motions pulsionnelles contradictoires formant le ça et visant à la décharge placent l’agir au centre de ces changements » (p. 33). De Senarclens s’intéresse plus particulièrement aux écrits de Freud regroupés autour du trauma précoce, entre l’être et l’avoir, le narcissisme et la sexualité : L’analyse avec fin et l’analyse sans fin, L’Homme Moïse et la religion monothéiste, Constructions dans l’analyse, et Le clivage du moi. L’auteur souligne que « pour Freud “construction” et “clivage du moi” sont deux entités inséparables » (p. 77). Ilse Grubrich-Simitis (1997) a par ailleurs bien mis en évidence les relations étroites et les cheminements communs par rapport au traumatique, entre les écrits de l’« Early Freud » et du « Late Freud », entre les Études sur l’hystérie et Moïse et le monothéisme.
<p>
De Senarclens envisage le facteur quantitatif du trauma comme du « trop » pulsionnel et du « pas assez » de capacité à l’organiser. Elle avance l’idée que pulsion-objet-trauma est comme une sorte de triade, où le trauma serait à la jonction de la pulsion et de l’objet. Le traumatique est le non symbolisé, l’irreprésentable qui est lié au moi idéal du narcissisme primaire au temps de l’infans, avant la capacité langagière. Elle propose de formuler avec modestie et circonspection des hypothèses concernant le lieu du symptôme et la potentialité d’avoir un sens. D’ailleurs, les réflexions de l’auteur sont teintées de modestie. En ce qui concerne la transformation psychique souhaitée, elle se situe, comme elle le signale, entre un « optimisme relatif » et un « pessimisme vivant ».
Bérengère de Senarclens, mise à part l’œuvre de René Roussillon, fait référence à plusieurs auteurs qui ont travaillé avec des patients non-névrotiques. Elle se réfère notamment aux signifiants formels de Didier Anzieu, à l’analité primaire d’André Green, à la figurabilité de Sàra et César Botella, à l’usage de l’objet et à la crainte de l’effondrement de Donald W. Winnicott, ainsi qu’à l’informe et la construction de sens de Jacques Press.
Les deux premiers chapitres semblent faire office d’introduction plus théorique que clinique : « Inconscient et états limites : du substantif à l’adjectif » et « Avatars de l’analité et patients limites ». L’auteur élabore la notion du trauma, considérée à partir de la deuxième topique freudienne. Elle met l’accent sur la valeur organisatrice de l’analité, phase de subjectivation, et sur les répercussions désorganisatrices de l’« oranalité » de Green.
La plupart des autres chapitres, comme leur titre l’indique, portent sur la technique et la relation transfert-contre-transfert : « Approche clinique », « La construction », « Fauteuil ou divan », « Questions de technique », « Un fantasme à valeur fétichique », « Cadre et transgression », « En quête de sens », « Le trauma et son écoute », « Quelle transformation psychique ? » et « Le corps a ses raisons ».
Malgré le fait que « le corps a ses raisons » soit le dernier chapitre, l’auteur remarque dans sa conclusion que « tout au long de cet ouvrage j’ai insisté sur la place du corps dans l’analyse, tant sur les manifestations corporelles du patient que sur le langage corporel de l’analyste » (p. 243). Par rapport à l’économie psychosomatique, elle se demande : « la douleur somatique protègerait-elle un moi qui serait menacé de morcellement ? » (p. 228) Et elle répond que mieux vaut une souffrance par un objet sadique que pas d’objet du tout.
Bérengère de Senarclens rapproche le patient limite du patient somatisant et souligne les similitudes entre ces deux entités cliniques. Elle se demande s’il serait envisageable d’entendre des symptômes physiques ou certains passages à l’acte comme des tentatives de symbolisation, comme une ébauche de communication d’avant le langage, le corps prenant ainsi de l’importance dans un rôle de vecteur potentiel de symbolisation. L’émergence de somatisation ou d’actings-out prend la valeur d’indicateurs d’un matériel primitif qui chercherait à se doter de sens et à perdre son pouvoir nocif. Elle s’ouvre à une écoute polyphonique, une écoute du primaire et du plus secondarisé, une écoute du corps, des actes, mais aussi des mots du patient et de l’analyste et de leur prosodie.
Il est intéressant de noter que les pionniers de l’École psychosomatique de Paris avaient déjà distingué certains patients qu’ils avaient appelés « les borderline psychosomatiques, proches de certains névrosés ou de certains psychotiques » (Marty et coll., 1963, p. 10).
Par ailleurs, l’auteur se différencie de l’École psychosomatique de Paris en soutenant qu’il n’y a pas nécessité de penser à une approche technique particulière avec des patients somatiques. Elle insiste sur le fait que la technique doit être la même pour les deux cas de figure.
Au fond des traumas précoces, il y a une dépression : « En deçà des mots il y a souvent une dépression très archaïque contre laquelle le patient a mobilisé toutes ses défenses » (p. 185). Des fantasmes contre-transférentiels émergent en miroir en passant par le corps. Dans une vignette clinique, l’auteur décrit son fantasme de prendre le patient dans ses bras, tel un tout petit enfant, comme si cela seul allait toucher la blessure archaïque et débloquer ce qui s’était gelé depuis.
De Senarclens se demande pourquoi certains patients somatisent facilement et pourquoi d’autres ont tendance à faire des actings ; elle émet ainsi l’hypothèse que cela dépend du temps où est apparu le traumatisme. La tendance à somatiser correspond à l’époque orale tandis que les actings sont plus tardifs, et se situent autour de l’organisation anale. Elle suggère qu’une somatisation en cours d’analyse pourrait s’imposer comme la figuration corporelle d’une émotion qu’il s’agit de décoder.
Il est remarquable que Bérengère de Senarclens ait mis le point sur les liens entre analité et fonctionnement opératoire, à partir du cas clinique d’un patient qui présente une maladie grave du système digestif. L’analyste remarque l’oscillation du patient entre deux modes défensifs, obsessionnel et opératoire ; de plus, elle soulève le déficit des défenses psychiques du patient, en raison d’un moi idéal primitif, ce qui entraîne la somatisation. Le grand vide représentatif, le trauma qui est plein d’énergie sans objet prend la valeur d’un aimant.
Le transfert des patients états-limites est avant tout narcissique, passionnel, avec des manifestations d’affects violents inorganisés qui expriment ces éprouvés primaires peu conscients. Le sujet entretient et répète en quelque sorte la plaie du tort qu’il a subi. Il incite l’analyste à s’impliquer en tant qu’objet d’étayage, en tant que double, ou par une mise en scène répétitive du lien primaire. Dans cette compulsion de répétition du trauma précoce, il y a également un côté positif, à savoir l’espoir que quelque chose s’élabore et se maîtrise de façon plus adéquate que par le passé, comme la possibilité de vivre un « éprouvé non éprouvé en quelque sorte » (p. 38).
Quand de Senarclens insiste sur le besoin de réduction des tensions au niveau le plus élémentaire, il me semble qu’elle tient compte, de façon implicite, de l’action de la pulsion de mort désintriquée et de la deuxième théorie des pulsions. Elle suggère le travail de l’architecte, la construction de l’irreprésentable, plutôt que celui de l’archéologue, l’interprétation du refoulé. D’une façon affirmative, elle souligne : « La construction concerne surtout le clivage tandis que l’interprétation porte davantage sur le refoulement » (p. 81). Les changements théorico-cliniques présupposent des changements de la place du contre-transfert. L’attention de l’analyste est loin d’être toujours flottante, et l’analyse du contre-transfert acquiert une valeur importante et devient un outil majeur.
De Senarclens s’oppose au « dogme post-freudien » (p. 116) du silence de la technique psychanalytique pour ce genre de patients. Elle indique qu’à l’appel au secours, il n’y avait comme réponse que le bruit assourdissant du silence. Dans une vignette clinique, elle écrit : « Je fus frappée de l’accrochage au perceptif […] dans la recherche effrénée d’un feed-back perceptif comme si c’était à travers mes yeux qu’il attendait effectivement confirmation de sa continuité psychique » (p. 69). En plus, dans le travail de symbolisation elle parle des interprét-actions de l’analyste, des actings qui prendraient valeur interprétative. Dans une vignette clinique, elle propose à une patiente un objet de son bureau, comme objet transitionnel, support perceptif d’une représentation que la patiente avait du mal à garder à l’intérieur d’elle-même. Elle soutient que cet acte peut constituer la première étape vers la symbolisation.
L’auteur met le doigt sur un point très important et en même temps délicat, la transgression du cadre, tant par le patient que par l’analyste. Elle fait remarquer que les transgressions déontologiques sont souvent commises avec des patients limites qui nous mettent à l’épreuve de façon intense. La personnalité et l’éthique du psychanalyste y occupent une place capitale. Le risque est pour le psychanalyste de trop s’impliquer dans une illusion contre-transférentielle de toute-puissance maternelle due à un transfert maternel idéalisé.
Suivant le même fil de pensée, l’auteur revient à l’opposition entre technique suggestive et analytique à l’instar de la peinture et de la sculpture : Freud (1905a) soutenait que la psychanalyse travaille comme la sculpture per via di levare, tandis que la psychothérapie travaille comme la peinture, per via di porre. Des éléments de suggestion sont inclus dans la construction de l’analyste. La co-construction avec le patient et essentiellement les reconstructions du patient protègent celui-ci de l’imposition de l’analyste. À mon avis, les grands risques proviennent toujours des tendances narcissiques de l’analyste, à savoir son auto-idéalisation.
Bérengère de Senarclens soutient que l’élaboration avec un tiers des mouvements contre-transférentiels est au cœur de l’éthique psychanalytique. « L’expérience clinique partagée avec d’autres analystes permet de retrouver un espace tiers […] d’éviter de tomber dans une sorte de dyade incestueuse et mortifère avec le patient » (p. 172).
Concernant l’interrogation : « fauteuil ou divan ? », de Senarclens met l’accent sur le cadre interne de l’analyste qui est indépendant du dispositif. Le seul fait du patient allongé sur le divan ne suffit pas pour « faire l’analyse ». L’écoute qui émanera du cadre interne constituera les fondements de l’analyse, tant sur le divan que dans le fauteuil.
Les patients états-limite sont très sensibles à tout ce qui émane de leurs analystes et il arrive souvent qu’ils se sentent désarmés sur le divan. Dans des cas qui s’accrochent au perceptif, celui-ci est essentiel parce qu’il renvoie au regard maternel qui n’est pas suffisamment intériorisé comme rassurant le narcissisme primaire. Or la disparition de l’objet du champ perceptif équivaut à l’effroi de la perte objectal et narcissique à la fois.
L’exploration et le travail analytique des fantasmes à valeur fétichique par une vignette clinique sont passionnants. Le fantasme fétichique pourrait condenser une pulsionnalité avide, alors qu’il évoquait la trace figée d’un vécu irreprésentable. Ce genre de fantasme exprime le besoin impérieux de se fondre dans un contenant idéalisé, prenant la fonction de procédé autocalmant. « Le fantasme fétichique commémorait un trauma dont la compréhension aurait pu rétablir sa continuité psychique… » (p. 141). De Senarclens avance l’idée que le fantasme fétichique sert d’organisateur et protège d’un dérèglement psychotique plus large, dû au vide du regard maternel et au défaut de rêverie maternelle. Il doit être conçu comme en attente de représentation.
Le souci qui traverse tout l’ouvrage de Bérengère de Senarclens est de donner du plaisir à vivre aux patients qui fonctionnent à travers une économie de survie, qui consiste à une issue entre la vie et la mort. C’est un travail de transformation à partir de la perception à l’hallucination, à la représentation des choses, à la symbolisation secondaire, et enfin aux mots.
Fotis Bobos est psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société Hellénique de Psychanalyse et membre titulaire de l’IPSO-Pierre Marty.
Références bibliographiques
Freud S. (1905a [1904]/2006. De la psychothérapie. OCF.P, VI : 45-58. Paris, Puf.
Grubrich-Simitis I. (1994/1997). Early Freud and Late Freud. London, Routledge.
Marty P., David C., M’Uzan M. de (1963). L’investigation psychosomatique. Paris, Puf.
<p>
Françoise Coblence, Le domaine de Psyché. La plainte, l’amour et l’affect, Paris, Puf, « Le fil rouge », 2023
 Françoise Coblence (1949-2021) était agrégée de philosophie, professeur d’esthétique, psychanalyste, membre titulaire et formateur de la Société Psychanalytique de Paris. Elle a été directrice de la Revue française de psychanalyse de 2012 à 2020, codirectrice de la collection « Le fil rouge » aux Presses universitaires de France. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages dont Le dandysme.
Françoise Coblence (1949-2021) était agrégée de philosophie, professeur d’esthétique, psychanalyste, membre titulaire et formateur de la Société Psychanalytique de Paris. Elle a été directrice de la Revue française de psychanalyse de 2012 à 2020, codirectrice de la collection « Le fil rouge » aux Presses universitaires de France. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages dont Le dandysme.
Ce livre posthume est constitué d’un recueil d’articles choisis par les éditeurs, Paul Denis et Catherine Ducarre, et je souhaite d’emblée souligner la réussite de leur travail, car la grande diversité des textes ici présentés me semble rendre justice à la fois à la richesse de la pensée de Françoise Coblence, mais aussi à sa profonde humanité (que j’ai eu la chance d’apprécier en travaillant auprès d’elle huit ans à la RFP).
Ainsi que j’essaierai d’en rendre compte, la lecture de cet ouvrage met en évidence son immense culture, sa connaissance précise du corpus freudien et plus largement psychanalytique, en particulier contemporain, la qualité extrême de son écriture enfin.
Mais la succession des chapitres permet aussi d’apprécier sa manière très personnelle de s’engager dans la théorie et la pratique psychanalytique. Ainsi le lecteur est frappé par le nombre important de textes centrés sur la présentation de la pensée d’un autre auteur, psychanalyste ou non : Hannah Arendt, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Levinas, Jean Starobinski, Norbert Elias, Jean-Bertrand Pontalis, Sigmund Freud, bien sûr ; et de manière plus latérale mais toujours attentive Paul Valéry, Charles Baudelaire, Gustave Mahler, Marcel Proust, Imre Kertész, et tant d’autres encore. Ce trait traduit à mon sens sa grande générosité pour entrer dans la pensée d’un auteur ou d’un artiste, et y inviter ainsi ses lecteurs, en se mettant elle-même en retrait.
Et néanmoins dans un certain nombre de textes, plus cliniques en particulier, nous percevons sa propre sensibilité, que ce soit dans sa relation avec ses patients, dans son expérience esthétique avec l’œuvre tel ou tel artiste, ou encore à propos de questions fondamentales de l’expérience humaine (et que le titre choisi annonce : La plainte, l’amour et l’affect).
Et c’est ainsi que ce volume parvient à mettre en évidence la place particulière de Françoise Coblence dans la communauté psychanalytique, et qui tient selon moi à ce qu’elle ait incarné de manière exemplaire l’équilibre précieux entre théorie et clinique, rationalité et sensibilité ; au sein des premières : solidité des références freudiennes et ouverture aux auteurs post-freudiens, mais aussi aux penseurs d’autres champs qu’elle fait dialoguer ensemble ; au sein des secondes : respect de la neutralité et du tact nécessaires tout en étant pleinement engagée et affectée par la relation thérapeutique.
Toutes ses qualités me paraissent en partie en lien avec le féminin, thème qu’elle aborde très souvent, et qui imprègne sa manière d’être psychanalyste, praticienne et auteure.
Dix-sept textes sont réunis, présentés dans l’ordre chronologique de leur publication.
J’ai choisi de les répartir en deux grandes familles, la première constituée par ceux consacrés principalement à un ou plusieurs auteurs, dont elle présente la pensée sur un thème donné ; la seconde plus directement consacrée à un objet de clinique psychanalytique.
Dans le premier groupe :
« Les transports de la pitié » aborde cette question à partir de deux auteurs, Arendt (plus particulièrement à propos de son livre, Rahel Varnhagen. La vie d’une juive allemande à l’époque du romantisme), et Rousseau (en se référant surtout à L’Émile).
Arendt développe une critique de la plainte (elle parle d’une « barbarie de la plainte »), telle qu’elle serait promue par le romantisme, et dont la psychanalyse serait l’héritière : « En érigeant la compassion en principe politique, en confondant les élans du cœur et la justice, elle priverait l’homme de l’accès à la pluralité effective, le confinerait dans l’obscurité – celle du privé, de la conversation des âmes, celle aussi des sombres temps » (p. 14). « [romantisme et psychanalyse] nous priveraient du véritable entretien, du dialogue ou de l’écriture capable d’instaurer un monde commun [en nous enfermant] dans la fascination pour l’exhibition des secrets et la curiosité pour les détails intimes » (p. 15). « […] La plainte n’atteindrait jamais l’autre. Sa manie généralisante, son illimitation renverrait son écho dans le secret et la solitude des cœurs » (p. 17). Réflexion très actuelle à notre époque de valorisation des victimes et de la « génération offensée ».
À Arendt, Françoise Coblence oppose alors Rousseau, que la première avait précisément condamné pour sa complaisance envers la plainte. « En dépit de la critique d’Arendt, il s’agirait bien alors pour Rousseau de montrer dans la pitié et la plainte qui en est corrélative les conditions primordiales d’une humanité effective. On sait l’importance que Rousseau accorde à la pitié. Elle modère dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même » (p. 20). Elle le cite alors dans L’Émile (1966, p. 289) : « Pour plaindre le mal d’autrui, sans doute il faut le connaître, mais il ne faut pas le sentir » (Coblence, p. 21), et elle commente : « La pitié nécessite le refus de la fusion […], s’accompagne de réserve, voire, aussi paradoxal que cela paraisse, d’une certaine froideur […] Condition de la reconnaissance de l’autre dans la différence à soi, et de l’extension possible, de la généralisation de la compréhension, le “transport” est tout à la fois passion de la ressemblance et maintien de la distance » (p. 22).
C’est par l’écriture que pourra se réaliser cette conjonction : « […] faisant accéder [la plainte] à une “autre scène” qui renforce, prolonge et réorganise les transports caractéristiques de la pitié » (p. 30). Ici nous retrouvons Arendt, pour qui « La question est bien toujours de savoir si la plainte n’appartient qu’à l’intimité des conversations ou si elle peut trouver accès à la lumière publique, et à quelles conditions » (p. 31), à la condition toutefois d’« unir la généralité de ce qui est humain avec la précision et la particularité des mots » (p. 32). Généralité qui se réalisera davantage dans l’écriture poétique, romanesque ou théâtrale : « La fiction permettrait à la plainte sans objet de trouver son destinataire et de se répéter sans répéter » (p. 34). On voit ici tout ce qui pourrait éclairer la psychanalyse sur ses rapports avec la philosophie, la littérature, la théorie et la fiction.
J’ai plus particulièrement développé la présentation de ce chapitre, car il me paraît exemplaire de la réflexion de Françoise Coblence, dans la mise en valeur de la pensée des autres, leur mise au travail aussi l’une par rapport à l’autre, sur des thèmes toujours sensibles pour lesquels on perçoit sa grande implication, et la forte résonance qu’ils suscitent chez le lecteur.
« Et l’amour, et l’autre »
C’est un texte difficile, dans lequel l’auteure nous présente la pensée de Levinas, dans sa complexité, ses paradoxes. Paradoxes auxquels font écho ceux de Marguerite Duras dans La maladie de la mort, et de Proust dans sa conception de l’amour. J’en retiendrai (ne pouvant rendre compte davantage ici d’un texte extrêmement dense) la question soulevée par Françoise Coblence sur l’étrange conception du féminin de Levinas, dont la réflexion pourtant audacieuse semble ici renouer avec les stéréotypes les plus convenus ; et la fraîcheur retrouvée dans les dernières lignes grâce à Nerval, comme une confirmation de la supériorité de la poésie sur la philosophie sur cette question.
« Dramaturgies et mythologies freudiennes », centré sur la pensée de Jean Starobinski (et plus particulièrement son texte « Psychanalyse et littérature » tiré de son ouvrage La Relation critique), en fournit également une démonstration convaincante. Starobinski a souligné l’importance, chez Freud, de la « force de conviction et sur la dimension tout à la fois littéraire et mythique où s’étaye cette force » (p. 112), montrant en même temps son ambivalence envers la littérature, et proposant de l’interpréter non sans ironie comme témoignant du refoulement de la part mythique de la psychanalyse. À propos d’Hamlet et de son rôle dans l’autoanalyse de Freud et l’élaboration du complexe d’Œdipe, il décrit comment « la poésie opère le passage du biographique à l’universel et au mythe, traduits ensuite dans le langage de la science » (p. 115) ; il voit dans la psychanalyse une « remythologisation du discours médical » (p. 117) avec en particulier « la traduction du religieux dans les puissances de la nature », dans la suite du romantisme. Mais à l’inverse, « c’est peut-être surtout son pessimisme qui empêche le naturalisme de Freud de trouver la nature admirable, compte tenu des forces de destruction qu’elle comporte et que la culture ne cesse de mettre en œuvre » (p. 118).
« Foules, masses et processus de civilisation » est l’occasion de faire dialoguer Freud avec Norbert Elias, « le plus psychanalyste des sociologues ». Pour le premier, dans Psychologie des masses et analyse du moi (Freud,1921c/1991), il s’agit de « proposer l’application de la psychanalyse du moi à la psychologie des masses » (Coblence, p. 155). Il décrit la masse comme « un groupe structuré, et très précisément structuré, par les liaisons libidinales avec le meneur et par celles de stricte égalité qui sont induites entre les membres. Ces liens sont dénués de l’ambivalence qui est celle des sentiments ordinaires : l’hostilité, l’intolérance en sont exclues ; le narcissisme y est limité par le lien au meneur. […] Dès lors, le destin de la haine est qu’elle soit projetée à l’extérieur » (p. 166). Grand lecteur de Freud, Elias lui adresse cependant deux critiques sur sa vision du lien entre l’individu et la société : « d’une part il reproche à Freud cette polarisation individu/société [dans laquelle l’autre n’est qu’un motif de restriction du bonheur de l’individu] ; d’autre part, il y voit une survivance des théories du contrat social […] comme s’il y avait des individus avant la société » (p. 172). Elias propose de concevoir un processus de civilisation « sans commencement », et qu’il faut historiciser ; ainsi il « nous aide à comprendre la civilisation (la Kultur) comme processus et l’intégration de l’individu dans ce processus, entre individu et société » (p. 173).
Dans « Une pensée rêvante ?», Françoise Coblence s’adresse directement à Jean-Bertrand Pontalis à propos de ses réflexions sur le rêve, et son intérêt pour le rêver, la pensée rêvante, de l’analysant et de l’analyste, se référant de manière privilégiée aux Carnets de Paul Valéry.
J’en rapproche « Entre sommeil et rêve : la place de l’affect » qui rapporte longuement une vignette clinique (la plus fouillée de l’ouvrage) dans laquelle l’analysante, soumise à des traumatismes importants, n’a au début de la cure aucun rêve, tandis que l’analyste est prise par des moments d’endormissement. Elle suggère que ceux-ci puissent constituer ce que Michel de M’Uzan appelle « chimère psychologique ». À partir de la reconstruction de son histoire, l’analyste cesse de dormir, et c’est l’analysante va reprendre le sommeil à son compte, ce qui va permettre la réapparition des rêves, avec également l’émergence des affects, ouvrant à l’élaboration de la séparation.
Ce texte me fournit donc la transition pour rendre compte à présent de ceux qui concernent moins un auteur particulier (sinon Freud, bien sûr) qu’un thème psychanalytique, et qui ouvrira donc davantage à des débats inter-psychanalytiques, car, pour Françoise Coblence, et cet ouvrage le met magnifiquement en valeur, la pensée passe toujours par le dialogue et la confrontation.
C’est le cas avec « Psyché et la différence des sexes ». L’auteure propose de dépasser ici le Freud de Quelques conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau anatomique (1925j/1992), centré sur l’angoisse de castration et ses déclinaisons chez la fille et le garçon, pour, avec Jean-Luc Donnet, faire l’hypothèse « que le refus du féminin (chez l’homme comme chez la femme) serait le symptôme après coup d’une féminisation primaire restée enclavée et non subjectivable dans le moi » (Coblence, p. 204). Ceci renvoie à l’enjeu primordial de la dépendance de l’enfant à l’objet, comme à son corps. Françoise Coblence illustre cette conception par deux vignettes cliniques de femmes qui n’ont pu vivre l’expérience de la dépendance, de la féminité primaire, en raison d’aléas biographiques et traumatiques leur ayant imposé de remplacer chacune pour leurs parents un garçon (frère de la mère et du père) ; exigence de réparation des parents qui les maintient paradoxalement dans une place infantile qui se répète et insiste. Car à l’inverse la traversée de cette phase initiale de dépendance intense seule permet la naissance de la subjectivité propre, ainsi que le figurent les multiples dessins et sculptures de Rodin intitulés « Psyché ».
Cette compréhension irrigue également le texte « La solution homosexuelle », puisque l’auteure y écrit : « La question dès lors, n’est plus tant celle de l’homosexualité que celle du féminin et de son intégration, dans les deux sexes. » (p.241), en s’appuyant en particulier sur une citation, très éclairante, de René Roussillon : « L’homosexualité nous « montre » ce qui est en souffrance d’intégration chez le sujet, elle porte la trace d’un échec de l’organisation d’une homosexualité primaire « en double » […] En ce sens, l’homosexualité, celle qui habite chacun d’entre nous à des degrés divers […] témoigne aussi de la quête indéfinie d’un miroir fidèle de ce qui n’a pas encore reçu de statut intrapsychique suffisant pour être appropriable » (p. 241, note de bas de page).
Dans « L’affect ment-il ? », l’auteure part de l’assertion freudienne : « L’affect a toujours raison » dans L’Interprétation du rêve (1900/2003, p. 510), étayée par anticipation par la rhétorique rousseauiste des Confessions ; mais elle résiste à cette dernière quand elle écrit pour conclure : « l’affect est ainsi qualitativement toujours menteur pour un point de vue ou un autre » (p. 254).
C’est une thématique proche qu’elle aborde dans le texte « Un visuel trop évident », écrit à propos du Traité de l’évidence, de Fernando Gil, et à une conclusion pareillement balancée qu’elle aboutit : « Fernando Gil suit un chemin parallèle à celui que cherche tout psychanalyste dans l’alliance de la force et du sens, de la quantité et de la qualité, dans l’articulation des processus primaires et secondaires, et dans l’importance que l’on peut accorder à l’affect, ou à la parole en tant qu’elle est à la fois voix et mots, rythme et logos, souffle et signification. » (p.273).
Dans « Les détours sont les voies », citation de Freud dans la vingt-deuxième des « Conférences d’introduction à la psychanalyse » (1915/1999, p. 444), Françoise Coblence met en évidence à quel point « toute la psychanalyse pourrait ainsi apparaître comme l’examen des détours empruntés par la libido pour trouver une satisfaction, ou des satisfactions substitutives, pour contourner la frustration, pour trouver des compromis capables de satisfaire nos différents maîtres et nos différentes instances » (p. 279). Jacques André a d’ailleurs intitulé sa belle et sensible préface à l’ouvrage, « Une esthétique du détour », qui témoigne de l’importance de ce thème pour l’auteure, et que j’ai souhaité moi-même souligner dans sa manière de passer toujours par la pensée des autres pour mieux dégager la sienne.
Je ne peux que mentionner, faute de place, un certain nombre de textes plus spécifiquement liés à des questions esthétiques :
– « Le dandy, androgyne de l’histoire ? », qui rappelle que ce thème fut celui du travail initial de Françoise Coblence, alors qu’elle était encore surtout philosophe spécialisée en esthétique. Si nous avons vu jusque là son intérêt pour le féminin, il s’agit ici d’une figure exclusivement masculine, mais qui « joue d’un masculin aux antipodes de la virilité, masculin qui use du féminin et le montre, sans l’intégrer, dans une pure apparence ». (p. 88).
– « La nature fait bien les choses » évoque la vision freudienne des liens entre création artistique et féminité, de l’opposition entre la beauté (à l’origine de l’émotion esthétique), et l’attrait sexuel, toutefois réunis dans une conception téléologique que Freud partage avec Kant.
– « Gustav Mahler : jalousie et rivalités » traite de l’intérêt des psychanalystes pour le compositeur, à propos de sa rencontre avec Freud et de ce qu’on en sait, et des liens entre son œuvre et la place du deuil dans sa vie.
– « Freud, Breton, et le pouvoir des images » rapporte avec précision les relations entre les deux hommes, et l’importance de leurs divergences.
– et enfin « Art, douleur et psychanalyse », à partir d’une analyse de Jean-Claude Rolland sur ce que l’art peut apporter à la psychanalyse concernant, notamment, la connaissance – et la reconnaissance – de la douleur, amène Françoise Coblence à constater les limites de ce que peut l’art face à la douleur, et en particulier celle causée par l’inhumanité qui s’est déchaînée au xxe Siècle.
Dans la suite de cette question, « Le trauma transmis : un corps étranger ? », termine remarquablement cet ouvrage en évoquant, à propos d’une cure, le film magnifique de Ruth Zylberman, Les enfants du 209 rue Saint-Maur. Je la cite : « Pour les descendants des survivants, la question est donc : à quelles conditions les traces de ces événements catastrophiques, qui ont été dissociées, clivées ou enkystées, en tout cas “déréalisées” pour une génération, peuvent-elles être intégrées dans la vie psychique de leurs descendants […] Le processus d’intégration des traces doit nécessairement passer, d’une part par la reconnaissance de la réalité des événements déniés ou écartés, d’autre part, par un travail de métaphorisation qui a été impossible pour la génération des survivants » (p. 310).
Au terme de cette recension, il me semble qu’il faut remercier vivement les éditeurs pour cette publication posthume, qui restitue la pensée d’une psychanalyste profonde et attachante en en montrant la richesse et la subtilité, et en assurant ainsi la transmission d’une œuvre elle-même tout entière consacrée à maintenir vivante en la partageant la pensée, que ce soit dans sa pratique ou dans l’écriture.
Benoît Servant est psychanalyste, membre de la SPP.
Sotiris Manolopoulos, Psychoanalysis and Euripides Suppliant Women : a tragic reading of politics, Londres, Routledge, 2022
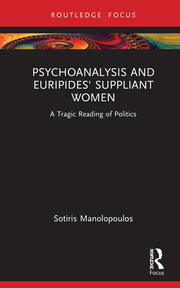 Sotiris Manolopoulos est un psychanalyste grec dont la pensée psychanalytique intègre, dans ses différents écrits, la mythologie, la littérature, les arts, et plus récemment le politique au sens large du terme, le tout dans un langage à la fois rigoureux et poétique, apte à tresser ensemble ces différents paramètres. C’est ce dont témoigne son plus récent ouvrage, paru en anglais, sur les Suppliantes d’Euripide.
Sotiris Manolopoulos est un psychanalyste grec dont la pensée psychanalytique intègre, dans ses différents écrits, la mythologie, la littérature, les arts, et plus récemment le politique au sens large du terme, le tout dans un langage à la fois rigoureux et poétique, apte à tresser ensemble ces différents paramètres. C’est ce dont témoigne son plus récent ouvrage, paru en anglais, sur les Suppliantes d’Euripide.
Le fonctionnement de l’appareil psychique, de l’inconscient dynamique et non dynamique, avec les dimensions des réalités interne et externe, des processus temporels (passé et présent), du deuil, des clivages, des fonctionnements en masculin/féminin, se croisent de façon stimulante dans cette tragédie d’Euripide à travers la lecture proposée par Manolopoulos, sans oublier des éléments issus de l’histoire bien sûr, mais aussi de la culture, de la politique, des institutions et structures de l’État et ses différents modes de gouvernance, et aussi avec les questions soulevées par la démocratie, la tyrannie et la guerre. Il s’agit de problématiques à la fois diachroniques et contemporaines (les guerres, les pandémies…). C’est un kaléidoscope unique que nous propose cette tragédie d’Euripide, qui se déroule dans le cadre du temple de la déesse Déméter (la déesse Cérès de la mythologie romaine, protectrice de l’agriculture, des moissons et de la fertilité), à Éleusis, ville à quelques dizaines de kilomètres d’Athènes, célèbre dans toute l’antiquité pour ses « mystères », un culte ésotérique très influent dans le monde antique. Les mères et les épouses des combattants originaires de la ville d’Argos, morts lors de l’expédition de sept chefs contre Thèbes, dans le cadre de la succession au trône de Thèbes, composent le chœur de cette tragédie. Elles supplient (Suppliantes) le roi d’Athènes Thésée pour l’inhumation de leurs hommes, question politique, culturelle et humaine, qui est le point de départ de l’ouvrage de Manolopoulos.
L’ouvrage est composé de six chapitres. Dans le premier, intitulé The Plot (L’intrigue), l’auteur nous fait suivre les méandres de la tragédie en nous introduisant dans ses ressorts inconscients à travers le personnage (et l’identité) de la déesse Déméter. Déméter est la déesse de la terre, à partir de laquelle émerge la vie, mais qui, dans ses obscures profondeurs, accueille aussi les morts et leurs secrets. L’auteur y voit une distinction entre inconscient dynamique et non dynamique. Son nom lui-même, Demeter, signifie Mère et Terre. Dans la pièce, les Athéniens sont qualifiés d’« autochtones », c’est-à-dire des êtres locaux, nés sur et dans cette terre. L’objet se forme dans la fusion symbiotique, et la perte de la toute-puissance, suite à la séparation, devient marqueur d’avenir. À travers le personnage de Æthra, mère de Thésée, qui fait preuve de compassion à l’égard des suppliantes, nous suivons le cheminement des processus inconscients, alors que des « mystères », des éléments surnaturels, sont en train de se libérer : émergence d’un matériel refoulé ou clivé ? Cependant – et c’est une nouveauté introduite par Euripide – il y a une nécessité de guerre, et cette dernière apparaît au-devant de la scène. Le déchaînement des passions, envisagées du point de vue de la deuxième théorie des pulsions, conduit à des relations de collage passionnel qui culminent dans l’union avec le divin dans le suicide d’Evadné, rendue folle par la mort de son mari (encore une nouveauté dans le mythe, introduite par Euripide).
Dans le deuxième chapitre, qui traite de la « position tragique », la mise à l’épreuve contemporaine de l’homme sous forme de pandémie est anticipée par Euripide comme une forme d’angoisse-signal d’alarme. La ville d’Athènes souffre de ce traumatisme de masse, une pandémie destructrice qui agit comme une rupture de continuité de civilisation. Mais là apparaît le paradoxe. L’épidémie ne mobilise pas des angoisses de castration liées à la force supérieure de la nature ; l’individu se sent dévasté, écrasé, mais en même temps éprouve des vécus d’élévation et d’élation. Quelque chose dans le vécu de passivité se mue en répétition active. Il est vrai que la menace qui plane sur la vie laisse peu d’espace au deuil, dans la mesure où le traumatisme précoce se réactive sans cesse. Ainsi les hommes perdent la possibilité de devenir des sujets de l’expérience du temps, ils perdent le sens tragique de la passagèreté.
Euripide présente la démocratie comme blessée gravement, mais pas de façon irréversible, par les pandémies. Elle conserve sa cohésion, au moment où la cité (polis) et ses citoyens éprouvent le besoin de partager une illusion d’immortalité comme défense contre les menaces de la réalité. Le drame – tout comme la démocratie – se réfugie dans l’arrogance de la toute-puissance, qui supprime limites et différences. Toutefois, à travers cette indifférenciation même, va émerger une certaine relation à l’objet. Car la capacité à devenir sujet tragique impose la distinction entre réalité interne et externe et l’entrée dans l’espace des phénomènes transitionnels, espace ayant la vertu de gérer le choc de la perte de l’omnipotence.
Euripide propose deux remèdes face à la douleur. D’une part, le temps atténue la douleur, de l’autre, les passions ne sont jamais éternelles. Hélas, le temps qui passe et l’oubli s’avèrent de bien piètres consolations. Le remède qui agit dans la durée pour soulager la douleur et la mort est le souvenir, la remémoration, sous peine que l’être humain soit livré aux tourments de fantômes éternels. À travers la crise – politique, sanitaire, mais aussi éventuellement individuelle – la mémoire devient souvenir. Le mythe garde en noyau une vérité historique qui permet de vivre le souvenir comme un événement réel, en chair et en os, qui a réellement eu lieu. C’est sur elle que va s’appuyer la vérité narrative – le « sujet parlant et agissant », dit l’auteur – qui permettra au vécu de devenir souvenir.
Face à l’intellectualisation et la rationalisation d’un côté, à la passion et à la confusion de l’autre, le divin oppose la sagesse et l’interprétation à travers le langage, elle-même espace intermédiaire entre sujet et objet. Quelles sont les limites de résistance d’une cité (polis) ? Jusqu’à quel point elle peut supporter le non-sens, le non-représenté, l’irreprésentable ? Quelle est la limite des capacités à supporter l’impensable, la « terreur sans nom » ? Rien ne sera achevé s’il ne passe pas par le langage, écrit Euripide au début de la pièce ; c’est la même chose pour le deuil, et Thésée invite Adraste à prononcer un discours funèbre « au bénéfice de la culture des plus jeunes ».
Euripide met en évidence les deux aspects du fonctionnement de la cité, de la culture. Les citoyens sont libres de s’orienter vers l’individualisation, la séparation, le deuil, l’autonomie, mais à la condition d’avoir intériorisé la crainte du pouvoir parental et les règles (surmoi fonctionnel). L’auteur intègre les points de vue d’Aulagnier sur le « contrat narcissique » à partir de la théorie freudienne du narcissisme, ainsi que ceux de Castoriadis et Kaës. L’hubris est une défense arrogante face à l’angoisse de désorganisation, et guette les mouvements vers toute nouvelle intégration. Euripide décrit le conflit au niveau des parents, qui doit conduire à l’élection d’un nouveau leader et d’une nouvelle version de l’histoire. L’intrigue des Suppliantes est tragique, elle illustre la bataille pour la conquête de l’organisation œdipienne. L’œuvre se termine par l’assomption, de la part des fils, de la culpabilité pour la mort des pères.
Le deuil non résolu, qui fait l’objet du troisième chapitre, peut être considéré comme le noyau des conflits politiques et des guerres à venir. Les Suppliantes transportent le théâtre à l’agora, dans un espace où s’expriment les passions, et où les oppositions apparaissent à l’avant de la scène. La reconnaissance des limites de l’omnipotence fait de la démocratie un régime tragique. Or le deuil ne peut avoir lieu tant que les dépouilles des morts ne seront pas enterrées : c’est ce que demandent les Suppliantes. En même temps, la mort réelle n’est pas considérée comme ayant eu lieu tant que l’on ne trouve pas un sujet à même d’assumer la culpabilité pour cette mort – sinon, la mélancolie guette, et le poids du traumatique reste impossible à métaboliser. Le « poids du monde », écrit Manolopoulos. C’est en vain que les Suppliantes invoquent la paix, les mères des morts refusent, et rien dans le discours funèbre d’Adraste ne peut dédommager de la mort de leurs enfants. Le travail du deuil conduit vers l’avenir, et dans le cas contraire, nous entrons dans la compulsion des répétitions interminables, une inefficiente éternité. Nous sommes là dans la seule dimension du temps linéaire.
Le mythe des Suppliantes, comme celui d’Œdipe, nous montre l’évolution et la structuration du monde du politique. Œdipe, poussé par l’épidémie qui frappe Thèbes, commence à en chercher les causes, et finit par se tourner vers l’intérieur de son psychisme ; il est appelé à découvrir et à intérioriser les fantasmes de toute-puissance, de bisexualité psychique et, en définitive, de maîtrise des pulsions. Il devient ainsi un sujet politique tragique. En revanche, le travail de deuil fait de nous membre à part entière de la vie en société.
Le noyau féminin chez les hommes comme chez les femmes (la position féminine-passive) fait l’objet des développements de l’auteur dans le quatrième chapitre. Les hommes ont beau dominer la scène politique, ce sont les femmes qui interviennent dans les moments critiques de l’intrigue. Nous abordons ici l’angoisse de castration et le « roc » de la féminité-passivité, tels qu’étudiés par Freud, puis Winnicott. Dans l’œuvre d’Euripide, la présence/absence, le silence/parole des femmes s’expriment à travers le rôle actif joué par le Chœur. Nous savons que le couple activité-passivité, tout comme la bisexualité, caractérise les deux sexes. Le refus de la position féminine-passive conduit les hommes à ne pas reculer dans la guerre. Alors que Thésée interdit aux mères de toucher les corps des morts, Evadné s’unit au corps mort de son mari.
Dans Les Suppliantes, derrière la scène, existe un espace éloigné que le spectateur ne peut apercevoir. C’est l’inconnue de l’intérieur du corps de la mère, avec ses contenus mystérieux et mystiques ; un ombilic qui conduit à l’inconnu (l’ombilic du rêve, selon Freud), un corps rempli de bébés et du pénis (Klein).
Le rôle du leader est de domestiquer ces forces surnaturelles cachées dans l’inconnu. Le problème est l’infini du processus, et le risque d’une stase dont toute créativité serait bannie. L’impossibilité des leaders à se laisser fertiliser par de nouvelles idées conduit au populisme et au totalitarisme.
Que signifie le fait d’être libre ? Les identifications féminines secondaires s’avèrent les plus compliquées. L’enjeu est le sacrifice, le deuil de l’omnipotence, l’ordre symbolique de la castration, l’acceptation de la différence des sexes et des générations, la coexistence harmonieuse d’éléments masculins et féminins (et non pas leur clivage, qui conduirait à des états paranoïdes). La non-acceptation de la coexistence, conflictuelle et névrotique, de la réalité interne, psychique, et de la réalité externe (la société) est un enjeu crucial pour le politique. Deux divinités, Déméter, déesse de la fertilité, et Athéna, déesse de la sagesse, du discours politique et de la guerre, risquent de s’avérer incompatibles entre elles. Les Suppliantes sont des mères. Pourquoi feraient-elles des enfants, si c’est pour les envoyer se faire tuer dans les guerres ? L’accouchement est douloureux aussi bien pour la mère que pour l’enfant, et les hommes deviennent des femmes lorsque la douleur du soldat blessé se rapproche de celle de l’accouchement.
L’intrigue se termine dans des négociations politiques basées sur la parole, et se prolongeant dans la mythologie, la religion et les serments (cinquième chapitre). Noyau de toutes choses, la relation mère-bébé est la trace qui s’oppose à la mort. Euripide ne propose pas de solutions. Mais il pointe que les différends non résolus du passé deviennent la cause des processus ultérieurs. Ils sont aussi cause à la fois de peur et de contrainte : retour donc au passé, via la contrainte de répétition. Athéna parachève l’œuvre en donnant un certain nombre d’instructions arbitraires. Les mots des processus secondaires, des négociations et des pactes ont besoin d’être consolidés par des actes magiques, puisant dans leurs sources primitives somatopsychiques, au-delà ou en deçà du sens. Euripide le poète devient prophète. Le mot-clé est la négociation, seul moyen pour que le clivé devienne doute, hésitation, incertitude, espace transitionnel, et pour que les frontières deviennent des zones de communication et de relation réciproque – l’équivalent de la relation intérieur-extérieur qu’assure le préconscient.
C’est ainsi que nous découvrons la fonction du négatif. Les Athéniens défendent les lois et les institutions, et la peur de la disparition, de la chute dans l’abysse – le négatif absolu – se positive à travers des fantasmes terrifiants (Amphiaraos avalé par la terre).
Manolopoulos montre dans son ouvrage que pour nous, spectateurs, les mouvements imprimés par les passions et les conflits de l’intrigue se transforment en processus ouvert : passer de la tragédie au tragique, part de tout humain, et de la politique au politique. Le tragique et le politique renvoient à l’objet analytique, une entité qui n’est ni d’un côté ni de l’autre, mais dans l’espace entre-deux. La tragédie comme la psychanalyse sont en relation avec le politique, en d’autres termes, avec la lutte des humains pour exister ensemble dans le monde. « Je pense », écrit Manolopoulos dans le sixième et dernier chapitre, intitulé « Un pré-texte de théorie politique », « que nous, spectateurs contemporains de la pièce d’Euripide, sommes l’avenir de cette œuvre politique ».
Vassilis Dimopoulos est psychiatre, psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société hellénique de Psychanalyse.
Patrick Merot, La croyance et le doute. De Sigmund Freud à Charles Sanders, Paris, Ithaque, 2023
 Voilà un livre des plus stimulants ; il ne peut laisser personne indifférent − d’abord parce que nul n’échappe aux croyances. Patrick Merot part de ce constat : La croyance est partout, « elle infiltre la moindre de nos pensées, le moindre de nos comportements, de nos actes. Elle fonde nos idéologies, nos engagements politiques. Les formes de pensée les plus rationnelles et la pensée scientifique elle-même ne sont pas indemnes du processus de croyance ». Ensuite, parce qu’au-delà de toutes les bonnes raisons dont elles se réclament, au-delà des valeurs, des idéaux projetés sur le futur ou des fidélités qu’elles invoquent, au-delà des arguments d’autorité sur lesquels elles s’appuient dans le champ de la connaissance, nos croyances répondraient pour l’essentiel – c’est le thème central de cet ouvrage − à des exigences basiques, élémentaires, d’ordre économique et que l’on pourrait qualifier comme relevant somme toute de la loi du moindre effort : « principe d’inertie » dans la terminologie freudienne.
Voilà un livre des plus stimulants ; il ne peut laisser personne indifférent − d’abord parce que nul n’échappe aux croyances. Patrick Merot part de ce constat : La croyance est partout, « elle infiltre la moindre de nos pensées, le moindre de nos comportements, de nos actes. Elle fonde nos idéologies, nos engagements politiques. Les formes de pensée les plus rationnelles et la pensée scientifique elle-même ne sont pas indemnes du processus de croyance ». Ensuite, parce qu’au-delà de toutes les bonnes raisons dont elles se réclament, au-delà des valeurs, des idéaux projetés sur le futur ou des fidélités qu’elles invoquent, au-delà des arguments d’autorité sur lesquels elles s’appuient dans le champ de la connaissance, nos croyances répondraient pour l’essentiel – c’est le thème central de cet ouvrage − à des exigences basiques, élémentaires, d’ordre économique et que l’on pourrait qualifier comme relevant somme toute de la loi du moindre effort : « principe d’inertie » dans la terminologie freudienne.
Ce qui fait la force de nos croyances, aux yeux de l’auteur, ce qui leur permet de tenir contre les vents et marées de la critique − toujours facile à déjouer, croyance contre croyance − c’est qu’elles donnent réponse à nos questions, elles nous laissent en paix, au repos, tandis que le doute, au contraire, lorsqu’il réussit à faire céder nos lignes de défense, nous oblige à mobiliser toutes les ressources dont nous disposons pour palier l’angoisse, tenter de retrouver une stabilité, échapper aux questions qui nous torturent l’esprit, nous mettent en cause, nous laissent face au vide ou à la complexité. Le travail, coûteux en énergie, auquel nous ne pouvons alors échapper pour revenir sur le terrain ferme de convictions solidement établies, est celui de la pensée, à la fois réflexive et tournée vers la réalité extérieure. La dialectique entre « activité de croire » et « activité de penser » est au cœur de cet ouvrage dont l’enjeu le plus profond ne tarde pas à se dégager comme étant celui du rapport de vérité que le sujet entretient − ou pas − avec lui-même : point d’incidence de la psychanalyse.
Dans un style limpide et précis, Patrick Merot, qui travaille depuis de nombreuses années sur ce thème de la croyance, nous fait partager son intérêt pour une découverte inattendue à ce sujet : celle des travaux d’un chercheur américain, Charles Sanders Peirce, plutôt identifié dans la communauté scientifique comme linguiste, et dont les réflexions originales portant sur la croyance sont beaucoup moins connues. Or elles ne présentent pas seulement des points de convergence surprenants avec les recherches de Freud (dont il n’eut manifestement pas connaissance, bien qu’ayant vécu à la même époque), mais la confrontation de leurs approches respectives permet de pousser plus loin l’analyse du phénomène sur un terrain qui est pour nous aujourd’hui d’une brûlante actualité.
L’empire des croyances sur l’esprit humain, et par voie de conséquence sur le comportement des groupes et des individus, cette combinaison d’impuissance (réelle) et de toute-puissance (imaginaire), n’est certes pas un fait nouveau. Ce phénomène est de tout temps avec sa double valence de « servitude volontaire » et de militantisme, lequel fait rarement défaut, tant il est avéré que croire c’est aussi vouloir imposer sa croyance aux autres. L’histoire retient de ce prosélytisme les formes les plus violentes, et les plus terrifiantes, qui ressurgissent périodiquement, en lien, notamment, avec la montée en puissance de fanatismes religieux ou la résurgence de fascismes politiques. Mais l’emprise s’exerce souvent de façon plus individualisée, feutrée, insidieuse, sous couvert d’une aspiration au « bien », au « vrai », en invoquant sans crainte des paradoxes, la « liberté » individuelle à l’encontre des idées reçues, toutes choses contre lesquelles il serait par là même difficile de s’ériger ; d’autant que s’y ajoute un crédit de reconnaissance personnelle au sein des communautés d’adoption qui s’en réclament. Il reste qu’aujourd’hui ce besoin de croire (et de faire croire) prend une tournure singulière à l’ère des influenceurs, des guérisseurs en tout genre, des porteurs de « vérités » prétendument novatrices qui se déploient sans entraves sur le terrain laissé vacant, dans les sociétés occidentales, par l’effondrement de croyances traditionnelles et la faillite d’utopies collectives qui, pour avoir engendré le pire, ont laissé leurs émules abasourdis – sans les priver pour autant de leurs admirables capacités de « résilience », car il y a toujours, par gros temps, un refuge, un port de plaisance où jeter les amarres. Une croyance cède le pas à une autre. L’extraordinaire développement des réseaux de communication y contribue de façon inédite, livrant les plus fragiles, notamment à l’adolescence où s’effectue la transition entre la dépendance infantile et le désir d’autonomie, au pouvoir de marchands d’illusions qui les écartent de la réalité, la leur autant que celle des autres, en leur faisant croire que rien ne doit venir entraver une prétendue « liberté » personnelle fondée sur le « ressenti », dans une méconnaissance absolue des obscures déterminations auxquelles chacun peut obéir sans en avoir conscience. L’appauvrissement du débat scientifique en certains domaines, au bénéfice d’une idéologisation de données parcellaires, prises pour le tout, contribue à faire fructifier ce marché. Le champ de recherches portant sur la psyché est loin d’y échapper. C’est même une cible privilégiée pour qui préfère s’en tenir à la prise en compte des données les plus facilement accessibles et qui dispensent d’avoir à penser.
Mais le travail de Patrick Merot n’a pas pour objectif de passer en revue les contenus de telles ou telles croyances, même s’il consacre d’amples développements à deux phénomènes particulièrement significatifs dont l’un est aussi vieux que l’apparition parmi les vivants d’une capacité réflexive sur la précarité de l’existence (croyance en la survie) tandis que l’autre nous renvoie à une actualité sociétale florissante, celle du complotisme qui poursuit avec passion le « diable » sur le terrain déserté par les pouvoirs divins. On laissera aux lecteurs le plaisir de découvrir ces approches pénétrantes qui, partant de ces exemples, cherchent à en repérer les ressorts inoxydables.
C’est en effet au « besoin de croire » dans ce qu’il a d’universel et de multifocal que Patrick Merot s’intéresse. On observera notamment que le fait religieux − auquel il avait consacré en 2014 une passionnante étude sous le titre Dieu la mère, traces du maternel dans le religieux − ce phénomène, qui reste omniprésent de par le monde, n’est plus au centre de sa recherche. Il n’en garde pas moins à ses yeux une valeur paradigmatique. En particulier, la mise en relation de l’expérience mystique avec la béatitude des liens fusionnels primitifs unissant le bébé à sa mère donne chair à la sérénité, la tranquillité, le repos auxquels toute croyance aspire. Ce qui renvoie à la question des origines.
Pour mémoire, Freud rapporte à une phase très précoce du développement la différenciation entre deux systèmes perçus comme archétypes du « croire » et du « penser », le passage du premier au second faisant intervenir une expérience cruciale qui est celle du manque. Lorsqu’il survient sous l’effet des inévitables (et nécessaires) défections de qui remplit la fonction maternelle, l’enfant est amené à contre-investir les satisfactions hallucinatoires qui lui permettaient de supporter provisoirement l’attente, au bénéfice de potentialités nouvelles qui sont celles de la pensée en prise sur la réalité, préludant à la capacité d’agir sur l’environnement. L’hallucinatoire trouvera refuge dans l’activité onirique qui exclut toute activité réflexive, le rêveur prenant ce qu’il imagine pour la réalité. De ce point de vue le rêve pourrait être considéré comme pur modèle de croyance.
Mais dans tous les domaines, et tout au long de notre existence, la tension entre les deux systèmes ne cessera pas de s’exercer lorsque le doute, qui remplit la même fonction que le manque aux origines, vient ébranler nos certitudes. Là se trouvent les points de convergence entre Freud et Peirce.
Freud fait de cette aspiration à réduire les tensions qui nous mettent à l’épreuve un facteur essentiel d’équilibre, gouvernant le cours des évènements psychiques. Ce qu’il a d’abord assimilé au principe physique d’inertie devient chez lui, par la suite, principe de plaisir, au sens de la satisfaction obtenue lorsque sont retombées lesdites tensions, sources, en tant que telles, de déplaisir. Figure de béatitude qu’il associera plus tard au « Nirvana » sans en masquer le potentiel mortifère.
Peirce ne navigue pas dans les mêmes eaux que Freud ; son approche est phénoménologique, mais la fonction qu’il attribue au doute est la même, faisant du contre-investissement des illusions, au bénéfice de l’examen de réalité, la condition d’une action efficace. Il n’est pas sans intérêt de noter à ce propos qu’il fut aussi le théoricien fondateur du pragmatisme, doctrine qui associe la vérité à l’efficacité. La façon dont il déplie les articulations entre croyance et action, de même qu’entre croyance et pensée, introduit cependant un décalage par rapport au modèle freudien, et permet quelques avancées.
– En premier lieu, il montre comment cette dialectique entre le « croire » et « penser » s’inscrit dans un parcours en boucle. Au circuit court de la crédulité naïve, boucle la plus économe qui dispense d’avoir à se poser des questions, viendrait simplement se substituer, sous l’effet du doute, un circuit long mettant la pensée au travail, mais pour en faire l’instrument d’une reconversion. Le travail de pensée n’a qu’une fonction de relai entre deux croyances ; « Produire la croyance, écrit-il, est la seule fonction de la pensée. »
– Deuxième observation : Peirce insiste sur le fait que le temps de la pensée n’est pas celui de l’action ; c’est celui d’une mise en suspens interrogative et réflexive. Le doute mobilise la psychè mais paralyse l’action motrice, et c’est seulement lorsqu’une nouvelle croyance se sera affirmée que le sujet se mettra en mouvement. À l’encontre de ce que pouvait suggérer le principe d’inertie, c’est donc la croyance qui fait agir.
Ces approches ont l’intérêt de lever quelques malentendus potentiels. La croyance, lorsqu’elle vient clore tout effort réflexif, constitue par là même un facteur d’inertie psychique, mais il serait difficile de prétendre pour autant que les croyants soient des êtres passifs, inertes et « décérébrés »… D’abord, parce que ce sont au contraire leurs croyances qui suscitent leurs engagements et chacun sait quelle énergie les êtres humains sont capables de déployer au service de ce à quoi ils croient, de leurs amours – fussent-ils aveugles –, des valeurs auxquelles ils adhèrent, des idéaux qui les animent et pour lesquels ils se dépensent sans compter. Ensuite, parce que si les fermes convictions apportent le repos, l’activité intellectuelle de ceux qui croient en quelque chose reste, en bien des domaines, très impressionnante ; ils sont loin d’être tous des « ravis » ou des paranoïaques. Ce qui vient dénoncer l’écart entre le concept de croyance et le vécu des croyants, c’est que d’un point de vue existentiel le circuit décrit par Peirce est sans cesse en action. Il l’est à la façon même dont le moi – et ses idéaux – renaissent constamment d’un affrontement entre les exigences pulsionnelles du ça et la réalité du monde. Mais cette approche se situe au-delà du principe de plaisir.
Deux remarques à partir de là :
– Du point de vue cognitif (terrain de rencontre entre Freud et Peirce), on oppose communément la croyance-conviction qui exclut le doute, se réclamant du vrai, à la croyance-hypothèse, qui se réclame seulement du vraisemblable. (Si je dis croire à la validité d’un témoignage, c’est que je n’en suis pas sûr.) Patrick Merot écarte cela de son propos, car c’est la croyance-conviction qu’il a en vue, tandis que la croyance-hypothèse, liée au doute, relève, en tant que telle de la pensée. L’évocation de l’espace transitionnel dont Winnicott fait le berceau de l’expérience culturelle ne peut cependant manquer de venir à l’esprit du lecteur pour évoquer le vaste champ d’expériences intermédiaires entre le subjectif et l’objectif. Difficile de s’en tenir à une opposition tranchée entre croyances-convictions et simples présomptions, car dans cette forme de clivage c’est le procès de l’imaginaire qui est instruit dans son rapport à la vérité. Et la question se pose dans tous les domaines. Si la dimension imaginaire peut être stigmatisée comme monde des chimères, lequel ne trouverait à se déployer de façon créative que dans le champ artistique, il n’en est pas moins un chemin de connaissance tourné vers la réalité. Les scientifiques en témoignent mieux que quiconque. Opposer le « croire » et le « penser », dans ce qui fait leur spécificité est une chose, mais s’interroger sur la façon dont ces modalités de fonctionnement psychique, plutôt que d’entrer en conflit peuvent conjuguer leurs potentialités dans l’appréhension objective de la réalité ne présente pas moins d’intérêt.
– Le choix ayant été fait d’étudier le mécanisme des croyances d’un point de vue cognitif indépendamment des contenus dont elles se saisissent, des objets qu’elles investissent, la force d’attraction, voire de fascination que ces derniers exercent sur nous, en réponse à nos fantasmes, est alors provisoirement laissée de côté. Mais dans un chapitre essentiel intitulé « Vérité, croyance et guérison », où la question de la croyance est rapportée à son enjeu, qui est celui de la vérité, et à la façon dont il sous-tend l’entreprise analytique, cette dimension du désir, de l’investissement pulsionnel, revient au premier plan. De quelle vérité, en effet, est-il alors question ? La cure aurait-elle pour but de délivrer le patient de ses illusions, d’accepter la déconstruction de ses croyances ? C’est assurément ce que l’on peut en attendre, avec le gain de liberté qui en résulte, mais de façon indirecte, et les réflexions de l’auteur sur la fameuse « guérison par surcroît » sont à ce sujet très significatives. La vérité que l’analyse poursuit, avec les moyens qui lui sont propres, est la vérité du sujet par rapport à lui-même, à ce qui détermine obscurément ses actes, ses croyances, ses pensées. Loin d’écarter les fantasmes, l’analyse cherche à en favoriser l’expression pour reconnaître les « morceaux de vérité », comme dit Freud, qu’inconsciemment ils véhiculent et réactualisent dans le transfert. Sa méthode n’est pas celle d’un travail intellectuel (plus souvent mis au service des résistances) ; la méthode est celle des « libres associations » fondées sur l’imaginaire comme sur le jeu des signifiants. Patrick Merot reprend à ce sujet les notions de « réalité psychique », aussi prégnante que la réalité matérielle, et de « vérité historique », celle que le sujet construit. Il s’engage aussi, sur cette base, dans un débat virtuel qui est du plus grand intérêt avec Michel Foucault, à propos des critiques que ce dernier adressait à la psychanalyse concernant la vérité.
Nul doute (!) qu’en suivant Patrick Merot dans le travail de pensée auquel son ouvrage convie le lecteur, ce dernier fera l’expérience inverse de celle qui est décrite comme un pénible labeur opposé à la douceur de vivre à laquelle on accède quand on ne se pose plus de questions… Mais c’est qu’il y a aussi un plaisir de penser. Un plaisir dont l’auteur n’est certes pas avare et qu’il a la générosité de nous faire partager.
Bernard de La Gorce est psychanalyste.
Syrine Slim, L’affaire Abraham et Torok. Légendes, vie et secrets, Paris, Puf, 2021
 Lorsque Syrine Slim m’a demandé à accéder aux archives de la SPP pour sa recherche sur Nicolas Abraham et Maria Torok – j’en étais en effet à l’époque le président – j’ai hésité. Son sujet était le lien entre l’œuvre et la problématique de la vie personnelle des psychanalystes. Thème tout à fait pertinent. On ne s’est d’ailleurs pas privé d’appliquer à Freud lui-même sa méthode d’investigation, comme ont pu le faire Didier Anzieu ou Jean Guillaumin. Ce dernier par exemple attribuant l’invention de la pulsion de mort aux deuils ayant frappé Freud – opinion que je ne partage pas, pensant plutôt aux effets du spectacle de l’autodestruction de l’Europe civilisée lors de la Première Guerre mondiale[1]. Maria Torok, elle aussi pensait ainsi que « […] une catastrophe familiale [un oncle faussaire], survenue lorsque Freud avait neuf ans, se tient à la base de sa théorie psychanalytique » (Rand, Torok, 1998, p. 184). L’hypothèse que Syrine Slim confirme dans son livre est que cette intuition peut être appliquée aux propres théorisations de Maria Torok avec Nicolas Abraham… « et que la théorie freudienne est devenue pour elle l’autre scène sur laquelle a pu se poursuivre ce qui restait encrypté en elle et Abraham » (p. 12).
Lorsque Syrine Slim m’a demandé à accéder aux archives de la SPP pour sa recherche sur Nicolas Abraham et Maria Torok – j’en étais en effet à l’époque le président – j’ai hésité. Son sujet était le lien entre l’œuvre et la problématique de la vie personnelle des psychanalystes. Thème tout à fait pertinent. On ne s’est d’ailleurs pas privé d’appliquer à Freud lui-même sa méthode d’investigation, comme ont pu le faire Didier Anzieu ou Jean Guillaumin. Ce dernier par exemple attribuant l’invention de la pulsion de mort aux deuils ayant frappé Freud – opinion que je ne partage pas, pensant plutôt aux effets du spectacle de l’autodestruction de l’Europe civilisée lors de la Première Guerre mondiale[1]. Maria Torok, elle aussi pensait ainsi que « […] une catastrophe familiale [un oncle faussaire], survenue lorsque Freud avait neuf ans, se tient à la base de sa théorie psychanalytique » (Rand, Torok, 1998, p. 184). L’hypothèse que Syrine Slim confirme dans son livre est que cette intuition peut être appliquée aux propres théorisations de Maria Torok avec Nicolas Abraham… « et que la théorie freudienne est devenue pour elle l’autre scène sur laquelle a pu se poursuivre ce qui restait encrypté en elle et Abraham » (p. 12).
Mais je me souvenais que la non-élection au titre de membre adhérent de Nicolas Abraham, suivie de sa mort de maladie, quelque temps après avait alimenté des rumeurs accusant la rigidité et le conservatisme attribués aux sociétés de l’Association Psychanalytique Internationale et en particulier la SPP d’avoir éliminé de la société un membre particulièrement original et créatif. Sa mort réelle ensuite apportant une dimension tragique. S’y ajoutait une ambiance d’obscurité, car, lors de l’élection, un membre s’y était opposé en raison d’une objection très sérieuse, mais qu’il ne pouvait révéler. La notion existait aussi d’une lettre écrite contre le candidat par son analyste, Béla Grunberger. Nicholas Rand, neveu d’Abraham, avait dénoncé ultérieurement des « irrégularités ». Dans quel esprit voulait-on rouvrir l’affaire ?
Nous avons reçu madame Slim avec Thierry Bokanowski, alors responsable du département des archives et choisi de lui faire confiance pour chercher une vérité historique.
Le résultat de son travail est passionnant et se lit comme un roman policier, avec un travail méticuleux d’enquête qui va aboutir à effectivement trouver un secret dans la vie de Nicolas Abraham et Maria Torok. Au passage, la SPP y est disculpée d’être meurtrière pour ses membres alors que les éléments évoqués ont bien existé, mais avec chacun une autre signification ou une autre temporalité. Syrine Slim détaille en décrivant le parcours analytique du couple la considérable évolution après-guerre de la formation des psychanalystes à la SPP et son éloignement progressif de la logique du modèle créé par Eitingon.
Mais le récit commence par la vie de Nicolas Abraham et Maria Torok, nés tous deux en Hongrie, en 1919 et 1925. Nicolas Abraham s’exile à Paris pour éviter le numerus clausus limitant le nombre des étudiants juifs en Hongrie en 1938. À la même époque, la famille de Marika Torok se convertit au catholicisme. Elle vivra l’occupation nazie de la Hongrie (en 1944) à Budapest « en permanent danger de mort », selon Nicholas Rand.
Étudiant en philosophie à Paris, Nicolas Abraham part en zone libre à Toulouse en 1940. Il y épousera en 1942 Etla Fryszman, une Polonaise. Un premier enfant, André, naît rapidement, suivi d’un second, Jean-Pierre, en 1944. Avec l’invasion de la zone libre, la famille doit se cacher le reste de la guerre. Nicolas Abraham apprendra l’extermination de presque toute sa famille hongroise. À cette époque semblent débuter les problèmes cardiaques de Nicolas – un rétrécissement mitral – et les problèmes psychiques graves de sa femme. Après la guerre et revenus à Paris, celle-ci sera hospitalisée en psychiatrie en 1946 puis internée avec un diagnostic de paranoïa. Plusieurs établissements se succédèrent. Le diagnostic devint celui de schizophrénie et elle fut transférée ensuite en province jusqu’à son décès en 2013. André se suicidera en 1971.
Le travail méticuleux de Syrine Slim qui contrôle toutes les informations est impressionnant en faisant apparaître toutes les imprécisions et les flous des biographies officielles proposées par Nicholas Rand, lequel a épousé secrètement Maria Torok après la mort de son oncle. Est-ce l’errance des transmissions orales ou en rapport avec ce qu’elle va découvrir : l’effacement progressif de l’existence de la première femme de Nicolas Abraham ?
Maria Torok arrive en France en 1947, s’inscrit à la Sorbonne et rencontre Nicolas Abraham en 1949. Sans suivre réellement une formation universitaire, selon l’auteure, elle va s’intéresser au Rorschach et faire une recherche à ce titre dans des classes de maternelle. Syrine Slim remet assez radicalement en cause la réalité des formations et de l’expérience professionnelle de Maria Torok auprès des enfants dont la dote la biographie de Nicholas Rand. Elle a commencé une psychanalyse avec Béla Grunberger. Il sera aussi l’analyste de Nicolas Abraham, sans que l’on sache quand a débuté l’analyse[2]. Après l’opposition de Grunberger à ce que l’analyse de Nicolas Abraham devienne didactique, celui-ci reprendra une analyse avec Serge Viderman.
Nicolas Abraham tient chez lui en 1959-60, rue Vézelay, des séminaires de psychologie phénoménologue qui ont un certain succès. Il se lie d’amitié avec Derrida qui apprécie sa pensée très originale « […] centrée autour de quelques mots-clés : la transphénoménologie, le symbole, l’anasémie, l’incorporation, l’écorce, le noyau et le fantôme », selon E. Roudinesco (1994, p. 601). Elle note qu’à la parution de Cryptonymie. Le Verbier de l’homme aux loups, préfacé par Derrida, l’année suivant la mort d’Abraham, Lacan montra publiquement son irritation devant l’intérêt rencontré (p. 603), ce que précise l’auteure. D’autres publications posthumes suivront : L’écorce et le noyau, en 1978, Jonas, en 1981, et Rythmes, en 1985. Son œuvre et celle de Maria Torok ont été prolongées par des continuateurs fidèles, dont Judith Dupont, Claude Nachin, Serge Tisseron et Pérel Wilgowicz. Certains collègues ont été choqués par la parution de l’enquête remettant en cause la probité de Nicolas Abraham et Maria Torok.
L’affaire institutionnelle
Syrine Slim précise des points importants pour des faits qui se déroulent pendant l’évolution de la formation à la SPP après-guerre. Les deux lettres écrites en 1958 et 1959 par Grunberger existent bien, mais ont été écrites bien avant le moment où Nicolas Abraham a demandé son affiliation à la Société psychanalytique de Paris et l’instauration à la même époque de la stricte non-intervention de l’analyste dans le cursus. Cette catégorie venait d’être créée en 1967 – en fait pour des raisons de représentation internationale – pour que soient pris en compte les élèves de l’Institut ayant terminé leur cursus, mais non encore élus membres adhérents en présentant un mémoire ou des travaux.
À l’époque où Abraham avait commencé son analyse avec Grunberger, celle-ci n’avait pas été validée comme didactique préparant à une formation. Dans la tradition Eitingon du reporting analyst, l’analyste devait à cette époque donner son accord pour la transformation d’une analyse thérapeutique en didactique. C’était donc la règle que Grunberger donne son avis et celui-ci était effectivement très fermement négatif. Il avait une bien meilleure opinion de Maria Torok. Dans l’évolution plus démocratique de la SPP, la société échappa à l’autorité unique du collège des titulaires[3] de l’Institut avec l’instauration de la catégorie des affiliés, élus également par les adhérents. Ainsi, malgré l’opposition ancienne de son psychanalyste, Nicolas Abraham put faire sa formation et devenir membre affilié de la SPP.
Lors du collège électoral au titre d’adhérent avec un rapport élogieux fait par Jacques Mynard, l’auteure révèle l’identité du membre adhérent qui s’opposa alors à l’élection de Nicolas Abraham. Il s’agit d’Henri Danon-Boileau – ce que m’avait confirmé Laurent Danon-Boileau. Celui-ci était pris dans un dilemme : analyste du plus jeune fils de Nicolas Abraham, il savait par son patient que ce dernier avait pris en analyse son propre fils aîné peu avant son suicide. C’était l’élément grave qu’il connaissait, mais qu’il ne pouvait pas révéler sans trahir la confidentialité due à son patient, explicitant donc que le secret était professionnel. L’éthique d’Henri Danon Boileau est indiscutable, et il a par exemple été un des rares analystes à proposer que les psychanalystes fixent un âge limite pour commencer de nouvelles cures afin de protéger les patients des risques de leurs défaillances ou disparitions[4]. Il avait commencé par s’appliquer cette règle à lui-même.
Mais surtout nous apprenons, ce qu’en revanche j’ignorais, que les articles avec des exemples cliniques présentés à l’appui de la candidature de Nicolas Abraham étaient tous cosignés de Maria Torok. Or il tombe sous le sens que le travail d’un analyste s’évalue sur sa pratique personnelle et Francis Pasche soulignera l’absence de mémoire clinique. Fain avec son humour habituel demanda si ne pas présenter un mémoire augmentait les chances d’avoir un rapport élogieux ! Se présenter sur travaux, ce qui était et est toujours possible suppose que ceux-ci comportent de la clinique personnelle. Le vote a finalement lieu : il est sans appel. Onze voix pour, quarante-cinq contre, deux blancs et huit abstentions. Il eut fallu les 2/3 des voix pour être élu.
Pour les psychanalystes qui en ont connu les protagonistes ou s’intéressent à la vie institutionnelle, le récit des débats est passionnant, entre les amis fidèles comme Barande qui défendent le candidat à tout prix, et ceux qui s’opposent en disant savoir pourquoi mais refusent aussi de le dire, arguant que le secret ne sera jamais tenu dans une assemblée si grande.
Les suites institutionnelles sont décrites, avec une demande ultérieure d’annulation du vote qui fut repoussée.
Questions
Des questions restent actuelles sur l’évaluation du travail d’un psychanalyste par ses collègues. Doit-on juger sur le travail écrit fourni et lui seul, sur la moralité du candidat, sur l’estime de ses collègues – ou leur amitié ?
Concernant Nicolas Abraham, et alors que ceux qui parlaient avec lui étaient certains de son expérience analytique, quelle était en réalité sa pratique clinique, quel que fût son génie théorisant ?
Syrine Slim fait une hypothèse sur le soulagement ressenti par Abraham lorsque René Major finit par lui montrer les lettres de son ancien psychanalyste, que Roudinesco pense lié à la preuve qu’il ne délirait pas. En observant que l’échec d’avoir sauvé son fils devait largement peser plus lourd face à la mort de son enfant, elle se demande aussi si le soulagement aurait été lié à ce que n’aurait pas dit Grunberger sur son patient, qui aurait pu craindre pire…
Nous laisserons le lecteur découvrir l’utilisation particulièrement signifiante que feront Nicolas Abraham et Maria Torok de l’argent versé par l’Allemagne à Etla Abraham au titre de victime des persécutions nazies, que son mari sut obtenir et s’approprier, après avoir fait la démarche pour eux deux. Ce faisant, Nicolas Abraham a indiscutablement spolié sa femme et son plus jeune fils au bénéfice de Maria Torok, comme son fils sera exclu par la suite des droits d’auteurs des livres de son père par Nicholas Rand. Il y a bien des fantômes.
L’auteure retrouve son point de départ et nous entraîne à la fin de l’ouvrage dans la théorisation du Verbier de l’homme aux loups, et explore le secret à l’œuvre dans la formation de la crypte, en particulier l’inceste frère-sœur – plus précisément sœur aînée-petit frère. Avec des extraits des correspondances entre Derrida, Sarah Kaufmann et Jean-Luc Nancy concernant la préface du premier au Verbier…, Fors, de soixante-dix pages et comme imprégnée du texte, elle interroge la part intime déniée dans toute théorisation psychanalytique – ou philosophique ? – mais montre aussi un Derrida comme sous emprise qui reconnaît qu’il a du mal à passer à une autre écriture et que malgré sa perplexité sur le fond « […] il est vrai que je trouve des cryptes et des fors partout chez Blanchot, maintenant » (p. 241).
Faut-il chercher la vérité ? J’avais parlé très agréablement avec Maria Torok lorsque j’avais recueilli son accord pour que la BNF numérise ses contributions à la Rfp. J’appréciais beaucoup son travail et avais découvert qu’elle connaissait le mien. Elle était en retrait, mais n’avait pas quitté la SPP. Ayant plus tard choisi Maladie du deuil et fantasme du cadavre exquis pour une sélection de grands articles pour les 80 ans de la Rfp, j’avais aussi à ce propos été en contact avec Nicholas Rand.
À moins d’adopter le point de vue de Michel Onfray destituant l’œuvre de Freud s’il a pu convoiter sa belle-sœur, il me semble essentiel de séparer l’œuvre et le jugement moral sur l’auteur. Les psychanalystes ont par définition eu besoin de se faire soigner. Mais ils ne sont pas les seuls à renier femme et enfants. Einstein a abandonné sa première femme et leur fils autiste. Je ne pense pas que cela modifie la pertinence de ses découvertes.
Il est sûr que la démarche impitoyable de l’auteure de recherche des faits n’épargne pas nos idéalisations – mais en cela elle fait œuvre utile –, et peut-être sous-estime-t-elle la trace traumatique des persécutions d’État dans le rapport à la loi de ceux qui les ont subies et ont parfois opéré des clivages de survie. Marika Torok dut changer de prénom et de religion à 13 ans. Nicolas Abraham était né l’année où la terreur blanche antisémite suivit la terreur rouge en Hongrie et avait perdu toute sa famille dans la Shoah. Relisant récemment le livre de Phyllis Grosskurth sur Melanie Klein, j’ai été à nouveau frappé par le poids pathologique de la relation entre Melanie Klein et sa mère, suivie à la génération d’après de la guerre avec sa fille Melitta, ainsi que de l’atmosphère incestueuse du lien avec son frère qui devait devenir médecin et mourut jeune de la tuberculose. L’auteure mentionne l’intérêt de Maria Torok pour cette question (p. 248). Melanie Klein elle aussi transformera la vérité historique pour effacer que sa première analyse d’enfant était celle de sa propre fille Melitta. À la fin de sa vie, elle écrivait au Premier ministre du Royaume pour demander à être reconnue comme… médecin. Non sans lien avec son œuvre…
Références bibliographiques
- Abraham N., Torok M. (1976). Le Verbier de l’Homme aux loups. Paris, Flammarion, 1976 ; Champs/Flammarion, 1999.
- Abraham N., Torok M. (1978). L’Écorce et le Noyau. Paris, Flammarion ; Champs/Flammarion, 1987.
- Abraham N. (1981). Jonas. Paris, Aubier-Flammarion.
- Abraham N. (1985). Rythmes. Paris, Aubier-Flammarion.
- Danon-Boileau H. (2010). Analyste terminé-analyste interminable. Rev Fr Psychanal 74(3).
- Derrida J. (1976). Fors, Les mots anglés de Nicolas Abraham et Maria Torok. Préface à Cryptonymie, le Verbier de l’Homme aux Loups. Paris, Flammarion.
- Rand N., Torok M. (1998). Questions à Freud : du devenir de la psychanalyse. Paris, Flammarion.
- Torok M. (1968). Maladie du deuil et fantasme du cadavre exquis. Rev Fr Psychanal 32(4).
- Roudinesco E. (1994). Histoire de la psychanalyse en France.2 1925-1985. Paris, Fayard.
- Denys Ribas est psychanalyse, membr de la SPP.
[1] Freud écrit à Eitingon le 18/7/1920 : « L’Au-delà est enfin terminé. Vous pouvez confirmer qu’il était à moitié achevé à l’époque où Sophie vivait et était florissante » (Max Schur. La mort dans la vie de Freud, p. 394).
[2] Ajoutant une dimension incestueuse à noter, la formation d’un couple entre analysés d’un même divan – frère et sœur de divan – a concerné d’autres analystes, favorisée par le petit nombre d’analystes didacticiens à l’époque.
[3] Les « titulaires » de l’époque était des formateurs élus à vie, membres de la Commission de l’Enseignement (CE), correspondant au statut international de didacticiens. Les anciens adhérents de l’époque sont maintenant appelés « titulaires » et certains d’entre eux sont élus à la fonction de formateur membre de la CE pour une durée de 7 ans, renouvelable, jusqu’à la limite de 78 ans.
[4] Psychanalyste terminé, psychanalyste interminable (2010).
Bernard Brusset, Psychanalyse et neurobiologie. L’actuelle croisée des chemins, Paris, Éditions In Press, 2022.
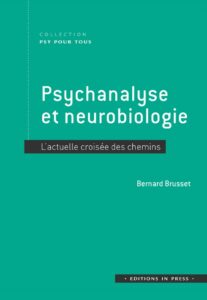 L’époque actuelle voit, en matière de recherche, une formidable expansion de ce que l’on appelle les neurosciences qui tentent l’établissement de ponts et la synthèse entre les sciences cognitives et l’étude des différents mécanismes et voies du système nerveux central, en particulier du cerveau. Mais ce faisant, la recherche plus spécifique en psychopathologie et en traitements biologiques psychiatriques semble passer au deuxième plan, du fait même que le projet des neurosciences correspond à une recherche fondamentale plus vaste. Et s’il y a des psychanalystes qui pensent pouvoir établir des liens entre ce projet de recherche et les fondamentaux de la métapsychologie – efforts dont témoigne le courant de la neuropsychanalyse –, il y a en revanche relativement peu de recherches sur les liens que l’on peut établir entre l’approche psychanalytique et les effets de la prescription des médicaments psychotropes, le type de relation qui s’établit entre thérapeute et patient en matière de soins psychiques (notamment à travers la notion de l’empathie), ou encore la question des émotions et des affects, centrale en psychanalyse, et leur traduction ou résonance au niveau du système nerveux central en particulier, du corps en général, en passant donc aussi par la problématique psychosomatique.
L’époque actuelle voit, en matière de recherche, une formidable expansion de ce que l’on appelle les neurosciences qui tentent l’établissement de ponts et la synthèse entre les sciences cognitives et l’étude des différents mécanismes et voies du système nerveux central, en particulier du cerveau. Mais ce faisant, la recherche plus spécifique en psychopathologie et en traitements biologiques psychiatriques semble passer au deuxième plan, du fait même que le projet des neurosciences correspond à une recherche fondamentale plus vaste. Et s’il y a des psychanalystes qui pensent pouvoir établir des liens entre ce projet de recherche et les fondamentaux de la métapsychologie – efforts dont témoigne le courant de la neuropsychanalyse –, il y a en revanche relativement peu de recherches sur les liens que l’on peut établir entre l’approche psychanalytique et les effets de la prescription des médicaments psychotropes, le type de relation qui s’établit entre thérapeute et patient en matière de soins psychiques (notamment à travers la notion de l’empathie), ou encore la question des émotions et des affects, centrale en psychanalyse, et leur traduction ou résonance au niveau du système nerveux central en particulier, du corps en général, en passant donc aussi par la problématique psychosomatique.
C’est à cette question que s’attèle le dernier livre de Bernard Brusset, Psychanalyse et neurobiologie, et nous noterons d’emblée qu’il utilise le terme de biologie, de neurobiologie, et non pas celui de sciences cognitives ou neurosciences, car, effectivement, la pensée psychanalytique peut trouver davantage d’interlocuteurs en croisant le chemin (pour paraphraser le sous-titre de l’ouvrage : « L’actuelle croisée des chemins ») des biologistes plutôt que des neuroscientifiques, même si évidemment des recoupements partiels avec les neurosciences sont nombreux.
Ainsi l’ouvrage est composé de quatre chapitres principaux. Le premier traite des liens entre la psychopathologie de la dépression et les médicaments antidépresseurs. Le deuxième examine une perspective, la psychosomatique, qui semble avoir traversé les époques et les différents courants de recherche biologique, sans jamais perdre de sa pertinence clinique empirique aux yeux des somaticiens. Le troisième examine plus spécifiquement le terme d’empathie, d’une part, parce qu’il fait débat au sein des pratiques psychanalytique et psychothérapique, d’autre part, parce qu’il s’agit effectivement d’une notion qui trouve des résonances en matière de neurobiologie. Enfin, le quatrième aborde la notion des émotions qui est l’un des rares concepts relatifs à l’affectivité qui est opérationnel en matière de recherches neurocognitives, et qui trouve une certaine parenté avec la pensée de Freud, même si le terme lui-même n’est pas devenu concept dans le corpus métapsychologique. Un dernier chapitre, tirant les conclusions de ces chemins croisés, décrit les défis de la situation présente pour ceux qui prônent, d’une façon ou d’une autre, le « soin psychique ».
La dépression, maladie du siècle selon une formulation de l’OMS, occupe le premier chapitre de l’ouvrage. Et déjà, une première question se pose : quelle dépression ? Celle qui se présente comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, avec toutes les apparences d’un brutal dérèglement de quelques humeurs cérébrales, ou au contraire la tristesse, qui peut être profonde, durable et suicidaire, éprouvée à la suite d’une perte qui bouleverse la vie de la personne, mais qui n’en est pas moins une cousine germaine du deuil ? Ou encore, cette dépression ou tristesse qui parfois accompagne toute la vie des personnes ayant vécu des pertes précoces, soit sous la forme d’une dépressivité chronique, soit sous la forme d’une potentialité dépressive qui les rattrape régulièrement au cours de leur existence ? Ou enfin, celle qui marque tout simplement le fait de grandir, cette série de pertes nécessaires qui accompagne autant de gains dans notre évolution psychosexuelle ? Et, dans cette grande variété clinique, quelles sont les parts respectives de la culpabilité et de la honte ?
Face à ces différentes dépressions, finement différenciées et décrites par de nombreux psychanalystes, une seule classe de médicaments : les antidépresseurs. Comment agissent-ils ? Et d’abord, méritent-ils leur nom d’« antidépresseurs » ? Ces produits chimiques qui combattent l’humeur dépressive seraient logiquement des euphorisants, à moins que leur effet soit plus souterrain, une action sur une inhibition généralisée des opérations cérébrales, effet donc sur le ralentissement idéique et moteur qui, au niveau de la description clinique et phénoménologique, n’apparaît que comme l’une des dimensions de la dépression, celle d’une réponse biologique. Ce premier chapitre traite de toutes ces questions, sans oublier les problèmes cliniques, techniques et éthiques que pose le développement d’un état dépressif en cours de traitement analytique ou psychothérapique.
L’objet du deuxième chapitre, la psychosomatique, a une longue histoire et, comme on le disait en préambule, a survécu aux progrès de la médecine au fil des décennies en tant que savoir empirique ou évidence clinique dont le maniement et la formalisation scientifique s’avèrent délicats. C’est probablement l’École française de psychosomatique qui a apporté les réponses les plus cohérentes et globales à ce qui semblait être un constat commun aux psychanalystes qui se sont intéressés aux maladies dites psychosomatiques, à savoir une certaine défaillance ou carence de l’expérience d’états affectifs et émotionnels chez les patients concernés (les émotions en tant que « chaînon manquant entre le somatique et le psychique », p. 45). Grâce au concept de pensée opératoire et de dépression essentielle, les psychosomaticiens français, dont Bernard Brusset expose les découvertes de façon claire et didactique, ont proposé une vaste synthèse qui permet de prolonger les élaborations freudiennes autour de la notion de l’affect et de ses destins. La notion d’alexithymie (littéralement, le manque de mots pour parler de la thymie, des affects), très familière aux psychanalystes de langue anglaise, trouve ici toute sa place en tant qu’opération défensive (plutôt que simple description clinique), dans une vision d’ensemble de l’économie pulsionnelle du sujet, en lien avec un certain travail du négatif, voire de la destructivité.
Comment aborder le terme désormais très courant d’empathie (Einfühlung, en allemand), littéralement : « ressentir de l’intérieur », donc l’action de se mettre à la place de l’autre ? Apparu en Allemagne sous la plume de psychologues et de philosophes à peu près à l’époque où Freud commence son parcours scientifique, et que Freud va utiliser à plusieurs reprises tout au long de son œuvre, sans jamais lui donner une valeur conceptuelle, il est controversé en psychanalyse. Nous rencontrons dans ce troisième chapitre les multiples ramifications d’une notion comme l’empathie, comportant la neurobiologie des neurones-miroir, les théories de l’esprit de la psychologie cognitive et des neurosciences sociales, mais aussi les notions de compassion, de tact et de contact développées par Ferenczi, souvent sous le regard dubitatif de Freud. Il est vrai que « la promotion de l’empathie se fait moins contre l’abus du pouvoir et de l’autorité de l’interprétation brutale que contre l’excès de réserve, de distance et de silence de l’analyste » (p. 64), ce qui, d’une part, peut conduire à des pratiques qui s’écartent d’une certaine déontologie psychothérapique, d’autre part, éloigne probablement le plan de la recherche. Il s’agit en effet d’un domaine au sujet duquel les psychanalystes pourraient dialoguer avec les neurobiologistes – à savoir les liens, déjà soulignés par Freud, de l’empathie avec les processus d’identification et leur intrication avec l’imitation. Au niveau de la pratique thérapeutique, Bernard Brusset montre que le terme d’empathie, étant le contraire de l’indifférence, n’est pas incompatible avec le terme de neutralité, notamment la neutralité comme absence de jugement. Par la suite, les travaux de Winnicott sur l’aire intermédiaire, de Green sur l’objet analytique, et de Ogden sur le tiers analytique montrent plutôt ce que l’empathie peut produire comme formations psychiques partagées, lorsqu’elle opère à l’intérieur d’un processus qui reste analytique. Dans ce même chapitre, l’auteur propose un récit de cure qui illustre les enjeux aussi bien de l’empathie que de la neutralité.
Le passage par l’empathie ouvre le chemin vers le quatrième chapitre du livre, traitant des émotions, que l’auteur place d’emblée au carrefour de « trois domaines d’appartenance : le physiologique (cardiaque, respiratoire, cutané, humoral, hormonal, métabolique, etc.), l’expérience corporelle sensible, et le psychisme comme sentiment et comme affect » (p. 91). Question donc extrêmement complexe, sans doute la plus complexe de celles que traite l’ouvrage, étant donné que les émotions apparaissent actuellement dans une multitude de champs de recherche hétérogènes. Bernard Brusset commence d’abord par la psychanalyse. La notion d’affect, que nous rencontrons chez Freud, sera progressivement modifiée et enrichie par les travaux de certains épigones, et l’auteur s’arrête assez longuement sur les travaux de Wilfred R. Bion. Ici, l’affect revient à ses sources sensorielles primaires, à ces sensations des premiers vécus somatopsychiques de l’expérience humaine, qui n’ont aucune chance de rencontrer des représentations, de connaître donc un destin de symbolisation et d’élaboration, s’ils ne passent pas par le laboratoire de traitement que représente la psyché maternelle. L’assimilation donc de ces expériences – le terme d’assimilation renvoyant déjà à la métaphore orale et digestive de ces opérations selon Bion – implique que leur métabolisme s’intrique avec celui de la mère, et plusieurs troubles mentaux, au premier rang desquels les différents états psychotiques, apparaissent avant tout comme des émotions restées à l’état brut, non « digérées ».
Or cette hypothèse concernant des émotions qui seraient restées à l’état brut, donc primitives, s’intrique forcément avec les travaux sur les émotions primaires, le terme de primaire étant ici entendu au sens de ces émotions de base que Darwin explorait déjà, et qui pourraient être identifiées, y compris par des voies cérébrales distinctes. Le chapitre débouche donc sur les travaux d’un chercheur comme Damasio, qui pourraient ne pas être très éloignés de l’hypothèse de Freud, selon laquelle nous posséderions un « patrimoine instinctif » qui serait proche des animaux. Nous entrons donc ici dans une logique « analogique », pour reprendre la distinction utilisée dans les théories dites computationnelles, en opposition à la logique « digitale », qui caractériserait le fonctionnement à base d’unités distinctes, comme les représentations (de chose ou de mot). Ce « cerveau émotionnel » bouleverse les causalités traditionnelles et notamment les termes dans lesquels elles s’affrontaient traditionnellement entre « organogenèse » et « psychogenèse » : « La causalité organique a produit un état psychique caractérisé à partir d’une émotion primaire, alors que la logique inverse est habituelle et peut faire illusion : des perceptions ou des pensées suscitent des émotions qui produisent des effets somatiques » (p. 102). Les causalités ascendante et descendante se combinent diversement. Les comportements addictifs entraînent des somatisations dont peuvent rendre compte les recherches neuropharmacologiques, comme l’ont montré les travaux de Jean-Pol Tassin (qui a aussi décrit les « bassins attracteurs analogiques » de la mémoire inconsciente).
Cette même approche analogique s’écarte d’un modèle du fonctionnement mental basé sur l’intelligence artificielle et se rapproche des théories connexionnistes et des modèles à base de probabilités, d’émergences et d’auto-organisation. Depuis un siècle, nous nous éloignons donc, en matière de fonctionnement cérébral et psychique, du modèle de la régulation (héritier de l’homéostasie de Cannon), Si celui-ci est toujours valable pour rendre compte d’un grand nombre d’opérations caractérisant le fonctionnement de l’organisme, il s’avère insuffisant dans le cas spécifique du cerveau et du psychisme.
Ce quatrième chapitre qui, on le voit, est d’une grande densité, consacre sa dernière partie aux sciences neurocognitives – qui font donc ici leur apparition dans l’ouvrage –, mais sous la forme de certains travaux, notamment français, sur l’« inconscient cognitif », enfin débarrassé, du moins partiellement, des obsessions localisatrices qui hantent la neurologie des fonctions supérieures depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Bernard Brusset discute les rapprochements et les divergences (pour le moment inconciliables) entre ces approches et la psychanalyse, à travers quelques notions paradigmatiques comme le refoulement ou l’intemporalité de l’inconscient, tout en constatant la difficulté persistante des sciences cognitives à concevoir l’inconscient autrement que comme le « non-conscient ».
Les « défis du présent », présentés par Bernard Brusset dans son cinquième et dernier chapitre, sont nombreux. Il en isole trois, du fait de leur intérêt particulier pour la théorie psychanalytique. D’abord, la topologie cérébrale comparée à celle proposée par la métapsychologie. Ici, le danger est grand, non seulement de revenir à la logique des localisations cérébrales, alors que celles-ci ont probablement donné tout ce qu’elles pourraient donner au cours du 20e siècle, mais aussi de voir disparaître la spécificité et l’originalité de la théorie de la sexualité, chez Freud, au profit d’une théorie plus vaste, et plus « molle », basée sur l’attachement et les interactions mère-nourrisson. Le deuxième défi a trait à l’évolutionnisme, où il est à nouveau question d’attachement et d’émotions primaires. Il a l’avantage d’établir une continuité entre le développement humain et celui des mammifères les plus évolués, mais il se heurte à la spécificité de la pulsion chez l’être humain, dans ses différences justement, et non pas dans ses similitudes, avec l’instinct. Le troisième défi est celui des « émotions primaires », qui donnent sans doute le terrain le plus prometteur de rencontre entre psychanalyse et neurobiologie.
On peut conclure, avec Bernard Brusset, que ce livre extraordinairement riche et stimulant pose en définitive la question du « propre de l’homme ». L’ouvrage contribue à montrer que cette question gagnerait à sortir de débats spéculatifs et idéologiques pour se concentrer sur l’étude précise et argumentée de la question de la continuité/discontinuité entre l’homme et l’animal.
Vassilis Kapsambelis est psychiatre, psychanalyste, membre de la SPP, directeur de la Revue française de Psychanalyse.
[/expand-maker]Monica Horovitz et Piotr Krzakowski (dir.) avec la participation de Janine Puget, Écrits intimes de psychanalystes pendant la pandémie. Journal de voyage en Confinia, Paris, L’Harmattan, « Études psychanalytiques », 2021.
 S’il porte sur tout ce qui a modifié et interrogé notre pratique d’analystes pendant la pandémie de la Covid 19, et notamment sur les effets du confinement, ce livre proclame son originalité par son contenu comme par sa construction.
S’il porte sur tout ce qui a modifié et interrogé notre pratique d’analystes pendant la pandémie de la Covid 19, et notamment sur les effets du confinement, ce livre proclame son originalité par son contenu comme par sa construction.
En mars 2020, au début de la pandémie et de la mise en place du travail psychanalytique à distance, Monica Horovitz propose à son groupe d’études sur Bion de se joindre à d’autres collègues, dont certains vivent à l’étranger, pour échanger et réfléchir sur cet inconnu qui advient ; comment elle et ses collègues font face à la crise suscitée par la pandémie, face à eux-mêmes, leurs patients et leurs supervisions. Elle expose ce projet d’un « journal de bord » à Janine Puget, qui, intéressée, souhaite y participer. Selon Yolanda Gampel, qui préface l’ouvrage, « Janine Puget était la seule analyste qui tissait de nouvelles théories, sans s’y cantonner, qui les transformait, les étendait, avec une pensée en tous points rhizomique […] Janine nous invite à devenir amis avec l’incertitude et nos conflits […] Cette ouverture et ce partage des pensées contribuent à former la paroi de l’enveloppe des espaces d’écoute pourtant dispersés » (p. 10).
Ce journal de bord collectif, dont Monica Horovitz tient la barre, est soutenu par les articles de Janine Puget et les notes des autres participants. Écrire, pour prendre la mesure de quelque chose d’autre, pour se permettre de penser à nouveau, dans une polyphonie de tonalités, de couleurs, de niveaux, d’espaces et de poèmes. Monica Horovitz a ainsi constitué un cercle de six rencontres ; Janine Puget fut présente à quatre d’entre elles, pendant les derniers mois de sa vie, entre maladie et santé, pour transmettre sa liberté d’être, d’investiguer et de créer.
L’organisation de l’ouvrage reflète cette complexité et cette richesse. Dans sa préface, Yolanda Gampel, de l’Université de Tel-Aviv et ancienne présidente de la Société psychanalytique d’Israël, présente le projet et en souligne le grand intérêt. Puis Monica Horovitz en dégage l’esprit et la portée. Viennent ensuite les articles de Janine Puget : celui de 2012, référence théorique du groupe, développe la théorie des « mondes superposés », tandis que le second, « Profanation créative, profanation dé-subjective », écrit en mai 2020, donc dans le cadre de cette expérience d’échanges, souligne le temps des incertitudes, où les concepts n’ont plus de sens univoque. La parole est alors donnée à l’ensemble des participants du groupe, en quatre temps ou chapitres successifs, ordonnés chronologiquement : 25 avril 2020, 9 mai 2020, 30 mai 2020 et 27 juin 2020. À l’intérieur de chaque chapitre, les contributions sont classées de façon plus ou moins thématique, mais c’est la liberté de ton et la diversité des regards qui frappent le plus. En guise de conclusion, Monica Horovitz nous invite « à la recherche des lucioles perdues ».
Nous présenterons ici très brièvement les deux articles de Janine Puget, puis quelques échos de chacun des quatre dialogues.
Monica Horovitz, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris et de la Société psychanalytique italienne, présente le contexte des deux mondes superposés. Penser le virus comme étranger limite nos capacités de défense et tend à nier qu’il est transmis par des liens, liens essentiels à l’espèce humaine ; finalement, l’étranger nous constitue. Dans une épidémie, de plus, c’est le voisin qui devient dangereux et apparaît sans masque. Mais ce sont aussi ces liens qui permettent recherche de vaccins et de traitements, et d’une façon de prendre soin les uns des autres : là où croît le danger, le salut grandit aussi (Hölderlin). L’article de Janine Puget et Leonardo Weller provenait d’un autre contexte, alors que Janine Puget était secrétaire scientifique de l’association Plataforma et Leonardo Weller, président de l’Association Psychanalytique argentine, participant au mouvement qui contestait un trop grand pouvoir des superviseurs et didacticiens sur la formation. En 1976 est née l’Association psychanalytique de Buenos Aires, restée à l’IPA (que Plataforma avait quittée après sa scission). Janine Puget a pu souligner combien cet article était aussi inspiré des relations entre analyste et analysé pendant la dictature argentine des années 1970-1980.
Lorsqu’une réalité extérieure menaçante et dangereuse concerne directement aussi bien l’analyste que l’analysé, ce monde superposé (on pourrait dire aussi « parallèle », précise-t-elle en 2020) interfère avec la logique de la relation analytique, transforme implicitement la position de l’analyste comme de l’analysé, impose une forme de symétrie contraire à la dissymétrie interne à la relation analytique. Le monde extérieur contamine la relation analytique, jusqu’à la violer ; on est tenté de rectifier les informations qui circulent, l’institution elle-même suscite des angoisses de castration primaires, et tout ceci provoque des distorsions dans l’écoute de l’analyste qui n’est plus à même d’entendre les relations objectales premières du patient. Les possibilités de sublimation sont destructurées au profit d’une prédominance de fonctionnements primitifs. Dans ce cas, l’analyse est de fait interrompue, les interprétations sont biaisées ou séductrices sans que l’analyste soit conscient de ce processus, car il se croit en plein contrôle de ses processus secondaires. Le premier travail indispensable est donc celui de la prise de conscience des distorsions qui sont à l’œuvre. L’article mène alors une description clinique des situations prototypiques de ce type, puis insiste sur les enjeux liés au narcissisme de l’analyste et à la qualité de sa propre analyse. Il faut garder à l’esprit que, lorsque le monde superposé fait irruption, nous serons inévitablement traumatiquement submergés dans un premier temps. Le silence de l’analyste peut être utile alors pour lui donner le temps nécessaire pour dégager son image et se remettre de cette blessure narcissique. Un cadre assez souple, mais ferme, une présence réceptive et une capacité d’attente peuvent le préserver comme objet de transfert.
Quant au second article cité, écrit pendant la pandémie, il reprend la thématique de « la subjectivité de la certitude et le sujet de l’incertitude », et il est émaillé de multiples « peut-être », qui soulignent l’enjeu essentiel de supporter l’incertitude, voire de s’en faire une alliée. Même s’il peut nous rester quelques convictions, et surtout une capacité accrue à tirer des leçons de l’expérience.
Résumer les associations qui se déploient dans les quatre chapitres qui suivent, en faisant droit aux différents courants de pensée, relève de l’impossible. Nous nous contenterons donc de quelques remarques sur des traits saillants, renvoyant le lecteur au plaisir de la découverte d’une pensée en situation, sérieuse, mais spontanée, chorale aux multiples voix, qui ne peut qu’attiser le désir de partager idées et préoccupations avec nos collègues.
Le 25 avril 2020, c’est le bouleversement relativement brutal des pratiques analytiques qui semble au premier plan : perte de la stabilité du cadre, canal sensoriel « partiel » du téléphone, empêchement de la décharge motrice du fait du confinement, etc. L’éveil d’une active curiosité aussi, qui vient répondre au désarroi. Et les échos d’ailleurs : l’Italie, à un moment où la contamination est la plus forte ; le Liban, avec l’enchevêtrement des multiples crises et de leur aggravation (jusqu’à l’ajout de quelques lignes sur l’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth). Et dans tout cela, comment s’y reconnaître, comment se reconnaître mutuellement ? Y compris avec le sentiment d’aller chez les gens les chercher, les multiples imprévus de la visio, le changement de sens du silence. Et ces enfants ou ces jeunes perturbés que paradoxalement (mais avec une mobilisation intense du service de pédo-psychiatrie), le confinement a permis d’être mieux reconnus de leurs parents. Ainsi que les fantasmes qui font leur chemin, même si la réalité virale omniprésente semble les recouvrir.
Le 9 mai 2020, il s’agit plutôt de penser pour sortir de l’informe ; paradoxalement, au sortir du confinement celui-ci peut apparaître comme un « espace protégé ». Les séances sont riches et intenses, mais il est difficile ensuite, dans un après-coup immédiat, de ressaisir sa propre pensée ; il faut à la fois lire, trouver à nourrir sa pensée et comprendre la diversité des réactions des patients au confinement ; quelquefois une créativité nouvelle, souvent un remaniement des relations entre intérieur et extérieur ; des moments « hors cadre » pourtant féconds : une patiente montrant une photo où elle n’est pas regardée par sa mère ou chantant son bébé à venir… Dans cette séquence, les vignettes cliniques sont plus nombreuses, plus développées, la réflexion sur les liens et sur la coexcitation libidinale se déploie. Le déconfinement va-t-il, parfois, refermer des espaces que le confinement avait ouverts ? Comment penser la différence entre un déménagement et les aménagements de l’analyse à distance ? La présence multiforme de la mort qui réveille tant de deuils va-t-elle s’atténuer ?
Le 30 mai 2020 surgissent nombre de questions sur le temps et l’avenir. Peut-on se représenter un avenir ? Les projets antérieurs à la pandémie ne sont-ils pas devenus caducs ? C’est aussi le moment de la joie de certaines retrouvailles en séance, de la continuité ou des différences entre l’expression des patients à distance ou en présence, des formes de protection contre la pandémie à l’intérieur du cabinet, des interrogations critiques sur certaines formes de régression dans les séances à distance – voire sur le souhait d’un analyste toujours présent, à distance certes, mais dans une immédiateté tendant à nier la distinction avec l’autre. Surgissent aussi des questions permanentes et fondamentales, comme celle du maternel en séance, mais que la comparaison entre la communication en présence ou à distance permet de conceptualiser de façon renouvelée. Soi et l’autre, les transformations laissées par ce qui s’est passé, notre rapport au temps sous-tendent les nombreuses évocations cliniques.
« Ilot de résistance à la confusion », selon Julie Augoyard, les rencontres qui ont été proposées par Monica Horovitz ont suscité un travail intense. Le 27 juin 2020, la même collègue souligne qu’« écrire fut ardu et douloureux autant que salutaire ». Nous avons la responsabilité de l’éthique psychanalytique, mais comment articuler notre cadre interne avec le setting que nous sommes amenés à proposer ? Les questions sur le temps se poursuivent, mais aussi sur les enfermements : Underground, d’Emir Kusturica, La colonie Dignidad, ou Stalker de Tarkowski, seul capable de conduire le Physicien et l’Écrivain au travers de la Zone dangereuse, pour parvenir à la Chambre, lieu de vérité. Ou encore, autrement, Tchernobyl… plus encore que le temps, l’enfermement et la contamination, c’est le corps qui est maintenant constamment sous-jacent ainsi que littérature et cinéma…, à l’instar d’Arsène qui n’ayant plus d’appareil dentaire peut maintenant « toucher son palais avec sa langue quand ça chatouille ». Dedans et dehors se réorganisent (autrement ?) et Piotr Krzakowski peut faire l’éloge de ces groupes de travail. Est-ce redécouvrir et renouveler le principe de réalité ? « Quelque part, la vie vécue reste entière », répond Christine Lorgeoux Gallais, et il s’agit bien de continuer de vivre, en assumant aussi les séparations et ruptures nécessaires. « La subjectivité de chacun est en formation tout le temps en fonction de ce que la vie sociale et politique crée », leur a dit Janine Puget.
Ce qui est nouveau se produit à partir d’un entre-deux impossible à nier. Être analyste fut pour Janine Puget l’exigence et la joie de traverser toujours de nouvelles frontières. Ce qui est répondre à la question de Monica Horovitz : « Comment faire face au changement quand il menace de nous déborder et de nous entraîner vers l’inconnu ? » Celle-ci rappelle pour conclure, en appui sur un exemple clinique très parlant, l’importance de la rencontre des corps et d’un setting incluant la présence physique, car il n’y aurait pas, lors de settings purement virtuels, ni de limite aux idéalisations ou aux diabolisations fantasmées, ni de limite aux désinhibitions sexuelles au langage cru favorisées par un sentiment illusoire d’intimité – ce qui est tout autre chose que l’élaboration de l’émotion qui surgit entre deux personnes.
Dominique Bourdin est psychanalyste, membre de la SPP.
[/expand-maker]Donald Campbell and Ronny Jaffé (ed.), When the body speaks (Lorsque le corps parle), London, Routledge, 2021.
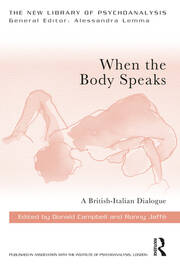 Composé de douze chapitres, ce livre est le fruit d’un dialogue régulier et ininterrompu durant près de quatorze années, entre collègues anglais et italiens, qui se réunissaient deux fois par an sur le thème du corps en analyse et ses manifestations au cours de la cure.
Composé de douze chapitres, ce livre est le fruit d’un dialogue régulier et ininterrompu durant près de quatorze années, entre collègues anglais et italiens, qui se réunissaient deux fois par an sur le thème du corps en analyse et ses manifestations au cours de la cure.
La question posée porte essentiellement sur les liens psyché et soma au sein de la dyade analytique. À mon sens il faut aussi penser à la différence entre corps érotique et soma biologique. Le corps érotique est bien présent dans la cure, mais souvent silencieux alors que le soma se manifeste bruyamment au travers de l’agir ou de la maladie.
Chaque chapitre est signé d’un auteur différent et la plupart entremêlent clinique et théorie. Les auteurs se réfèrent à la métapsychologie freudienne, mais également aux avancées théoriques de Melanie Klein, Donald W. Winnicott, Wilfred R. Bion et Didier Anzieu, entre autres.
Cette diversité fait l’intérêt et la richesse du livre comme elle semble avoir fait celle de ces échanges lors des rencontres.
On peut regretter que les recherches et écrits de l’École de Psychosomatiques de Paris, Michel de M’Uzan, Pierre Marty, André Green, ne soient mentionnés que dans le chapitre VIII, « Expressions somatiques d’affects irreprésentables », sur lequel je reviendrai plus loin, car c’est celui dont les conceptions me sont le plus proches.
Ce livre se centre donc essentiellement sur le corps dans la cure, soit le corps érotique et vivant et parfois aussi le corps malade.
En plus de l’accent mis sur « corps sain/corps malade », tous les textes insistent sur l’unité psychosomatique de l’humain, ce malgré leurs divergences théoriques. En 2006, j’avais moi-même publié dans l’IJPA un article nommé « L’indissociable unité de psyché et soma » (Aisenstein, 2006) où j’affirmais cette vision moniste.
Je reprendrai néanmoins le point de vue défendu par Green selon lequel une vision moniste n’exclut en rien l’amalgame d’organisations non homogènes qui, elles, diffèrent structurellement. J’ajouterai une différence de taille : le corps se réfère au sensoriel et à l’érotique, et le soma au biologique.
Dans certains chapitres, la question de la sensorialité est très présente, d’autres portent plutôt leur attention sur le fantasme inconscient.
La façon de travailler lors de ces rencontres consistait à se pencher sur le récit verbatim de séances. Cette méthode permettait l’étude minutieuse d’un moment clinique seul, sans introduction ni historique. Le groupe était donc à même de se centrer sur les interactions patient/psychanalyste. Cette méthodologie semble avoir contribué à affiner et détailler les différences et ressemblances entre façons de faire, donc à enrichir leurs recherches.
Les matériaux cliniques exposés dans cet ouvrage résultent d’une méthode dont on sent qu’elle a été élaborée au fil des ans.
Dans le chapitre VII, Barbara Piovano raconte comment les collègues purent partager peu à peu l’idée selon laquelle la relation de psyché et soma pouvait être mieux comprise dès lors que la cure devenait le lieu d’échanges dialectiques entre corps et esprit, entre objet et sujet.
Il n’est pas possible de commenter l’ensemble, j’ai donc pris le parti de me centrer sur les chapitres III, VIII et IV.
« D’une transmission de la sensorialité du corps au sein des échanges dans l’analyse. »
Ce chapitre, par Ronny Jaffé, porte sur le contre-transfert et la transmission au travers du transfert de ce qu’il nomme « body scars » que je traduirais par « les bleus ou les blessures du corps ».
Il propose l’idée selon laquelle l’analyste pourrait entendre et métaboliser des sensations sensorielles somatiques qui lui seraient transmises par des éléments somatiques propres au patient. Il écrit textuellement : « des fragments somatiques du patient ». Par conséquent, les sensations corporelles du psychanalyste deviendraient « l’instrument et le cœur de la cure ». J’ai trouvé cette conception très subtile et intéressante. J’aurais tendance à la rapprocher de l’article de Marty (1952) sur le contre-transfert avec les patients malades (Aisenstein, Smadja, 2010).
Dans ce texte magistral, Marty évoque justement les impressions de fragmentation du corps induites par le corps malade au travers d’une identification narcissique qui envahit l’analyste et dénie son altérité. Marty ne parle pas d’identification projective, mais ce qu’il décrit y ressemble. Jaffé va également citer Bion qui écrivait : « L’analyste devrait se sentir à l’unisson des douleurs et malaises dans le corps du patient. C’est au travers d’une compréhension profonde au niveau corporel qu’il peut donner une interprétation qui puisse être entendue, sentie et humée puis partagée par l’analyste et le patient (Bion, 1963/1979).
Jaffé relate longuement les cas de deux patients ; c’est passionnant de voir sa réceptivité aux éprouvés corporels de ses patients et la façon dont il parvient à les élaborer au travers d’un contre-transfert que je dirais « somato-psychique » magistralement analysé.
Federico est un homme, d’une quarantaine d’années, marié et père. Il débute son analyse après une crise existentielle et affective. Il n’éprouve pas de désir pour sa femme et a une histoire parallèle, secrète, avec une femme qu’il aime passionnément, mais qui le fait souffrir en raison de sa grande instabilité émotionnelle. Après un an d’analyse, il la quitte et entame une liaison avec une jeune femme dont le passé avait été traumatique, ce qui amène lentement le patient à se souvenir d’une dépression maternelle, et d’aspects sombres d’une enfance jusque-là décrite comme heureuse. En effet dans les premiers temps de son analyse Federico était identifié à un père tranquille et content de lui-même et de la vie, mais un peu indifférent à son fils. À ce point, l’auteur pense à un passage de Green sur l’idéalisation dans l’analyse puis sur sa théorie de « la mère morte ». Il devient clair que les choix d’objets féminins du patient ont à faire avec la dépression maternelle. L’analyste note se sentir « raide et momifié (stiff and mummified) » durant les séances. C’est au décours du récit d’un rêve que lui revient le souvenir d’une odeur désagréable que dégageait Federico au début du traitement. Jaffè s’interroge sur ce flash-back olfactif et le rapporte à une puanteur ancienne. Avec finesse, il écrit que si son nez sentait la puanteur cela ne voulait pas dire que le patient était malodorant. Il ajoute que les émotions peuvent sentir bon ou sentir mauvais.
Je signale ce passage qui me semble très remarquable pour illustrer un véritable travail du contre-transfert. Après le récit de trois rêves, l’auteur va décrire comment ce souvenir olfactif lui permet d’entrer en contact avec les pulsions agressives et sexuelles, ce qui conduit le patient à se remémorer sa relation infantile à sa mère.
L’histoire de Gulia relate le cas d’une patiente atteinte d’une maladie dermatologique dont les identifications primitives allaient de pair avec des tendances symbiotiques. Jaffé évoque Joyce McDougall (la peau contenant un corps pour deux) et le Moi-peau de Didier Anzieu. Il cite aussi Bion qui écrit en 1974 : « Nous rencontrons des strates de peau qui ont été conscientes et superficielles et deviennent de libres associations[1] » (Bion, 1974). Comme avec Federico, on voit l’analyste faire travailler des vécus corporels du patient qui résonnent chez l’analyste. L’élaboration de matériaux archaïques et de ressentis somatiques contre-transférentiels ont permis de mettre à jour un clivage précoce psyché/soma.
Dans ces deux récits, nous voyons l’analyste travailler au plus près du patient au travers du matériel verbal, mais aussi infra-verbal et sensoriel.
« Lorsque le corps parle, l’expression somatique d’affects irreprésentables. »
C’est le titre du chapitre de Luigi Caparrotta. Je me sens profondément en accord avec cet auteur qui pose la question, centrale pour moi, de l’affect. L’affect naît de la rencontre d’une motion pulsionnelle avec une représentation adéquate. Ceci implique que le langage puisse communiquer les affects. Or les psychosomaticiens savent que nous rencontrons des patients dont la pensée et le discours sont coupés de leurs racines pulsionnelles. Ces situations sont souvent issues de traumas précoces. Winnicott, lui, parlait d’une « dissociation » psyché /soma. La mère facilite l’ancrage corporel de l’infans, elle est garante du lien psyché/soma, idée que l’on retrouve en filigrane chez Marty dans sa conception de la « fonction maternelle du thérapeute ». Si, en raison de conditions néfastes, la psyché ne trouve pas son ancrage corporel, il surviendra une dissociation primaire qui fera le lit de dissociations ultérieures entre affects et représentations. Winnicott explique superbement que, dans ces cas- la, l’intellect risque de séduire la psyché, ce qui donne un discours qui peut être brillant, mais non enraciné dans le corps pulsionnel.
Luigi Caparrotta donne, dans ses récits cliniques, nombre d’exemples de ces dissociations. Il développe des idées très proches de Winnicott et de l’École Psychosomatique de Paris. Il écrit que le psychisme émerge du soma, je suis d’accord et rappelle Tertullien qui avait déjà écrit « La pensée est acte de chair ».
Justin est un homme d’âge moyen pour qui le choc de la puberté a eu des conséquences désastreuses. L’advenue d’un corps sexué masculin semble avoir été si menaçante qu’il s’était réfugié dans un attachement préœdipien envers un jeune garçon. Ceci bien qu’il soit marié et un père aimant pour sa famille. Justin était un patient profondément perturbé qui au cours de moments délirants projetait des images féminines sur son propre corps. Il s’était une fois ainsi tailladé la pointe des mamelons. Caparrotta considère que Justin s’est construit autour d’un clivage entre le corps sexué et états affectifs et ne dispose pas les capacités nécessaires pour symboliser ses sentiments.
J’ai trouvé intéressante la façon dont l’auteur élabore et travaille les projections de ce qui ne peut pas être vécu psychiquement sur le corps propre du patient. Caparrotta fait là un travail remarquable. En raison de la gravité du cas, il met en place un suivi conjoint avec un psychiatre qui le médicamente, et l’analyste reste de plus très attentif à le cadrer durant ses propres absences au cours desquelles le patient régresse massivement. Dans un transfert homosexuel érotisé, Justin se montre autodestructeur. Malgré son inquiétude, l’analyste prend le parti de supporter les scénarii d’automutilation tant qu’ils sont mis en mots et exprimés. Il les entend comme de l’agressivité contre lui et contre ceux que Justin aime. Il interprète ces fantasmes disant qu’il n’est pas prêt à être le spectateur de ces mises en scène. Il me semble voir un moment mutatif lorsque Justin peut accéder à de la culpabilité envers son analyste. Je reste très admirative de la capacité de l’analyste à poursuivre patiemment ce travail fructueux avec ce patient difficile.
J’évoque brièvement le second cas de Julia, 34 ans, chez qui la peur de sa sexualité naissante était telle qu’elle s’était coupée du monde et avait choisi de se droguer pour créer sa « bulle ». Pour elle le corps n’était pas le lieu des affects. Comme Justin, cette patiente ne pouvait pas se servir du langage pour communiquer ses émotions et utilisait son corps pour décharger des tensions inélaborables.
Caparrotta montre avec subtilité comment pour ses deux patients les désordres du corps étaient devenus le moyen d’accéder et de communiquer leur détresse, mais aussi leur haine que l’analyse parviendra enfin à « psychiser ».
J’ai choisi de terminer par le chapitre IV, « Perfume », de Mariapina Colazzo-Hendricks, j’ai été d’emblée interpellée par la citation de Yoko Ogawa, auteur que je lis avec passion. La phrase « Perfume belongs forever and only to the past » est tirée d’un roman profond et subtil « Cristallisation secrète » qui traite de la mémoire et du destin des souvenirs dans un monde où peu à peu tout disparaît.
Ce chapitre est étonnant, il se confronte non seulement aux difficultés somatiques du patient, mais prend en compte celles de l’analyste. Le travail de contre-transfert est ici développé et interrogé avec finesse et rigueur. Ainsi, alors qu’à la suite d’un accident l’analyste avait perdu certaines facultés sensorielles, dont l’odorat, la patiente inondait l’espace analytique de parfums et de récits sur les saveurs. La rencontre du contre-transfert avec la remémoration de sensations somatiques enfouies et d’un transfert cherchant à pénétrer le corps de son analyste donne lieu à un remarquable travail de « co-création ». On a l’impression que la dyade analytique était traversée par des transmissions d’inconscient à inconscient telles que décrites par Freud en 1915 (Freud, 1915e/1988).
Colazzo-Hendricks montre combien il a été crucial d’élaborer sa propre souffrance somatique pour entrer en contact avec des couches archaïques du psychisme de cette patiente. Sa demande initiale concernait son sentiment de ne pas être « vraie ». C’est passionnant de voir tout au long du texte comment l’auteur parvient au travers de ses propres traumas à saisir la souffrance infantile d’une patiente dont l’enfance fut lourdement grevée par des conflits passionnels avec mère et grand-mère. Elle relate des séances verbatim où le lecteur peut voir comment elle se confronte avec fermeté aux identifications projectives et à la destructivité. Elle utilise son contre-transfert comme une boussole pour tenter d’adapter ses interprétations au niveau de la patiente. Je dirais qu’elle fait un travail superbe où l’on voit une analyste mettre tout son travail préconscient au service du patient.
Puisqu’il me faut conclure je dirai simplement que ce livre vaut d’être lu, il offre un panorama européen des conceptions actuelles sur l’unité somato-psychique de l’humain et une clinique riche, vivante, de grande qualité.
Références bibliographiques
Aisenstein M., Smadja C. (1991), Introduction à l’article de Pierre Marty : « Les difficultés narcissiques de l’observateur devant le problème psychosomatique ». Int J Psychoanal 2 : 343-396.
Aisenstein M. (2006). L’indissociable unité de psyché et soma. Int J Psychoanal 87 : 667-680.
Bion W.R. (1963/1979). Éléments de Psychanalyse. Puf, Paris.
Freud S. (1915e/1988). L’inconscient. OCF.P, XIII. Chap. VI « Communication entre les deux systèmes ». Paris, Puf.
Tertulien. Dans De Corpis Ressurectio. Chap. XVIII de l’Apologeticum, Éditions Guillaume Budé
Marilia Aisenstein est psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris, de la Société Hellénique de psychanalyse et de l’IPSO.
[1] ‟We encounter a number of skin layers that once were superficial and conscious and now are free associations”, W.R. Bion in Brazilian Lectures, San-Paolo, Rio de Janeiro, Imago Editora, 1974.
[/expand-maker]Jean-Yves Tamet (dir.), Incertitudes en psychanalyse, Paris, Fario éditions, 2021
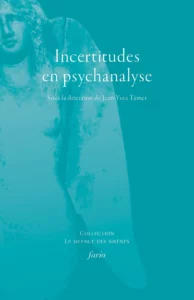 Ce recueil est une réaction à la pandémie, omniprésente même lorsqu’elle n’est pas mentionnée de façon explicite. Certains textes ont d’ailleurs été écrits en plein premier confinement, ce que l’on comprend au fil de la lecture, avec l’effet déstabilisant d’être projeté à nouveau dans un temps autre, à un moment où nous étions encore livrés à l’imprévisible sans qu’une issue à la situation ne se profile à l’horizon. C’est la pandémie qui apporte l’incertitude. Elle est d’abord perturbatrice et traumatique, puis, grâce au temps de la réflexion et à celle de l’écriture, porteuse d’un doute méthodique salutaire. C’est par le biais d’une association de Jean-Yves Tamet, qui a dirigé ce volume de la collection « Le silence des sirènes », que nous passons de cette pandémie, événement contingent extérieur à la psyché, à quelque chose de plus intime. Il cite dans son avant-propos une phrase qui aurait été prononcée par Freud au moment où celui-ci débarquait à New York en 1909, en compagnie de Ferenczi et Jung : « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste… » (Nous devons cette phrase à Lacan qui dit la tenir de Jung.) L’incertitude, donc, comme principe actif de la psychanalyse.
Ce recueil est une réaction à la pandémie, omniprésente même lorsqu’elle n’est pas mentionnée de façon explicite. Certains textes ont d’ailleurs été écrits en plein premier confinement, ce que l’on comprend au fil de la lecture, avec l’effet déstabilisant d’être projeté à nouveau dans un temps autre, à un moment où nous étions encore livrés à l’imprévisible sans qu’une issue à la situation ne se profile à l’horizon. C’est la pandémie qui apporte l’incertitude. Elle est d’abord perturbatrice et traumatique, puis, grâce au temps de la réflexion et à celle de l’écriture, porteuse d’un doute méthodique salutaire. C’est par le biais d’une association de Jean-Yves Tamet, qui a dirigé ce volume de la collection « Le silence des sirènes », que nous passons de cette pandémie, événement contingent extérieur à la psyché, à quelque chose de plus intime. Il cite dans son avant-propos une phrase qui aurait été prononcée par Freud au moment où celui-ci débarquait à New York en 1909, en compagnie de Ferenczi et Jung : « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste… » (Nous devons cette phrase à Lacan qui dit la tenir de Jung.) L’incertitude, donc, comme principe actif de la psychanalyse.
Parmi les textes qui évoquent directement l’impact de la pandémie sur les pratiques analytiques, ceux d’Évelyne Séchaud, Jean-François Chiantaretto et Leopoldo Bleger reviennent sur la question controversée de la cure à distance – en l’occurrence, au téléphone. Même pour ceux qui contestaient vivement cette pratique avant le confinement de mars 2020, elle est souvent devenue nécessaire, « comme s’il fallait réparer une voie d’eau dans la coque d’un bateau pour éviter qu’il ne coule » (Séchaud, p. 87). Ces textes explorent, avec subtilité, la transformation de cures tout à coup menées par canal interposé. Séchaud, par exemple, retient la mise à mal de l’une des fonctions majeures du cadre, celle de pare-excitation. Elle raconte les séances en présence d’autres membres de la famille, et plus précisément celle au cours de laquelle le cadre est subitement devenu mobile, sa patiente, en retard, ayant commencé le coup de téléphone alors qu’elle marchait encore dans la rue… Elle s’attarde ensuite sur une patiente qui, au moment du confinement, avait été en analyse depuis plus de dix ans à raison de trois séances hebdomadaires. Celle-ci vivait particulièrement mal l’effraction des séances au téléphone. C’est néanmoins au cours de l’une d’entre elles qu’elle met en récit pour la première fois un souvenir d’enfance important qu’elle avait tu jusque-là. Vivant en Algérie pendant la guerre, elle avait croisé dans un passage obscur un soldat algérien prisonnier dont elle avait tenté, sans succès, de dénouer le bâillon. Ce soldat devient, entre les mains de Séchaud, une figure de l’analyse en temps de Covid, sa sortie de l’oubli, le prétexte d’une réflexion sur le rôle catalyseur de l’incertitude liée au confinement dans l’effraction traumatique du souvenir. Concrètement, pour l’analyste, c’est le téléphone qui aurait permis à la patiente de partager ce souvenir. Pourtant, ce que l’analyste retient de l’impact de la crise sanitaire sur sa pratique est une inflexion de l’écoute analytique vers une écoute psychothérapeutique, inflexion qu’elle dit accepter à condition qu’elle soit elle-même sujette à une écoute analytique.
Les réflexions des différents auteurs sur ce moment de crise qui, pour un temps, nous aura tous expulsés hors de notre monde habituel montrent comment la pandémie acquiert un sens différent au sein de chaque cure – il est une construction de la dyade analyste-analysant. Chiantaretto, évoque des séances au téléphone avec une patiente au profil limite. Au téléphone, il sent que sa voix change de statut pour sa patiente, qu’elle devient « garante d’une présence dans l’absence » (p. 104), se met à signifier la continuité, fait important pour cette patiente pour qui la pathologie repose sur la conviction profonde de la défection originelle de l’autre-aidant (trait commun aux psychopathologies limites selon l’auteur). Les séances téléphoniques mettent ainsi au jour toute une dimension sexualisée du transfert, un registre hystérique de la cure, jusque-là refoulée, explique l’analyste.
Le texte de Leopoldo Bleger m’a séduit par la liberté de son assemblage. Il est une chronique de l’analyse à distance sous Covid-19, ce qui permet à l’auteur de relever les détails parlants de son expérience dans ses modifications même. Le premier confinement avait ravivé ses souvenirs du coup d’État de mars 1976 en Argentine – même sens du danger imminent, nous dit-il, et même besoin de faire des choix quand bien même la situation est incertaine et que l’on risque toujours d’« en faire trop ou pas assez », selon le sous-titre de son texte. Le second confinement, en octobre 2020, ne nécessite plus que quelques jours de réadaptation, note-t-il. Cette fois-ci, c’est son besoin d’ordre qu’il remarque, son besoin de respecter les horaires et les vacances habituels, de se préparer pour ses séances, comme il le faisait lorsqu’analyste et patient pouvaient travailler l’un en présence de l’autre. Le cadre est là, non seulement pour contenir les angoisses du patient, nous rappelle-t-il, mais aussi celles de l’analyste. Mais la pandémie en teste les limites et nous interroge, d’où cette question fort pertinente de Bleger : la pandémie fait-elle rentrer dans le cabinet une réalité extérieure mise entre parenthèses par l’investissement transférentiel du patient et de l’analyste, ou ne fait-elle que révéler une réalité – y compris politique – qui est toujours déjà là, mais « en sourdine » ?
Le texte se termine sur les échanges d’un groupe de travail sur l’analyse à distance qui s’était réuni avant la pandémie. L’auteur rejoint Séchaud dans son refus de renvoyer dos à dos dans un schéma trop manichéen la cure type et la cure à distance. Il n’en récuse pas moins l’argumentaire qui consiste à dire que les séances à distance sont le produit inévitable de la globalisation, et il appelle à réfléchir sur ce que l’adoption de ce moyen de travail nous dit de la conception que l’on se fait de la cure. Pas de conclusion, ici, mais plutôt une ironie finale, celle de l’expérience in vivo des séances à distance rendues nécessaires par la pandémie, y compris pour leurs plus fermes opposants.
À bien des égards, le véritable sujet de ce recueil n’est pas tant l’incertitude que les rapports incertitude-certitude. Il est un examen des multiples manières dont ces deux termes font couple. Pour Chiantaretto, les certitudes « limites » (déjà évoquées) font système avec les incertitudes de l’analyste, que celles-ci soient nosographiques, qu’elles portent sur l’indication thérapeutique, ou qu’elles affectent sa capacité de lecture du transfert et du contre-transfert. Bleger, citant De la certitude, de Ludwig Wittgenstein, nous rappelle que l’enfant commence par croire ses parents et que la contestation de leurs savoirs n’arrive que dans un second temps (p. 35).
Claire Trémoulet évoque la cure d’une patiente déprimée, jeune intellectuelle bilingue arrivée en France depuis un pays totalitaire, pour qui le despotisme politique de son enfance n’a d’égal que celui interne de son moi idéal. Face aux certitudes tranchées de la patiente, remparts contre ses angoisses et incertitudes, pas de place pour le travail associatif de l’analyste, pour sa créativité thérapeutique. Tout se figeait dans un transfert où dominait l’emprise de la patiente sur le procès analytique. « Rendez-vous avec l’incertitude » (c’est le titre du texte) est le récit d’un voyage thérapeutique en terre du doute, voyage vital pour le déroulé de la cure. Le récit de la transformation évoquée dans ces pages est d’autant plus émouvant que celle-ci n’est rattachée à aucun moment saillant, aucun événement thérapeutique. Pas d’interprétation clé, d’intervention transformatrice, mais de multiples allers-retours dans le transfert et le contre-transfert. Deux belles pages (p. 158-159) décrivent avec finesse le dégel et les changements afférents. Du côté de l’analyste : sa progressive relaxation corporelle, l’émergence de ses fantasmes, la transformation des notes prises en séance (le verbatim laisse place à l’associativité), l’accès à une mise en images des paroles de la patiente. Du côté de la patiente : abandon des constructions théorisantes, acceptation des silences, réorientation de ses dires, qui s’adressent progressivement aux absents aussi bien qu’à l’analyste présente. En lisant le texte de Trémoulet, des scènes de films d’Éric Rohmer me sont revenues en mémoire, scènes dans lesquelles le réalisateur filme l’attente, l’ennui. Rien ne semble se passer, et pourtant la vie des personnages s’y développe comme d’elle-même, hors scénarisation intempestive. Dans la cure décrite par Trémoulet, accepter l’incertitude offre le moyen de séparer deux scènes, celle de la patiente et celle de l’analyste, ce qui à son tour permet l’ouverture d’un espace intermédiaire de jeu (p. 161) dans lequel la patiente se dépêtre petit à petit de ses imagos parentales et se met à occuper son corps propre.
Le texte d’Isabelle Alfandary m’a également semblé proche d’un univers cinématographique ou littéraire. Non pas qu’il nous plonge dans la fiction. Tout se joue autour de ce qu’un adolescent dit un jour à son analyste au sujet d’une scène insolite vue avant une séance et rapportée au cours de celle-ci. En plein printemps, il observe une subite tombée de neige et sa fonte aussi subite. Le texte, émouvant, tourne autour de la séparation entre ce jeune patient et l’analyste qui était persuadé que le moment de mettre un terme au travail en commun était arrivé. C’est dans ce contexte que s’insère le récit de ce moment de surprise face à l’observation d’un phénomène à mi-chemin de la nature et du rêve. Qu’est-ce qui convoque ici le cinéma ou la littérature ? Intimement convaincu que ce que le patient partageait à ce moment-là était quelque chose d’essentiel, l’analyste se voit dans l’incapacité d’en interpréter le sens ou d’en démêler les tenants et aboutissants associatifs. Le vrai côtoie le mystère. Car c’est bien du départ finalement accepté par le patient qu’il s’agit dans le texte d’Alfandary. Ce récit de neige qui fond met en lumière l’importance d’accueillir l’incertitude d’une séance, de recevoir ce qui a été partagé au-delà ou en deçà de ce qui pourrait donner lieu à une interprétation et cela sans « éteindre le halo du rêve », selon la jolie formule utilisée par Catherine Parat dans un texte qui fait valoir tous les avantages de l’intervention face à l’interprétation, potentiellement beaucoup plus traumatique (2013, p. 168).
Reste à dire, au sujet de ce volume, que le plaisir du texte y est manifeste. Roland Barthes utilisait cette formule entre autres pour décrire une jouissance de la lecture qui ne s’explique que si le lecteur devient co-auteur du texte écrit – relation complexe qui pourrait être prise comme métaphore de l’imbrication du transfert et du contre-transfert. Ce plaisir tient en partie au décentrement lié à la thématique de l’incertitude. La brièveté des écrits, qui relèvent souvent de l’art du fragment ou de l’esquisse, y est également pour quelque chose – l’instant, le moment révélateur, y sont très présents. La proximité du fait littéraire explique peut-être pourquoi on voit poindre dans ce volume un questionnement qui rappelle celui, majeur, de l’anthropologie à la fin des années 1980. Cette discipline connut alors un tournant réflexif qui porta sur ses modes d’écriture propre, sur sa manière de représenter ou d’écrire « les autres » et, partant, sur la poétique cachée en son for intérieur. Dans cet esprit, Laurence Apfelbaum s’interroge sur le genre auquel appartient l’écriture de cas. Elle détaille quelques-unes de ses formes et, à partir de là, se met à relever dans plusieurs écrits psychanalytiques, y compris de Freud, des métaphores qui tentent de saisir le travail analytique. Plutôt que d’insister sur la célèbre métaphore archéologique de Freud, elle s’intéresse plutôt à la comparaison qu’il fait, dans une de ses lettres à Fliess (6/8/1899), entre sa conception globale de L’Interprétation des rêves et une promenade. Ce qui interpelle Apfelbaum, ce sont les métaphores du cheminement psychanalytique, parfois cheminement aveugle, d’où la présence dans son texte du tableau de Nicolas Poussin Orion aveugle cherchant le soleil levant (1658). Le colosse y cherche la lumière, certes, mais surtout le tableau est lui-même composé de façon à ce que le colosse ne soit pas forcément ce que le spectateur remarque en premier et qu’il soit amené à le chercher, ce qui peut mettre un certain temps. La figuration d’un cheminement nécessite elle-même un cheminement, exige de creuser pour aller au-delà de la surface apparente du tableau. D’image en image, l’analyste tente d’imaginer la forme d’un texte adapté à cette tâche un peu particulière qui est de rendre compte par écrit d’un travail dont le propre est de procéder par associations interposées. En guise de conclusion, elle place la littérature, ou la littérarité, non pas du côté du compte-rendu, de la présentation clinique, mais de la cure elle-même, dont « les citations » les « souvenirs de séances » finissent par former « le livre d’une cure » (p. 26).
Brouillant, à son tour, les frontières entre l’écriture de cas et la littérature, Marie Sirjacq évoque une cure dont le patient s’avère être, après quelques pages, un personnage de roman (Goro dans Suisen, d’Aki Shimazaki). L’enjeu est alors, à travers une cure imaginaire, d’allonger ce patient pas comme les autres, homme de pouvoir rarement effleuré par le doute, et l’amener à accueillir ses incertitudes « comme des perles et non des grains de sable » (p. 152).
Les textes rassemblés dans cet ouvrage donnent à l’incertitude psychanalytique des formes diverses et la place en des lieux variés : l’écoute, la perception du transfert, toujours difficile à saisir du fait du refoulement (Catherine Chabert), le cadre, la technique, la métapsychologie, la langue, les dires du patient et de l’analyste (par exemple, l’incrédulité que l’analyste peut parfois exprimer). Il trace également un vaste champ sémantique autour de l’incertitude qui jouxte l’hésitation, l’inaccompli, l’indécision, la remise en question, le flottement, le flou, l’imprécis, et j’en passe. Il nous renvoie également, de façon tacite, à une incertitude relativement absente des propos explicites des auteurs, celle qui semble parfois planer sur l’avenir de la psychanalyse elle-même.
Références bibliographiques
Parat C. (2013). L’affect partagé. Rev fr Psychosom 44(2) : 167-182.
Boris Wiseman est psychanalyste à l’Institut de la SPP. Il a été enseignant-chercheur dans plusieurs UFR de lettres françaises, y compris, jusqu’à 2016, à l’université de Copenhague.
[/expand-maker]Fred Busch, A Fresh Look at Psychoanalytical Technique. Selected Papers on Psychoanalysis, Londres, Routledge, 2021
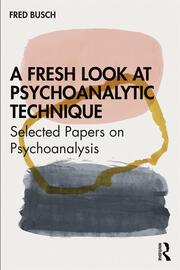 J’ai rencontré Fred Busch il y a fort longtemps lors d’un congrès de l’API ou d’une rencontre de l’Association psychanalytique Américaine (APA). J’ai toujours été frappée par sa vaste culture analytique comme par la clarté de son style d’exposition. Il ne s’agit donc pas du premier de ses livres sur lequel je propose une note de lecture mais du troisième. J’aimerais dire d’emblée de l’auteur que nous lui devons de porter l’analyse française au-delà de l’Atlantique.
J’ai rencontré Fred Busch il y a fort longtemps lors d’un congrès de l’API ou d’une rencontre de l’Association psychanalytique Américaine (APA). J’ai toujours été frappée par sa vaste culture analytique comme par la clarté de son style d’exposition. Il ne s’agit donc pas du premier de ses livres sur lequel je propose une note de lecture mais du troisième. J’aimerais dire d’emblée de l’auteur que nous lui devons de porter l’analyse française au-delà de l’Atlantique.
Réunissant plusieurs de ses articles sur des thèmes qui lui sont chers, les quinze chapitres de ce livre remarquable dévoilent ce que j’appellerai « un véritable voyage psychanalytique » de l’auteur.
Je m’attarderai sur les trois pages de l’introduction qui me semblent poser d’emblée les enjeux majeurs de l’ouvrage. Sa passion des trente dernières années, nous dit Busch, a été d’élaborer une technique qui soit en résonance avec ce qui est dénommé aux US le modèle structural, soit la seconde topique, dont Busch écrit qu’elle y aurait été négligée. Cette dernière est évidemment adossée à la seconde théorie des pulsions dont elle est la conséquence directe. Il est vrai que la culture psychanalytique américaine de l’époque était fondée sur le courant de l’Ego-Psychology, que Busch peut critiquer sans toutefois jamais le renier. La technique de mise consistait essentiellement à analyser les défenses et à interpréter des contenus inconscients sans tenir compte des forces qui justement entravent ou bousculent ceux-ci.
Busch raconte avec beaucoup d’authenticité combien, jeune analyste, il remarquait déjà l’inefficacité de certaines de ses interprétations qui visaient à « découvrir des secrets enfouis », écrit-il. Ce serait surtout une conférence de Paul Gray, lors d’un congrès international, puis la lecture du livre Reading French Psychoanalysis[1], en 2009, qui lui auraient ouvert de nouvelles perspectives.
Toute la construction de ce livre tourne autour de la question du moi comme l’arbitre du travail psychique que peut se permettre un patient en tenant compte des modulations de son angoisse. Je n’énumérai pas tous les chapitres mais pour camper le ton de l’ouvrage j’en cite quelques-uns :
« La recherche d’une vérité psychique », « Quelques ambiguïtés sur la méthode de la libre association et ses implications techniques », « Un concept de l’ombre : la pensée préconsciente » ; et aussi quelques autres plus inhabituels et personnels : « Peut-on faire passer un chameau dans la fente d’une aiguille à coudre ? », « Je vous aime, voilà pourquoi je vous ignore »…
Dès l’ouverture, Busch défend farouchement le métier de l’analyste, puis souligne l’intérêt d’être cliniquement au plus près du travail préconscient, car il s’agit parfois de construire des représentations de l’impensé irreprésentable et non seulement du refoulé. Nous pouvons voir ici combien Busch est proche de certaines de nos conceptions et de nos auteurs, je pense essentiellement à André Green, Pierre Marty, César et Sàra Botella. Plus loin, de longs moments sont consacrés à la notion de vérité en analyse et dans la cure. L’auteur suggère que la recherche d’une vérité risque de nous éloigner de la vérité psychique du patient, ce que j’entends à l’instar de la réalité que nous opposons à la réalité psychique. Busch va citer Kriss qui, dès 1956, avait écrit que, lors d’état traumatique, les souvenirs vont servir de bouclier autobiographique et rendre difficile l’accès aux émotions et fantasmes.
Les références sont nombreuses et une clinique riche soutient toujours le propos. Je reste un peu sur le chapitre IV intitulé : « Pensées sur La Résistance Inconsciente ».
Pour Busch, c’est la seconde topique qui permet la deuxième théorie freudienne de l’angoisse et donne son plein sens au travail sur les résistances. Pour lui, la façon la plus fructueuse consiste à aborder en premier lieu les défenses les plus proches du moi conscient. Par exemple, dire au patient que s’il reste silencieux, c’est sans doute en raison de ce qu’il se défend contre ce qu’il vit comme un danger ; soit choisir une technique interprétative qui ne s’attaque pas d’emblée aux mouvements inconscients.
Toutes les vignettes cliniques de l’auteur me font sentir en terrain familier, sa technique, en effet, me semble proche de la mienne, et entre autres de celle qui nous a été enseignée par Marty à l’institut de psychosomatique. Busch connaît bien la littérature de l’École psychosomatique de Paris dont il n’est pas sans voir les affinités avec les siennes, c’est-à-dire « procéder par petites touches, stimuler le travail associatif, compter sur la participation du patient… » Comme René Roussillon, il va jusqu’à parler de « conversation psychanalytique ».
L’auteur se penche ensuite sur : « Quelques ambiguïtés de la méthode de l’association libre et leurs conséquences techniques ». Aujourd’hui encore, la libre association couplée à l’énonciation de la règle fondamentale reste le pivot de l’analyse. L’estimation des capacités associatives du patient est l’outil princeps pour la préconisation du cadre. Je veux souligner ici la différence entre associativité et association libre, c’est en effet la première qui permet la seconde. S’il existe des patients dont le discours est associatif, dès la première rencontre, il y a aussi ceux qui, au lieu de mettre en scène une histoire, récitent une biographie. Existent aussi ceux pour qui la première rencontre avec un psychanalyste fera naître une associativité nouvelle, ou mettre en route quelque chose qui nous permet d’en faire le pari. Mais Busch livre ici une idée originale sur l’association libre. Il s’appuie sur Kriss et Gay pour qui la méthode de la libre association ferait des résistances la « pièce maîtresse » du processus analytique.
Quelque peu sceptique dans une première lecture rapide, mais après y avoir repensé, j’ai trouvé cette vision intéressante. Et l’on peut en effet voir la résistance comme la « pierre angulaire » du processus associatif. Un patient qui suivrait la règle fondamentale sans jamais y déroger mettrait son analyste à rude épreuve.
Après s’être posé la question de ce « que nommons-nous une interprétation profonde ? » l’auteur se demande : « Avons-nous perdu l’esprit[2] ? Ce qui pourrait également être traduit par avons-nous perdu la tête ? »
Dans ce court chapitre de dix pages, Busch examine avec acuité la question de l’efficacité de l’interprétation qui diffère de sa justesse, il pose de plus le problème, original, de se demander à qui, du patient ou du psychanalyste, « appartient » l’interprétation.
Une longue illustration clinique nous montre un analyste proposant une interprétation de transfert à un patient qui l’accepte mais explicite qu’il pense s’agir là d’un scénario de l’analyste auquel il se conforme pour lui plaire. Il s’agirait dès lors d’une co-création qui m’évoque Daniel Widlöcher qui parlait lui de « co-pensée ».
Bref, nous dit Busch, s’il pense que la grande majorité de nos collègues sont des « experts » capables de saisir des dynamiques inconscientes subtiles, rien ne dit que cette compréhension puisse aider le patient. Il ajoute qu’avant d’interpréter il faudrait souvent l’aider à se construire ce qu’il appelle « an analytic mind », expression difficile à traduire, littéralement une « pensée psychanalytique », mais qui à mon sens voudrait plutôt dire une réflexibilité, ou autoréflexivité psychanalytique[3] ». C’est bien, me semble-t-il, ce que nous recherchons au travers des interprétations dans le processus, contrairement aux interprétations classiques de contenus.
J’ai choisi de me concentrer ici sur les chapitres IX, XII et XV, qui m’ont semblé les plus emblématiques de l’ouvrage.
Un concept de l’ombre la pensée préconsciente
Busch examine très minutieusement les textes freudiens, de 1915 à 1938. Dans la première topique, Freud voyait le préconscient comme « l’ombre du conscient ». Mais l’ombre n’existe pas sans lumière, les pensées et les sensations inconscientes ne prennent forme qu’à la lumière du conscient.
Dans cet article[4], Freud présente la pensée préconsciente comme s’étendant entre la barrière du système inconscient à celle du système conscient. Busch considère que cette avancée porte déjà en germe la description de la seconde topique décrite surtout en 1923 (Freud, 1915/2010), où une partie du moi devient inconsciente sans toutefois venir s’agglomérer à l’inconscient refoulé.
Il compare le dessin de 1923 au dessin proposé par Freud en 1933 dans Les Nouvelles Conférences (Freud, 1933/1984) et en conclut que pour Freud l’importance de la pensée préconsciente s’est beaucoup accrue entre 1915 et 1933. L’auteur ajoute que, si Freud redéfinit les concepts d’inconscient, préconscient, conscient, cinq ans plus tard dans l’Abrégé (Freud, 1938/1975), il s’agit maintenant de qualités.
À plusieurs moments de ce texte, Freud assimile préconscient et moi comme inconscient et ça. Busch note d’ailleurs que, dans un article de 1974, Green (1974) décrit le préconscient comme le terrain privilégié où se rencontrent analyste et patient.
L’auteur s’attache à tracer une ligne de démarcation entre des rejetons de l’inconscient qui s’actualisent, plutôt que de s’exprimer au travers du langage et la pensée associative fondée sur les représentations. Il cite Green qui parlait de « pensées sans penseur ». Busch évoque ces différences au travers de vignettes cliniques illustratives des implications techniques qu’elles entraînent (p. 129-131). Il s’attarde aussi d’une façon très intéressante à différencier ce qui serait « pensée préconsciente » de ce qui serait « communication inconsciente ».
« Peut-on enfiler un chameau dans la fente d’une aiguille à coudre ? »
Sous ce titre provocant, l’auteur va s’attaquer à la question de ce qu’il nomme « action-langage », qui n’est pas sans rappeler « l’agir de parole », décrit par Jean-Luc Donnet. Les développements de Busch me semblent remarquables. Je ne peux que les résumer ici de façon lapidaire. Il cite Freud pour qui la compulsion de répétition est toujours une répétition agie[5]. Il insiste sur l’idée qu’une différentiation fine entre le langage-action et un verbe régi par l’association libre implique des techniques interprétatives très différentes.
En ce qui concerne le premier le rôle du contre-transfert est prévalent.
C’est ce dernier qui, grâce au travail psychique de l’analyste, permet un travail de transformation du langage-action en représentations. De plus l’accent est mis sur le processus, et non sur les contenus inconscients. De cela il donne un long exemple clinique passionnant.
Pour clore ce chapitre Busch écrit non sans humour : « Oui il est possible d’enfiler un chameau dans la fente d’une aiguille à coudre », mais à condition qu’il s’agisse de mots liés à un tissu représentatif.
Le chapitre XV, dernier de ce livre s’intitule « Je vous aime, voilà pourquoi je vous ignore »
À partir de constatations banales issues d’une clinique ordinaire, l’auteur s’interroge sur ces patients à qui l’analyste annonce des vacances ou une interruption brutale inattendue sans qu’ils bronchent, mais glissent vite sur autre chose. Au-delà des interprétations classiques, il va proposer une grille de compréhension qui repose sur la conceptualisation de « la mère morte » greenienne. Il voit dans ces « non réponses » une mise en acte qui cherche à maintenir l’objet en vie, à le réanimer et à surtout ne pas aggraver son état. Il relate une séance de la cure d’un patient, Jim, à qui il doit annoncer une absence inopinée de quatre à six semaines.
Jim, dont la mère s’est gravement déprimée et alcoolisée alors qu’il était enfant, semble être resté le soignant de cette mère jusqu’à sa mort à elle.
Lorsque Busch lui annonce cette longue absence dès la fin de la semaine et ajoute qu’il s’agit d’une chirurgie urgente, Jim le surprend : après un « je suis désolé » très convenu, il se lance dans le récit détaillé du week-end. L’analyste se sent « deadened[6] », dévitalisé et absent. Il constate qu’il est blessé, son narcissisme est atteint, ce qui le fait penser à la mère narcissique de Jim qui avait, lui, appris à cacher son angoisse pour la protéger. Cette association lui permet de comprendre qu’il s’agit bien là d’une répétition mise en acte des craintes d’enfant de Jim.
Busch termine ce chapitre en écrivant « Une note sur le narcissisme de l’analyste ». Avec subtilité et authenticité, il évoque ces moments inévitables où nous ne parvenons plus à être en résonance avec certains côtés de nos patients. Nous avons alors tendance à penser en termes d’identification projective et à imaginer que le patient nous fait vivre quelque chose qui aurait à avoir avec son hostilité à notre endroit.
Il nous faudrait dès lors aller plus loin dans l’analyse du contre-transfert sans perdre de vue que le patient, lui, fait ce qu’il peut et du mieux qu’il peut, car sa relation à son psychanalyste répète sa relation à un objet primaire internalisé.
Ainsi un patient qui donne l’impression d’ignorer son analyste peut chercher ainsi à le ménager pour le garder en vie.
Construit à partir d’un recueil d’articles plus ou moins anciens, ce dernier livre de Busch se présente comme une somme sur l’œuvre d’une vie. Le lecteur voit combien sa théorie est toujours enracinée dans une clinique vivante et subtile. Il s’agit d’un ouvrage qui donne envie de travailler et retravailler la métapsychologie comme la clinique.
Marilia Aisenstein est psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris et de la Société Hellénique de psychanalyse
Références bibliographiques
Freud S. (1914/1981). Remémoration, répétition, perlaboration. La technique psychanalytique. Paris, Puf.
Freud S. (1915/2010). L’Inconscient. Métapsychologie. Paris, Puf, « Quadrige ».
Freud S. (1923/1972). Le Moi et le ça. Essais de Psychanalyse. Paris, Payot.
Freud S. (1933/1984). Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris, Gallimard.
Freud S. (1938/1975). L’abrégé de psychanalyse. Paris, Puf.
Green A. (1974). Surface analysis and deep analysis: the role of preconscious in psychoanalytical technique. Int J Psychoanal 1 : 415-423 (pas de traduction en français).
[1] Édité par Dana Birksted-Breen, Londres, Taylor & Francis, 2009.
[2] Mind.
[3] Voir Busch F., 2013: Creating a Psychoanalytic Mind. A Psychoanalytic Method and Theory Londres, Ed. Rootledge, et Aisenstein M., 2014, « Construire une pensée psychanalytique, une méthode, une théorie », Revue française de psychanalyse, Paris, Puf.
[5] Freud S. (1914/1981). Remémoration, répétition, perlaboration. La technique psychanalytique. Paris Puf.
[6] (9) La traduction littérale serait : « Je me suis senti mort, dévitalisé », mais j’aurais plutôt envie d’utiliser un mot du vocabulaire courant des adolescents d’aujourd’hui qui disent souvent « il, ou elle, m’a ghosté ».
[/expand-maker]Hervé Mazurel, L’inconscient ou l’oubli de l’histoire, Paris, La Découverte, 2021
 Sa lecture en ces temps de guerre, troubles et inquiétants, m’a incité à présenter cet ouvrage qui ouvre une réflexion sur les liens entre psychanalyse et histoire. Des évènements mondiaux comme la pandémie, le réchauffement climatique, les dictatures ou la guerre en Ukraine perturbent nos conditions habituelles d’exercice. N’est-il pas temps que les psychanalystes entrent en dialogue avec les historiens ? Historien des affects et de l’imaginaire, Hervé Mazurel codirige la revue Sensibilités. Histoire critique et sciences sociales. Le livre prend racine dans sa thèse de doctorat, soutenue en 2019, dans laquelle sont discutées les thèses d’historiens, sociologues, anthropologues concernant les rapports de l’histoire et de la psychanalyse. L’auteur décrit trois processus sociohistoriques qui auraient donné naissance à la conception moderne de l’individu comme « être séparé » (p. 202) : le processus de civilisation, le processus de privatisation, le processus d’individuation. Le premier assure le passage de la répression des affects et des pulsions par une autorité extérieure à l’autocontrôle intériorisé. Le deuxième concerne l’instauration du secret de l’intimité sans lequel le dispositif de la cure psychanalytique serait impensable. Le troisième fait que l’individu devient plus autonome avec un sentiment accru de sa différence (p. 207).
Sa lecture en ces temps de guerre, troubles et inquiétants, m’a incité à présenter cet ouvrage qui ouvre une réflexion sur les liens entre psychanalyse et histoire. Des évènements mondiaux comme la pandémie, le réchauffement climatique, les dictatures ou la guerre en Ukraine perturbent nos conditions habituelles d’exercice. N’est-il pas temps que les psychanalystes entrent en dialogue avec les historiens ? Historien des affects et de l’imaginaire, Hervé Mazurel codirige la revue Sensibilités. Histoire critique et sciences sociales. Le livre prend racine dans sa thèse de doctorat, soutenue en 2019, dans laquelle sont discutées les thèses d’historiens, sociologues, anthropologues concernant les rapports de l’histoire et de la psychanalyse. L’auteur décrit trois processus sociohistoriques qui auraient donné naissance à la conception moderne de l’individu comme « être séparé » (p. 202) : le processus de civilisation, le processus de privatisation, le processus d’individuation. Le premier assure le passage de la répression des affects et des pulsions par une autorité extérieure à l’autocontrôle intériorisé. Le deuxième concerne l’instauration du secret de l’intimité sans lequel le dispositif de la cure psychanalytique serait impensable. Le troisième fait que l’individu devient plus autonome avec un sentiment accru de sa différence (p. 207).
Est-il possible d’historiciser l’inconscient et le complexe d’Œdipe ? Mazurel considère le complexe d’Œdipe comme « un simple produit historique situé, repéré par Freud dans les familles bourgeoises de Vienne et non généralisable à d’autres sociétés » (p. 231). Il souhaite que le complexe d’Œdipe soit compris comme un évènement historique au long cours, culturellement situé, et que l’inconscient embrasse tout le social-historique. Il pense qu’« il est plus que temps de se défaire du biais patriarcal de la psychanalyse freudienne et lacanienne » (p. 471)[1]. La thèse de Mazurel est que « l’inconscient n’est pas une donnée stable, immuable, éternelle d’une nature humaine elle-même invariable ». Il évoque une résistance de la psychanalyse à l’histoire, voire un déni de l’historicité. La psychanalyse serait une théorie anhistorique de l’homme et de la société, comme l’affirmait Cornélius Castoriadis, philosophe et psychanalyste, qui dénonçait « ce postulat délirant, au sens rigoureux du terme[2] » de la psychanalyse, « seule activité humaine hors du temps et qui ne serait pas partie prenante de la société et de l’histoire ». Michel Tort, lui, déclarait que pour délimiter la dimension de l’inconscient, on l’a fétichisé dans un hors temps en faisant surtout appel à la structure ou la biologie[3]. Le refus de toute transmission biologique, génétique, phylogénétique de la chose psychique parcourt le livre. Si le temps n’existe pas dans l’inconscient, alors l’inconscient serait au-delà du social. Pour s’y opposer, Mazurel en appelle à Norbert Elias, figure centrale de son ouvrage, sociologue historien qui considère le temps comme un symbole social (p. 141), alors que pour Freud l’inconscient serait un invariant qui échappe à l’histoire collective, a fortiori s’il est structuré comme un langage, comme le croit Lacan. Ce rejet de l’historicité par la psychanalyse fait dire à Bourdieu que l’inconscient est oubli de l’histoire. Il soutient par exemple l’idée de construction historique du féminin et du masculin.
La psychanalyse ignore l’historicité de l’habitus, façon dont le social s’inscrit pour imposer des façons de penser, de sentir, de désirer (p. 151). Pour Pierre Bourdieu, chaque individu porte en lui une part de l’histoire collective : la psychanalyse serait tombée dans le piège de l’anhistorisme alors que l’historicité est lovée au cœur de notre vie inconsciente sous la forme de l’habitus, dont un des traits essentiels est de se faire passer pour « naturel ». Cette conception de l’habitus, qui est transmission sociale et culturelle, s’oppose à la notion freudienne de transmission phylogénétique des caractères psychiques acquis. Il existerait une singularité individuelle faite de collectif. L’histoire individuelle dans sa singularité se forge dans les rapports sociaux (Corcuff, 1999, p. 211). L’aphorisme de Bourdieu semble, à mon avis, concerner davantage le temps court de l’histoire et l’inconscient historique refoulé, et non l’inconscient du temps long de l’histoire et des fantasmes originaires. Il est peu fait référence dans l’ouvrage aux concepts de la psychanalyse après Freud, comme par exemple « le faux-self » social, décrit par Winnicott en 1954, et qui recouvre, pour une part, celui d’habitus. Non sans humour, Mazurel écrit : « Et si l’invariant variait ? », s’appuyant sur Cornelius Castoriadis qui dénonce « la dénégation acharnée » opposée par la psychanalyse au caractère historique de la réalité sociale. Pour Elias, l’inconscient n’existe pas hors du temps ; il est le produit de l’histoire collective. Son projet est d’inscrire le psychisme freudien dans le temps long de l’histoire collective. Sa conception du « processus psychique de civilisation » (1936) s’élabore à la lecture de Malaise. Sa pratique de l’analyse de groupe avec Foulkes, pendant la guerre, l’incite à préciser sa thèse : les individus sont toujours reliés les uns aux autres. Mais André Green ne dit pas autre chose : « Définir le sujet par ses relations à ses géniteurs, c’est détruire le concept d’in-dividu, décentrer le Moi et défendre l’idée d’un sujet comme produit de relations. C’est aussi reconnaître l’inéluctable socialisation du sujet[4]. »
Selon Elias, le processus civilisateur s’est accéléré au xviie siècle dans le sens du contrôle et du refoulement pulsionnel : hygiène, fourchette, invention de la chambre à coucher, salle de bains, etc. La « curialisation des guerriers » en noblesse de cour fut imposée par l’absolutisme royal pour assurer le monopole de la force par l’État. Il en résulte « une transformation de l’économie psychique individuelle » repérable dans « l’habitus psychique » du courtisan, processus qui s’étendit à la société française. La figure du courtisan (Elias, 1933)[5] fait saisir les relations souterraines et silencieuses qui tissent l’inconscient, le social et l’historique. L’exemple de la société de cour montre la corrélation étroite entre les transformations psychiques de l’individu et les mutations de la société. Le développement de la civilité dans la société de cour de la période absolutiste s’accompagne de censure affective et de plus grande maîtrise de soi (p. 215). Elias décrit le passage « de la contrainte sociale à l’autocontrainte », affirmant que l’histoire d’une société se reflète dans l’histoire de l’individu et inscrit les pulsions du ça dans l’histoire : « Les pulsions du ça ne se rapportent pas moins que les autres énergies psychiques à des données sociologiques, elles ne sont pas moins soumises à l’effet de l’évolution historique que le structure des fonctions du Moi et du Surmoi » (1975, p. 91)[6]. L’erreur commune, selon Mazurel (p. 189), qui affirme l’indissociabilité du psychologique et du sociologique, serait de partir d’un individu isolé pour se demander ensuite comment la société influe sur lui, alors que l’individu présocial n’existe pas. Loin d’être à l’extérieur de l’individu, la société est en lui. Le « je » sans « nous » est une conception tardive de l’histoire. Cette « représentation égocentrique de la société » (p. 191) aurait empêché la psychanalyse de concevoir « le sur-moi comme produit historique d’une société » (p. 193). Le social n’est pas dénié chez Freud, poursuit Mazurel, mais la réflexion reste embryonnaire malgré la célèbre citation de l’Abrégé (1938) : « La psychologie individuelle est aussi, d’emblée et simultanément, une psychologie sociale. » La survalorisation du « je » ne correspond pas seulement à un moment de la découverte de l’inconscient freudien ; elle est aussi le fruit d’une longue histoire européenne (p. 201) qui se poursuit aujourd’hui dans nos sociétés individualistes aux pathologies avant tout narcissiques.
Dans son chapitre « L’incertain refoulement de l’agressivité », Mazurel reproche à Freud ses points de vue sur la civilisation et la guerre fondés sur l’idée de l’homme éternel, tendant à exclure l’homo historicus traversé par les variations culturelles. Ainsi Alain Corbin cherche à comprendre le supplice meurtrier infligé par une foule de paysans à un jeune noble qui a crié « Vive la République ! » (p. 332)[7]. Refusant d’en rester aux pulsions destructrices d’une foule en liesse dans un village du Limousin, l’historien donne une cohérence au drame en dégageant les puissants conflits qui opposaient paysannerie locale, viscéralement attachée à l’Empire, à la Noblesse, au clergé et à la bourgeoisie. Craignant la défaite de Napoléon III, la foule se vantait d’avoir fait « rôtir un Prussien ». Le profond dégoût pour ces formes de cruauté se serait progressivement renforcé depuis le Moyen-Âge pour s’inverser à partir de la guerre de 14-18, matrice des violences extrêmes. George L. Mosse oppose le concept de « brutalisation » à l’idée de « civilisation des mœurs » d’Elias, ce que confirment l’arrivée d’Hitler et la Deuxième Guerre mondiale (p. 339). Après « l’individu standard » de Margareth Mead ou la « personnalité de base » de Ralph Linton et Abram Kardiner, Siegfried Kracauer montre dans De Caligari à Hitler (1947) comment le cinéma allemand révèle la psychologie profonde prédominante en Allemagne[8]. Il rejoint le concept d’« habitus national » développé par Elias dans The Germans (p. 261). Stéphane Audoin-Rouzeau, dans Combattre (2008), montre qu’Elias, qui a connu le choc traumatique du champ de bataille, n’est d’aucun recours à qui veut regarder de près la violence guerrière et paroxystique[9]. Pour André Burguière, Elias aurait fait un immense travail de sublimation par son analyse de la curialisation des guerriers, alors que ses plus vives blessures de l’existence le laissent « sans voix ». Elias a en effet connu les tranchées, ses parents livrés aux nazis et l’exil. Proche en cela de Freud, il s’appuie sur le narcissisme des petites différences comme facteur déterminant dans le déclenchement des conflits. Il aborda la Shoah à la fin de sa vie. Dans The Germans (1989), il met l’accent sur l’extrême rationalisation de l’usage de la violence bureaucratique et impersonnelle, ainsi mise à distance. Il décrit un « désir de soumission » assurant un degré inouï d’obéissance à l’autorité meurtrière. L’exacerbation des tensions dans le champ social et le besoin de sécurisation identitaire seraient à l’origine du national-socialisme, utilisant les juifs allemands comme figure repoussoir, « contretype » fantasmé (p. 355). On peut regretter qu’Edgard Morin, le penseur de la complexité et de la culture de masse, ne soit pas évoqué, lui qui commence son œuvre par L’an zéro de l’Allemagne (1946).
Dans le chapitre « Paroxysme et profondeur » est soulignée la réserve des historiens face aux évènements paroxystiques comme la guerre, la terreur ou le carnaval. Selon Corbin, « l’historien ne doit rien refuser de voir ». Le paroxysme de la fête, suivi à travers le temps, constitue un laboratoire privilégié pour approcher l’historicité de l’inconscient (p. 386). Ainsi le maquillage narcissique du sujet contemporain remplace-t-il le masque repoussant de jadis. Pour Mazurel, il importe de ne pas faire l’impasse sur les affects que le paroxysme impose à « la recherche soucieuse de retrouver l’expérience vive des acteurs d’autrefois » (p. 395). Il insiste sur l’influence considérable de Georges Devereux sur les historiens. Le fondateur de l’ethnopsychiatrie affirmait, en 1951, l’existence d’un lien consubstantiel entre l’expérience du terrain et la cure analytique, et la nécessité de réintégrer l’affectivité du chercheur dans le champ de l’observation (p. 225). Les « maladies de l’âme sont différentes d’un peuple à l’autre, l’inconscient est universel » (p. 226). Mazurel exprime ses réserves devant « un héritage ambigu » (p. 330) qui accorde au complexe d’Œdipe une valeur universelle tout en affirmant faire place à la diversité des cultures. J’avoue ne pas comprendre la contradiction que Mazurel croit déceler chez Devereux, là où je vois de la complexité. La prise en compte, par le chercheur, du contre-transfert lui donne une compréhension plus profonde de son objet d’étude, ce qui fait dire à Audoin-Rouzeau au sujet du génocide rwandais de 1994 : « C’est quand notre subjectif est le plus engagé qu’on a le plus de chance d’être objectif » (p. 397).
L’histoire critique n’aurait-elle pas fonction d’une thérapie (« procédé archéologique » selon Paul Ricœur et Michel Foucault) avec l’inconscient entendu comme refoulé historique, à condition d’élucider ce qui a rendu inconscient un phénomène historique ? Dans un autre livre, Le Président est-il devenu fou ?, Patrick Weil, illustre, selon moi, la question de la levée du « refoulé historique » consécutif au travail d’analyse de l’historien à partir des archives[10]. Premier exemple : Weil a retrouvé à Yale le manuscrit original de Bullit et Freud, « Le président Wilson, portrait psychologique », et découvre que la version publiée a été caviardée plus de trois cents fois. Deuxième exemple : Weil découvre que, contrairement à ses engagements, le président Wilson, de retour aux USA, a refusé de faire ratifier le traité par les parlementaires américains. Wilson, homme aux multiples revirements, ne voulait pas se confronter pour des motifs passionnels à son rival démocrate, empêchant la ratification promise à Georges Clemenceau. Le texte prévoyait l’engagement militaire des USA et de l’Angleterre au cas où la France serait attaquée à nouveau par l’Allemagne !
Même si l’auteur pousse parfois trop loin les antagonismes entre psychanalyse et histoire, la lecture de ce livre érudit et passionnant est stimulante. Ce livre dense m’a intéressé jusqu’aux dernières lignes (voir « Coda », spécialement p. 583-584). Mazurel pense que la psychanalyse est en train de payer chèrement son oubli de l’histoire pour avoir « lié malencontreusement le sort de ses constructions les plus déterminantes à des formes historiques contingentes » (p.489)[11]. La critique est forte. Mais il y a chez Freud une conception de la vérité historique enfouie au fond de la psyché humaine. Aussi le génie de Freud n’est-il pas tel que le cadre conceptuel de sa pensée puisse autoriser une vision plus large que celle qu’il pouvait avoir à son époque ? Il y a dans ce livre une contradiction féconde entre, d’une part, la critique des conceptions universalistes du complexe d’Œdipe et de l’inconscient, et, d’autre part, l’appropriation incontestable par les historiens contemporains d’une démarche proche de celles des psychanalystes pour faire parler les archives. « Le métier d’historien n’est-il pas, depuis toujours, méditation et expérience de la perte, du manque, de l’absence et du même coup art de faire parler les moindres détails et bribes de l’archive ? » (p. 540).
Philippe Jaeger est membre de la SPP.
[1] Castoriadis C. (1975/1999). L’institution imaginaire de la société. Paris, Seuil, p. 452.
[2] Castoriadis C. (1978). Les carrefours du labyrinthe t. 1. Paris, Seuil, p. 157.
[3] Tort M. (2007). « Préface. Une psychanalyse avec l’histoire ». Dans A. Duvallois. Une psychanalyste dans l’histoire. Paris, Campagne Première.
[4] Green A. (1992). Le mythe, un objet transitionnel collectif. La Déliaison. Paris, Les Belles Lettres, p. 158.
[5] Elias N. (1993) Engagement et distanciation. Contribution à une sociologie de la connaissance. Paris, Fayard.
[6] Elias N. (1969/1975). La dynamique de l’Occident. Paris, Calmann-Lévy.
[7] Corbin A. (1990). Le village des « cannibales ». Paris, Flammarion.
[8] Kracauer S. (2019). De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand. Paris, Klincksieck, p. 7.
[9] Audoin-Rozeau S. (2008). Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne. Paris, Le seuil.
[10] Weil P. (2022). Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l’État. Paris, Grasset. (Voir recension de cet ouvrage dans le présent numéro).
[11] Tort M. (2005) La fin du dogme paternel, Paris, Flammarion, p. 20.
[/expand-maker]Thomas H. Ogden, Vers une nouvelle sensibilité analytique. Le vivant (et le mort) dans le cabinet d’analyse, Paris, Ithaque, 2022
 Les huit articles, publiés entre 2016 et 2022, que Thomas H. Ogden rassemble dans son nouvel ouvrage, semblent tracer les contours d’un nouveau paradigme de la psychanalyse. Celui-ci s’articule autour d’une conception de la psychopathologie conçue comme « incapacité de grandir et d’exister plus pleinement dans sa vie avec le sentiment d’être quelqu’un dans le monde réel » (p. 18). Le sous-titre, Le vivant (et le mort) dans le cabinet d’analyse, révèle ce qui oriente cette nouvelle sensibilité analytique : l’expérience de qui se sent vivant. L’existence, référée à la capacité de se rêver en devenir, articule ainsi l’être et le devenir propres à tout être qui se sent vivant, et vient qualifier la santé.
Les huit articles, publiés entre 2016 et 2022, que Thomas H. Ogden rassemble dans son nouvel ouvrage, semblent tracer les contours d’un nouveau paradigme de la psychanalyse. Celui-ci s’articule autour d’une conception de la psychopathologie conçue comme « incapacité de grandir et d’exister plus pleinement dans sa vie avec le sentiment d’être quelqu’un dans le monde réel » (p. 18). Le sous-titre, Le vivant (et le mort) dans le cabinet d’analyse, révèle ce qui oriente cette nouvelle sensibilité analytique : l’expérience de qui se sent vivant. L’existence, référée à la capacité de se rêver en devenir, articule ainsi l’être et le devenir propres à tout être qui se sent vivant, et vient qualifier la santé.
L’évolution d’une psychanalyse « épistémologique » vers une psychanalyse « ontologique » s’est selon lui opérée par le biais d’une « pensée […] qui est passée de l’attention donnée aux relations d’objet interne inconscientes au combat que nous menons tous pour exister plus en tant que personne capable de se vivre comme un être réel et de plain-pied dans la vie » (p. 22). Ce qu’Ogden repère comme un mouvement général de l’histoire de la psychanalyse se trouve déjà sous forme d’oscillations subtiles et permanentes dans la pratique de chaque analyste et dans chaque cure. Il envisage parfois même qu’elles ne soient que les deux faces d’une même activité analytique, considérant alors la « dimension ontologique de la psychanalyse » (p. 34).
Si la psychanalyse épistémologique s’organise autour de la recherche d’un savoir sur le monde interne inconscient du patient et sa relation avec le monde extérieur, c’est qu’elle postule qu’il est empêché, dans sa vie actuelle, par l’infantile. L’analyste aide alors le patient à prendre conscience de la manière dont il est vécu par celui-ci, dans des interprétations du transfert envisagé comme répétition. Cette démarche s’oppose, selon Ogden, à celle qui favorise l’expérience par laquelle le patient « accède à cette compréhension de manière créative » (p. 25) qui lui permet d’être plus pleinement lui-même, ce qu’une formule de Donald W. Winnicott semble illustrer : « en tissant des objets autres-que-moi dans le schéma personnel » (Winnicott, 1971c, p. 10). Par une façon d’être avec le patient, l’analyste, qui favorise l’advenue de phénomènes transitionnels, rend possible des expériences, des états-d’être, jusque-là jamais expérimentés par le patient, parmi lesquels la communication silencieuse de soi à soi, proprement impensable, directement en lien avec le fait d’être en vie. Quant à Wilfred R. Bion, il oppose à la compréhension de ce qui se passe en séance le fait d’être pleinement là, de faire corps-avec, de façon à pouvoir éprouver inconsciemment quelque chose qui s’apparente au vécu impensé ou inimaginable du patient. La fonction alpha du « rêver », qui traite des impressions sensorielles brutes comme autant de réponses corporelles à l’expérience, « est un événement psychique au cours duquel l’individu devient un sujet qui fait l’expérience d’être soi-même » (p. 31), ce qui fonde sa capacité à se sentir réel, en vie, et pas seulement sa capacité à donner du sens. Cela induit, dans la pratique analytique, un certain renoncement au souvenir, à la compréhension, et plus fondamentalement à l’idée de guérison du patient.
Aux yeux d’Ogden, deux articles fondent la psychanalyse ontologique : « De la communication et de la non-communication […] » (Winnicott, 1963a), et « L’utilisation de l’objet et le mode de relation à l’objet au travers des identifications » (Winnicott, 1969b), dont il fait une relecture à partir d’une traduction personnelle, qui rend compte de la conflictualité et de la processualité de la pensée de Winnicott. Le premier article appréhende ce qu’il en est, pour un individu donné, de l’état d’être et de la communication au sein de son noyau essentiel, « simplement en continuant d’exister » avec la « mère-environnement » (Winnicott, 1963a, p. 156), au cœur du soi le plus isolé. Dans une relation d’objet pathologique, un « faux soi » est en relation avec « un objet vécu uniquement comme une atteinte au sentiment de soi du nourrisson » (p. 46). Il est clivé d’une partie du nourrisson « en relation avec un objet subjectif, ou de simples phénomènes basés sur des vécus corporels, ceux-ci étant à peine influencés par un monde perçu objectivement » (Winnicott, 1963a, p. 157) ; phénomènes sans sujet, ni objet, ni corps, qui nous permettent de penser cette communication primitive. Paradoxe de la pensée de Winnicott qui affirme que cet état d’être « porte [cependant] en lui tout le sens du réel », et qu’il est présent dans toute expérience humaine. Cela lui permet de penser certaines formes de repli, comme le besoin d’une forme de communication secrète avec des objets subjectifs en lien avec des vécus sensoriels, qui permet à l’individu de retrouver le sens du réel. Alors qu’habituellement c’est la communication avec des objets intermédiaires dont l’ordre d’expérience n’est ni objectif ni subjectif qui fonde le sentiment du réel. La subtilité de ce jeu permet à Winnicott de penser le rapport complexe entre deux assertions : « n’être pas trouvé est une catastrophe » (ibid., p. 160), mais il est essentiel de rester « toujours introuvable » (ibid., p. 161) : être reconnu par l’autre, sans s’en trouver exposé dans son identité. Cela permet également de distinguer le fonctionnement d’une mère lorsque son bébé ne la perçoit que comme un objet subjectif, puis objectivement. Une troisième forme de relation et de communication évoque à Ogden la créativité avec laquelle l’on peut puiser dans la richesse du langage, mais également la mimique, la gestuelle pour transmettre quelque chose de nos ressentis dans ce qui peut se penser comme un espace transitionnel.
La reconnaissance « de l’expérience du noyau intime silencieux du patient » (p. 56) doit conduire à la prudence clinique, notamment lorsqu’un patient utilise les mots pour étouffer celle-ci. Tant que l’analyste ne sera pas perçu comme un objet distinct, ses interprétations menaceront ce soi silencieux. Il est essentiel de ne pas trop savoir, de ne pas trop comprendre. La retenue, la mise en latence de l’interprétation est souvent ce qui permet que le patient y accède de lui-même de manière créatrice. Ce temps où l’analyste converse avec lui-même, en écho avec ce qu’il vit dans la séance, a des chances d’être en lien avec ce que vit émotionnellement le patient, et constitue pour lui une opportunité d’expérimenter l’analyste comme une personne distincte et faire l’expérience de n’être pas complètement seul.
Dans le second article étudié par Ogden, Winnicott nous éclaire sur le processus qui permet au nourrisson de passer de la relation à l’utilisation de l’objet, et au principe de réalité de devenir une dimension du conscient. Ce processus qualifié de maturation innée réside dans la destruction de l’objet réel puis dans le constat jubilatoire de sa survie. Ogden précise la nature de cette destruction : la mère a le sentiment d’être détruite en tant que mère. C’est la réalité de cette expérience qui fonde pour l’enfant le sentiment de la réalité extérieure de sa mère. Le processus de maturation évoqué dépend donc de la capacité de la mère à survivre au sentiment d’être détruite en tant que mère et à se montrer vivante dans la relation à l’enfant. Elle apparaît alors comme séparée, remplaçable. À son tour, l’analyste ne doit pas tenter d’atténuer la destructivité du patient à son égard. Selon Ogden, la perception par le patient de la douleur de l’analyste dans cette attaque de sa fonction est ce qui favorise son accès au registre de l’utilisation de l’objet.
Mais Ogden insiste sur le fait que ce « changement d’orientation de la psychanalyse », qui apparaît comme radical, s’inscrit dans une évolution des pratiques sous l’impulsion de conceptions différentes de l’esprit depuis Freud jusqu’à Bion. Il reposerait sur le « passage d’une conception de l’esprit comme « appareil psychique » qui traite l’expérience » (p. 123), c’est-à-dire qui s’offre comme une solution à la pression ressentie de toute part, à une vision de celui-ci comme « processus se constituant par l’acte même de vivre l’expérience » (p. 123). Pour rendre compte de cette évolution, Ogden appréhende les récits des psychanalystes, déductions et métaphores relatives à ce qu’ils imaginent être les débuts de la vie psychique, qui induisent des conceptions radicalement différentes de l’esprit et du travail analytique.
Il s’intéresse particulièrement à « la fonction psychanalytique de la personnalité » (p. 107), élaborée par Bion : s’offrant comme une opportunité de métaboliser la charge émotionnelle générée par les expériences vécues, le rêve apparaît comme une disposition ou un effort consubstantiel à la santé psychique. Une altération de cette disposition à rêver son expérience laisse dans l’inconscient une partie de ce qui fait l’individu sans que celui-ci ne puisse se l’approprier. C’est dans cet impensé inéprouvé que Ogden situe la vérité que le sujet vient chercher dans l’analyse. Il y a donc dans le rêve et dans toute tentative analytique de le remettre en branle une démarche de connaissance de soi. L’émergence dans le langage de cette vérité éprouvée dans la séance est ce qui permettrait que cette vérité émotionnelle se fasse jour, sans avoir à penser qu’elle lui préexiste : cette expérience se vit dans la séance, par diverses formes de communication langagière, en fonction de la relation particulière qu’entretiennent à ce moment-là les significations manifestes et les significations latentes de la communication entre les deux protagonistes en présence. Elles prennent des formes singulières à chaque instant de l’analyse, parmi lesquelles l’auteur repère trois types de discours : « direct, tangentiel et non sequitur » (p. 145). La vérité n’émerge jamais sous la forme de la transmission directe d’un contenu, comme c’est le cas dans la conversation ordinaire ; elle jaillit plutôt dans les disjonctions du langage et entraîne une perte de cohérence qui déroute les protagonistes, dans une perplexité et un ravissement qu’ils peuvent partager. Parce qu’inconnu et inattendu, ce qui émerge alors peut être l’occasion d’une ouverture psychique et de la connaissance de soi. Ogden réintroduit l’opposition entre quelque chose qui serait su et quelque chose de radicalement nouveau expérimenté à l’occasion de ces disruptions dans l’ordre du langage. Pour autant, il précise que « ce qui est vrai de cet instant doit [encore] être psychiquement créé ; le patient et l’analyste doivent pouvoir le « songer » en s’engageant ensemble dans l’expérience consciente et inconsciente de se laisser changer par la vérité de l’instant » (p. 147). Si le discours direct est une forme d’échange qui joue peu de la souplesse du langage, de la polysémie, de sa capacité à pouvoir faire émerger des images, le discours tangentiel puise, quant à lui, dans la potentialité métaphorique du langage comme parole animée par des événements (glissements de sens, erreurs syntaxiques, grammaticales, etc.) qui témoignent de liens multiples à explorer. Le discours non sequitur en est le paroxysme, lorsque l’échange vire au non-sens, mais qu’il se passe quelque chose entre l’analysant et l’analyste qui fait exister une vérité jamais approchée jusqu’alors.
Tenter ainsi de qualifier un discours qui peut osciller dans le temps même de la séance vise à mettre au jour les frayages inconscients de la vérité d’un vécu. C’est ce qu’Ogden tente d’appréhender lorsqu’il prend comme objet ses propres écrits analytiques. Comme discours, ils sont le fruit d’un processus qui a conduit à ce qu’une expérience vécue en tant qu’analyste avec ses patients puisse émerger, prendre forme à la faveur des mots. La conceptualisation n’est pas quelque chose d’extérieur à cette création ; cette création prend sens dans le partage inter-analytique et le souci de transmission ; comme forme de pensée, et utilisation particulière du langage, elle est le fruit d’une expérience. À la manière d’un récit de rêve ou de séance, elle est une fiction qui a valeur de vérité pour celui qui l’énonce, mais qui ne doit pas s’ignorer en tant que fiction. Ogden souligne la prédominance de la forme verbale active dans ses propres fictions théorico-cliniques qui traduisent la processualité à l’œuvre dans le fonctionnement psychique et la séance d’analyse.
Les situations cliniques dont Ogden fait le récit permettent d’appréhender cette dimension ontologique du travail analytique et les incidences cliniques de son positionnement : une attention particulière à la manière dont il s’adresse au patient, plus qu’au contenu, le choix d’une description pour tenter de rendre compte autant que possible de l’expérience vécue en séance plutôt que celui de l’explication, eu égard à l’ambivalence de l’analysant à se comprendre ou se méprendre ; et afin que lui-même parvienne à se rêver plus pleinement.
C’est bien la vitalité de la psychanalyse en son devenir qui semble avoir aiguillonné la volonté d’Ogden de réunir et faire dialoguer ses articles.
Jeanne Ortiz est psychanalyste à l’Institut de Psychanalyse de Paris.
[/expand-maker]Cosimo Schinaia, La crise écologique à la lumière de la psychanalyse, Paris, Imago, 2022
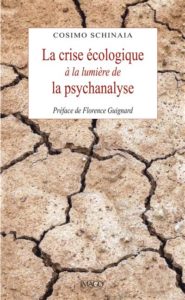 Ce livre est un plaidoyer fervent pour l’implication des psychanalystes dans le problème de la crise écologique. Contrairement à ce que disent les auteurs de la préface et de la postface, ce n’est pas le premier ni le seul. En effet, outre l’ouvrage collectif sous la direction de Luc Magnenat qui est cité à plusieurs reprises (La crise environnementale sur le divan, 2019, In Press), d’autres sont parus à peu près au même moment en France dont les numéros du Coq-Héron (« Péril environnemental et psychanalyse », Éres, 2023), du Présent de la psychanalyse (« Civilisation en détresse », Puf, 2022), et des « Débats en psychanalyse » (Planète en détresse : fantasmes et réalités, Puf, 2022), pour ne citer que ces ouvrages, sans oublier celui de Roland Gori : Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? (Les liens qui libèrent, 2020). Si les échanges sont le « tissu conjonctif de l’humanité », comme il l’écrit lui-même (p. 169), et si s’organiser est une nécessité pour pouvoir agir, le fait de rendre compte de son livre ici me donne, outre le plaisir de sa lecture, celui de nourrir ce tissu conjonctif dont nous avons plus que jamais besoin.
Ce livre est un plaidoyer fervent pour l’implication des psychanalystes dans le problème de la crise écologique. Contrairement à ce que disent les auteurs de la préface et de la postface, ce n’est pas le premier ni le seul. En effet, outre l’ouvrage collectif sous la direction de Luc Magnenat qui est cité à plusieurs reprises (La crise environnementale sur le divan, 2019, In Press), d’autres sont parus à peu près au même moment en France dont les numéros du Coq-Héron (« Péril environnemental et psychanalyse », Éres, 2023), du Présent de la psychanalyse (« Civilisation en détresse », Puf, 2022), et des « Débats en psychanalyse » (Planète en détresse : fantasmes et réalités, Puf, 2022), pour ne citer que ces ouvrages, sans oublier celui de Roland Gori : Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? (Les liens qui libèrent, 2020). Si les échanges sont le « tissu conjonctif de l’humanité », comme il l’écrit lui-même (p. 169), et si s’organiser est une nécessité pour pouvoir agir, le fait de rendre compte de son livre ici me donne, outre le plaisir de sa lecture, celui de nourrir ce tissu conjonctif dont nous avons plus que jamais besoin.
Ce qui m’a le plus touchée dans ce livre structuré en dix chapitres se situe à l’origine : celle de la préoccupation écologique de l’auteur, qui a vécu très intimement la dévastation du paradis de son enfance, Tarente, l’antique cité portuaire fondée au huitième siècle avant J.-C. par une colonie de spartiates en exil avant d’être à nouveau « colonisée » dans les années soixante du xxe siècle par le complexe sidérurgique ILVA, suivi d’une raffinerie appartenant à Shell, cette nouvelle colonisation industrielle en ayant fait, après une période de prospérité très cher payée en effets collatéraux meurtriers (que ce soit pour le paysage, la nature ou la population), la ville la plus polluée d’Europe, actuellement en faillite à la suite de diverses malversations et erreurs de gestion.
Quand, de retour dans sa ville natale, Schinaia cherche à retrouver les « dunes dorées de son enfance » (p. 25), la plage aux eaux limpides et poissonneuses où ils se rendaient en autobus son frère et lui accompagnés de leur mère venue les chercher à la sortie de l’école, il ne trouve qu’une « véritable décharge laide et malodorante, tout comme les collines dites écologiques, situées entre le complexe sidérurgique et le quartier de Tamburi » (idem) – collines écologiques dans lesquelles un décret du maire a interdit aux enfants d’aller jouer à cause de la toxicité de l’air et de l’empoisonnement de la terre.
« Adieu les petites coquilles Saint-Jacques, adieu les huîtres », écrit Schinaia (ibid.), après s’être souvenu des cueillettes de fruits de mer et des pâtes aux tellines ou aux palourdes que sa mère cuisinait de retour à la maison. Le livre pourrait presque s’arrêter là tant la force de cette évocation peut faire écho à cette douleur que chacun peut connaître s’il a fait l’expérience du saccage réel et souvent irrémédiable des lieux enchantés et sauvages habités jadis, dont le charme se mêlait à celui des rêveries et des attentes de l’enfance certes, mais n’y était pas réductible. Il ne s’agit pas de la perte inéluctable de paradis imaginaires, mais du saccage orchestré de notre paradis terrestre, tous deux bien réels (le paradis et le saccage) qui se poursuit de jour en jour. D’une réalité charnelle, spirituelle, psychique, sensuelle, dans laquelle notre vie s’enracine et dont la perte ne peut être que mortelle.
Depuis très peu de temps, quelques années à peine, l’écologie, le climat, la survie de l’humanité sont au premier plan des préoccupations d’une bonne partie de la planète après des décennies pendant lesquelles les alertes, alarmes, prévisions concernant le désastre en train de s’accomplir ont été superbement ignorées. Est-il encore temps ou bien trop tard ? Un découragement massif fera-t-il suite au déni ? On ne sait pas. Le message de Schinaia, à l’instar de celui de Freud qu’il cite, est de ne pas se laisser paralyser par la mélancolie environnementale, source d’inertie et d’apathie. « La voix de l’intellect est basse, mais elle ne s’arrête point qu’on ne l’ait entendue. Et après des rebuffades répétées et innombrables, on finit tout de même par l’entendre », écrit Freud dans L’avenir d’une illusion (Schinaia, 71-180 ; Freud, 1927a, p. 436) ou plus loin, dans une lettre à Anna : « Nous serons toujours prêts à mener la lutte pour un degré supérieur de l’humanité, le combat contre la lourdeur et la dévastation » (2006, p. 458).
Cependant, comme le montre Schinaia, ce n’est pas seulement la voix de l’intellect, mais celle de l’être tout entier qu’il faut écouter, ou celle de la nature comme dans Le cri de Munch, dont l’interprétation proposée par Giulia Bartum, selon Schinaia, à partir d’une annotation du peintre lui-même sur le dos de sa toile fait, non pas le cri d’épouvante du personnage, mais « un cri infini parcourant la Nature » (p. 178), peut-être le cri de la Terre elle-même. Et d’ailleurs sans doute ne faut-il pas choisir, opposer l’homme à la nature, la nature à l’homme, l’humain au non humain comme dirait l’anthropologue Philippe Descola, comme il s’agit de ne pas opposer l’esprit à la chair, mais de comprendre l’unité du vivant qui nous concerne intimement et totalement.
Le livre de Schinaia est passionné et très bien documenté. Pas de manichéisme, pas de « chasse aux sorcières idéologique » (p. 168), ni de leçon de morale donnée d’une position supérieure de juste sans péché. Même s’il identifie, comme d’autres avant lui, la sociopathie de certains personnages au pouvoir et celle plus globalement du capitalisme (« Nos profits valent plus que leurs vies »), même si la part hubristique et la part sage de chacun ne s’intriquent ni ne se manifestent de la même façon chez tous, il rappelle ce que la psychanalyse nous permet de savoir, mais que nous avons parfois tendance à oublier : « Les aspects pervers et destructeurs de la nature humaine ne se trouvent pas seulement chez les criminels, les méchants ou les climato sceptiques les plus endurcis, mais sont présents en chacun de nous » (p. 167).
C’est cela que pourrait permettre la psychanalyse face à la crise actuelle : la lucidité. Comme dans toutes les crises, comme dans toutes les épreuves vitales. Lucidité sur la réalité de la catastrophe en cours, les pertes irrémédiables qui ont déjà eu lieu et qui vont survenir encore, nous touchant et touchant nos enfants, attaquant notre vie même dans toutes ses dimensions – sans avoir recours aux mécanismes de défense confortables à court terme que sont le déni, le clivage et la projection. Lucidité et acceptation de la dépendance et des limites auxquelles nous confronte cette crise, lucidité par rapport à nos attentes irréalistes et à notre propre déraison qu’encouragent toutes les incitations à consommer toujours plus dans tous les domaines.
Nous sommes dépendants de la nature autant qu’elle l’est de nous. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, disaient les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes aussi dépendants les uns des autres. Nous ne pouvons pas donner libre cours à notre avidité, à notre folie consumériste, pour compenser notre vide intérieur, nos carences affectives, nos failles narcissiques, ou prendre notre revanche sur quelque mauvaise mère que notre Terre représenterait. J’ajouterais que nous avons tout intérêt à ne pas trop mobiliser nos défenses maniaques face aux terribles angoisses dépressives qui accompagnent forcément notre prise de conscience, prise de conscience à ajuster chaque jour, car nous avons terriblement envie de nier tout ça – de recourir à des simplifications rassurantes, de nous vivre en victimes, de ne pas bouger, de ne rien changer.
La collusion plus ou moins inconsciente avec la crise environnementale (signalée par Harold Searles [1962] et reprise par Luc Magnenat [2019] est aussi une manifestation de la pulsion de mort et de la jouissance destructrice qui y est associée. Le fantasme de fin du monde et d’anéantissement de tous et de tout, à la fois peur et désir comme tout fantasme, est peut-être tapi au fond de chacun de nous (orgie apocalyptique apportant à la fois la satisfaction des désirs matricides et fusionnels régressifs et leur punition radicale).
Le livre de Schinaia est organisé de façon méthodique et aborde chaque aspect de la crise. C’est dans les chapitres sur le gaspillage, la pollution sonore et lumineuse et enfin les déchets, qu’il nous apporte des exemples cliniques parlants, mettant en évidence de façon éclairante le lien toujours à travailler et à interroger, surtout dans les circonstances actuelles, entre le monde intérieur et l’extérieur, la réalité et le fantasme. Il consacre un chapitre au rapport de Freud avec la Nature – rapport évoluant au fil du temps et qui prend finalement en compte les aspects destructeurs et les aspects vitaux, régénérants, de cette Nature avec l’humain qui en fait partie et vit en son sein. Il récuse également la critique radicale du progrès – qui a apporté les bienfaits que l’on sait, mais souligne que c’est à un prix inacceptable, parce que le bien-être matériel et le profit de quelques-uns ont pris une place prépondérante, excessive, sans que le soin de notre maison commune (comme dit le pape François dont il cite à plusieurs reprises la très puissante encyclique Laudate si) et des habitants de passage que nous sommes n’ait été suffisamment pris en compte et pensé.
Il n’est pas trop tard, nous dit Schinaia, mais c’est un souci de tous les instants qui doit nous animer, non pas pour nous plaindre et entonner une lamentation stérile de tonalité sadomasochiste (c’est moi qui le dis), mais pour agir, penser, élaborer des solutions, trouver des alternatives vitales, prendre soin. Prendre soin est notre métier d’analystes, soit dit en passant.
Le dernier chapitre « Les serviteurs de l’avenir » nous invite à… jardiner. Cultiver notre jardin, prendre soin, arroser et faire pousser. En cette période de sécheresse particulièrement poignante où les grands arbres se dessèchent et arborent en juillet les couleurs de l’automne, quand ils ne brûlent pas dans des incendies dramatiques dont l’ampleur nous remplit d’effroi, cette invitation, qui est à prendre au sens premier, concret, autant que comme une métaphore, ouvre la voie à une forme de consolation active, créatrice. Nos plantes et nos forêts prennent soin de nous autant que nous prenons soin d’elles, comme nos animaux, nos fleuves et nos montagnes, nos océans et nos nuages, comme tout le vivant dont nous faisons partie, auquel nous appartenons autant qu’il nous appartient. Et comme notre pensée.
Dominique Tabone-Weil est psychanalyste, membre titulaire de la SPP.
Références bibliographiques
Bourdin D. et Tabone-Weil D. (dir.) (2022). Planète en détresse : fantasmes et réalités. Paris, Puf.
Dupont J., Fognini M., Adam E. (dir.) (2020). « La psychanalyse face au péril environnemental ». Le Coq-Héron.
Pape François (2015). Laudato si. Encyclique, mai 2015. Rome, Éditions du Vatican.
Gori R. (2019). Et si l’effondrement avait déjà eu lieu. Paris, Les liens qui libèrent.
Magnenat L. (dir.) (2019). La crise environnementale sur le divan. Paris, In Press.
Searles H. (1972/2019). Unconscious processes in relation to the environnemental crisis. Psychoanal Rev 59 : 361-374 ; traduction Luc Magnenat, 2019, op. cit.
[/expand-maker]Patrick Weil, Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef d’État, Paris, Grasset, 2022
 Patrick Weil, connu pour ses travaux sur la nationalité et la laïcité, est historien, directeur de recherche au CNRS. Professeur à Yale, il a eu accès aux archives de William Bullitt à l’origine de la biographie qu’il publie.
Patrick Weil, connu pour ses travaux sur la nationalité et la laïcité, est historien, directeur de recherche au CNRS. Professeur à Yale, il a eu accès aux archives de William Bullitt à l’origine de la biographie qu’il publie.
William Bullit est d’abord journaliste et correspondant de guerre pendant la guerre de 14. Il débute très jeune une carrière diplomatique et participe à la délégation des États-Unis des négociations du Traité de Versailles. Il démissionne, reprochant au président Wilson d’avoir accepté des clauses trop dures avec l’Allemagne, contrairement à ses engagements d’une paix sans vainqueurs. Sa déposition devant le Sénat contribue à justifier l’opposition des républicains à l’adhésion des États-Unis à la SDN. Wilson refuse tout compromis avec le Sénat pour ratifier le traité et va faire voter ses partisans contre la ratification. Il empêche ainsi l’adhésion de son pays à la SDN dont il a été le promoteur. Commence alors pour William Bullitt une période de traversée du désert. Une crise personnelle et conjugale le conduit à entreprendre une analyse avec Freud en 1926. Il écrit à cette époque une pièce sur le Président Wilson qu’il ne parvient pas à faire jouer.
À travers la carrière de Bullitt, nous suivons l’histoire des relations internationales dans l’entre-deux-guerres. Mais pour les psychanalystes il est surtout le coauteur avec Freud de Le Président Wilson, une étude psychologique[i]. En 1930, il propose à Freud d’écrire sur le Président Wilson dans le cadre d’un projet de livre sur les diplomates du Traité de Versailles. Freud lui demande de réunir du matériel qui permette d’écrire un livre consacré à Wilson. Bullitt recueille des archives et de nombreux témoignages de proches de Wilson. Au cours de plusieurs séjours, la collaboration s’intensifie, parfois interrompue par la maladie de Freud ou la reprise de séances de Bullitt sur le divan de Freud. En 1932, le livre est achevé. Si, à l’origine, la partie biographique était l’œuvre de Bullitt et la partie théorique celle de Freud, Patrick Weil montre comment elle devient le résultat d’une élaboration commune. Ainsi Bullitt amène Freud à ne presque plus mentionner la pulsion de mort dans le livre. Pour schématiser la thèse de l’essai, les deux auteurs font de la fixation de Wilson à son père pasteur l’origine d’une homosexualité psychique passive sublimée dans une identification christique. La haine inconsciente envers le père est aussi la cause de ruptures définitives avec des amis surinvestis, comme le colonel House, son bras droit.
À l’issue de ce travail, Bullitt reprend une activité politique et, dans ce contexte, il juge la publication du Président Wilson inopportune, au grand regret de Freud qui aurait publié une première biographie psychanalytique. Soutien de Franklin Roosevelt, Bullitt est chargé d’établir des relations diplomatiques avec l’URSS et devient le premier ambassadeur des États-Unis à Moscou, avant d’occuper les mêmes fonctions à Paris de 1936 à 1940. C’est depuis ce poste qu’il joue un rôle déterminant pour permettre à Freud de quitter l’Autriche en 1938. Il envoie le chargé d’affaires américain à Vienne auprès de Freud pour manifester la protection des États-Unis et aussi récupérer le manuscrit du Président Wilson. Il rencontre l’ambassadeur d’Allemagne à Paris et fait intervenir l’ambassadeur des États-Unis à Berlin pour que Freud et sa famille obtiennent des visas de sortie. Un agent de l’ambassade américaine est chargé de veiller sur Freud pendant le voyage. Bullitt avec Marie Bonaparte accueille Freud à Paris à sa descente du train.
Après avoir négocié l’entrée des Allemands à Paris sans dommages pour la capitale, il rentre aux États-Unis en juillet 1940, considérant que le gouvernement de Vichy est fasciste et aspire à ce que la France devienne un vassal de l’Allemagne nazie. Cette position, en avance sur celle du gouvernement américain, amène son remplacement comme ambassadeur en France. Il joue un rôle dans la décision du débarquement américain en Algérie. Il tombe en disgrâce après avoir rapporté à Roosevelt les propositions homosexuelles qu’avait faites le sous-secrétaire d’état qui est contraint à la démission. Devenu un opposant à Roosevelt, il fait campagne comme journaliste pour que le gouvernement provisoire du Général de Gaulle soit reconnu par les États-Unis. Ne réussissant pas à s’engager dans l’armée américaine, il intègre les Forces françaises libres comme officier auprès du Général de Lattre et participe au débarquement en Provence. Après-guerre, les candidats à la présidence qu’il soutient ne sont pas élus et Bullitt arrête son activité politique, continuant à exposer ses idées comme journaliste.
Il persiste cependant à différer la publication du Président Wilson sous prétexte de ne pas publier l’ouvrage du vivant de la veuve de Wilson. Mais après sa mort, il continue à hésiter. Seuls quelques psychanalystes éminents, Ernest Jones, Max Schur, ont le droit de prendre connaissance du manuscrit avec d’infinies précautions. Patrick Weil met en avant des considérations politiques et religieuses pour expliquer les réticences de Bullitt à la publication du Président Wilson. Mais les psychanalystes peuvent aussi y voir la difficulté à exposer un objet transférentiel surinvesti. Il demande ainsi une avance astronomique de droits d’auteur et fait envoyer des Marines pour récupérer le manuscrit après que Jones l’a lu.
Le livre est finalement publié au moment de la mort de Bullitt à Paris en 1966, ses bonnes feuilles ayant fait la une de la presse américaine. Cette publication divise la communauté analytique. Anna Freud et Erik Erikson en contestent l’authenticité, Theodor Reik et Paul Roazen considèrent le texte comme une découverte majeure. Anna Freud met en doute le rôle de Freud dans l’écriture de l’essai, ne reconnaissant l’œuvre de son père que dans l’introduction. Elle avait proposé des corrections refusées par Bullitt. Le chapitre général, qui avait été traduit par Freud en allemand est publié en 2017 sous le titre Abrégé de théorie analytique.
Mais le manuscrit publié par Bullitt a été profondément modifié par rapport à l’original dont chaque chapitre a été signé par Freud et Bullitt. Patrick Weil l’a retrouvé dans les archives de Yale. Bullitt a procédé à plus de trois cents coupes et modifications dans le texte publié en 1966. Il prétend que ces corrections ont été faites avec Freud à Londres en 1939. Patrick Weil montre qu’il n’en est rien et qu’elles sont l’œuvre du seul Bullitt. Il a tout d’abord remplacé le terme instinct par Éros. Il a supprimé la référence à l’angoisse de castration. Surtout ce qui concerne l’homosexualité de Wilson est édulcoré. L’interprétation de la bisexualité du Christ à travers sa soumission au Père est supprimée. Patrick Weil explique les corrections de Bullitt par son souci de ne pas heurter les chrétiens et l’Église avec des interprétations sur l’homosexualité du Christ en pleine guerre froide. Il est alors devenu farouchement anticommuniste et proche de Nixon. Les psychanalystes pourront s’interroger sur ce que ces corrections révèlent de leur auteur et de ses défenses par rapport à l’homosexualité.
Après la lecture de cette passionnante biographie qui se lit comme un roman, il reste à espérer qu’une édition critique du Président Wilson soit publiée.
Alain Zivi est psychanalyste, membre de la SPP.
[i] Sigmund Freud and William Bullitt, Thomas Woodrow Wilson, a psychological study. Weidenfeld and Nicholson Ltd, Londres, 1966 ; Le président Thomas Woodrow Wilson, un portrait psychologique. Traduit par Marie Tadié. Paris, Albin Michel, 1967 ; Réédition Payot et Rivages, Paris, 2005.
[/expand-maker]Isabelle Alfandary, Science et fiction chez Freud. Quelle épistémologie pour la psychanalyse ?, Paris, Ithaque, 2021
 À l’heure où se référer aux exigences scientifiques de Freud est considéré comme audacieux quand ce n’est pas dénoncé comme anachronique, le livre d’Isabelle Alfandary est bienvenu. Depuis toujours, la psychanalyse est vivement interpellée, sommée de faire la preuve de sa validité. Le paradoxe étant que dans le même temps, elle n’a jamais été aussi présente dans des formes de vulgarisation normalisée, cantonnant la force et l’originalité de sa langue à une sorte d’esperanto applicable à des pratiques déliées parfois de toute théorisation et bien éloignées des exigences scientifiques auxquelles Freud tenait tant.
À l’heure où se référer aux exigences scientifiques de Freud est considéré comme audacieux quand ce n’est pas dénoncé comme anachronique, le livre d’Isabelle Alfandary est bienvenu. Depuis toujours, la psychanalyse est vivement interpellée, sommée de faire la preuve de sa validité. Le paradoxe étant que dans le même temps, elle n’a jamais été aussi présente dans des formes de vulgarisation normalisée, cantonnant la force et l’originalité de sa langue à une sorte d’esperanto applicable à des pratiques déliées parfois de toute théorisation et bien éloignées des exigences scientifiques auxquelles Freud tenait tant.
Avec son ouvrage Science et fiction chez Freud, Alfandary revient sur le projet freudien de fonder une science de l’inconscient « pour en examiner les prémisses, les problèmes et les impasses » (p. 6), en considérant la question de la scientificité toujours ouverte, c’est-à-dire susceptible de générer de nouveaux et féconds questionnements.
Le projet de cet ouvrage est né d’un séminaire qu’Alfandary animait au Collège international de philosophie sur les différents styles et genres d’écriture freudienne. Le constat s’est imposé d’une correspondance entre les styles de transmission et les modélisations épistémologiques élaborées au fur et à mesure par Freud pour appréhender au plus près les découvertes opérées par la clinique. Si Michel de Certeau (1987) avait déjà souligné l’existence de deux types de textes chez Freud (ceux pratiquant la théorie, ceux l’exposant), Alfandary propose d’aborder d’une manière inédite l’articulation des différents styles d’écriture freudienne avec des modèles épistémologiques spécifiques.
L’originalité et la force de sa proposition sont de relier la question de la validation scientifique à celle de la fiction. Elle montre à l’œuvre et rend pensable comment chez Freud la référence à la fiction œuvre bien au-delà même de l’ancrage dans la littérature (Shakespeare, Sophocle), et peut être envisagée comme « moyen d’exploration, de modélisation et de transmission de l’hypothèse de l’inconscient » (p. 9).
La fiction est l’« intuition théorique » (p. 10) que Alfandary met au travail avec beaucoup de finesse dans sa lecture de Freud de bout en bout du livre, délimitant ainsi son champ d’exploration de l’invention freudienne. Si Freud « ne reconnaît pas le concept de fiction pour sien » (p. 9), son usage – ici central et revendiqué comme tel – est placé sous l’égide d’une citation de Jean Laplanche (2006, p. 156) : « On ne doit pas priver un auteur [Freud] de ses propres limites. » Alfandary montre ainsi à la fois la valeur heuristique de la fiction et les limites sur lesquelles elle bute, appelant chaque fois l’élaboration d’un nouveau modèle. Elle en fait un opérateur épistémologique permettant d’interroger la scientificité de la psychanalyse, en n’omettant pas, suivant Laplanche (1993, p. 7), que « l’exigence, c’est quelque chose qui est dicté par l’objet […] c’est l’objet inconscient qui oriente l’évolution même de la pensée ». Il s’agit dès lors de « repenser la psychanalyse freudienne dans l’entrelacs entre science et fiction, et ce malgré la résistance, voire le déni, qui anime Freud face à un concept qui lui paraît antinomique de toute démarche scientifique digne de ce nom » (p. 10) – tant il craignait qu’elle ne soit versée dans le registre de l’idéologie ou de la croyance.
L’ensemble de l’ouvrage est dès lors placé sous le sceau du premier chapitre consacré à l’hypothèse de l’inconscient et à son régime paradoxal. L’argumentation d’Alfandary s’adosse au texte de Freud de 1915, L’inconscient, pour soutenir combien l’inconscient relève d’une hypothèse qui conditionne la possibilité du processus analytique opérant dans chaque situation clinique. Cette hypothèse de travail se mue en hypothèse de principe, qui précisément ne relève pas d’un régime de vérité. Cette préservation d’un statut d’hypothèse pour l’inconscient est fondamentale : elle permet de qualifier la psychanalyse comme science, car « elle valide la psychanalyse en suspendant la positivité de son savoir » (p. 32).
La valeur logique de l’hypothèse de l’inconscient, conçu comme la condition de possibilité des phénomènes qualifiés de « psychiques », est attestée par ses formations et ses effets, l’objet exploré – l’inconscient, la réalité psychique et en particulier le transfert et son agissement – ne pouvant être accessibles directement. La preuve de l’inconscient est ainsi obtenue par inférence selon une logique qu’Alfandary qualifie de « transcendantale » (p. 33), soulignant l’héritage de la philosophie des Lumières dont la psychanalyse relève le défi en se référant à Kant. Elle ressortit à l’entendement (et non à la raison) et au savoir (et non à la foi), et propose une connaissance médiate de phénomènes qui demeureraient sinon inexplicables. L’enjeu ne relève pas de la causalité, mais bien de la nécessité d’un principe qui ne peut être l’objet d’une expérience. Ainsi, l’hypothèse de l’inconscient s’inscrit dans une dialectique paradoxale : elle permet d’étendre les limites du connaissable, mais simultanément énonce les limites de la connaissance en rappelant que l’inconscient ne peut être reconnu que dans ses effets et dans l’après-coup de sa saisie. C’est bien « l’objet » à découvrir qui impose une mise au point progressive : « Le régime de la preuve est posé comme expérimental, cumulatif et rétrospectif, ce qui équivaut à repousser sine die sa validation » (p. 26-27). La méthode tente donc d’établir les conditions de son accessibilité et de son dévoilement.
« La science freudienne est en prise avec un au-delà qui ne peut qu’être postulé sans pouvoir être soutenu ou articulé sur le modèle d’un savoir positif » (p. 32). Cette formulation très éclairante proposerait-elle l’idée d’un au-delà d’un savoir attestable correspondant en même temps à un postulat nécessaire pour penser ? Autrement dit un au-delà par nature inconnaissable et par nature nécessaire qui impliquerait qu’à chaque cure « l’analyste est condamné à inventer », comme le soutient François Roustang (1976) ? Cela me semblerait convoquer la pensée de Piera Aulagnier, notamment la dialectique qu’elle souligne entre le toujours déjà connu de la théorie et le non encore connu porté par chaque cure. La démarche d’Alfandary nous oblige par ailleurs, selon moi, à nous interroger sur la nécessaire différenciation entre la théorie et la métapsychologie, au sens où la métapsychologie serait une spéculation à partir du contre-transfert alors que la théorie correspondrait à des propositions généralisables énoncées à partir des cures et de la psychanalyse appliquée. Différencier théorie et métapsychologie permet d’interroger en quoi elles sont en lien, toute théorie n’étant pas issue du contre-transfert. Jean-Claude Rolland définit la « pensée métapsychologique » comme « une pensée visionnaire transmise à l’analyste par son propre contre-transfert » – ce qui implique de poser la métapsychologie comme « une méthode de pensée visionnaire qui s’impose plus qu’elle ne se découvre, mais qui à la faveur de cette transmission s’approfondit » (2015, p. 303). Cette approche me paraît converger avec l’idée de l’autrice selon laquelle, pour sortir de l’impasse de la preuve, Freud cherche à valider son invention à partir de la transmission (p. 50). La fiction comme « tiers terme » permet alors d’imaginer les liaisons entre conscient et inconscient et viendrait suppléer à une représentation manquante. La fiction ainsi définie ne se situerait-elle pas d’abord du côté de la métapsychologie, au sens où elle procède d’une spéculation rendue nécessaire par l’élaboration du contre-transfert ?
L’ouvrage suit dès lors les différentes modélisations élaborées par Freud, selon un mouvement relativement chronologique, amplifié très opportunément par Alfandary à des fins didactiques.
Le premier modèle épistémologique est celui des Études sur l’hystérie, référé au registre de la fiction détective. À partir de l’énigme narrative du symptôme hystérique et de son nouage traumatique, la recherche de sens procède de l’intrigue dans une dynamique de causalité où la dimension anamnestique occupe une place importante. La démarche est celle d’une science détective, science des signes, des détails, qui permettrait de remonter à la scène des conflits psychiques, réduisant le fonctionnement de la psyché à une causalité évènementielle. Ce modèle, fonctionnel et explicatif, apparaîtra vite limité au fil des cures, trop simpliste, négligeant le caractère plurifactoriel de la symptomatologie et la complexité de l’intrication des causes et des effets dans la vie psychique. Freud va ainsi passer des récits de cure à des études de cas.
Le « modèle casuel », plus complexe, préside à l’écriture des grands cas cliniques, de « Dora » à « l’Homme aux loups ». Chaque cas freudien vaut d’abord par et pour lui-même. Chaque cure a été rédigée par Freud, le mettant à l’épreuve de la complexité et de la pluralité des formes appelées par sa restitution, inévitablement prise dans les rets de la technique et de la dynamique transférentielle. Ce qui fait cas est donc issu de réseaux d’intrications complexes entre le patient et l’analyste, entre l’histoire des symptômes et l’histoire du travail analytique, entre les matériaux psychiques et la forme de leur énonciation, entre le transfert du patient et le transfert de l’analyste. Alfandary écrit : « À cet égard, la preuve par le cas est toujours une preuve par le transfert et la preuve du transfert, la preuve de l’élément indéterminé et de la dimension irréductible de l’autre » (p. 48).
Avec « Dora », Freud met au jour certaines lois du fonctionnement psychique dans l’hystérie, permettant de soutenir des règles de reproductibilité de la méthode avec d’autres cas souffrant d’hystérie. Confronté au caractère intempestif et éruptif des effets de la cure, il découvre également le transfert à l’œuvre dans la cure. En écrivant sur sa patiente, il se rend compte que le travail analytique commence avec la limite, la résistance, c’est-à-dire le transfert et la butée du contre-transfert (qui ne sera théorisé qu’après). Alfandary souligne que dès lors toute modélisation « tranquille » n’est plus possible, et Freud passe à une épistémologie plus argumentative.
La rhétorique dans « l’Homme aux loups » est en effet plus défensive, l’enjeu étant de solliciter une adhésion du lecteur à ses nouvelles propositions scientifiques sans que cette adhésion soit assimilée à la croyance en un dogme. L’enjeu épistémologique consistant à ne pas céder sur la rationalité est à la mesure du scandale introduit par la prise en compte du caractère traumatique du sexuel infantile, « facteur cardinal organisateur de la psyché » et de l’importance de la construction/reconstruction comme suppléance à la remémoration. La médiation de la fiction de la scène primitive est nécessaire pour étayer le bien-fondé du caractère réel de la scène traumatique et assurer paradoxalement la rationalité de sa démonstration. Cependant, la relation entre le rêve et la scène originaire procède d’une nécessité qui relève néanmoins d’un saut associatif et logique. Il faut ainsi pouvoir suspendre délibérément son incroyance pour pouvoir suivre Freud sur les pas d’une crédibilité de sa démonstration, c’est-à-dire une démonstration de sa crédibilité.
Il me semble que l’idée de la fiction comme suppléance de la représentation manquante et comme exigence d’une spéculation provenant de l’expérience du contre-transfert pourrait être reliée au geste de Freud dans « l’Homme aux loups » consistant à faire voir la scène primitive. Cette idée accréditerait cette notion de « tiers terme » pour le concept de fiction.
Alfandary souligne combien avec ce cas « Freud a poussé la tentative de la preuve clinique de l’hypothèse de l’inconscient à sa limite » l’argumentation confrontant à la reconnaissance d’un point d’impossible dont témoigne l’extravagance de la « prière de croire ». Dans le prolongement de ce constat, je souhaite ici souligner un passage sous la plume de Freud : « le patient a adopté très tôt ma conviction ». Cela ne pose-t-il pas la question du rapport entre conviction et crédibilité, c’est-à-dire en quoi la conviction transférentielle et contre-transférentielle de l’analyste participe à la crédibilité de ce qu’il propose au patient ? Question d’autant plus compliquée quand on pense que l’argument de Freud pour convaincre le lecteur est la conviction du patient par rapport à l’interprétation de l’analyste. Ce qui pose la conviction du patient comme preuve (!) comme souligné par Jean-François Chiantaretto (1999).
Les nouvelles limites rencontrées seront néanmoins l’occasion d’une relance méthodologique (p. 157). C’est ainsi dans d’autres atours que la fiction apparaît dans les derniers chapitres : ceux de l’hypothèse fantastique des origines, autour de l’hypothèse anthropologique du meurtre du père et celle de la pulsion de mort, où chaque fois la fiction vise à rendre compte de la destructivité humaine. La notion de mythe scientifique est alors convoquée pour penser au-delà de ce qui est vérifié-vérifiable et/ou remémorable. Cependant, qu’il s’agisse du cas de « l’Homme aux loups » ou du modèle anthropologique, l’enjeu est d’atteindre la vérité historique sur le modèle de la fiction.
Le modèle anthropologique du mythe scientifique repose sur l’analogie entre animisme et névrose et plus largement entre le primitif, l’enfant et le névrosé, qui fonde l’analogie entre phylogenèse et ontogenèse. L’analogie entre culture et symptômes vise à mettre en rapport des phénomènes qui ne semblent pas avoir de lien en apparence et permettent à Freud de penser les processus de la vie psychique dans leur rapport à une généalogie des productions culturelles et sociales : de nouer le collectif et le singulier. Cependant, Alfandary pose une question fondamentale quant au risque de postuler une origine unique pour la névrose, la religion, la morale et la société, et de dériver vers une psychologisation du social (p. 201-202). Caractérisant Freud d’« incontestable mythographe » (p. 204), elle ouvre alors une nouvelle question : « une science est-elle justifiée à s’appuyer sur un mythe, fût-il scientifique ? »
La problématique de la pulsion de mort comme spéculation clôt le dernier chapitre de l’ouvrage. Si la pulsion demeure une construction théorique, « sans son inférence, toutefois, la psychanalyse serait incapable de formuler la moindre de ses thèses » (p. 206). La fiction sous forme de fable spéculative permet ainsi de soutenir l’hypothèse de la pulsion de mort. Et si la légitimité de la spéculation biologique est remise en cause par Freud lui-même, « elle éclaire une situation clinique observable et sinon incompréhensible : la contrainte de répétition » (p. 209).
L’hypothèse freudienne selon laquelle « au commencement était, dans tous les cas, la mort […] le principe de liaison n’intervenant que dans un temps second » (p. 215), relie les fictions anthropologiques et biologiques – Freud met « implicitement en rapport l’élémentaire de la vie cellulaire avec la complexité de la vie psychique » (p. 215). Si l’on peut s’interroger sur la soutenabilité d’un abord similaire pour ces deux plans, il n’en reste pas moins que la proposition de la fiction comme opérateur épistémologique remplit son pari.
L’ouvrage est un bel hommage au travail de Freud, à sa rigueur scientifique et à son génie. Il illustre brillamment la nécessité pour les analystes d’incessamment (re)conquérir le noyau épistémologique de l’hypothèse freudienne de l’inconscient.
Références bibliographiques
Chiantaretto J.-F. (1999). L’écriture de cas chez Freud. Paris, Économica.
Laplanche J. (1993). Le fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud. Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
Laplanche J. (2006), Problématiques VI, L’après-coup. Paris, Puf.
Roustang F. (1976). Un destin si funeste. Paris, Payot.
Rolland J.-C. (2015). Quatre essais sur la vie d’âme. Paris, Gallimard.
Catherine Matha est psychanalyste membre de l’APF
James A. Grotstein, Un rayon d’intense obscurité. Ce que Wilfred Bion a légué à la psychanalyse, Paris, Ithaque, 2016
 « Ce livre, écrit Antonino Ferro (2009), constitue une sorte de rêve sur l’ensemble de l’œuvre de Bion, qui permet de frayer la voie à un nombre infini d’associations. Un rêve qui n’est pas à décoder, mais qui perpétuellement ouvre la voie à de nouvelles pensées et développe l’aptitude même à penser. » C’est si vrai et en cela si proche de Bion, lui que Grotstein n’a pas manqué de considérer toujours en train de rêver.
« Ce livre, écrit Antonino Ferro (2009), constitue une sorte de rêve sur l’ensemble de l’œuvre de Bion, qui permet de frayer la voie à un nombre infini d’associations. Un rêve qui n’est pas à décoder, mais qui perpétuellement ouvre la voie à de nouvelles pensées et développe l’aptitude même à penser. » C’est si vrai et en cela si proche de Bion, lui que Grotstein n’a pas manqué de considérer toujours en train de rêver.
Pourquoi ce titre ? Bion communiqua à son analysant Grotstein cette indication de Freud : « Quand on conduit une analyse, il faut projeter un rayon d’obscurité intense afin de mieux faire luire dans les ténèbres ce qui jusque-là avait été obscurci par l’éclat de l’illumination. » Tout le livre se propose à la fois comme un magnifique hommage à son analyste, de même que comme une vaste réflexion sur l’œuvre de Bion dans une mise en perspective des différents liens et articulations qui la composent et l’animent, car cette œuvre est en constant mouvement, elle vit. De même que s’y trouvent aussi entretissées des pensées issues de leur vécu partagé. Toutefois, ce qui contribue à la qualité de ce livre exceptionnel est la manière dont Grotstein, non seulement met en valeur les idées de Bion, dans un mode d’exposition les approfondissant, mais propose aussi son propre développement à partir de ces idées. C’était un souci de Bion qu’elles ne soient pas institutionnalisées.
Si nous revenons à Bion, nous pouvons ainsi appréhender, à travers Grotstein, une œuvre qui est une formidable théorie de la connaissance commencée par l’identification projective des émotions et des pensées sans penseur, dans la mère, dont la capacité de rêverie et la fonction Alpha vont permettre leur transformation en pensées pensables, en sentiments, en pensées oniriques et en souvenirs. Que propose alors Bion en penseur de la clinique et particulièrement de la séance ? De se défaire de la mémoire et du désir pour faire place à la foi dans la réponse créative de l’inconscient, en supposant une orientation sur l’être et les « transformations » dans, depuis et vers O, la vérité absolue quant à la réalité ultime, ineffable. Ce qui nous conduit d’emblée au Bion « mystique », le plus souvent mal compris, et taxé de religiosité.
L’introduction du livre commence par « Le langage des grands accomplissements » que Grotstein explicite à partir de la communication entre l’enfant et sa mère, le patient et l’analyste, avec cette idée que les émotions charrient la vérité personnelle du sujet. Grotstein met alors l’accent sur la manière dont Bion rêvait en acte ses sentiments et ses écrits. De l’émotionnel, il met en valeur celui partagé, en définissant la réponse émotionnelle entre les deux protagonistes en lien avec une conception de l’inconscient caractérisée précisément par les émotions et l’imagination infinie. De la conception du besoin de l’autre pour devenir soi-même découle la pensée d’une théorie et d’une pratique clinique accordant au couple et à sa rencontre en devenir, le moteur des « transformations ». Les post-bioniens, comme Ferro et G. Civitarese, les situeront dans « le champ, ou le post-champ ». Il est intéressant de noter que Grotstein a le souci, pas si fréquent, de situer Bion dans le solide ancrage kleinien, mais avec l’indication d’une assomption de la position dépressive associée à la capacité négative qui permet de ne faire qu’un avec les émotions, permettant ainsi la rencontre avec le Soi créatif infini. Bion, selon Grotstein, visait l’atteinte de la foi et de la capacité négative afin de pouvoir devenir O.
Il nous montre clairement comment Bion a déplacé l’attention exclusive sur les pulsions vers les émotions et restructuré l’idée de pulsions en A, H, C, amour, haine et connaissance, en catégories émotionnelles pour ces liens. Bion, note-t-il, reconsidère la manière dont Freud appréhendait l’onirique en permettant à l’expérience inconsciente du rêve d’être pensée consciemment, alors qu’il entend l’étendre et le soumettre aux pensées du rêve, afin de les rêver. L’analyste, dira Grotstein, devra rêver la séance comme la mère rêve le vécu du nourrisson. C’est ainsi aussi qu’il sera possible de passer de la mentalisation à la pensée, à partir de la transformation des éléments Bêta en éléments Alpha, grâce à la fonction Alpha qui met en place et en ordre la vie émotionnelle. Grotstein ne manque pas de saisir le protocole transformationnel de Bion correspondant à un cycle mental et émotionnel.
Il pose alors avec la dimension du trauma et de la terreur sans nom les divergences d’avec Klein, plus à l’aise dans la psychose infantile, souligne Grotstein. Il propose que la divergence provienne, sans doute, du fait que Bion a ajouté l’infini à la pensée de Klein, ainsi que sa transformation du concept d’identification projective, alors que lui, Grotstein, va définir la trans identification projective comme une activité émotionnelle plus intense. Avec l’introduction du concept contenant-contenu, dont il analysera précisément la fonction qu’il donne à la mère et à l’analyste dans la relation en leur attribuant un état de rêverie qui manifeste la résonance avec l’état du patient, Grotstein insiste sur la nécessité, pour Bion, de s’immerger dans un état réceptif de rêverie, alors que, souligne-t-il, la théorie de l’esprit repose en partie chez lui, précisément, sur le concept de transformation et de rêverie.
Discutant du transcendantalisme de Bion, Grotstein explique que Bion retient les formes idéales qu’il rattache à Platon, alors que l’appareil sensoriel conçoit ces éléments comme « sens commun ». Dénommées « Mémoires du futur », précise-t-il, elles constituent ces instruments de la réalité psychanalytique qui servent à résonner avec O, vérité absolue ou vérité ultime.
Il faut rendre grâce à Grotstein de définir très clairement la métathéorie de Bion, conjuguant à la fois une théorie de la connaissance, une ontologie et une métapsychologie. À nouveau, Grotstein va se référer à Klein, dont la pensée, dit-il, est prolongée « avec élégance ». Cette référence est suffisamment rare pour être à nouveau soulignée. Mais il est vrai que Bion, analysé par Klein, était kleinien, et très proche de Rosenfeld, particulièrement du dernier Rosenfeld qui selon les dires de ce dernier, joua un rôle dans son installation à Los Angeles. Bion décédé, Grotstein reprit son analyse interrompue avec un kleinien. Mais revenons à cette métathéorie et comment la définit-il ? Il y place la vérité des expériences émotionnelles comme élément central avec, je le cite « la foi comme son gardien et comme présence qui plane au-dessus d’elle, et avec O comme à la fois ce qui initie ces expériences et ce qui les réal-ise. » Ce qui signifie, déclare-t-il, une sorte de transcendance qu’il entend démontrer. Et de se référer à O, le sujet des sujets qui ne peut être ni sujet des sens ni de contemplation. Or, comme il le dit, l’expérience de O est le privilège du sujet ineffable de la psychanalyse. Cet abandon du moi par l’analyste, qui pourrait nous faire penser asymptotiquement à la « dépersonnalisation » chez de M’Uzan, nous fait devenir O, ce que Grotstein propose de conceptualiser sous la terminologie de « position transcendante », qui se développe depuis l’enfance, y compris fœtale, à tolérer, et dit-il, à souffrir, et donc à être en résonance avec O, dénomination de l’être ou de l’existence en soi. On ne peut que penser à ce que Grotstein élabore en termes de « présence ». D’où cette définition afférente du mystique qu’il nous donne selon Bion, à savoir celui qui voit les choses comme elles sont vraiment.
Comme précédemment, Grotstein interroge à nouveau l’édifice kleinien, cette fois au niveau des positions dont on devrait dire, selon lui, qu’elles sont psychotiques tant elles sont omnipotentes. Elles doivent être pensées en termes de défenses maniaques, paranoïdes ou dépressives contre l’émergence de O. Ce qui le conduit à une véritable ontologie de la vérité qu’il oppose à l’objet obstruant qui s’attaque aux pensées et aux liens avec les autres objets, dégagé chez Bion avec ce qu’il décrit de façon saisissante, par exemple, de la projection à l’envers. Dans son analyse du contenant/contenu, qui lui fait suite, Grotstein rappelle les six étapes par lesquelles s’est effectué le développement des théories bioniennes :
- Le contenant/contenu et sa formalisation ;
- La fonction Alpha, comme propriété requise du contenant maternel ;
- Les transformations par les fonctions alpha, transformations des contenus d’éléments bêta correspondant à des impressions sensorielles non mentalisées d’expériences émotionnelles, en éléments Alpha, mentalisés et aptes à la réflexion, à la mémoire, au rêve, etc. ;
- L’attention conçue comme version spécialisée de la conscience, en tant qu’organe sensoriel réagissant aux qualités psychiques : conscience inconsciente, intuition, etc. ;
- O, le concept « définitoire » dit Grotstein, eu égard aux conceptualisations antérieures. N’oublions pas ici les transformations en O dont Grotstein va évoquer le refus par ceux qu’il appelle les « kleiniens de Londres » ;
- La vérité émotionnelle qui se transforme en O – la Vérité Absolue (indifférente, impersonnelle) quant à la Réalité ultime – en vérité personnelle tolérable (acceptable).
Grotstein semble ajouter ici un septième point, l’unisson, présent chez Bion, puisque la mère, non seulement autorise les communications émotionnelles projetées en elle à « incuber », mais elle leur permet aussi de résonner avec ses propres émotions originaires, issues de sa mémoire d’expériences conscientes et inconscientes. C’est ce qui va permettre le passage, comme Grotstein le souligne, à un sens personnel malgré l’impersonnalité initiale de O. Ne pas penser ce concept contenant/contenu sans référence à l’identification projective constituerait une erreur, car c’est lui qui trame les échanges dans le rapport intersubjectif mère/enfant, comme patient/analyste. Il concevra un seuil minimal de bonté dans ce contenant maternel, mais surtout il nous livre une analyse croisée du contenant/contenu et du holding winnicottien, extrêmement fine et utile, en grande partie traitée par Ogden dans : « Tenir, contenir, être et rêver » (2005/2012).
Le concept winnicottien d’environnement contenant : « holding environnement » est utilisé comme synonyme de contenant/contenu chez Bion, déclare Grotstein. Pour Winnicott, explique-t-il, l’enfant kleinien, dont Klein parle très précisément dans Le Sevrage (1937), est cet enfant actif, et selon lequel le sein est le fondement d’existence. Le second enfant, celui de Winnicott, c’est l’enfant en tant qu’il est. La mère du holding fonctionne en objet d’arrière-plan, se préoccupant de favoriser le développement autonome de son enfant. Ceci m’apparaît être une certaine interprétation du holding de Winnicott dont ce dernier n’a pas son pareil pour expliquer la faillite en termes de holding mécanique, facteur de grave dissociation notamment dans la névrose obsessionnelle. Peut-être que Grotstein, en la caractérisant de « coach existentiel », une présence en arrière-plan de l’identification primaire a-t-il tendance à en diminuer l’importance ? Les soins assurés de manière mécanique, sans ressources émotionnelles et affectives, ont un impact pathologique important chez l’enfant. D’une certaine manière, l’on retrouve cette idée dans la conception de Green de « la mère morte ».
La mère contenante de Bion soutient et absorbe les états émotionnels de l’enfant, en les transformant et en les lui « interprétant ». Or, remarque Grotstein, toutes les conceptions du contenant n’ont pas envisagé la fonction « transcendante » du contenant, par lequel le bébé acquiert la capacité de converser par le biais de la mère/analyste avec son autre Soi, son Soi inconscient infini. Grotstein nous invite, en référence aux ultimes implications de la théorie de Bion, à considérer santé et maladie mentales comme concernant l’activité du contenant, d’abord externe puis internalisé. O et non plus les pulsions, sauf la pulsion de vérité affirme-t-il, devient « cause première ». Tout va se trouver déterminé par les interactions entre O et le contenant.
Grotstein nous introduit alors avec subtilité à la trans-identification projective qu’il définit en lien avec l’identification de l’objet avec la projection qui a lieu en lui. Pour Grotstein, elle désigne la forme intersubjective de l’identification projective. Toutefois, selon lui, l’identification projective ne s’exerce pas entre le sujet et l’objet externe, mais entre le sujet et sa représentation de lui-même. Ici Grotstein cite le Bion de Cogitations qui affirme qu’il s’agit de la limitation imposée par nos sens qui ne nous permet pas de connaître véritablement la réalité, nous n’avons alors de l’objet qu’une image d’un objet internalisé. Grotstein propose à ce propos la conception d’un « co-sujet » qui forme aussi sa propre image du sujet qui se projette en lui. « Ultimement, une résonance mutuelle induite se produit entre ces deux images. » Nous pouvons donc considérer, et ceci a une incidence clinique considérable, que dans le modèle bionien à deux personnes (et non freudien ou kleinien à une seule), se produisent de multiples changements dynamiques dans la relation à l’objet dans son rôle de contenant. À nouveau, une comparaison avec la pratique clinique avancée par le dernier Rosenfeld s’impose au niveau de l’exigence de O qui domine sa clinique, en assurant au patient une renaissance authentique, sans apparaître bien sûr sous ce vocable tant la formulation conceptuelle de Bion lui est spécifique. O, objet de la transformation, devient « le coup de cœur » de la psychanalyse, déclare Grotstein pour affirmer plus avant que O est indifférent et impersonnel. « A, H. C lui donnent la personnalité », à savoir un sens personnel.
L’espace me manque pour déplier ici les différents liens que Grotstein relie dans le système transformationnel bionien. Le chapitre consacré aux « Transformations » en témoigne particulièrement. Ainsi, nous donne-t-il en exemple la recension de l’outillage théorique absolument nécessaire de l’analyste selon Bion. À propos des Transformation de O et en direction de O, Grotstein souligne que Bion n’a pas discuté ces transformations, or selon lui le sujet « devient » ce qu’il a expérimenté. C’est ainsi que le O impersonnel (ou destin) peut devenir la propriété personnelle du sujet.
Au terme de ce voyage, il me semble nécessaire dans ce commentaire en mouvement de Grotstein, de reprendre « L’activité du rêver » de Bion. Grotstein nous montre très bien comment la rêverie, la fonction Alpha, la barrière de contact, la grille, la césure, toutes ces conceptions qu’il a déployées et que je n’ai pas toutes reprises, appartiennent aux « structures de support » qui sous-tendent l’activité onirique, cette « jumelle » qui rend possible l’activité de pensée. Dans son épilogue, Grotstein définit la tâche de l’analyste selon Bion comme étant celle de rêver nos émotions et celles de nos patients. Il ajoute : « J’ai distillé le meilleur de Bion en termes d’activité onirique, d’activité de pensée et de devenir, avec pour horizon constant, les idées de Foi et de Vérité émotionnelles. » Quelle meilleure initiation à cette métathéorie que cette approche si remarquable ?
Béatrice Ithier est psychanalyste, membre de la SPP
Sous la direction de Patrick Landman et Denys Ribas, Ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes, Toulouse, Érès, 2021.
 L’objectif de l’ouvrage est précisé dans l’introduction : « Nous examinerons, pour mieux les dissiper, les confusions, hésitations et amalgames qui paralysent encore actuellement les débats sur l’autisme, non seulement entre les professionnels eux-mêmes, mais aussi avec les familles » (p. 8). La forme de l’ouvrage est une suite d’articles. Jacques Hochmann fait un rappel historique de la naissance et de l’évolution, en France, des divers cadres institutionnels dédiés aux enfants en difficulté. Il expose les modes de prise en charge fondés sur le modèle freudien et décrit six conditions d’efficacité : collaboration avec la famille, respect des routines, différenciation des espaces, temps de synthèse, mise en récit de la situation, supervision. Catherine et Alain Vanier dénoncent l’extension nosographique des troubles du spectre de l’autisme (TCA), expurgée de la notion de psychose infantile. Ils s’appuient sur l’apport de Maud Mannoni, qui évoquait l’étiologie somatique de l’autisme et l’insuffisance de la psychanalyse seule à prendre en charge ces enfants. Les auteurs s’interrogent sur les raisons de la transformation du débat scientifique en « guerre de religion ». Marie Selin utilise le modèle lacanien et fait une lecture fonctionnelle de la « structure autistique » : refus de l’autre, de la parole, maladie de la libido, défaut des frontières corporelles, jouissance qui se situe « sur un bord ». Cette structure se constitue sur « une absence d’objet (objet pulsionnel) radicale entre le sujet et son Autre ». Cet autre comme figure de l’absence contrarie l’émergence de la fonction imaginaire. La personne en situation d’autisme tente de réprimer son angoisse par l’immuabilité.
L’objectif de l’ouvrage est précisé dans l’introduction : « Nous examinerons, pour mieux les dissiper, les confusions, hésitations et amalgames qui paralysent encore actuellement les débats sur l’autisme, non seulement entre les professionnels eux-mêmes, mais aussi avec les familles » (p. 8). La forme de l’ouvrage est une suite d’articles. Jacques Hochmann fait un rappel historique de la naissance et de l’évolution, en France, des divers cadres institutionnels dédiés aux enfants en difficulté. Il expose les modes de prise en charge fondés sur le modèle freudien et décrit six conditions d’efficacité : collaboration avec la famille, respect des routines, différenciation des espaces, temps de synthèse, mise en récit de la situation, supervision. Catherine et Alain Vanier dénoncent l’extension nosographique des troubles du spectre de l’autisme (TCA), expurgée de la notion de psychose infantile. Ils s’appuient sur l’apport de Maud Mannoni, qui évoquait l’étiologie somatique de l’autisme et l’insuffisance de la psychanalyse seule à prendre en charge ces enfants. Les auteurs s’interrogent sur les raisons de la transformation du débat scientifique en « guerre de religion ». Marie Selin utilise le modèle lacanien et fait une lecture fonctionnelle de la « structure autistique » : refus de l’autre, de la parole, maladie de la libido, défaut des frontières corporelles, jouissance qui se situe « sur un bord ». Cette structure se constitue sur « une absence d’objet (objet pulsionnel) radicale entre le sujet et son Autre ». Cet autre comme figure de l’absence contrarie l’émergence de la fonction imaginaire. La personne en situation d’autisme tente de réprimer son angoisse par l’immuabilité.
Hélène Suarez-Labat expose ensuite les apports de Frances Tustin et Geneviève Haag. Pour Tustin, l’impossibilité de l’échange sensoriel précoce parents-enfant constitue un « trou noir », séquelle de séparation prématurée. Le développement psychique est présenté comme « production de formes » à partir des sensations corporelles. Dans l’autisme, les formes primitives ne sont ni intégrables ni partageables. Elles restent fixées de façon « bidimensionnelle », à la surface du corps. Haag développe la fonction d’enveloppe. Elle développe un schéma de contenance en boucles successives qui facilite la transformation de l’excitation en pulsion (sensations-affects). Le rythme, le regard sont des facteurs d’intégration.
Didier Houzel présente l’apport de Daniel Meltzer : exploration de la seule subjectivité, focalisation sur le transfert, référence à la théorie de la relation d’objet. Meltzer décrit le fonctionnement autistique à partir de son concept de démantèlement du moi, à savoir le déphasage des différents canaux sensoriels, nommé ici « défaillance de la comodalité ». L’apport essentiel est cette exigence d’attention soutenue : le thérapeute doit percevoir tout élément inquiétant, le verbaliser. Si Freud a théorisé le primat du pulsionnel en référence à l’arc réflexe vu comme unidimensionnel, Melanie Klein a introduit un troisième terme, l’objet, qui instaure une tridimensionnalité des interactions. La personne autiste évoluerait dans un espace intermédiaire, bidimensionnel. S’appuyant sur les travaux d’Esther Bick, de Wilfred R. Bion, Meltzer pense voit la personne autiste en défaut de contenance du fait de son contact unimodal, adhésif.
Jean-Claude Maleval expose la théorie du « bord autistique ». Il fait référence à l’hypothèse de Rosine et Robert Lefort d’une défense autistique contre l’angoisse par une interruption radicale du flux d’affects. L’objet autistique, trouvaille individuelle, devient un bord avec lequel la personne autistique entretient une relation fusionnelle. Si le thérapeute s’y intéresse, parvient à partager cet investissement, une modification de la communication peut advenir. La mise en sens n’est pas l’objectif. Il s’agit plus d’une mise à disposition comme objet partiel malléable. Une étape transférentielle fusionnelle peut signaler une avancée évolutive. Le thérapeute se mue alors en simple assistant « discrètement actif », pratiquant un « doux forçage », de type incitatif et non éducatif. Ce travail thérapeutique, sans remémoration ni interprétation, reste psychanalytique dans la mesure où il s’agit de percevoir les processus inconscients propres au fonctionnement autistique, de les comprendre, de les utiliser à bon escient.
Denys Ribas expose la nécessité d’une prise en charge précoce et intense, analytique et éducative, de l’autisme. Cette intervention relève, pour lui, d’une hospitalisation de jour à temps partiel ou d’un travail de groupe plusieurs fois par semaine. Il décrie les discours partisans, s’appuyant sur des modèles univoques, voyant à tort un rapport d’exclusion entre éducatif et thérapeutique, inné et acquis. Il reprend le modèle de Meltzer d’un fonctionnement bidimensionnel, ne contenant ni introjection ni projection, seulement un collage adhésif. Cette incapacité projective différencie l’autisme de la psychose. Ribas regrette que le cadre des psychoses non délirantes, dans lequel jadis était inclus l’autisme, ait été expurgé du DSM, de même que la confusion entraînée par la création de l’ensemble imprécis « Troubles du spectre de l’autisme ». Il décrit le mode de prise en charge analytique : respect de la temporalité propre à l’enfant, des stéréotypies, des alternances de fonctionnement duel ou tiercéisé, de la défaillance du masochisme primaire entraînant une incapacité du différé de l’action. Un lien est fait entre désintrication pulsionnelle et démantèlement, sorte de « clivage passif sans angoisse » (p. 151), autre marqueur différenciant autisme et psychose. Le dualisme pulsionnel est bien sûr actif chez les personnes en situation d’autisme, auto-sensualité sur un versant, temps circulaire de l’itération sans fin sur l’autre versant. La prise en charge institutionnelle permet un investissement intriquant des thérapeutes « par la mise en sens du matériel clinique que leur permettent leurs théorisations ».
Tristan Garcia-Fons évoque les aléas de l’inclusion scolaire. Il critique l’extension du domaine du handicap et un étiquetage diagnostic indexé sur le DSM nécessaire pour tout dossier MDPH, avec « le dernier avatar représenté par le nouveau paradigme des troubles neurodéveloppementaux » (p. 164). Pour lui, il existe des obstacles à l’inclusion scolaire : les troubles relationnels, les particularités sensorielles, les difficultés de l’image du corps.
Nora Markman met l’accent sur la spécificité du dispositif transférentiel. « L’analyste décrit, toujours, ce qui est fait, prêtant parfois une intention de jeu aux actes de l’enfant. » Dans cette mise en langage de chaque instant, nomination à l’adresse de l’enfant construisant un récit à deux, l’analyste « met le rapport à son inconscient au service d’autrui » (p. 180).
Chantal Lheureux-Davidse présente un aspect neurophysiologique : l’inversion, à la naissance, du système GABA, qui ralentit la croissance neuronale et permet au bébé de ne pas être submergé par trop d’informations et de sélectionner celles qui proviennent de l’environnement humain. L’enfant autiste n’aurait pas ce « GABAschift », donc ce filtrage. Le travail en psychothérapie vise à l’aider à opérer cette sélection dans ses afférences sensorielles brutes. Il prend en compte la douleur, la souffrance, la violence que le retentissement neurovégétatif de ce défaut provoque. L’accordage, la mise en mots l’aident à cette conversion des sensations en perceptions.
Dominique Tourres-Landman développe l’intérêt du psychodrame individuel dans la prise en charge des autistes à haut potentiel. Ce cadre thérapeutique permet à ces adolescents ayant un langage, par la mise en scène, de sortir de leur isolement. La relation y est initialement désirée comme dyadique, immuable, sans fantasme. Le respect d’une temporalité très graduelle est essentiel.
Pierre Delion expose les conditions de l’accès à la symbolisation. La représentation de mot rassemble, par son abstraction supérieure, les éléments épars de la représentation de chose, savoir les données sensorielles. L’auteur fait appel à la sémiotique selon Peirce, pour distinguer icône, indice, symbole. L’enfant autiste fonctionnant en mode adhésif ne peut prendre la distanciation nécessaire à l’analogie, essentielle à la symbolisation. Il reste au niveau iconique, et c’est pourquoi les pictogrammes l’aident, par conditionnement, mais ont vocation à être prolongés, au-delà de leur aspect purement fonctionnel, pour stimuler la symbolisation.
Bernard Golse fait un exposé sur les stéréotypies qu’il présente comme un évitement de l’objet. Le mouvement vers l’objet de façon unimodale interdirait de le ressentir comme extérieur à soi et déclencherait un contre-mouvement de retrait. Les états post-autistiques pseudo-obsessionnels seraient une séquelle de cet évitement itératif.
Jean-Michel Thurin propose les résultats d’une étude de recherche en conditions naturelles de personnes autistes. Il s’agit d’une analyse des résultats de soixante-six psychothérapies à partir d’instruments de mesure posés au départ, puis à deux, six et douze mois du processus, composés d’une vingtaine d’items. L’objectif était d’évaluer les résultats de la psychothérapie (étude quantitative) et de chercher à en préciser le mode d’action (étude qualitative). L’analyse factorielle permet une comparaison entre familles de psychothérapies (TCC/psychodynamique). Les données étudiées montrent le caractère caricatural de cette opposition et relativisent le sens des étiquettes et leur influence sur les pratiques réelles.
La dernière partie de l’ouvrage se compose de témoignages. Simon Marie, personne autiste, partage ses connaissances sur cette différence neurologique, d’origine neurodéveloppementale qui entraîne des perturbations du développement affectif et cognitif. Il insiste sur la minorité que représente l’autisme de Kanner, par opposition à la majorité de syndromes d’Asperger, autisme sans déficience intellectuelle, sous-diagnostiqués. Le défaut d’empathie, d’habiletés sociales, le besoin de solitude, l’introversion sont présentés comme des spécificités qu’il ne s’agit pas d’annuler, mais d’aider. Pour lui, ce tableau est en adéquation avec le projet psychanalytique qui ne dépend pas que des critères de la médecine par les preuves et ne vise pas a priori la disparition des symptômes. Simon Marie revendique que l’autisme d’Asperger soit reconnu comme une forme d’intelligence particulière.
Mireille Battut fait récit de son expérience de mère d’enfant autiste suivi en psychothérapie analytique. Elle fut bouleversée le jour où son fils, sans langage, a porté une main à l’oreille et s’est mis à chanter, d’une voix juste et assurée. Une passion secrète devenait support d’investissement intense et occasion d’une durable percée évolutive. Elle s’insurge contre les conditions de l’inclusion scolaire. « Faire société, au singulier pluriel » (p. 271) serait une approche qui respecte l’être au monde différent des enfants autistes, à commencer par une prise en charge éducative et psychothérapique.
Françoise Rollux est également mère, mais d’un enfant autiste maintenant adulte et fait récit de la psychothérapie dont il a profité. Il s’est d’abord agi, pour le thérapeute, d’assurer « une clôture » à un enfant qui ne semblait percevoir en lui ni au dehors aucune limite. Un apaisement trouvé, il s’est ensuite agi de commenter ses bruits, gestes, mouvements, sans interpréter. La longue prise en charge a fait prendre conscience à Françoise Rollux la part de sa propre angoisse, de son histoire familiale, dans la détermination des états émotionnels de son fils. Un détachement était nécessaire. Une synergie a pu s’opérer entre le cursus de la mère et celui de son fils.
Patrick Sadoun, père d’un enfant autiste, revient sur la querelle française, sur la recommandation de la HAS de mars 2012, document dans lequel on ne trouve aucune condamnation de la psychanalyse qui est seulement qualifiée de non consensuelle, ce qui, en soi, n’est pas une nouveauté. Le texte est prudent, rappelant en introduction la nécessité du colloque singulier afin de définir ensemble les soins appropriés, entre choix éclairé du patient, observation du clinicien et dernières connaissances scientifiques. Il regrette l’intolérance de certaines associations de parents crispées dans un besoin de certitude.
Philippe Marie Reliquet fait également part de son expérience de père d’enfant autiste. Il évoque le travail de décryptage des techniques originales de communication de sa fille : détournement, refus, chansons, humour, sincérité, fatigue. La psychothérapie et la facilitation par le rapport duel ont permis un apaisement et la compréhension de ses attitudes. Il affirme, lui aussi, la complémentarité des méthodes éducatives et de la psychothérapie.
Dans leur conclusion, Patrick Landman et Denys Ribas destinent ce livre aux médias et aux décideurs. Ils soulignent les points de convergences entre professionnels de formation analytique, la place du sujet, la dimension éthique de la relation… Ils évoquent aussi les points de divergence, comme la possibilité d’une sortie de l’autisme. Ils dénoncent l’activisme sectaire de certaines associations de parents qui discréditent l’approche psychanalytique de l’autisme. Ils affirment le caractère irremplaçable de l’écoute analytique de la souffrance psychique que représente l’autisme. Ils retracent l’évolution scientifique des psychanalystes qui ne reconnaissent plus l’autisme comme une psychose qu’il faudrait guérir et qui incriminerait les parents. Ils contestent certains modèles neurocognitivistes, comme le lien entre théorie de l’esprit et autisme, et l’origine uniquement neurodéveloppementale des perturbations sociales observées. Le statut du diagnostic psychiatrique pose un problème : il était discriminatoire et confidentiel jadis, réservé aux praticiens. Sa communication devenue obligatoire le transforme en identité revendiquée. Plus encore, il semble contraint par les catégories scientifiques, mais aussi politiques, du DSM, qui peuvent déranger. Ils sont d’avis que les psychanalystes devraient davantage mettre en place des programmes de recherche à partir d’études cliniques randomisées comme Jean-Michel Thurin en présente ici. « Il est primordial de démontrer l’efficacité de la psychanalyse » (p. 311).
En conclusion, il nous a semblé que la vocation pédagogique affichée par les auteurs entrait en contradiction avec la forme choisie, c’est-à-dire la succession d’articles indépendants. La volonté politique de faire démarche commune rend l’ouvrage éclectique, hétérogène, rassemblant des auteurs aux positionnements parfois opposés (sur l’origine neuro-développementale, la sortie de l’autisme, le statut de symptôme, l’évolution nosographique, la neuro-atypie) qui peuvent induire chez le lecteur un sentiment de confusion. Néanmoins, cet important travail permet d’actualiser la spécificité de la prise en charge psychothérapique de l’autisme, en parallèle à celle des méthodes éducatives. Il montre l’évolution scientifique des psychanalystes, loin des caricatures figées, leur humilité dans la reconnaissance des erreurs du passé, le caractère irremplaçable de l’écoute analytique de la souffrance de la personne en situation d’autisme, et de ses proches. Souhaitons que notre ministre de la Santé, dans les moyens de transport, entre conseil de défense, conférence de presse, visites de terrain, ait le temps de le lire.
Jacques Boulanger est psychanalyste, membre de la SPP.
Sous la direction de Dominique Bourdin et Dominique Tabone-Weil, Planète en détresse : fantasmes et réalités, Paris, Puf, « Débats en psychanalyse », 2022.
 Planète en Détresse, ouvrage collectif de la collection des « Débats en psychanalyse », propose une prise de conscience et une réflexion infiniment novatrice pour la psychanalyse. Car il ne s’agit pas seulement de réfléchir, comme Freud nous y invite dans Malaise dans la Culture (1930a ) à un nouveau traumatisme collectif dans l’intrication des psychologies individuelles et groupales. Il s’agit, comme le proposent les directrices de ce volume, Dominique Bourdin et Dominique Tabone-Weil, d’ouvrir un débat sur une détresse dans la Nature qui compromet définitivement la vie, une Nature déjà largement endommagée par la destructivité humaine. La menace que les confinements ont fait peser sur nos capacités analytiques nous a permis d’en mesurer l’ampleur et d’y réfléchir après-coup. Nous ne pouvons pas, à la suite de Freud dans ce texte historique « Éphémère destinée » choisi pour introduire le livre, envisager de « reconstruire tout ce que nous avons détruit » en élaborant notre « deuil de la perte », car la destruction est définitivement en marche. Mais les auteurs de ce livre, loin d’être dans le déni ou le catastrophisme, nous offrent un espace de pensée pour continuer d’élaborer les détresses collectives et individuelles. Ce travail de culture consiste à dompter les forces mortifères à l’œuvre dans les fantasmes destructeurs, mais également sauveurs, suscités par le désastre écologique.
Planète en Détresse, ouvrage collectif de la collection des « Débats en psychanalyse », propose une prise de conscience et une réflexion infiniment novatrice pour la psychanalyse. Car il ne s’agit pas seulement de réfléchir, comme Freud nous y invite dans Malaise dans la Culture (1930a ) à un nouveau traumatisme collectif dans l’intrication des psychologies individuelles et groupales. Il s’agit, comme le proposent les directrices de ce volume, Dominique Bourdin et Dominique Tabone-Weil, d’ouvrir un débat sur une détresse dans la Nature qui compromet définitivement la vie, une Nature déjà largement endommagée par la destructivité humaine. La menace que les confinements ont fait peser sur nos capacités analytiques nous a permis d’en mesurer l’ampleur et d’y réfléchir après-coup. Nous ne pouvons pas, à la suite de Freud dans ce texte historique « Éphémère destinée » choisi pour introduire le livre, envisager de « reconstruire tout ce que nous avons détruit » en élaborant notre « deuil de la perte », car la destruction est définitivement en marche. Mais les auteurs de ce livre, loin d’être dans le déni ou le catastrophisme, nous offrent un espace de pensée pour continuer d’élaborer les détresses collectives et individuelles. Ce travail de culture consiste à dompter les forces mortifères à l’œuvre dans les fantasmes destructeurs, mais également sauveurs, suscités par le désastre écologique.
Dans son article intitulé « L’investissement massif de la décroissance écologique, un avatar inconscient de la jouissance dans le dépouillement et la castration », Jérôme Glas propose de réfléchir à la mise en jeu du complexe de castration face à la menace écologique énoncée par le socius. Une menace réelle, perceptive, qui peut résonner avec un manque inhérent à la catastrophe annoncée. Cette menace pourra être reprise dans le registre de la névrose et, sous l’égide d’un surmoi post-œdipien efficient, inviter après-coup à des formes de renoncement tempérés tenant compte des impératifs environnementaux. Glas souligne au passage la richesse des travaux scientifiques et culturels (dont ceux de Hans Jonas en 1979) dont chaque individu pourra disposer pour aménager ces compromis psychiques. Mais, comme le titre de son article l’indique, Glas utilisera ses précédents travaux de recherche pour proposer de façon très argumentée une autre forme de résistance psychique face à la menace climatique : celle où l’organisation infantile du complexe de castration volerait en éclats pour laisser la place à une psychologie des Masses où les valeurs d’une décroissance militante occuperaient l’idéal du moi (je parlerais plutôt de moi idéal ?) individuel et collectif. Glas fait allusion aux travaux d’André Green pour montrer que l’idéal du moi peut devenir le lieu d’un idéal de pureté morale qui prendrait ici la forme de la jouissance du dépouillement à l’œuvre chez les activistes d’une « écologie radicale posant la décroissance en idéal absolu à atteindre ». Cet objet désincarné serait le lieu d’une jouissance absolue et sans limites dans une régression à un état où la représentation du manque ou de la castration serait éliminée.
Lorsque la réalité externe, ici la pandémie et ses résonances catastrophiques avec les enjeux climatiques, réveille des fragilités narcissiques précoces, pouvons-nous maintenir les fondamentaux de la situation analytique ? Rémy Puyuelo a su inventer un cadre pour son patient, Noé, qui préservera ses espaces de vie grâce à un espace de soin et de jeu où être « psychanalytiquement non psychanalyste » permettra à Noé de devenir patient. Dans un premier temps, il s’agira de recevoir la femme de Noé avec son accord. Le récit de la vie de son mari permet à Puyuelo de mesurer comment le confinement a pu menacer une identité narcissique précaire faute de « lieu psychique d’ancrage » (Ysée Bernateau). L’achat par Noé d’un abri montagnard à l’air pur pourra se représenter comme un « cluster de survie », une prothèse identitaire, qui permettra à la nouvelle maison psychique de Noé d’être investie par toute sa famille dans un plaisir partagé. Puyuelo utilise le jeu de l’enfant à la ficelle (Winnicott) pour créer un cordon entre lui et sa femme, double de l’analyste. La ficelle prendra la forme d’une BD (Genèses apocalyptiques, de Lewis Trondheim, 1999) où les jeux de case inviteront Noé à une narration moins clivée, plus libre, habitée de sensorialité. Mais c’est une autre BD prêtée à Noé, La mort farceuse de Trondheim (1999), qui provoquera sa décompensation sous forme d’attaques de terreur et sa venue en consultation avec les ficelles de la première situation analytique avec sa femme. Puyuelo poursuivra avec un homme dont les défenses maniaques ne sont plus opérantes, et dont la survie psychique s’accroche à l’espace contre-phobique représenté maintenant par l’analyste. Le jeu des productions culturelles, ficelles d’une tentative de figurabilité graphique, se poursuit avec les dessins sur le Déluge de Léonard de Vinci que partagera son analyste avec Noé. Figures de la vieillesse et de l’exil, ces dessins permettent à Puyuelo d’interpréter l’abri psychique montagnard comme un lieu de sépulture. Le sentiment de vieillesse peut être représenté par le désir du désinvestissement du monde, le négatif d’un lieu psychique qui aurait toujours manqué à Noé. Cette interprétation permettra à l’analyste de proposer à son patient un abri vivant, chez un autre thérapeute, où Noé pourra s’approprier un préconscient à lui, fort de son emprunt auprès d’un analyste d’un espace psychique réanimé par le jeu de productions culturelles dans un cadre au secours de la fortification du moi.
Nous ne sortons pas indemnes de « L’animal en soi(t) », article d’Anne Maupas qui nous fait vivre le combat de l’anthropologue Nastassja Martin (dans son livre autobiographique Croire aux fauves) avec un ours du Kamchatka, ou le combat d’une jeune patiente dont le « transfert animal » maintient sa psychanalyste aux aguets. Car il ne s’agit pas seulement de réfléchir à l’animalité en nous, « trace de l’expression de notre pulsionnalité, ou symbole de l’objet inatteignable », comme le proposera sa thérapeute à Martins, mais de nous confronter à la « problématique ancestrale de la coexistence des êtres vivants » au cœur du travail de civilisation. À partir des travaux de l’anthropologue Philippe Descola sur la pensée animiste, Maupas éclaire le voyage psychique de Martins, étayé sur un corps et des rêves empreints de sa lutte avec l’ours, pour réfléchir aux limites et aux rencontres mythiques entre les espèces vivantes. Travailler sur ces limites permettra à la patiente de Maupas de découvrir un « entre-deux », espace psychique intérieur où le travail des limites entre les espèces, les sexes et les générations lui permettra d’investir de façon plus apaisée son combat pour un monde meilleur. La pensée cosmogonique (créatrice du monde) à laquelle nous invite Maupas suppose de supporter un certain degré d’anarchie (Nathalie Zaltzman), de désordre ou de désorganisation nécessaires pour nous confronter aux risques vitaux issus de notre rapport à l’environnement non humain. L’attaque récurrente des territoires de la psychanalyse permettra-t-elle aux psychanalystes de renouveler leur capacité à interroger les combats et les revendications nécessaires aux choix de l’avenir du monde ? Pour Martine Girard, il s’agira d’interroger les vécus de catastrophe existentielle à la lumière des travaux de Winnicott sur la psychose dans ses liens avec les défaillances de l’environnement précoce de double dépendance mère-bébé. Son article propose une analyse rigoureuse de l’utilisation abusive du texte posthume et inachevé de Winnicott sur la « crainte de l’effondrement », utilisation qui néglige les doutes et les confusions que Winnicott entretient lui-même dans ce texte qu’il présente « comme l’envers de sa théorisation sur l’environnement précoce ». À l’aide de la métapsychologie freudienne, Girard propose de donner aux vécus d’effondrement dans la cure la place de ces traumas impensables qui se transformeront en représentations psychiques grâce au transfert sur un environnement thérapeutique fiable, mais inévitablement frustrant. Il s’agira pour le patient d’éprouver les effets d’annihilation des défaillances précoces de l’environnement pour se les approprier pulsionnellement grâce à la colère qu’il pourra adresser à l’analyste. L’invitation à vivre ces « moments psychotiques » dans la cure ne relève pas d’un phénomène universel renvoyant chacun à la précarité de la condition humaine dont nous consolent les mythes et la religion. Il s’agit de réaménager dans la cure ces défenses radicales contre la désorganisation, dont Winnicott souligne qu’elles peuvent prendre la forme de désorganisations actives, en offrant un environnement thérapeutique de soin dont de nombreux travaux (comme ceux de Elsa Grubrich-Simitis) montrent qu’il s’agit d’atteindre certaines souffrances et non de les interpréter. Et tout cela « sous réserve de ne pas confondre les accidents psychotiques dans la cure et les psychoses avérées » qui relèvent de travaux psychiatriques comme ceux de Jules Cottard ou François Tosquelles dont Girard souligne la spécificité. L’impensable de la fin du monde, de la disparition de notre propre espèce, nous inviterait-il à un travail de pensée sur les racines infantiles de l’expérience de la perte, afin de nous constituer un abri, une « maison de l’instant », avec une confiance retrouvée ? Tel serait l’enjeu que proposent Catherine Bruni et Jean-Baptiste Dethieux dans des « constructions de sens » faisant appel à des productions culturelles ancrées dans des histoires individuelles comme ceux de Günther Anders (2002), Bertrand Vidal (2012), Ernesto De Martino (2016), Éva Weil (2020), Lars Von Trier (2011), ou Luc Magnenat (2019). Ces productions culturelles nous invitent à donner aux angoisses d’anéantissement, de perte ou de castration, une trame narrative dans un travail de tissage entre l’intime et le collectif. L’irreprésentable des traumas précoces trouverait un « attracteur narratif » dans les récits collectifs de fin du monde, mais les angoisses œdipiennes, et leurs désillusions parfois catastrophiques, pourraient également s’élaborer dans cet aller-retour entre déni et travail de figurabilité. L’exigence de travail imposée par les racines infantiles de nos pertes serait-elle le seul moyen de remédier à l’excès de réalité de la dernière menace de « fin du monde » ?
De façon saisissante, Magnenat illustre par une interruption brutale d’analyse à la sortie du confinement, comment nous, psychanalystes, pourrions partager avec nos patients à notre insu une détresse sans lieu psychique, qui nous conduirait à l’abandon de notre position analytique. La réflexion très élaborée de Magnenat sur la façon dont la clinique désincarnée du confinement, sans présence physique, nous a privés des résonances corporelles nécessaires à notre travail, mais nous a également propulsés dans une psychologie de masse où nous partagerions la condition de victime avec nos patients, prend une dimension dramatique dans son exemple clinique. Son patient invitera pendant le confinement son analyste à figurer ses angoisses psychotiques sous la forme d’un SDF, ce qui lui permettra de supporter l’attente du retour au cabinet. Mais ce retour provoquera la décision brutale d’interrompre l’analyse dans un recours à un tableau sur un mur de Magnenat, où figure le mot « manque », pour signifier l’absence de « lieu à soi », dans cette condition de SDF que le confinement aurait représenté en ce début d’analyse. Ce manque de « lieu à soi » a été entretenu par une collusion inconsciente où la langue partagée serait devenue ce qu’elle « représente plutôt que de représenter ce qui se vivait », comme dans l’œuvre de Samuel Beckett citée par Magnenat. Privé de capacité de symbolisation, l’analyste devient lui-même sans lieu à soi, renvoyé à la condition universelle des SDF orphelins de la Nature qui donne la vie. Nous ne savions pas que nous étions riches, ce titre également en conclusion de l’article de Magnenat, résonne tragiquement avec la crainte de ne plus disposer de la richesse d’un cadre analytique en soi, à l’abri des « stimuli extérieurs », pour héberger la détresse de nos patients que nous pourrions partager avec eux à notre insu.
Entendre la détresse écologique et ses retentissements mélancoliques comme une lutte contre la perte d’un monde, celui d’avant chez les adolescents et les jeunes adultes, permet à Amélie de Cazanove de nous proposer une clinique où les revendications militantes, leurs « poids d’auto-accusation comme revers des attaques des générations précédentes », devront trouver dans le travail analytique une ouverture vers l’ambivalence et le tiers dans l’épreuve du transfert. Ce tiers introuvable chez cette jeune patiente suicidaire, qui idéalise son analyste pour mieux la rendre impuissante, prendra la forme d’une production culturelle, Melancholia (2011) de Lars von Trier. Alimentant la rêverie secrète de l’analyste, le double visage des héroïnes mélancoliques et soignantes du scénario permettra de faire émerger un objet primaire précocement désinvesti, mais infiniment ravageur dans le transfert sur l’analyste. La connaissance et le travail de recherche cinématographiques de Cazanove lui permettent de nous montrer comment le cinéma se prête aux logiques de survie dans des scénarios catastrophes où la subjectivation en danger peut trouver refuge dans cet espace culturel intermédiaire qui échappe aux enfermements idéologiques.
Dominique Tabone-Weill utilise les travaux de recherche de ceux qui continuent de penser l’impensable de nos désirs inconscients et autodestructeurs à l’œuvre dans l’épuisement de notre Terre-Mère, pour démontrer, de façon très argumentée, comment les concepts psychanalytiques peuvent nous aider à dénoncer les forces mortifères en jeu dans les revendications du côté de la dénonciation comme de la réparation. Le refoulement de notre avidité destructrice nous permet-il de maintenir au niveau de fantasme archaïque la réalité de notre destructivité ? Ou l’idéalisation de la mère Nature en paradis perdu par le militantisme écologique permet-elle à contrario de nous maintenir dans l’impuissance de l’enfant coupable devant une punition méritée ? Les effondrements collectifs impensables des siècles derniers nous conduiraient-ils à revivre un effondrement faute d’avoir pu prendre en compte les précédents ? Ou l’illusion que nous pourrions vaincre les forces qui détruisent notre environnement serait-elle un vœu inconscient d’immortalité ? Les prophéties apocalyptiques seraient-elles alors une version déguisée de la pulsion de mort et du vœu déguisé de la mort de notre planète ? Et les psychanalystes eux-mêmes, sous couvert de la dénonciation des excès des deux camps opposés, n’auraient-ils pas participé à l’inertie de la pensée face à la destructivité en marche ? De nombreuses questions intriquant l’individuel et le collectif à la lumière de nos outils de psychanalystes permettent à Tabone-Weill de conclure sur la nécessité de continuer d’interroger nos parts subjectives, Thanatos en chacun de nous, dans notre responsabilité de l’hubris collective à l’origine de cette menace planétaire. Le travail de culture, son invitation au renoncement à l’hubris pulsionnelle, n’est-il pas le propre de la cure analytique ?
Dominique Bourdin et Dominique Tabone-Weil, psychanalystes, membres titulaires de la SPP
sous la direction de Kostas Nassikas, L’absence. Aux origines du signe et du transfert, Paris, L’Harmattan, 2021.
 Kostas Nassikas, psychanalyste membre de l’Association psychanalytique de France, responsable médical de la Maison des Adolescents du Rhône et chargé de cours en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Lyon-1, a déjà publié, outre Exils de langue (2011, Puf), dont Bernard Golse a rendu compte dans notre revue (2012/3), en tant que directeur deux ouvrages importants : Fabriques de la langue (2012, Puf, « Le fil rouge »), et Autorité et force du dire (2015, Puf, « Monographies de la psychiatrie de l’enfant »). Tous deux ont pour point commun avec le présent ouvrage, outre le fait d’être tirés de colloques, de faire se rencontrer psychanalyse, sémiotique et linguistique, mais aussi philosophie et poésie, autour de la place du langage dans le processus d’humanisation (on retrouve ainsi dans ces différents ouvrages certains auteurs). Le thème de l’absence, ainsi que l’indique son sous-titre, est tout particulièrement en jeu dans cette rencontre.
Kostas Nassikas, psychanalyste membre de l’Association psychanalytique de France, responsable médical de la Maison des Adolescents du Rhône et chargé de cours en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Lyon-1, a déjà publié, outre Exils de langue (2011, Puf), dont Bernard Golse a rendu compte dans notre revue (2012/3), en tant que directeur deux ouvrages importants : Fabriques de la langue (2012, Puf, « Le fil rouge »), et Autorité et force du dire (2015, Puf, « Monographies de la psychiatrie de l’enfant »). Tous deux ont pour point commun avec le présent ouvrage, outre le fait d’être tirés de colloques, de faire se rencontrer psychanalyse, sémiotique et linguistique, mais aussi philosophie et poésie, autour de la place du langage dans le processus d’humanisation (on retrouve ainsi dans ces différents ouvrages certains auteurs). Le thème de l’absence, ainsi que l’indique son sous-titre, est tout particulièrement en jeu dans cette rencontre.
La contribution de Nassikas, « Absence et création du signe dans le transfert », met en évidence l’intérêt de cet abord pluriel. La réflexion sur le pouvoir de « recréation constante » (Saussure) du langage éclairera en effet le processus de la cure, « reprise du besoin de création des lieux psychiques du sujet pour ce qui, de son histoire vécue, n’a pas eu de tels lieux ni des représentations psychiques » (p. 59). Les références au « mimisme » chez Marcel Jousse, au « chiasme » chez Maurice Merleau-Ponty, qui soulignent le lien corporel du sujet à l’environnement, éclairent les premières étapes du développement qui permettent de « maintenir présent l’objet qui est sensoriellement absent », processus dont la représentation psychique sera une étape ultérieure. Or ce sont ces mêmes premières étapes que l’on retrouve dans l’actualisation et l’agir transférentiels. L’auteur distingue en effet deux processus de sémantisation dans la cure, le premier qui passe par la langue, le deuxième qui « passe autant par la parole que par les actes ou les gestes du patient et de l’analyste […] visant la satisfaction pulsionnelle, ici et maintenant, par des ‟objets” incarnés par et dans la personne de l’analyste » (p. 59-60).
Cette compréhension est alors illustrée par une vignette clinique. La visée de la cure sera de transformer « ces ‟actes transférentiels” dont il est question ci-dessus, en actes langagiers [c’est-à-dire] quelque chose qui est plus près de l’acte : le mouvement qui met en lien le besoin pulsionnel du sujet vers l’objet de satisfaction, ‟objet” qui a été repéré, mais pas représenté dans l’espace transférentiel » (p. 65).
Cette distinction entre « repéré » et « représenté » amène l’auteur à se référer à la notion de pointage (deixis) étudiée dans le développement du bébé, et à la distinction, à la suite de Pierce, de trois niveaux de connaissance : primaire, secondaire, ternaire, ce dernier introduisant à la tiercéité, la dimension institutionnelle, la représentation des absents ; il permet aussi de passer du jugement d’attribution au jugement d’existence ; il sous-entend acquise la distinction entre signes de la perception externe, perception interne de l’affect, représentation ; il permettra « la construction de la causalité de l’absentement perceptif de l’objet et le sens des contenus relationnels et pulsionnels sujet- représentation de l’objet » (p. 74).
« La transformation du « repérage” en représentation et en « lieu psychique” pour le sujet dépendra du travail de liaison et d’interprétation de trois éléments : a) ceux de la parole du patient, b) ceux de ses rêves, et c) les éléments perceptifs que le patient amène en lien avec la situation analytique » (p. 74).
« Depuis l’absence, présence du rêve », d’André Beetschen, s’intéresse donc au second de ces trois éléments. Il évoque plus particulièrement les rêves des personnes disparues ; et il cite Jean-Claude Rolland : « Le rêve […] est le recours octroyé au rêveur de renouer le lien avec les objets auxquels, assez peu sincèrement, il a dû renoncer dans la vie éveillée » (p. 89). Au rebours des mécanismes d’« absentement perceptif » décrits plus haut, il s’agirait ici de nier l’absence en créant l’illusion de la présence. Mais le travail du rêve (et éventuellement le travail analytique sur les rêves) ne participera-t-il pas à l’inverse au travail de deuil et de renoncement en amenant le rêveur à réaliser l’appropriation subjective de l’investissement de l’objet ? Ne produit-il pas à sa manière la transformation décrite dans la cure de l’acte transférentiel en acte langagier ?
Les textes suivants concernent plus spécifiquement la psychologie de l’enfant. La capacité du renoncement à l’objet est au cœur de la contribution de Golse, « Le bébé, l’absence et l’écart. De la discontinuité à l’absence en passant par la question des écarts à l’objet ». Son intérêt à mon sens est de mettre l’accent sur la progressivité de la séparation, qui la permettra précisément. Il me semble qu’il éclaire ainsi puissamment le rôle du langage dans ce processus. Il rappelle pour commencer l’importance chez Freud de la rencontre initiale avec un objet source de satisfaction (alors que l’on a parfois surtout insisté sur le rôle de son absence), mise en valeur qui sera reprise avec insistance par Winnicott puis René Roussillon. Puis il souligne que les recherches récentes montrent que le bébé serait d’abord attentif au degré de stabilité ou de variabilité de la mère, avec le degré d’écart qui serait intolérable (un écart limité étant à l’inverse « stimulant » pour la pensée, l’introduisant à la tiercéité). Il relève ensuite l’intérêt de penser la naissance en termes de continuité entre la vie fœtale et la vie post-natale, en raison de l’expérience du fœtus des discontinuités de la voix maternelle, qui serait comme une préforme de la question de l’absence de l’objet. Enfin, et c’est pour moi l’intérêt principal de sa réflexion, il propose de concevoir la capacité de l’enfant à supporter l’absence de la mère comme dépendante du respect d’une progressivité, d’écarts gradués, parlant de « gradient spatio-temporel des symbolisations en fonction de l’écart » (p. 129), en s’appuyant sur la notion winnicottienne de « capacité d’être seul en présence de la mère », de « boucles de retour » et d’« identifications intra-corporelles » de Geneviève Haag.
La clinique de l’enfant est également au cœur du texte d’Amina Bensalah (orthophoniste et linguiste), « Processus de sémiotisation du rapport de la présence à l’absence. Analyse d’interactions précoces ». Elle y décrit un travail d’observation d’interactions mère bébés de 6 semaines à 3 ans, qui l’amène à souligner le « jeu de réajustements réciproques » mis en évidence, mouvements interprétatifs liés à la capacité de transfert sémiotique (translation et traduction d’une modalité sensorielle vers une autre).
Elle est aussi l’objet de la contribution de Claire Squires, « Le langage : de l’absence à l’intersubjectivité », centrée sur les aspects cliniques et thérapeutiques, illustrée par deux vignettes d’enfants très en souffrance en raison de carences parentales dans les possibilités de communication avec leur enfant. « Les consultations avec des enfants en retard de parole mettent en évidence la nécessité d’une disponibilité de l’objet, sa souplesse, sa malléabilité, nécessaires au langage » ; ce qui vient confirmer les considérations développées par les deux précédents textes.
« Entre manifestation de soi et représentation de l’absence », de Jean Peuch Lestrade, présente un dispositif de médiation thérapeutique « théâtre d’ombres » proposé dans un hôpital de jour pour enfants. Il décrit comment ce dispositif permet de mettre en jeu un certain nombre de situations propices au déploiement du langage et de la représentation. Sont ainsi abordés le langage et le mimage, la question de la place, les passages et la traversée de l’écran, la différence entre identitaire et identificatoire, entre signature et signe. À côté de ces textes de cliniciens sont présentées des réflexions de sémanticiens et de linguistes.
« L’absence, propre de l’humanité », de François Rastier (sémanticien), lui permet de présenter sa théorisation sur les zones anthropiques : identitaire, proximale et distale, cette dernière spécifique de l’humain, car établie par les langues. Il rappelle que celle-ci fut reprise par André Green à propos du discours psychanalytique, ce qui y est énoncé étant « interprété au moyen du transfert comme concernant quelqu’un d’autre dans une relation qui réunit l’aA, l’ailleurs, et l’aA, l’autrefois » (p. 44). « On peut faire l’hypothèse que l’Inconscient est une forme intériorisée et ainsi personnalisée du distal, peuplé de lois religieuses et scientifiques et parcouru de conflits interprétatifs. En ramenant l’énigme distale du monde absent dans le monde obvie, la cure, psychanalytique ou chamanique (peu importe ici), soigne effectivement en établissant du sens partagé là où régnait une énigme impartageable » (p. 46).
« Le temps impliqué, ou l’impasse des temporalités », de Fabienne Boissieras (enseignante-chercheuse en sciences du langage), s’intéresse plus particulièrement, à propos de la temporalité, au schème du chemin. Celui-ci « postule cette continuité, non une continuité lisse, mais une continuité faite heureusement de micro-intervalles logiquement agencés et possiblement remobilisés ad libitum lorsqu’il s’agit de traiter et de surmonter l’absence » (p. 157) […] Ce qui correspond à l’état même de la langue construite dont la caractéristique est d’obéir à une chronologie » (p. 158). Je rapprocherai cette réflexion de celle de Golse sur le « gradient spatio-temporel ». « Un des buts de l’analyse est bien de rétablir la continuité avec ce qui peut avoir été le commencement personnel du patient, lequel en vient à configurer son histoire selon de nouvelles normes d’organisation temporelle et par une appréhension active du temps » (p. 158).
« La corporéité du signe linguistique, un ‟être là” pour dire l’absence », de Claudine Olivier, également enseignante-chercheuse en sciences du langage, se consacre à « l’émergence du signe linguistique à partir de représentations de scènes d’interaction » (p. 164), « dispositif de co-présence et d’interaction d’individus physiquement et donc psychiquement distincts entre eux, tout en étant reliés par des intérêts communs ou concurrents » (p. 165). L’auteure donne alors un certain nombre d’exemples de cette dimension interactive. Mais tout en étant « animé » par celle-ci, l’échange langagier est aussi prise de distance par rapport à cette interaction : face au risque de « prédation » inhérent à toute rencontre, l’activité langagière ménage un « axe imaginaire, vide médian ou point mort » (p. 181). Pourtant, en sens inverse, c’est probablement cette origine interactive qui assurera à la parole sa dimension de substitut à l’objet absent ; et dans la cure analytique, grâce au transfert, « il s’agit pour le sujet de prendre part à la scène, alors que, dans une scène passée, il n’avait pas pu ou pas su se placer, avait été exclu, anéanti ou effacé » (p. 182). Ceci étant rendu possible par « la prise de distance vis-à-vis d’interactions et de places qui avaient précédemment bloqué l’émergence réussie du sujet » (idem). On retrouve ici certaines considérations de Nassikas vues plus haut sur le second niveau de sémantisation, celui des « actes langagiers ».
Le volume donne enfin une grande place à la poésie : François Vaucluse (« Réelles absences »), Athanios Alexandridis (« Dans l’Absence, un Je(t) »), Hervé Bauer (« Pas là »), Alain Wexler (« Espaces improbables »), Démosthène Agrafiotis (« VOIX/VOIDS, II et VOI(x)DS, II »), dont il n’est pas possible de rendre compte, et auxquels on ne peut que renvoyer. Je citerai simplement ce qu’en dit Nassikas dans son introduction : « Le ‟regard” de ce livre sur l’absence est enrichi par celui des poètes ; nous pensons en effet que ce regard-ci s’enracine là où les signes trouvent leurs sources et prennent leur force. On peut en effet considérer que les mots du poète excèdent la langue et ses effets : ils (re)créent, quand ils réussissent, à travers les mots la présence du signe et les conditions de son émergence ; ils contribuent ainsi à la (re)création constante de la langue elle-même. Cela est le résultat de la nécessité devant laquelle celle-ci se trouve : instituer toujours un nouveau sens, c’est-à-dire nommer les ‟choses” ou les ‟signes” que le mouvement créatif du poète, plongé dans le vécu des instants de la vie et du temps, amène devant elle. Le poète réussit cette œuvre quand il retrouve en lui la perte de ses certitudes concernant ‟sa place” et en rencontrant en lui la présence de la pluralité humaine qui code socialement les signes en instituant la langue. C’est au contact de cette ‟perte de soi” et de la rencontre, ‟discussion” originelle avec les ‟autres”, que prend source la création du contenu de l’œuvre poétique, création qui, rappelons-le, est simultanée avec celle de la langue. Cette rencontre s’effectue à travers les signes, ce qui explique la place centrale que ceux-ci occupent dans la poésie, où la métaphore les rend présents, alors que la prose est centrée sur le référent du signe et ‟utilise” plus abondamment la métonymie » (p. 7).
« Présence, disparition et transfiguration de l’image à partir de la poétique de Gaston Bachelard », du philosophe Jean-Jacques Wunenburger, propose une reprise philosophique de la poésie, à partir de Bachelard, mais aussi d’Yves Bonnefoy. L’imaginaire y est ici pensé comme permettant non seulement de retrouver les objets absents, mais d’évoquer l’expérience de la transcendance (mystique ou poétique) : « L’imagination est donc moins une faculté qu’un processus, l’image est moins une représentation qu’un flux rythmique et tensoriel, l’imaginaire moins une irréalisation du monde que sa surréalisation qui oppose au monde objectif un autre monde, qui est moins subjectif, car il ne serait alors que son envers, que trans-subjectif, c’est-à-dire à la frontière osmotique du dedans et du dehors, du moi et du non-moi, ce que Merleau-Ponty appelle ‟chair”, et que Bachelard appelle rêverie cosmique et intime. » C’est donc aussi tout le champ de la création qui est ainsi ouvert, renouant avec certaines réflexions psychanalytiques du même ouvrage sur cet enjeu dans la cure.
J’espère ainsi avoir donné un aperçu de la grande richesse de ce livre, et de la pertinence majeure qu’il démontre du rapprochement entre psychanalyse, linguistique, poésie et philosophie.
Benoît Servant, psychanalyste, membre de la SPP.
Quatre recensions de livres parues dans la Revue des livres du numéro « Espérance ».
Vladimir Marinov, Le charognard, le boucher et le guerrier. Essais sur l’Œdipe mélancolique, Puf, Paris, 2021
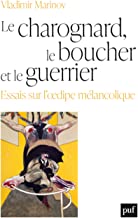 Dans son nouvel ouvrage, Vladimir Marinov poursuit une réflexion engagée il y a quelques années sur l’Œdipe mélancolique, qu’il articule ici avec trois figures redoutables repérées dans le discours de ses patients, et qui donnent au livre son titre provocateur : Le charognard, le boucher et le guerrier. Essais sur l’Œdipe mélancolique. Provocateur, parce que ce titre indique d’emblée qu’il sera ici question du rapport de l’humain à la carne, dans sa crudité, sa violence, voire sa jouissance nécrophile et nécrophage… Entendons que cet humain y est appréhendé dans une perspective tout à fait freudienne, qui articule phylogenèse et ontogenèse, mais également clinique en chair et en os et clinique exploratrice, formule empruntée à Guy Rosolato, et que constituent les œuvres culturelles. Voilà qui donne une idée de la richesse du champ ainsi couvert, champ que Marinov arpente d’un pas érudit, mais non sans esprit associatif, richesse inscrite dans le pluriel du sous-titre, tant sa lecture d’Œdipe et d’Hamlet ou son étude de trois œuvres clés de Francis Bacon constituent des essais à part entière.
Dans son nouvel ouvrage, Vladimir Marinov poursuit une réflexion engagée il y a quelques années sur l’Œdipe mélancolique, qu’il articule ici avec trois figures redoutables repérées dans le discours de ses patients, et qui donnent au livre son titre provocateur : Le charognard, le boucher et le guerrier. Essais sur l’Œdipe mélancolique. Provocateur, parce que ce titre indique d’emblée qu’il sera ici question du rapport de l’humain à la carne, dans sa crudité, sa violence, voire sa jouissance nécrophile et nécrophage… Entendons que cet humain y est appréhendé dans une perspective tout à fait freudienne, qui articule phylogenèse et ontogenèse, mais également clinique en chair et en os et clinique exploratrice, formule empruntée à Guy Rosolato, et que constituent les œuvres culturelles. Voilà qui donne une idée de la richesse du champ ainsi couvert, champ que Marinov arpente d’un pas érudit, mais non sans esprit associatif, richesse inscrite dans le pluriel du sous-titre, tant sa lecture d’Œdipe et d’Hamlet ou son étude de trois œuvres clés de Francis Bacon constituent des essais à part entière.
L’unité tient à la thèse qui structure l’ensemble de l’ouvrage : l’existence d’un complexe d’Œdipe mélancolique empreint d’une sexualité prégénitale. Partant du vif de l’expérience de sa clinique, Marinov remarque une similitude entre le comportement et les fantasmes de charognard que les humains ont connus à travers les âges, en commençant par la préhistoire, en ceci qu’il y est question de l’ingestion d’un corps potentiellement toxique, dont la mise à mort est opérée par un autre, mais dont le charognard jouit du spectacle dans une attitude d’attente passive et voyeuriste propice à la honte. Or ce personnage du charognard s’associe souvent au guerrier et au boucher, association qui met en évidence une relation triangulaire : chasseur/guerrier, proie/victime et charognard/spectateur avant de devenir acteur. Parallèlement, l’incorporation mélancolique se rattache pour Marinov à une relation plutôt triangulaire que duelle, l’auteur repérant dans l’œuvre freudienne un certain clivage entre complexe d’Œdipe, narcissisme et mélancolie. « La notion d’Œdipe mélancolique tend à jeter un pont entre narcissisme et complexe d’Œdipe, en suggérant que ces deux notions doivent être pensées conjointement, théoriquement et cliniquement parlant. En effet, une relation triangulaire défaillante précède souvent un narcissisme et une relation d’objet fragile » (p. 24). L’Œdipe mélancolique plongerait ses racines dans une relation triangulaire précoce, prégénitale et préobjectale.
Des conceptions psychanalytiques de ces racines, qui anticipent au plus près le point de vue qu’il développe, Marinov dresse l’inventaire après avoir exposé le cas inaugural de Corneille, patiente qui « vient, au tout début de son travail analytique, à ses séances comme si elle allait à la boucherie ». L’histoire de cette patiente met en évidence l’association entre des fantasmes de boucherie individuelle, en rapport avec un abus sexuel pédophile, la boucherie de la guerre et la position de bouc émissaire au sein d’une histoire familiale caractérisée par un silence sépulcral. S’appuyant sur sa propre clinique, les travaux d’analystes et d’anthropologues, Marinov rappelle combien la relation mère/enfant laisse toujours infiltrer du tiers et combien ce dernier, très précocement, « avant même de distinguer l’autre, perçoit une différence », même si l’autre est dans le psychisme maternel (p. 50). Le solipsisme du narcissisme primaire freudien ayant cédé au réel d’une dyade incluant un tiers, fût-il fantasmatique, avec qui l’enfant partage sa mère (D.W. Winnicott, Michael Balint, Jean Laplanche), l’auteur propose de penser l’appauvrissement toxique de la libido du moi, que Freud pose à l’origine de la mélancolie, comme l’effet de la confrontation avec un comportement maternel (mais il peut aussi s’agir, comme dans le deuxième cas qui sera présenté, Antigone, d’un comportement paternel se substituant à celui maternel) ressenti comme toxique ou empoisonné, et le rapport narcissique du moi avec l’objet perdu, la fameuse ombre tombée, comme une « forme d’épousailles, [de) victoire œdipienne, fût-elle mélancolique et masochiste par rapport à un tiers rival » (p. 48). En ce sens, le fort attachement affectif entre la mère et l’infans lors de position dépressive dans l’Œdipe précoce (Melanie Klein) peut être entendu, à l’éclairage de l’Œdipe mélancolique, comme une complicité victorieuse contre un tiers paternel, tout comme l’attachement incestueux et identificatoire de l’enfant à la mère dans le complexe de la mère morte (André Green). L’enfant y devient le rival invincible d’un père trop vivant qui chercherait à « entrer dans la nécropole blindée qu’il partage avec la mère ». Effet d’une captation spéculaire, la fixation à la mère morte relèverait donc également d’un sentiment de victoire paradoxale : « dans le caveau partagé avec (elle), aucun tiers ne peut entrer ». L’union à la mère réellement ou psychiquement morte constitue donc également « une forme nécrophile où l’érotisme comporte un attrait pour le cadavre et une fixation incestueuse à la mère vécue comme une puissance souveraine et destructive identifiée à la mort » (Rosolato p. 74). On notera à ce propos comment Marinov prolonge de manière tout à fait convaincante l’analyse faite par Karl Abraham (p. 116) de l’acte suicidaire inconscient du peintre suisse Giovanni Segantini, en y relevant cette dimension érotique incestueuse. Jusque dans « la dernière dyade » (p. 75), celle déjà repérée par Freud dans la synonymie « mère-mort », et dont fait état Michel de M’Uzan avec les patients en fin de vie. La fin de l’analyse, signifiée par la mort du patient, peut apparaître comme « une victoire » de ce dernier sur son analyste, puisqu’il rejoint plus vite que lui la mère morte, ne le laissant qu’assister passivement à ses victorieuses retrouvailles. Dans cette perspective, l’Œdipe mélancolique nous apparaît comme une « mélancolie adressée », où la fusion mortifère avec l’objet perdu consiste aussi en une victoire masochiste contre un tiers. Relevons la non-équivalence entre mère (sein) et père (pénis) dans cette distinction précoce, source de configurations mélancoliques de l’Œdipe sur un versant maternel ou paternel. Séduction de nature psychotique où « les pulsions nécrophiles font intervenir massivement une sexualité prégénitale au sein de l’Œdipe précoce », l’Œdipe mélancolique serait proche des figures de la protomélancolie telle que repérée par Jean-Claude Rolland (p. 77). Du reste, comme le rappelle Jacques André, cité par l’auteur, il existe chez Freud un lien entre la « disparition » du Complexe d’Œdipe et la mélancolie puisque le mot allemand, Untergang, est celui-là même qui est utilisé dans l’évocation de « la fin du monde » (p. 19). Se fondant sur l’écoute de ses patients, mais aussi sur la reprise d’un rêve de Freud, Marinov analyse, dans un chapitre qui rend hommage à la pensée de Pierre Fédida (p. 122), combien l’espace du rêve constitue l’espace privilégié de l’expression de l’Œdipe mélancolique, en ce « qu’il ne représente pas seulement une scène, mais aussi une sépulture vivante pour le monde des disparus », l’évocation des morts et des revenants. Nombreuses sont en effet chez les patients ici présentés les conséquences de deuils en rapport avec des cadavres mal enterrés, réellement ou psychiquement (deuil d’un enfant mort-né, deuil d’un inconnu absolu) et que l’auteur rapproche de ce que Freud formule dans son texte sur l’inconscient, discuté par Laplanche, « Die Agnoszierung des Unbewusten », à considérer comme l’effet du retour de spectres ou de revenants. On terminera cette recension des très riches pages consacrées aux traces d’un Œdipe mélancolique dans la littérature psychanalytique par l’attention portée aux concordances entre singulier et collectif, notamment avec la pensée de Nicolas Abraham et de Maria Torok, où l’émergence du langage et du tiers s’articule à une scène originaire (p. 66). Ce lien entre l’individu et le collectif constitue un axe important de l’ouvrage, tant dans l’anamnèse des patients dont plusieurs portent les traces des événements tragiques de l’histoire contemporaine que dans la portée universelle des œuvres présentées.
Les sept cas qui suivent sont ceux qui ont conduit l’auteur à développer sa pensée sur la perversion nécrophile (ici présente uniquement sous forme de fantasmes et non pas de passage à l’acte pervers), pensée au long cours qui s’inscrit dans une continuité dont cet ouvrage constitue un maillon supplémentaire. Notons que certains des cas rapportés s’inscrivent, avec la thématique de l’inceste, dans une brûlante actualité. On ne saurait ici les évoquer tous. J’en mentionnerai deux, Antigone et Giuseppe, en ce qu’ils incarnent, en dépit de la singularité de leur histoire, de leur environnement et de leur fantasmatique, des formes de l’Œdipe mélancolique qu’éclairent les figures du charognard, du boucher et du guerrier. Antigone présente un Œdipe mélancolique sur le versant paternel. Sujette aux addictions (tabac, alcool), une anorexie grave donne à son corps décharné l’apparence d’un cadavre. Ce « moi-momie » Marinov le pense comme la sépulture vivante d’un père mort dont il lui est impossible de faire le deuil. Garçon non advenu, abandonnée aux soins paternels par une mère carriériste, Antigone présente les traits d’une forme mélancolique de séduction telle que la décrit Catherine Chabert, et dont Marinov relève ici les conséquences dans la « conviction » de sa patiente « d’avoir activement séduit le père », faute de pouvoir réanimer la froideur de la mère, et la majoration de la culpabilité liée au fantasme matricide. La relation narcissique et spéculaire particulièrement forte entre le père et la fille masque « une relation œdipienne précocissime, hautement conflictuelle ». Cette triangulation précoce et les positions passives et actives qu’elle engage, l’importance de la problématique ingestion/incorporation avec ses échos psychiques, les effets d’une séduction perverse réelle de l’adulte conduisant l’enfant à l’identification à l’agresseur (Ferenczi, p. 97) vont être au cœur de l’analyse. Au corps sec de l’anorexique qui embaume en elle la dépouille du père, aux fantasmes nécrophages supplétifs à une union incestueuse perpétuée dans l’au-delà de la mort, à la bile noire de la mélancolie Marinov oppose, et se soutient de, la théorie des humeurs, ces fluides corporels (sperme, lait, sang, eau) que se partagent père, mère et enfant. C’est dans le déplacement fantasmatique des liquides et la fluidification des substances que pourra s’opérer un début de retrouvailles avec le giron maternel. « Dans l’après-coup du travail accompli avec A., mais aussi avec d’autres patients addictés, j’ai pensé que l’une des particularités de ce travail consistait à l’attention portée non seulement aux affects, à leur représentation, à la mise en scène de leur monde fantasmatique, mais aussi à la fluidité et métamorphose de leur humeur fortement entravée par des traumatismes et des relations d’objets précoces (p. 105). Sous ses différents aspects (dépression, toxicomanie, paranoïa, TCA, abus pédophiles), la clinique transnosologique de l’Œdipe mélancolique convoque toujours un tiers, mais dont l’apparition peut longtemps se soustraire à l’exhumation par le sujet ou l’analyste. Elle engage dès lors la question du spectre, ou du vampire, et impose comme tâche importante dans le travail avec les patients de donner plus de contours corporels et d’histoire à ces absents. C’est ce en quoi a consisté l’impressionnant travail réalisé avec Giuseppe au moyen de collages pensés à la manière de rêves, allant de la figuration de fantasmes nécrophile et nécrophage entre la mère et le fils jusqu’à l’émergence et la reconnaissance de la figure d’un père « doublement » mort dans les tourments de la Deuxième Guerre mondiale, et dans la parole de la mère.
Marinov convainc à mettre en lumière l’existence d’un Œdipe mélancolique qui induit une puissante régression et passe par l’épreuve de l’informe et de l’archaïque du corps et de la psyché.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, il déploie plus amplement les figures du charognard (vautour, rat, corbeau), du boucher-sacrificateur et du guerrier à travers les mythes, les religions, les grands rites funéraires, les productions artistiques antiques et contemporaines qu’il explore et auxquels il consacre autant d’attention qu’à sa clinique. Marinov donne ainsi à voir les fantasmes et les représentations qui sous-tendent l’univers psychique de ses patients, convaincu, « comme Freud, que les fondements préhistoriques de l’humain continuent à se refléter dans les chefs-d’œuvre artistiques et littéraires » (p. 349). Deux célèbres patients sont écoutés à l’aune du rapport corps/cadavre dans leur histoire et le traitement qu’en fait la culture : l’épisode hypocondriaque de Schreber, analysé comme une forme de mélancolie corporelle au sein d’un Œdipe mélancolique de type psychotique, est mis en lien avec un fantasme majeur du président qui pense que Dieu aime surtout les cadavres, la religion archaïque perse et les effets d’une éducation paternelle toute-puissante, militaire et sadique. Le fantasme de boucherie et la symbolique du vautour y prédominent. Concernant l’Homme aux rats, Marinov rappelle son surnom d’oiseau charognard (Leichenvögel) que Freud cite à la fin de son compte rendu, et remarque qu’il est davantage question des fantasmes nécrophiles du patient dans le Journal d’une analyse que dans le compte rendu du cas publié. On soulignera l’hypothèse du fantasme voyeuriste charognard dans l’analyse du chœur tragique du théâtre grec, comme « héritage » de la position de ces humains ayant assisté à la mise à mort du grand meneur du troupeau, et qui ressent devant le spectacle tragique « une jouissance par lui-même ignorée » contre-investie par des sentiments de pitié et de crainte. L’analyse des pièces de Sophocle (Œdipe Roi, Œdipe à Colone) et de William Shakespeare (Hamlet) décèle dans le hors-champ de la structure des trois tragédies le noyau mélancolique caché dans l’anamnèse des héros, qui fera basculer les noces érotiques en épousailles macabres. L’ouvrage s’achève sur un essai à part entière consacré à celui qui « rassemble dans son histoire et dans son œuvre, le génie en plus, les traits de tous les patients […] de la première partie du livre », et dont deux d’entre eux avaient évoqué l’univers, le peintre anglais Francis Bacon. Pour Marinov, la psychanalyse comme la littérature et l’art sont de formidables outils antidépressifs et anti-mélancoliques. Mais, comme il le rappelle, pouvoir accéder à un certain équilibre psychique, voire à des capacités de sublimation pulsionnelle, n’impose-t-il pas d’explorer au préalable les zones les plus sombres de l’histoire individuelle et collective ? Son ouvrage en apporte une convaincante démonstration.
Martine Mikolajczyk est psychanalyste.
François Marty et Mélanie Georgelin, La latence à tous les âges de la vie. Un bouclier pour défendre le moi, Paris, In Press, 2021.
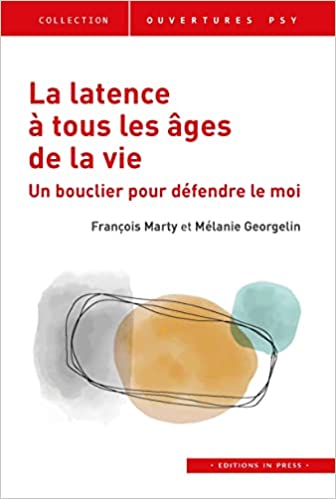 À revers de l’apologie de l’immédiateté, en réponse à la violence et à l’impulsivité, au règne de l’écran lisse plutôt qu’aux apories du creux, François Marty et Mélanie Georgelin nous invitent à une promenade, une « prise de temps » pour explorer des chemins de traverse et « se rafraîchir aux sources de la latence », selon l’expression de Nathalie Zilkha (2021). Elle offrira aux lecteurs une riche exploration du processus de latence, celui qui permet de profiter de la promenade sans se soucier uniquement de l’arrivée. Dans leur ouvrage, Marty et Georgelin nous engagent à penser la latence non pas seulement comme la période de l’enfance, « stase silencieuse de la libido au cours du développement, mais bien comme un processus, un régulateur de la vie psychique et ce tout au long de la vie » (p. 10). Ce travail est largement nourri des élaborations d’analystes ayant étudié la notion de latence : René Diatkine, Évelyne Kestemberg, Paul Denis, François Kamel, Christine Arbisio, André Green et d’autres encore.
À revers de l’apologie de l’immédiateté, en réponse à la violence et à l’impulsivité, au règne de l’écran lisse plutôt qu’aux apories du creux, François Marty et Mélanie Georgelin nous invitent à une promenade, une « prise de temps » pour explorer des chemins de traverse et « se rafraîchir aux sources de la latence », selon l’expression de Nathalie Zilkha (2021). Elle offrira aux lecteurs une riche exploration du processus de latence, celui qui permet de profiter de la promenade sans se soucier uniquement de l’arrivée. Dans leur ouvrage, Marty et Georgelin nous engagent à penser la latence non pas seulement comme la période de l’enfance, « stase silencieuse de la libido au cours du développement, mais bien comme un processus, un régulateur de la vie psychique et ce tout au long de la vie » (p. 10). Ce travail est largement nourri des élaborations d’analystes ayant étudié la notion de latence : René Diatkine, Évelyne Kestemberg, Paul Denis, François Kamel, Christine Arbisio, André Green et d’autres encore.
L’ouvrage s’écrit à deux plumes : Marty nous guide dans la conceptualisation du processus de latence, à partir de ses travaux sur l’adolescence et la temporalité notamment ; Georgelin nous raconte et nous fait penser une clinique hors les murs, hors le divan : clinique de l’enfant, de l’enfant violent en institution, de la personne âgée… Tous deux font appel à de nombreuses œuvres culturelles, de l’art des cavernes aux jeux vidéo, qui toutes, ouvrent des champs de symbolisation à leurs spectateurs, petits ou grands. Marty ouvre son propos avec une incartade préhistorique savoureuse et bien documentée, en suivant Freud dans ses hypothèses phylogénétiques. Il convie l’homme préhistorique entrant en latence avec la sédentarisation, devenant alors penseur, historien et artiste. De la métapsychologie freudienne de la latence dessinée par Marty on retiendra ici le caractère biphasé du développement psychosexuel rendant centrales les notions d’après-coup et de refoulement ; le lien profond entre latence et préconscient et le latent du rêve. Marty va se pencher plus précisément sur le déclin du complexe d’Œdipe qui précède et permet l’entrée en latence. Le pivot central de la latence est la désexualisation, au sens d’une réorganisation de l’économie pulsionnelle, la libido ne disparaît pas, mais prend de nouveaux chemins, nous dit-il : inhibition quant au but, déviation, sublimation. L’énergie libérée est consacrée aux processus secondaires et aux investissements culturels et sociaux. On observe le développement du courant tendre et l’avènement de l’issue identificatoire. Ainsi se développent l’instance surmoïque et l’armada défensive du moi, celui-ci « prend possession de son domaine », nous dit Winnicott (1958). Le complexe s’intériorise et prend progressivement son statut d’organisateur de la vie psychique. Marty met en exergue le rôle de soutien narcissique de l’environnement. L’objet parental doit perdre de son attractivité, pour devenir compagnon et premier objet de transfert. L’enfant latent développe sa subjectivité à l’abri, non des cavernes, mais de ses cabanes et autres carnets secrets. L’identification aux pairs prend le relais des identifications parentales et creuse un écart générationnel structurant. L’aire transitionnelle de la latence devient une aire d’expérimentation organisatrice.
La latence comme processus
La latence procède d’une « construction précoce sans cesse remise sur le métier : attendre, penser, temporiser, faire preuve de souplesse, réaménager, investir, désinvestir sont autant de mouvements que le sujet va pouvoir opposer aux poussées pulsionnelles, aux effractions traumatiques, aux crises ou drames de la vie » (p. 70). Marty propose une extension de la notion de latence au-delà et en deçà de sa période classique, jusqu’à en faire un registre fondamental et fondateur de l’activité psychique. Il construit une théorie de la latence et en esquisse une topique : « Nous faisons l’hypothèse que le latent appartient au préconscient (première topique) et ne superpose pas exactement au refoulé, et qu’il est au service des fonctions du moi (deuxième topique) » (p. 237). « La latence est le lieu (registre topique) où s’affrontent les forces psychiques conscientes préconscientes et inconscientes, mais aussi et surtout un processus ouvert à la dynamique psychique et au traitement des excitations (registre économique) et des conflits (registre dynamique). Elle instaure une temporalité, elle sépare et relie les deux piliers du sexuel : l’infantile et le pubertaire » (p. 71). Elle introduit le temps, mais aussi l’espace, avec l’accès au volume, à l’intériorité et à la perspective. La latence s’apparente au travail du pare-excitation et constitue « un holding psychique » (p. 78). Marty approfondit la notion de contenance et évoque la constitution des enveloppes psychocorporelles. Sans elles, l’enfant ne pourrait pas tracer de rond fermé, dessiner de tête son bonhomme, devenir « propre », et encore moins garder un secret ! Marty décline et explicite les vertus de la latence : vertus antipsychotiques, traitement préventif de la violence, vertu anti-traumatique, tolérance à la discontinuité et à la passivité, intégration du féminin.
Latences au long cours
Marty et Georgelin tentent de nous faire saisir comment les processus latentiels sont à l’œuvre tout au long de la vie. Marty nous plonge au cœur d’un échange ordinaire entre un bébé et sa mère. On rêve dans le présent de cette scène au long apprentissage que devra faire le bébé : attendre et différer la satisfaction sans en être détruit, mais encore intégrer mille nouveautés effrayantes, en appui sur la contenance et les capacités de rêverie maternelles qu’il intériorisera progressivement. Il hallucine le sein et la satisfaction : avec les autoérotismes, la machine à penser se met en marche. Sans quoi, la décharge resterait le mode d’autotraitement des tensions.
Georgelin laisse un peu de côté la théorie largement évoquée déjà, et choisit d’illustrer les enjeux de l’enfance à travers des œuvres cinématographiques et littéraires. Elle nous montre combien la curiosité sexuelle des enfants, même partiellement atténuée, reste vive. Ils se tournent fréquemment vers la mythologie, l’archéologie, ou des œuvres populaires contemporaines : Harry Potter, la trilogie Dragons ou certains jeux vidéo, pour aborder leurs questionnements originaires. Elle nous montre même comment les réseaux sociaux peuvent constituer une aire transitionnelle et latentielle pour certains jeunes, en ce qu’ils leur permettent d’expérimenter à très petites doses et de loin, l’altérité et les enjeux génitaux trop brûlants et désorganisants encore. Elle s’intéresse au roman familial qui ouvre un ailleurs autrement. Il conduit l’enfant à une position subjective : choisir d’adopter ou non ses propres parents. Pour que l’écriture interne de ce roman puisse se déployer, il faut que l’enfant soit en contact avec la culture et l’altérité, qu’il soit confronté à des différences occasions de comparaison. Le roman familial se double bien pour l’enfant de la possibilité de s’inventer lui-même, de construire et manipuler à sa guise « des identités narratives » selon l’expression qu’elle emprunte à Paul Ricœur.
Ce qui est mis en latence, ce sont des questions, parfois sous forme de théories, ébauches de contenus psychiques énigmatiques. Les théories sexuelles infantiles apparaissent comme des « pierres d’attente » (p. 26). Le travail psychique en cours est suspendu et remis à plus tard, mis au secret du préconscient où il profite à couvert des avancées du moi. Le refoulement n’est que partiel et permet des échanges entre instances et un travail souterrain, entre défenses et poussées pulsionnelles. Marty développe de façon très intéressante la métaphore de l’anamorphose : l’enfant serait face à la sexualité comme devant une anamorphose, « il ne voit d’abord que la partie manifeste, ce qu’il peut en comprendre là où il est de son développement » (p. 26). Plus loin, plus tard, après une mise en latence qui lui laisse un temps de maturation, sa vision de la sexualité prendra un autre sens, il y découvrira de nouvelles interprétations. Tout cela prépare ce que j’appellerai « le coming-out adolescent », coming-out sexuel et subjectif : s’assumer soi dans le monde, assumer ses désirs, renoncer à d’autres et s’accommoder de la culpabilité de vivre. Marty s’emploie à une analyse approfondie des enjeux adolescents dans leurs relations dialectiques avec la latence. Celle-ci constitue comme on l’a vu les coulisses de l’adolescence, mais elle est également largement sollicitée au décours de la crise dans ses fonctions protectrices et créatrices. Le coup de tonnerre pubertaire provoque un emballement économique où Éros et Thanatos repartent à plein régime. Il s’agit d’une traversée périlleuse avec un fort risque de désintrication. Marty s’intéresse au traitement de l’excitation et de l’angoisse chez l’adolescent submergé. On pense à « l’âge bête » décrit par Denis (2001/2011, p. 134) : l’adolescent use de la bêtise comme d’une protection, un « recours d’urgence » dans l’attente de possibilités de traitement psychique momentanément débordé. Après cette resexualisation massive viendra le processus de psychisation de la pulsion et de construction subjective. Marty met en discussion le concept de seconde latence proposé par divers auteurs.
Marty s’intéresse largement à la notion de temporalité psychique à l’adolescence. « L’enfant pubère relit son histoire, et le pubertaire la constitue en même temps en tant qu’infantile » (p. 151). Il se crée un passé et un présent dans le même mouvement. Marty distingue et travaille finement différentes figures de la temporalité psychique à l’adolescence à travers plusieurs vignettes cliniques.
Pour illustrer les enjeux de l’âge adulte et les mouvements de latence qu’il recèle, Marty va amener de la matière clinique. Avec la Norma, héroïne de Bellini, il met en regard clivage et latence. Chez Jeanne, il nous montre comment des états d’angoisse non traités, restés latents ou en souffrance, vont trouver dans le cadre analytique une surface de révélation, une contenance, à l’image du vase qu’elle demande à son analyste de placer à sa vue, entre eux deux. Marty nous régale enfin avec de merveilleux extraits de Proust qui racontent le baiser du soir tant attendu et espéré par le petit Marcel dans son lit. Marty admire comment son écriture fait revivre et durer le plaisir… Délicieuse latence !
Enfin, Georgelin nous propose des pistes de réflexion intéressantes sur le passage à la retraite et le grand âge. Après ce cheminement au long de la vie, les auteurs décrivent des « ratages de latence » chez l’enfant, qu’ils mettent en lien avec certaines tendances sociétales : hyperstimulation, disparition du temps libre et des espaces de rêverie, valorisation de la précocité, hypersexualisation… Ils évoquent la flambée des consultations pour hyperactivité, troubles de l’attention et des apprentissages. En contrepoint, Georgelin nous invite à réfléchir à la transmission des capacités de latence entre les générations, elle parle « de legs de latence » (p. 211). Les auteurs évoquent les propriétés thérapeutiques de l’institution et défendent les thérapies non brèves pour l’enfant comme un trésor de liberté.
La latence en séance
Les réflexions sur ce thème parsèment l’ouvrage sans faire l’objet d’un chapitre. Si « se donner du temps » est un des marqueurs principaux de la latence, le travail analytique devient quasiment une proposition de latence. Tous deux partagent le même projet : celui de réaménager le rapport du sujet à lui-même. Pour que le processus analytique se déploie, il faut l’instauration du cadre, la régularité des séances bien entendu. Il faut aussi l’abstinence et la patience de l’analyste pour que le discours soit mis en dépôt dans la suspension provisoire, sans interprétation ou interprétation prématurée, afin que le sujet se trouve lui-même. La latence de l’analyste permet de résister à la tentation de l’agir, à la destructivité et de préserver un espace de pensée et de rêverie. Dans un ouvrage récent Les belles espérances (2020), Catherine Chabert traite de l’attente, des espoirs et des désillusions. Elle montre comment l’attente peut être féconde et source de transformation. Le transfert, et son lot d’espérances inconscientes, se noue, invisible, mais certain, sous le manteau comme le travail de latence. On ne peut pas le presser, il lui faut de la constance pour se faire variable. Souvent à la faveur d’un événement transférentiel, comme dans une soudaine éclaircie, le transfert se dévoile. On en perçoit alors l’ampleur, la nature et les nœuds. Le discours et les éprouvés latents prennent un relief et un sens nouveau, les deux comparses du couple analytique peuvent en saisir et en penser quelque chose.
Parallèlement à ce travail, d’autres auteurs contemporains étudient les processus latentiels (Angelergues, Maurice, Tirilly, 2021). Cet engouement nouveau témoigne de la pertinence de cette façon originale de penser la latence, tant dans la clinique de l’enfant et de l’adolescent que la pratique analytique avec les adultes. L’apport de Marty et de Georgelin rebat les cartes métapsychologiques et ouvre nombre de perspectives cliniques.
On termine la lecture avec une conscience aiguisée de la tessiture et des leviers qu’offre la latence. Je finirai sur le magnifique tableau que dresse Georgelin des deux Rosa, Bonheur et Luxemburg. Dans leurs pas et dans le sillon de cette lecture édifiante, nous nous sentons engagés à puiser dans nos ressources de latence les dispositions d’écoute et de patience, la créativité, les capacités d’élaboration et de transformation, et enfin les armes de résistance qui font profondément et résolument de nous des cliniciens !
Émeline Labbé de la Genardière est psychologue clinicienne et psychodramatiste.
Références bibliographiques
Angelergues J., Maurice C., Tirilly A. (dir.) (2021). La latence, période et processus. Paris, Puf, « Débats en psychanalyse ».
Chabert C. (2020). Les belles espérances. Le transfert et l’attente. Paris, Puf.
Denis P. (2001). Éloge de la bêtise, Paris, Puf. Repris dans De l’âge bête. La période de latence. Paris, Puf, 2011.
Winnicott D.W. (1958/1989). Analyse de l’enfant en période de latence. Processus de maturation chez l’enfant. Paris, Payot.
Zilkha N. (2021). Quand l’adolescence se rafraîchit aux sources de la latence. Dans Angelergues J., Maurice C., Tirilly A. (dir.), La latence, période et processus. Paris, Puf, « Débats en psychanalyse ».
Daniel Oppenheim, Le désir de détruire. Comprendre la destructivité pour résister au terrorisme, Caen, C&F éditions « Interventions », 2021
 Dans ce petit livre incisif, Daniel Oppenheim se confronte et nous confronte au désir de détruire – des nazis au djihadisme, de la Shoah à Daesh. Psychiatre et psychanalyste, Daniel Oppenheim a écrit quatorze livres et de très nombreux articles, notamment sur le cancer, le handicap sévère ou, comme cette fois, sur la barbarie humaine. Partant de ce qui peut générer la destructivité radicale et sa mise en actes, il examine les formes de résistance à la destructivité collective, avant de présenter quelques exemples d’une « littérature de résistance », et de montrer combien il importe de comprendre et de prévenir l’extension de la violence destructrice.
Dans ce petit livre incisif, Daniel Oppenheim se confronte et nous confronte au désir de détruire – des nazis au djihadisme, de la Shoah à Daesh. Psychiatre et psychanalyste, Daniel Oppenheim a écrit quatorze livres et de très nombreux articles, notamment sur le cancer, le handicap sévère ou, comme cette fois, sur la barbarie humaine. Partant de ce qui peut générer la destructivité radicale et sa mise en actes, il examine les formes de résistance à la destructivité collective, avant de présenter quelques exemples d’une « littérature de résistance », et de montrer combien il importe de comprendre et de prévenir l’extension de la violence destructrice.
Déjà en 2015, Daniel Oppenheim avait écrit une Lettre à un adolescent sur le terrorisme (Bayard). Le terrorisme actuel est une des manifestations de la destructivité, qui se met en actes aussi sous bien d’autres formes, et que le psychanalyste réfère en dernière instance à la pulsion de mort. L’auteur présente ainsi d’entrée de jeu une réflexion accessible au non-spécialiste sur la destructivité telle que la comprend le psychanalyste : « Le penchant à l’agression est chez l’homme une disposition pulsionnelle originelle et autonome », écrit Freud en 1929 dans Le malaise dans la culture.
La première partie du livre montre les mécanismes et les processus qui peuvent conduire un jeune vers l’engagement terroriste. La réflexion de l’auteur est ici pluridisciplinaire et il évoque l’apport des historiens, des juristes, des sociologues et des anthropologues, ainsi que celui de tous ceux qui travaillent au contact de ces jeunes tentés par le terrorisme. Il souligne d’ailleurs toujours la différence entre l’attrait de la violence destructrice et le passage à l’acte terroriste. Néanmoins, le rapport à la mort – perçue, crainte, imaginée, voire apparemment désirée – est toujours central. Les terroristes mettent en acte des terreurs archaïques, les montrent et les font subir à leurs victimes. Chez ces jeunes, le rapport au temps, à la lignée, à l’histoire fait difficulté. L’appartenance au groupe permet l’instauration d’une néo-identité, coupée des autres qui ne partagent pas le même engagement, rassurante même si la perspective est un sacrifice radical, bardé de certitudes. C’est du côté de l’accompagnement permettant le recul du sentiment d’insécurité, d’un éventail d’actions politiques et de l’insertion dans l’histoire familiale, que Daniel Oppenheim perçoit des issues possibles. L’auteur propose alors un décryptage de l’autobiographie de Rudolph Höss, le commandant du camp d’Auschwitz (1940-1943), après avoir dirigé Dachau (1934-1938) et Sachsenhausen (1938-1940), qui écrivit son autobiographie en prison. Soulignant ses contradictions, Daniel Oppenheim tente de dégager ce qui l’a conduit à assumer avec fierté cette responsabilité d’exterminateur.
Le chapitre suivant examine des formes de résistance à la destructivité collective. Il commence par montrer les séquelles de la barbarie chez des adultes, notamment des rescapés de la Shoah, ainsi que chez des adolescents et des enfants. Le livre devient ici plus clinique et présente en particulier un exemple d’entretiens psychanalytiques avec un jeune garçon malien de 10 ans, albinos, dont les mouvements destructeurs sont intenses. Il évoque aussi la difficulté pour des jeunes de faire avec des séquelles de la barbarie subie par des grands-parents ; comment s’opposer à eux sans se sentir identifié au camp des bourreaux ? Et que dire du fardeau porté par les enfants d’exterminateurs de masse ? Daniel Oppenheim évoque ici le documentaire My Nazi Legacy (2015), de David Evans et Philippe Sands, qui présente deux enfants de génocidaires, et la relation tissée avec eux par le juriste Philippe Sands. Niklas Franck critique radicalement son père, qu’il juge monstrueux, tandis que Horst von Wächter idéalise le sien et défend sa respectabilité. Le dialogue avec ces deux enfants soutient l’interrogation de Daniel Oppeheim sur la façon de recevoir et de soigner les enfants qui reviennent de Syrie (ou d’autres zones de combat), et dont nombre de parents s’étaient affiliés à Daesh.
Le dernier chapitre s’attache à présenter quelques ouvrages d’une « littérature de résistance » qui, en décrivant la destructivité, « apprend à la lire » et permet au lecteur de s’y confronter. Daniel Oppenheim ne nous précise pas ce qui a commandé le choix des œuvres retenues ni l’ordre de leur présentation. La littérature russe prédomine, à l’exception de Faulkner et de Victor Hugo. On perçoit comment chaque compte rendu, souvent rédigé à partir d’un montage de citations, permet de mettre en lumière différents visages de la destructivité, ainsi que leurs enjeux.
Le Tchékiste de Vladimir Zazoubrine (1922-1923) montre la déshumanisation des membres de la Tchéka – créée en 1917 pour combattre la contre-révolution –, devenus des « machines à tuer » et à torturer, sans haine ni états d’âme. Faiblesse et doute sont des trahisons. Soubrov, qui boit depuis qu’il a tué son frère, sera à son tour exécuté, sans protester.
Dans Cavalerie rouge, Isaac Babel (arrêté en 1939 et exécuté en 1940) décrit en de courts récits la campagne de Pologne (avant-dernier épisode de la guerre civile) qu’il a suivie en 1920 comme correspondant de guerre. S’il lui est reproché lors de son procès de couvrir de boue les commandants communistes et d’être incapable de voir les bouleversements grandioses de la lutte des classes, il évoque la disparition des abeilles, et note la transformation des carrioles en supports de mitrailleuse. Il sait décrire la violence des combats, l’antisémitisme meurtrier, la famine, la vie quotidienne, les rivalités, ainsi que le courage de la cavalerie rouge. L’auteur fait entendre la voix unique et pathétique de chacun et la façon dont les affrontements traversent les familles. Juif russe, intellectuel pacifiste, Isaac Babel n’est pas extérieur à ce qu’il décrit, il est lui aussi humilié et menacé par les Cosaques ; la beauté de son écriture intègre l’horreur sans l’atténuer.
Daniel Oppenheim présente ensuite L’Envie de Iouri Olecha et Le Royaume juif de Lamed Shapiro. Le Journal d’Olecha, né en 1899, n’est paru intégralement qu’en 1999, tandis que L’Envie date de 1927 et raconte l’affrontement de deux frères. Le plus jeune veut développer des fast-foods dans la Russie soviétique, tandis qu’Ivan rejette cette société nouvelle, brutalement transformée, qui réifie l’homme et privilégie les machines. Contre les révoltes guerrières et cette société stérile, Ivan lance la révolte des sentiments, qui risquent de disparaître. En fait ils subsistent, mais sont devenus inaccessibles à ceux qui n’éprouvent plus que de l’envie, avec le seul refuge de l’indifférence désabusée.
Né en Ukraine en 1878, Lamed Shapiro émigre aux États-Unis en 1906, à la suite d’une vague de pogroms ; il publie trois recueils de nouvelles, dont Le Royaume juif, où il dénonce avec une grande force la barbarie des pogroms. La perte des repères et l’intériorisation de la violence sont soulignées. Le fils du rabbin rejette sa religion rendue responsable des massacres et devient antisémite. Un jeune homme tue sa mère qu’on a violée devant lui, pour abréger ses souffrances et supprimer cette vision d’horreur, mais en vient à tuer aussi la jeune fille dont il est amoureux. L’enfant témoin, sidéré, parle avec les morts du cimetière, mais une nuit d’orage lui fait revivre le pogrom. Comment se protéger de l’horreur, comment guérir de la barbarie, comment parvenir à en témoigner ?
Quatre-vingt-treize (1874), de Victor Hugo, décrit l’affrontement entre les révolutionnaires et les chouans. Nul n’échappe à la guerre, mais la terreur est-elle nécessaire ? Le débat entre Cimourdain et Gauvain illustre la tension entre une République de l’absolu, qui ne transige pas, et une République de l’idéal, qui vise à préserver des sentiments humains au-delà de la violence. Sa perplexité devant la barbarie montre Hugo oscillant entre doute et certitude, entre pessimisme et optimisme sur le destin des peuples et leur possibilité de s’émanciper des tyrannies et de la misère.
Enfin L’Intrus de Faulkner décrit le racisme ordinaire, inscrit dans le style de vie sudiste : un vieil homme noir est accusé d’avoir assassiné un homme blanc, et tous les Blancs attendent son lynchage ; l’accusé déchaîne d’autant plus de hargne qu’il est élégant et vit parmi les Blancs. Charles, un jeune garçon de 16 ans, découvre, derrière les apparences, que l’assassin est un des frères de la victime. Naguère sauvé par le vieux Lucas, Charles a voulu rembourser sa dette en assumant de trouver la vérité pour sauver Lucas. D’où sa résistance civile aux évidences communément partagées.
« Pour nous, étudier fut, dès le début, se révolter » : Daniel Oppenheim cite en exergue de sa conclusion ce témoignage de Peter Weiss (L’esthétique de la résistance). Les dernières pages du livre se veulent une alerte : au-delà même de la radicalisation de certains jeunes, la destructivité agie poursuit sa progression et son extension. On pourrait évoquer ici le livre du chercheur Hugo Micheron, Le Djihadisme français (Gallimard, 2020), repris de sa thèse de sociologie, qui en montre l’implantation dans les quartiers et dans les prisons et qui analyse les formes de propagande et les rapports de ces groupes avec la Syrie. « Il reste beaucoup à comprendre pour prévenir le développement actuel de la violence destructrice », souligne Daniel Oppenheim ; il y faut un travail interdisciplinaire où chacun s’engage. L’auteur évoque les dérives et les ambiguïtés des réponses politiques, et montre comment le sentiment d’insécurité est source d’une passivité culpabilisée qui entretient le sentiment d’impuissance (encore accru par la crise du Covid). Il déplore que la relation entre l’appareil d’État et les citoyens soit bien loin des formes d’accompagnement et de négociation positive qui se cherchent entre médecins et malades, parents et enfants, enseignants et élèves. La psychanalyse reconnaît la pulsion de mort à l’œuvre dans la destructivité, mais il sait aussi qu’elle peut être liée à Éros et devenir une force constructrice ; et que les symptômes sont aussi des tentatives de guérison.
Dominique Bourdin est psychanalyste SPP, agrégée de philosophie, docteur en psychopathologie fondamentale.
Benoît Peeters, Sàndor Ferenczi, l’enfant terrible de la psychanalyse, Flammarion, Paris, 2020
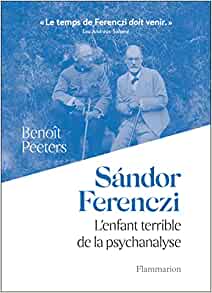 Dans une très belle édition, illustrée de photos d’époque émouvantes (par exemple une carte de Sàndor Ferenczi à Freud avec son portrait en médecin militaire en 1915, ou l’anniversaire de Ferenczi fêté par la Société hongroise de psychanalyse en 1929), le livre de Benoît Peeters nous invite à suivre l’histoire mouvementée des liens entre Freud et Ferenczi dans les cercles analytiques à l’origine de nos institutions. Baptisé par Freud comme son « paladin et grand vizir secret » (p. 13), Ferenczi devint à son insu l’enfant terrible de la psychanalyse et finira ostracisé par Freud et ses disciples « plus freudiens que lui » (p. 334). Peeters utilise les nombreuses correspondances entre Freud, Ferenczi et leurs interlocuteurs (1908-1933), pour nous révéler la fécondité de ces échanges sur les plans scientifique et institutionnel, sur fond de luttes de pouvoir souvent passionnelles.
Dans une très belle édition, illustrée de photos d’époque émouvantes (par exemple une carte de Sàndor Ferenczi à Freud avec son portrait en médecin militaire en 1915, ou l’anniversaire de Ferenczi fêté par la Société hongroise de psychanalyse en 1929), le livre de Benoît Peeters nous invite à suivre l’histoire mouvementée des liens entre Freud et Ferenczi dans les cercles analytiques à l’origine de nos institutions. Baptisé par Freud comme son « paladin et grand vizir secret » (p. 13), Ferenczi devint à son insu l’enfant terrible de la psychanalyse et finira ostracisé par Freud et ses disciples « plus freudiens que lui » (p. 334). Peeters utilise les nombreuses correspondances entre Freud, Ferenczi et leurs interlocuteurs (1908-1933), pour nous révéler la fécondité de ces échanges sur les plans scientifique et institutionnel, sur fond de luttes de pouvoir souvent passionnelles.
Le premier chapitre met en scène la condamnation par Freud du dernier texte de Ferenczi, « Les passions des adultes et leur influence sur le développement du caractère et de la sexualité des enfants », dont la lecture dans une visite au 19, Bergasse (septembre 1932), fut interrompue par l’arrivée d’Abraham Brill, président de l’American Psychoanalytic Association, un des disciples ouvertement hostiles à Ferenczi et beaucoup moins intime de Freud. Le visage déformé par ses opérations successives de la mâchoire, parlant avec difficulté, nous précise Peeters, Freud, exaspéré, n’a de cesse que de demander à Ferenczi, lui-même très affaibli par la maladie, s’il va enfin accepter la présidence de l’Association Psychanalytique Internationale, un « remède de cheval » qui devrait lui permettre de quitter « l’île des rêves de ses enfants fantasmatiques » pour « rejoindre le combat des hommes » (p. 290). Freud insiste pour que le texte de Ferenczi ne soit pas présenté au Congrès de Wiesbaden, convaincu que l’intérêt de Ferenczi pour les traumatismes infantiles représenterait une véritable régression vers sa théorie de la séduction à laquelle il a renoncé trente-cinq ans plus tôt. Le verdict est fatal : Ferenczi s’est « engagé sur une pente glissante, l’éloignant des techniques classiques de la psychanalyse » (p. 13). Cette introduction de Peeters est d’autant plus frappante que les découvertes de Ferenczi rejetées par Freud nous paraissent aujourd’hui infiniment contemporaines dans leur réflexion sur la séduction originaire des adultes ou sur le contre-transfert dans les enjeux thérapeutiques de la cure. Mais Freud confiera à Max Eitingon que Ferenczi a été trop « loin pour trouver le chemin du retour » (p. 299).
Le caractère sentimental des liens entre Freud et ses apôtres, leur utilisation au service de la « Cause » deviendront rapidement un des fils rouges de ce livre que nous pouvons parcourir comme un feuilleton. L’affranchissement progressif de sa soumission à Freud, ce père avec lequel il « ne pouvait être adulte » (p. 298), vaudra-t-il à Ferenczi de rejoindre le camp des frères exclus comme Carl G. Jung, puis Otto Rank et Alfred Adler ? Ferenczi est le seul qui partage la passion de Freud pour l’archéologie, et leurs nombreux voyages et vacances communes sont accompagnés d’une correspondance intense (d’une vingtaine d’années) dont Peeters nous montre combien la fécondité de la pensée s’enracine dans des confidences intimes, véritables morceaux de séances analytiques.
L’histoire de Ferenczi, accompagnée d’une courte biographie qui nous donnera les éléments du transfert de son histoire familiale sur sa nouvelle famille analytique, est initialement évoquée par Peeters comme celle d’un homme « paralysé d’admiration » pour Freud, « ébloui par l’éloquence du Professeur et la puissance de ses réflexions » (p. 21). Ferenczi confiera à Freud, dès leur première rencontre, qu’il a l’impression que sa « vie vient de commencer » et que la psychanalyse lui a permis de « se sentir réellement homme » (p. 25).
Mais les correspondances de Ferenczi et Freud, et leurs coulisses dans les échanges avec les autres disciples, montrent également les rapports douloureux entre eux sur fond d’un combat pour la Cause dont Peeters nous révèle le prosélytisme. Freud ne se prive pas d’utiliser l’énergie de Ferenczi, son enthousiasme et ses talents, mais également ses attaques frontales contre les analystes tombés en disgrâce, alimentées par son désir de rester le disciple favori, pour en faire un allié au service des premières organisations analytiques. Il utilise également l’enthousiasme de l’élève ébloui pour « se laisser aller à ses fantasmes théoriques et accroître sa propre assurance » (p. 54). Ces fantasmes lui permettent d’éloigner les « éléments indésirables qui font du mal à la cause » par une compréhension analytique des associations selon le modèle de la horde sauvage dont il dénonce la « pathologie » tant la « flatterie des frères aînés envers un père à l’autorité intangible » masque leur désir de « l’évincer pour prendre sa place » (p. 80). Affichée au service de l’organisation du mouvement par Freud, cette déclaration donne cependant le ton des attaques personnelles au sein des premiers cercles, et Ferenczi sera rapidement accusé d’un « désir infantile injustifié d’être le premier et l’unique auprès du père » (p. 83).
Peeters nous raconte ce fameux voyage aux États-Unis, l’excitation croissante de ses amoureux préparatifs (p. 65), comme l’occasion d’un resserrement des liens entre Freud et Ferenczi, « tous les deux très gentils » (p. 66), sur le dos de Jung dont Freud interprétera à Ferenczi l’évanouissement qu’il aurait provoqué comme l’expression d’un souhait de mort à son égard. Puis, sous prétexte « d’honnêteté psychanalytique » et de recherche de la « vérité » avec un « père et un professeur » (p. 79), Ferenczi livre à Freud sa vie amoureuse avec Gisela Palmos et sa fille Elma. Se met en place assez rapidement une folie à quatre où les analyses successives de la fille de Gisela avec Ferenczi, Freud, puis de nouveau Ferenczi, l’offrent en otage aux liens homosexuels entre Freud et Ferenczi (comme Emma Eckstein sera la victime de la folie à deux de Freud et Fliess [Stratchey, p. 99]). L’indiscrétion devient la règle dans les correspondances, toujours au nom de la science, et la supervision des cures d’Elma Palmos, une jeune fille de 23 ans, alterne avec l’envoi de textes scientifiques élaborés dans la même attente d’une « bénédiction paternelle » (p. 163). Bien que Peeters propose très justement que ces « interférences entre amitiés, amours, liens familiaux et relations professionnelles nous paraissent aujourd’hui comme de grossières transgressions thérapeutiques » (p. 131), il montre également comment les liens entre disciples peuvent prendre en otage patients, amis ou collègues dans des confidences réciproques dont la fécondité scientifique s’alimente d’une liberté de parole qui puise ses racines dans l’infantile, toujours au nom de la « vérité » analytique.
L’idéalisation de la psychanalyse, entretenue par Freud avec l’aide de Ferenczi, ira jusqu’à proposer que la « maîtrise totale de ses faiblesses personnelles » devrait être la règle pour les disciples qui défendent la Cause auprès du Professeur. Mais c’est à coup d’interprétations sauvages que les correspondances affichent ces « faiblesses personnelles », dans un refoulement des rivalités pour le pouvoir au nom de la purification de la vie intime. Ferenczi, qui finit par s’engager dans une analyse intensive avec Freud (1914), devient ainsi le plus loyal, le « successeur pleinement valable », et « l’État-Major des offensives internes », dans un verdict sur le dos du dernier exclu : « Jung, ce gredin névrotique, n’est pas parvenu à la maîtrise de soi, comme vous » (p. 144). Et Freud de déclarer que Ferenczi vaut « toute une société » analytique, celle de la Hongrie, tout en offrant à ce « frère irréprochable », qui avait eu à « lutter avec un complexe fraternel marqué » (p. 210), la création en 1910 de l’Association Psychanalytique Internationale.
Peeters illustre admirablement comment la grande Histoire, ses bouleversements politiques sur fond de persécutions antisémites et d’effondrement des empires, de famine et d’épidémies, donnera à l’organisation du mouvement international analytique un rôle politique dans le désir de « modifier la société » comme « précurseurs de l’humanité entière » (p. 56). La psychanalyse, « l’enfant de tous les soucis » de Freud, devient « une question de vie et de mort » face aux menaces de dissidences (p. 224). Mais Peeters montre également comment la toute-puissance de l’analyse s’étend, au-delà des souffrances historiques, aux maladies dont les racines psychiques sont évaluées à l’aune des conflits institutionnels. La « douleur d’écrire » de Ferenczi, fondée sur de véritables troubles neurologiques, est interprétée comme le symptôme du renoncement nécessaire au plaisir d’offrir ses « découvertes pour plaire à Freud » (p. 55). Encouragé cependant par Lou Andréa Salomé, Ferenczi élaborera son penchant d’« incorrigible thérapeute » dans des écrits novateurs sur la technique analytique. Loin du groupe des frères, cette première femme analyste peut déjà annoncer que « le temps de Ferenczi doit venir », exergue que Peeters adoptera en première page de son livre.
Le suspense du livre de Peeters, celui du destin d’un disciple qui peu à peu s’affranchit de son maître pour devenir un penseur original et immortel à son tour, prend tout son poids lorsque nous suivons pas à pas l’assassinat scientifique de Ferenczi à la fin de sa vie. Ce fils préféré va-t-il devenir un dissident à son tour ? Ses écarts de pensée continueront-ils de stimuler celle de Freud ou contrediront-ils définitivement ses tentatives de défendre l’orthodoxie analytique ? Freud, affaibli par son cancer et les privations liées à la situation politique, se tient d’abord dans une sorte de réserve lorsque Ferenczi et Rank présentent leurs travaux ensemble, à l’Association de Vienne (1924). Bien qu’il privilégie initialement l’amitié sur les « faiblesses » de ses disciples, dans un certain pessimisme sur sa propre survie au sein de l’IPA, la rupture forcée de Rank avec la « communauté fraternelle » (p. 231) permettra à Ferenczi de survivre encore quelques années parmi les disciples.
Freud se montre de plus en plus affaibli et propose à Ferenczi de s’installer à Berlin après la mort de Karl Abraham. Mais Ferenczi choisit l’émancipation en décidant de partir pour la « maudite » Amérique » (Freud), en partie pour des raisons financières, mais également dans le désir d’affirmer son rôle au sein de l’IPA. C’est dans ce pays, continuellement décrié par Freud comme une source de « trahison et d’abandon » (p. 242), que Ferenczi élaborera le début de sa pensée la plus originale sans doute nourrie par une expérience clinique intense dans un autre univers.
La santé de Ferenczi, ses malaises répétés en lien avec sa maladie neurologique sont évoqués par Peeters en toile de fond de l’opposition douloureuse entre Ferenczi et Freud. Alors que Ferenczi élabore ses réflexions novatrices sur la technique analytique, tout en perdant la présidence de l’IPA au profit d’Eitingon, Freud laisse entendre qu’une « sénilité précoce » accompagnerait sa nouvelle « analyse oppositionnelle » (p. 253). Tout en définissant Ferenczi comme « thérapeute incorrigible », Freud tente cependant de s’interroger : « il est fort possible que vous pratiquiez l’analyse mieux que moi, mais je suis saturé de l’analyse en tant que thérapie, fed up … » (p. 254). Dans un premier temps, Freud se dit prêt à respecter la volonté d’autonomie intellectuelle de celui dont il déclare alors qu’il « n’y a personne que je vous aie préféré ». Mais il met sur le compte d’une « troisième puberté » les écarts de pensée de Ferenczi, dont « l’extinction devrait le conduire à la maturité » (p. 265). Les interprétations de Freud sur la clinique de Ferenczi deviennent cinglantes : ces « petits jeux sexuels » avec ses patientes sont issus d’une « furor sanandi, faute d’avoir trouvé auprès de ses collègues l’amour qu’il réclame » (p. 270). Alors que Freud déclare ouvertement « ne pas aimer ses malades », et promeut la neutralité analytique comme une forme d’indifférence, Ferenczi ne le suit plus sur ce terrain (p. 279), et met en veille leur correspondance. Freud devient méprisant dans ses confidences à Eitingon : « Il est vexé qu’on ne soit pas ravi qu’il joue au Papa et à la Maman avec ses élèves » (p. 289). Pour Freud, désabusé, la « racaille » des névrosés n’a de valeur que financière et scientifique, et son choix de la « primauté de l’intellect » au service de la psychanalyse isolera définitivement Ferenczi du premier cercle.
Peeters nous fait vivre la mort scientifique progressive de Ferenczi de façon indissociable de sa maladie et de sa disparition finale, par étouffement, le 22 mai 1933. « Régression névrotique envers le père et les frères » (Freud, p. 290), « grand malade qu’il faut protéger » (Ernest Jones, au moment où il brigue la présidence de l’IPA), « dégénérescence psychique de type paranoïaque liée à sa déception d’amour envers Freud » : les attaques personnelles se multiplient pour censurer l’œuvre de Ferenczi. La lecture de son texte sur la « Confusion des Langues » au congrès de Wiesbaden (1932) recevra un accueil glaçant. Et Ferenczi interprétera lui-même l’approche d’une mort prématurée comme un « suicide involontaire » (p. 297) selon une formule de Georg Groddeck, proche de Freud à l’époque.
Le nom de Ferenczi disparaîtra peu à peu des cercles psychanalytiques qu’il a contribué à fonder, dans une stratégie collective d’effacement menée par Jones et Brill que démontre Peeters de façon très documentée. Le douloureux rejet de son disciple par Freud sera cependant élaboré dans son texte « L’analyse finie et l’analyse infinie » (1937), long dialogue posthume avec celui qui avait travaillé, à la lumière de son analyse inachevée avec Freud, le problème de la fin de l’analyse.
C’est grâce aux efforts constants de Michael Balint que Ferenczi sera enfin publié dans son intégralité, quinze ans après sa mort. Une négociation serrée avec Jones, dont la biographie de Freud achève d’assassiner Ferenczi en décrivant sa maladie mentale et ses « germes psychotiques » comme la source de la « déviance sérieuse de son jugement scientifique » (p. 340), prend la forme d’un combat pour la publication d’une lettre rectificative dans l’International Journal. Balint, exécuteur littéraire de Ferenczi, veut défendre l’idée que c’est paradoxalement pendant sa maladie et son isolement que Ferenczi a « écrit des choses comme il n’en aurait même pas rêvé dans ses meilleurs jours » (p. 334). Balint a recours, de façon très subtile, à l’idée que l’un comme l’autre (Jones et lui), sont d’anciens analysants de Ferenczi, ce que Jones s’était bien gardé de noter, et propose que son droit de réponse invite les « générations suivantes à la tâche de démêler la vérité ». Pour Balint, les textes de Ferenczi publiés pendant ces années que Jones qualifie de « pur délire » « anticipent de quinze à vingt-cinq ans le développement de la technique psychanalytique » (p. 344).
En résumé, si Freud initie le rejet de Ferenczi du mouvement analytique de l’époque en le qualifiant de dissident, ce sont ses disciples qui contribueront à son effacement de la vie scientifique pendant plus de vingt ans après sa mort. Ces querelles assassines ont cependant prouvé leur fécondité dans l’œuvre de ses successeurs qui ont, peu à peu, « rétabli la vérité » (p. 360).
En conclusion, au-delà de l’histoire analytique de Ferenczi, le livre de Peeters nous confronte aux fondements éprouvants du mouvement analytique et nous invite sans doute à réfléchir à la spécificité des luttes de pouvoir dans nos institutions contemporaines.
Claire-Marine François-Poncet est psychanalyste, membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris.
Jean-Claude Rolland, Le verbe devant l’inconscient. Nouvelles données métapsychologiques, Paris, Ithaque, 2021.
 Le dernier livre de Jean-Claude Rolland est un véritable cadeau que nous fait son auteur. Inspiré, superbement écrit, dans une langue à la fois élégante et précise, cet ouvrage s’inscrit dans les suites d’une recherche que je crois commencée dès 2002 avec Sur le discours intérieur (2002), dans l’ouvrage d’hommage à André Green et poursuivi dans Avant d’Être celui qui parle (2006), suivi, entre autres, par les Quatre Essais sur la Vie de l’Âme (2015), et enfin Langue et Psyché (2020), paru en 2020 chez Ithaque.
Le dernier livre de Jean-Claude Rolland est un véritable cadeau que nous fait son auteur. Inspiré, superbement écrit, dans une langue à la fois élégante et précise, cet ouvrage s’inscrit dans les suites d’une recherche que je crois commencée dès 2002 avec Sur le discours intérieur (2002), dans l’ouvrage d’hommage à André Green et poursuivi dans Avant d’Être celui qui parle (2006), suivi, entre autres, par les Quatre Essais sur la Vie de l’Âme (2015), et enfin Langue et Psyché (2020), paru en 2020 chez Ithaque.
Le Verbe devant l’Inconscient cherche, ainsi que le dit Rolland au travers d’une belle métaphore, à mettre à jour la « nature métisse » de l’âme entre parole et psychisme.
Composé de dix courts chapitres les cent-cinq pages du livre dévoilent une métapsychologie ee et vivante qui porte sur le « verbe » au plus profond de l’âme.
Il s’agit de voir le langage, dans sa matérialité, à l’œuvre dans la cure.
Pour Rolland, il y a d’abord un mixte de sensations et d’images qui va franchir le seuil du verbe, ce serait à l’analyste écoutant d’insérer une construction de pensée qui lui permette de différencier ce que le patient lui dit, à lui, de ce que ce discours lui fait. Je trouve cette distinction subtile et éclairante. Nous n’avons en effet pas coutume de discerner l’un de l’autre et pourtant il y a bien une parole qui énonce et une parole qui fait.
Jean-Luc Donnet avait lui, très différemment, parlé d’un « agir de parole ».
Ce que l’auteur nomme « parole inchoative » est ce qui jaillit de la sensorialité brute ; elle est l’œuvre du processus primaire. Rolland voit la langue comme résultat d’un processus qui, à partir d’amalgame d’images et de signifiants, « installe une structure sémantique » ; celle-ci participe donc du tabou de l’interdit de l’inceste en le représentant à l’intérieur de la psyché. En ce sens on peut dire que la langue s’incarne dans la vie psychique à partir d’images préalables fragmentées.
Pour l’auteur, il est possible et surtout souhaitable de « fantasmer métapsychologiquement ». En effet, à partir du discours intérieur, la pensée métapsychologique du psychanalyste se construit au contact du récit associatif du patient, elle permet à l’analyste de « repérer les significations multiples et encore en germe portées par la parole du patient ».
Il est très impressionnant de voir combien la pensée de Rolland ne quitte jamais le couple formé par les deux protagonistes de la scène analytique, il n’évoque jamais l’analyste sans inclure le patient qui retentit sur le psychisme du premier. J’aurais, moi, ajouté qu’il l’entame et le transforme.
Dans cette même veine, l’auteur se réfère à des lettres échangées par Freud et Lou Andréas Salomé. Dans l’une d’elles, Freud écrit : « […] les corrélations et relations de dépendances existant dans le monde extérieur peuvent d’une manière plus ou moins fiable être reproduites ou reflétées dans le mode intérieur de notre pensée […] » (1915/1970).
C’est sans doute cela qui fait dire à Rolland que « la substance de la métapsychologie relève du reflet ».
Elle surgit « in situ » au cœur de l’expérience transférentielle, mais risque de nous leurrer, car loin d’être une science elle est une méthode, une nécessité impérieuse pour le praticien immergé dans la cure qui « perdait son âme » entre les mains des théoriciens purs.
La pensée métapsychologique serait par conséquent pour l’inconscient l’équivalent d’un organe des sens qui y détecterait des éléments agglomérés par le refoulement et rétablirait les séparations anciennes. L’auteur parle ici de « scalpel ». Freud avait d’ailleurs insisté sur la fonction séparatrice, à ce sujet il a écrit, toujours à Lou Andréas Salomé : « Ce qui m’intéresse est la séparation et l’organisation de ce qui autrement se perdrait dans la bouillie originaire » (1915/ 1970, p. 43). Il s’agit donc là d’un processus qui mène à une construction.
Le chapitre III s’intitule « Le chantier du processus primaire ».
Se fondant sur une étude minutieuse du texte freudien (1900a/2003 ; 1905c/2014), l’auteur montre que les avancées premières issues de ces travaux n’ont pas donné lieu à une révision qui tient compte de l’évolution de la pratique actuelle. Il se confronte à la difficulté de recenser les opérations engagées aujourd’hui dans le processus analytique.
Freud signale dans l’Interprétation du rêve (Freud, 1900a) qu’un appareil psychique qui ne possèderait que le processus primaire ne peut exister. Au cœur de l’inconscient, le processus primaire, qui consiste en motions de désir, est dans une activité permanente qui interpelle le refoulement. Plus tardif, le processus secondaire cherche à produire : « […] une inhibition de ce déversement et une transformation en investissements quiescents, sans doute avec élévation de niveau » (Freud, 1900a/2003, p. 655).
Rolland identifie trois tâches dans le processus primaire.
Réguler les mouvements de déplacement et de condensation ; ordonner les rassemblements et disjonctions des différents ingrédients ; enfin, instaurer une mémoire de l’infantile qui cherche à résister au refoulement.
Condensation et déplacement concernent les objets du désir infantile tôt introjectés dans nos mémoires inconscientes, ils sont, nous dit joliment l’auteur, « les mouvements de l’âme ».
Grâce à eux, les représentations et affects transitent dans nos psychismes, s’y transforment et se recomposent, produisant les myriades de scènes qui font la richesse de la vie psychique.
À partir de là, l’auteur va passer par Léonard de Vinci, Picasso, Raphaël, une création mythique des Aborigènes d’Australie, et la poésie d’Arthur Rimbaud pour approcher le concept de « Zusammenhang[1] » dont il dira qu’il est aussi présent dans la cure analytique. Ces « compositions », que je verrais plutôt comme des concaténations, sont des formations elles aussi « métisses » puisqu’elles participent de lieux psychiques divers et sont à l’œuvre tant dans la création de croquis par Picasso que dans la recherche de la ligne pure de Raphaël ou l’écriture du Bateau ivre de Rimbaud, que dans le mythe des Warlpiri d’Australie centrale qui disent que pour attraper leurs futurs parents les enfants à naître se serviraient d’un « propulseur de rêves ». Cela m’a rappelé La femme sans ombre[2], de Hugo von Hofmannsthal où, dans l’opéra de Richard Strauss, il y a un magnifique chant par le chœur des « enfants non-nés » interpellant la femme du teinturier Barak qui s’apprête à vendre son ombre renonçant ainsi à la fertilité.
Ces « compositions » qui seraient des décompositions, condensations et recompositions sont aussi à l’œuvre dans la cure. Rolland offre ici un récit clinique. Au cours de ce dernier, on voit comment une représentation d’attente est mise en lien avec une formation inconsciente qui, grâce à l’énergie qui est la sienne, va propulser cette concaténation dans les instances supérieures du psychisme. Là, grâce au processus et au transfert, adviendront les signifiants.
Par la suite, et sous le titre de « Connexions et séparations », Rolland rassemble les opérations qui relèvent de la déliaison. Ceci implique une vision de l’appareil psychique en tant que construction dont les pièces peuvent se disjoindre, se condenser, et enfin se conflictualiser.
Ces opérations sont différentes selon qu’elles concernent une instance ou l’autre, par exemple la disjonction du signifié et du signifiant se fait sous l’égide de la négation.
La disjonction du moi, du je et de la langue se produit au cœur de la cure lorsque le moi abandonne la maîtrise de sa parole. Cette « troisième langue », nous dit l’auteur, se met au service du moi inconscient qui a ses propres lois. Par analogie avec l’association libre dans la cure, l’auteur cite et étudie les poètes : Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Valéry, Paul Celan.
Un très beau passage (p. 53-55) est consacré à une analyse du Bateau ivre. Écrit par Rimbaud à 16 ans, il raconte, à la première personne, la dérive d’un navire sans maître, chahuté par les flots. Je n’en rappelle que les tout premiers vers :
Comme je descendais des fleuves impassibles
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cible
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
Et enfin les quatre derniers :
Je ne suis plus baigné de vos langueurs ô lames
Enlever leur sillage aux porteurs de coton
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.
En relisant ce poème, je crois bien voir ce que Rolland nomme « déconnexion de la langue et du je. Il écrit : « Cette première disjonction entre le moi et le Je se double d’une seconde opération consistant en ce que le ‟Jeˮ, au lieu de rester son outil, se donne les pleins pouvoirs sur la langue qui devient en quelque sorte sa créature [Elle] y déploie la puissance d’invention qui lui est propre […] »
L’auteur prend Le Bateau ivre pour exemple de cette disjonction Je/Langue dont il propose qu’elle reflète le clivage pensé par Freud entre une sexualité infantile avide et prématurée et l’action du refoulement qui rejette ces expériences dans l’inconscient pour qu’elles soient inaccessibles à la mémoire ordinaire. Il passe sans transition à un récit de cure :
Un patient mélancolique, en face à face, habituellement douloureux et très mutique arrive un jour en retard, il s’était trompé d’heure. Il se dit ensuite obsédé par un vers « L’œil était dans la tombe et regardait Caïn ». L’analyste propose un lien avec le temps oublié qui met le patient en colère. Il change de posture, s’avance dans le fauteuil et fixe longuement son analyste d’un « regard froid, presque cruel ». Il s’intéresse ensuite à un tableau abstrait dans lequel il devine deux tours, les Twin Towers, et dit avoir pensé que cet événement tragique a exercé un effet jouissif sur le monde. Songeant à « l’objet tombé sur le moi l’accable de sa haine » (Freud 1916-17g), Rolland dit : « L’œil était dans la tombe… vous procurait peut-être le même effet jouissif. » Interprétation apparemment mutative pour cet homme.
L’auteur commente disant que la langue de ce patient s’est libérée de la tutelle du moi pour se mettre au service du moi inconscient.
Ainsi il voit la rime comme exemple d’une disjonction de l’expression et de son contenu idéique sous l’égide du processus primaire.
Le chapitre VII est une recension des premiers concepts métapsychologiques, suivie d’un questionnement sur l’élargissement possible du champ de la métapsychologie. L’auteur reprend une thèse fort intéressante, déjà défendue dans Langue et Psyché, selon laquelle le fondement de l’associativité relève peu de la langue courante. Il fait donc l’hypothèse d’une « troisième langue » que le flux du transfert rapproche des formations de l’inconscient qui la travaillent.
Pour mieux cerner ces phénomènes, Rolland va passer par l’examen comparatif avec d’autres systèmes linguistiques, entre autres, la langue égyptienne et l’approche linguistique du poète russe Ossip Mandelstam. L’étude par ce dernier de la langue poétique souligne un « rapport conflictuel entre voyelles et consonnes » ; pour lui, la poésie se doit d’être attentive « aux restes dont elle dispose, à ses décombres, aux éclats d’une pensée blessée. Le mot apparaît comme le survivant meurtri d’une parole blessée ».
La théorie de la langue que développe Mandelstam est captivante et illustre certaines hypothèses de Rolland. La représentation verbale serait une matrice pleine d’images dont surgit la parole, Mandelstam écrit : « Le vers vit de l’image interne […] c’est l’image interne qui résonne et que l’ouïe du poète a palpée. » Rolland y voit une analogie avec ces moments de la cure d’un patient où surgit une représentation que nous ne pouvons pas expliciter, mais nous sentons que « les mots du patient pénètrent en profondeur dans notre chair et que ce que nous lui disons bouleverse l’architecture de son monde intérieur… ».
Si Mendelstam travaille surtout sur des intuitions, l’auteur lui va les traiter comme « des préconceptions métapsychologiques qui résonnent avec sa conception théorique d’une ‟troisième langueˮ ».
Le chapitre suivant se penche sur la construction dont l’auteur pense qu’elle serait une avancée freudienne « étrange ». Interprétations et constructions appartiennent à un continuum langagier et participent de la parole inchoative comme le « discours intérieur » nourries par le contretransfert et le transfert du patient. La troisième langue, elle, ne s’active que dans le cadre d’une intime interlocution. À titre d’exemple, il relate une très belle séance assez évocatrice pour me rappeler des moments cliniques privilégiés.
Après avoir relu à la loupe les textes où Freud parle de la construction, l’auteur se penche sur la contribution de Winnicott. Dans La consultation thérapeutique chez l’enfant, ce dernier évoque un enfant nommé Ashton qui avait développé du talent pour la peinture et la musique dont il disait lui-même que cela l’aidait à contrôler ses hallucinations. Ashton dessine deux masses avec au milieu une petite masse ronde ; Winnicott relie son dessin aux bruits de ses parents la nuit. Communiquée à l’enfant cette interprétation le conduit à un examen plus approfondi de sa relation aux parents[3].
L’enfant ressort de cette séance, débarrassé de l’angoisse de ses hallucinations sonores, ce qui fait dire à Rolland :
« Quelque chose de très secret du commerce de l’analyste et patient, faisant écho à ce qui se passait entre ses parents, et pas très différent d’une transmission de pensée, s’est produit là, dont nous sommes exclus ; ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas vraie. »
Revenant à la poésie, l’auteur se tourne ensuite vers Marguerite Yourcenar qui inclut les oracles à son anthologie des poètes de la Grèce antique (1979). Les oracles devaient être déchiffrés par la pythie, ou les prêtres du temple, et donc soumis à leurs interprétations. Et, en effet, un aphorisme célèbre d’Héraclite « Le seigneur qui vaticine à Delphes ni ne cache, ni n’énonce, il signifie », nous le rappelle. Dans la pensée grecque, le mystère du signe fait la poésie de l’oracle peut-on lire sous la plume de Yourcenar.
Ces réflexions nous amènent à nous demander si dans la cure l’interprétation n’a pas pour fonction de nommer l’obscur objet du désir ? Et en ce sens l’interprétation relèverait d’un acte de parole « extra-ordinaire ».
« Meine ideal-und schmerzenkind », « Mon enfant idéal et de douleur », c’est ainsi que Freud (Freud, 1985c [1887-1904]2006) nommait sa métapsychologie, et c’est aussi le titre du dernier chapitre de ce livre passionné et passionnant.
Mon intérêt pour la douleur, dont je fais un « sine qua non » de la pensée, a été spécialement suscité par cette expression de Freud, dont j’avoue qu’elle m’était jusque-là totalement inconnue.
La formule peut paraître surprenante, car Freud tenait à sa métapsychologie dont il avait l’ambition qu’elle fasse référence « à des processus mentaux comprenant leur description des points de vue dynamique, topique, économique ».
Rolland fait l’hypothèse que cette « sorcière » chère à Freud porterait le reflet, voire la marque, de l’objet même qu’elle veut traiter, soit la douleur psychique sous toutes ses formes. La pensée métapsychologique serait en ce sens l’écho de la mémoire douloureuse des éprouvés infantiles.
Sous la plume de l’auteur, on peut lire : « La douleur évoquée par Freud au sujet du penser métapsychologique réactualiserait-elle celle qu’affronta le premier homme pensant ? »
Il ajoute l’idée selon laquelle la métapsychologie « dénuderait » l’observation clinique pour en faire paraître l’ossature pensée qui pourrait avoir suscité le malaise de Freud.
Cette douleur qui semble n’avoir jamais quitté ce dernier est illustrée par plusieurs moments que souligne Rolland : l’abandon de sa neurotica, l’abandon de son autoanalyse.
De cet abandon « naîtra la méthode métapsychologique comme son substitut par retournement[4] de l’attention sur sa propre personne », propose-t-il.
À ce point, l’auteur revient à ses analogies fructueuses avec les arts pour évoquer la force poétique de ce que Valéry avait nommé « le phénomène photo-poétique » et il est vrai que pour Freud aussi l’image est une source d’illumination qui nous ouvre un monde inconnu.
En effet, la métaphore fait apparaître des images jusque-là invisibles, des analogies, dont Aristote pensait qu’elles étaient la source de la pensée métaphorique, donc d’une pensée incarnée.
En guise de conclusion, Rolland rend hommage à Green pour avoir mis en lumière une négativité qui est le propre de l’inconscient.
Après 1915, la réflexion freudienne n’a cessé d’approfondir sa recherche, mais sans être parvenue à une complétude conceptuelle, cela participe sans doute de cette douleur ontologique que Jean-Bertrand Pontalis nommait « douleur d’exister » et que Benno Rosenberg évoque dans ce qu’il a appelé la « dimension masochique de l’existence ».
Bref, il s’agit là d’un livre rare, concis et original, d’une violence maîtrisée ; il bouleverse certaines de nos conceptions. Il a de plus l’immense mérite d’être aussi le fruit d’une érudition rare qui, loin d’être seulement psychanalytique et métapsychologique, prend la peine de nous confronter à d’autres domaines : poésie, linguistique, anthropologie, histoire et littérature ce qui fait de sa lecture un moment de vrai plaisir
Références bibliographiques
Freud S. (1985c [1887-1904]2006). Lettres à Wilhelm Fliess : 1887-1904. Paris, Puf.
Freud S. (1900a/2003). L’interprétation du rêve. OCF.P, IV. Paris, Puf.
Freud S. (1905c/2014). Le trait d’esprit et sa relation à l’inconscient. OCF.P, VII. Paris, Puf.
Freud S. (1915c/1988). Pulsions et destins de pulsion. OCF.P, XIII : 163-185. Paris, Puf.
Andreas-Salomé L. (1915/1970), Correspondance avec Sigmund Freud. Paris, Gallimard.
Rimbaud A. (1871/2020). Le bateau ivre et autres poèmes. Paris, Flammarion.
Rolland J.-C. (2002). Sur le discours intérieur. Dans S. Botella (dir.) Penser les limites : écrits en l’honneur d’André Green : 338-346. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Rolland J.-C. (2006). Avant d’être celui qui parle. Paris, Gallimard.
Rolland J.-C. (2015). Quatre essais sur la vie de l’âme. Paris, Gallimard.
Rolland J.-C. (2020). Langue et psyché. Paris, Ithaque.
Rolland J.-C. (2021). Le verbe devant l’inconscient. Nouvelles données métapsychologiques. Paris, Ithaque.
Yourcenar M. (1979). La couronne et la Lyre. Paris, Gallimard.
Marilia Aisenstein est psychanalyse, membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris et de la Société hellénique.
[1] Composition, mot déjà apparu chez Freud dans l’Interprétation du rêve pour décrire une construction inconsciente fabriquée à partir d’un percept qui s’agglutine à un désir inconscient devenant une formation inconsciente autonome.
[2] Créé le 10/10/1919 à Vienne, la fameuse diva Lotte Lehmann y tient le rôle-titre.
[3] Citation du texte de Winnicott.
[4] Décrit dans Pulsions et Destin des Pulsions (Freud, 1915c), le retournement sur la personne propre est une opération complexe sous l’égide du processus primaire, elle n’est pas sans prix et s’accompagne souvent d’un « double retournement pulsionnel » : en son contraire sur la personne propre.
Quatre recensions de livres parues dans la Revue des livres du numéro « Pouvoir des imagos ».
Nicole Llopis-Salvan, De l’émotion à l’affect (percevoir ce qui nous touche), Paris, In Press, 2021
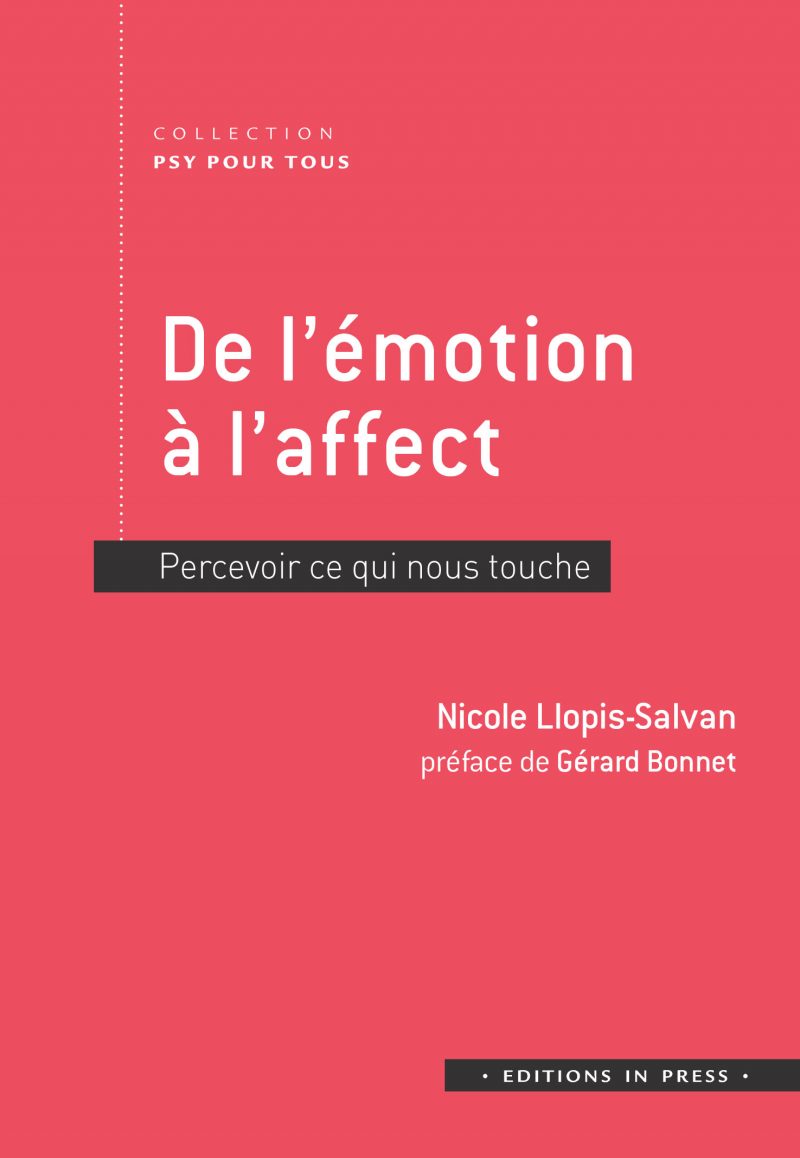 En présentant ce livre dans la collection qu’il dirige, Gérard Bonnet rappelle l’opposition classique de l’émotion et de la raison et la mode actuelle des méthodes de gestion des émotions. En dehors des effets négatifs de leur répression, les émotions trouvent expression dans les liens, les groupes, les rites et les codes pour la cohésion sociale, et dans les créations artistiques.
En présentant ce livre dans la collection qu’il dirige, Gérard Bonnet rappelle l’opposition classique de l’émotion et de la raison et la mode actuelle des méthodes de gestion des émotions. En dehors des effets négatifs de leur répression, les émotions trouvent expression dans les liens, les groupes, les rites et les codes pour la cohésion sociale, et dans les créations artistiques.
En avant-propos du livre, Nicole Llopis-Salvan cite Marcel Mauss (1921) selon lequel l’émotion est langage et symbolique. L’obligation de son expression dans le deuil conduit à la question : qu’en est-il en matière de santé mentale ?
Dans l’introduction, l’auteure établit la distinction de l’émotion, du côté de la force vitale et des expériences de plaisir-déplaisir, et de l’affect comme concept psychanalytique, c’est-à-dire comme représentant pulsionnel. Suivant l’étymologie, elle situe l’émotion comme source interne à l’origine de mouvements psychiques de l’intérieur vers l’extérieur, et l’affect du côté de la perception, donc du rapport à la réalité et aux objets.
Au premier chapitre, le commentaire de L’étranger de Camus, étayé sur l’interprétation détaillée des psychanalystes argentins, illustre bien le « cheminement vers la levée de la répression des affects et le parcours vers une forme de subjectivité… » : du deuil impossible à la mélancolie et à la paranoïa : le meurtre comme suicide, et la rencontre avec le prêtre pour le renversement final du roman.
Au chapitre deux : « l’affect, un concept psychanalytique » est situé en référence au traité de Georges Dumas (1948) (mais pas à Darwin ni à notre contemporain Alain Damasio qui distingue émotion et sentiment). Pour Dumas, trois dimensions : physiologie, psychologie (dynamique) et socialisation : d’une part les sensations et les besoins (l’autoconservation et la reproduction en partage avec les animaux), d’autre part, les sentiments, les passions, et l’expression des émotions réprimées de la tristesse ou de la peur comme « psychologie statique ».
Le fil conducteur est ensuite l’œuvre de Freud (avec une brève vignette clinique). De « l’affect coincé » et de la méthode hypnocathartique, au modèle fondamental du couple affect-représentation comme représentant pulsionnel (p. 38) et à la première topique (1915). « Le moi, lieu de l’affect, doit se protéger du déséquilibre lié à la surcharge de l’excitation », d’où : formation de compromis, identification, sublimation. On peut penser ici au destin des affects dans les processus de liaison et de déliaison des symptômes névrotiques et à l’isolation obsessionnelle.
Le destin du facteur quantitatif du représentant pulsionnel est soit la répression complète de sorte que la pulsion n’apparaît pas, soit elle se manifeste comme un affect doté d’une coloration qualitative quelconque (les échanges et confusions d’affects), ou elle est transformée en angoisse. Le cas de Mme B. illustre cet aspect : les nombreuses raisons d’être angoissée sont ramenées, dans le transfert, à la conflictualité œdipienne.
L’introduction du narcissisme (Freud, 1914) comporte l’idée d’une destructivité interne comme entrave à l’action du narcissisme de vie (d’où le narcissisme négatif décrit par Green). Avec la deuxième topique et le dualisme pulsionnel, la place de la destructivité et du principe de Nirvana change la perspective métapsychologique, par le jeu des instances : le ça (chaotique ouvert à son extrémité du côté somatique), le moi (en partie inconscient) et le surmoi. « La seconde topique passe du qualitatif au structural ».
Dans « Le moi et le ça » (Freud, 1923), l’hypothèse d’un inconscient non refoulé permet une vue d’ensemble que notre auteure résume de la façon suivante : « Ainsi, si l’on reprend le trajet de l’énergie pulsionnelle, qui va du passage du physiologique au psychique, on observe une chaîne qui passe par les sensations et les émotions, l’affect et la représentation ; le niveau le plus élaboré psychiquement étant celui des représentations de mots » (p. 43). « Ainsi, deux situations différentes s’envisagent : celle de la représentation qui peut accéder au préconscient grâce au langage, et celle des sensations internes ou des sentiments qui peuvent (court-circuitant le préconscient) accéder directement à la conscience sans être connectés à une pensée » (p. 45). Le cas de Fabienne en donne une forte illustration. On songe ici aux motions pulsionnelles de « l’inconscient du ça », finalisées par l’agir, en rupture avec l’activité psychique de figuration et de représentation.
En 1925, « La négation » a modifié la polarité affect-représentation (p. 47) : « La représentation refoulée peut parvenir à la conscience sans l’affect qui lui est associé. Toutefois, l’affect refoulé peut entraver les processus de pensée et l’accès à la conscience de la représentation. Seule l’association représentation et affect […] peut lever le refoulement ».
Sans entrer dans la complexité du texte Inhibition, symptôme et angoisse (Freud, 1926) (les affects négatifs, la douleur, la détresse), l’auteure choisit le fétichisme (Freud, 1927) pour montrer comment le couple affect-représentation, défait, ne comporte pas le refoulement de l’affect, mais le clivage : le désaveu de la représentation, le déni de réalité et le fantasme surinvesti. Une étape dans la pensée de Freud qui annonce le clivage dans les psychoses, la destructivité et les « agonies primitives ».
La conclusion de cette première partie du livre reprend celle de Green (Le discours vivant, 1973) : il ne faut pas opposer l’intellect et la passion, mais définir le cadre général de la théorie de l’affect : la structure (les deux topiques), le conflit entre deux affects contraires, l’économie (la quantité et la transformation).
Au chapitre trois, « D’autres auteurs après Freud », l’auteure en dit davantage au sujet de Green et, à partir de lui, succinctement, de Winnicott et de Bion. La thèse sur le discours vivant, vive critique de la théorie lacanienne du signifiant, donne un rôle majeur à l’affect. Corrélativement au refoulement de la représentation, la répression ordonnée par la censure, transforme les affects de différentes manières. Ses destins dans le rêve le montrent : variation d’intensité, déplacement, transformation en son contraire. S’il advient à la conscience par les représentations de mots, il trouve une première forme dans les représentations de chose (et d’objets) : « L’affect comme un événement psychique en l’attente d’une forme. » Green en tire des conclusions sur la nécessaire prise en compte des affects de l’analyste dans la relation de transfert, dans « la passion du transfert ». Fil conducteur pour l’analyse dans les organisations non névrotiques, le transfert peut prendre la forme d’une folie partagée dans l’interpsychique où s’actualisent les relations mère-enfant précoces. Comme le rappelle l’auteure, la perspective de la perte, et de la représentation de l’absence de représentation, est, pour Green, la condition de l’intériorisation de la fonction contenante de la mère-environnement (Winnicott) et, par le double retournement, de la constitution de la structure encadrante de l’activité de pensée.
Il est évident que, dans ce livre, Llopis-Savan ne peut expliciter davantage les théorisations de Green sur le devenir des affects dans leur rapport aux passions, aux pulsions destructrices, au retrait d’investissement des dépressions primaires, aux notions de psychose blanche, deuil blanc ou syndrome de la mère morte (qu’elle cite cependant) et, plus généralement, dans le travail du négatif. Un autre livre serait nécessaire.
De Catherine Parat, l’auteure retient une conception de l’affect dans la cure, le transfert de base, le concept d’affect-partagé et expose une vignette clinique dans laquelle se manifeste l’activation émotionnelle ; de Christian David, l’idée que l’affect est la trace interne de l’existence de l’autre, de l’extériorité de l’objet. Il récuse le primat de la représentation sur l’affect et des mots sur les choses. La représentivité de la pulsion a une relative indépendance (dans La bisexualité psychique, 1992). La relecture du cas de Dora et de la théorie du rêve (avec M. Fain, 1962) contribue à la psychosomatique à l’Ipso. Plus originale est sa théorie de la « perversion affective » qui est ici résumée.
Au chapitre 4 : « L’émotion comme finalité de la création artistique ? » est, curieusement, illustrée par l’œuvre de Marina Abramovic : l’Art corporel et « les performances » « pour sortir l’émotion […] une souffrance commune à tous ». Un commentaire freudien aurait sans doute fait référence à la dimension exhibitionniste-voyeuriste de la théâtralisation, et, lacanien, au narcissisme spéculaire. Mais il s’agit plutôt, me semble-t-il, de tentatives agies de réparation des traumas narcissiques précoces et des carences maternelles précoces, suggérant par exemple le modèle du « mirroring », celui de « l’attachement » et de « la résilience » ?
Intitulé « L’affect est-il une voie pour penser le symptôme ? », le chapitre 5 expose « la rencontre clinique » avec une vignette personnelle, et rappelle, dans la psychosomatique de l’Ipso, les notions de mentalisation, de pensée opératoire, ou encore de surinvestissement du factuel. Un état des lieux sans autre interrogation sur l’alexithymie et sur le travail du négatif (Green). Des questions qui auraient demandé un trop grand développement.
Plus personnel est le chapitre 6 : « Le rire, un affect particulier » : défi et triomphe narcissique sur la souffrance dans les rapports au corps, à la réalité extérieure et aux autres. Ce qu’il en a été chez Freud, dans sa vie et dans son œuvre, omet l’épisode douloureux de la cocaïne (et, par-là, la question des addictions), évoque le contexte personnel de l’introduction de la pulsion de mort, et rend compte de la théorie de l’humour par l’état interne des rapports moi-surmoi et par la dimension sociale (Freud, Le Witz, 1927). Mais il y a divers types de rires dont celui du soulagement de l’état de tension, celui de l’excitation liée à la peur, le rire halluciné de J.-B. Clamence dans « La chute » de Camus, et, en citant Jean-Luc Donnet, le rire en séance. Mais il s’agit surtout de l’idée de l’auteure du « rire d’effroi ». Effroi est la traduction de Schreck en allemand, c’est-à-dire, dans Inhibition, symptôme et angoisse, l’angoisse traumatique, dite « automatique », de débordement du moi, par opposition à l’angoisse comme signal adressé au moi pour la mise en jeu des défenses. Le rire compulsif de la petite Albertine, 9 ans, associé à une agitation bruyante et tapageuse, évocatrice de l’excitation maniaque, serait un mode d’expression agi de l’angoisse traumatique.
Le contre-transfert dans le champ clinique (Chapitre 7 : « Affect et travail de contre-transfert ») expose succinctement l’évolution des idées sur le contre-transfert et le rôle de Paula Heimann, qui est citée (p. 123). On aurait pu s’attendre à la notion de régrédience dans le contre-transfert au sens de César et Sara Botella, mais l’auteure parle de « passivation » (en un sens bien différent de celui que Green lui donne). Le cas clinique de Josiane illustre bien le travail d’élaboration du contre-transfert comme moyen d’accès à l’inconscient du patient : ce que ressent douloureusement l’analyste est induit par le mode de communication de la patiente. Il est la répétition à rôles inversés de la relation avec sa mère comme non-communication ayant induit dès l’enfance des troubles somatiques (et/ou somatomorphes). Est ensuite discutée la difficile question de la double inscription dans la prise de conscience de l’inconscient : l’hypothèse fonctionnelle et l’hypothèse topique : changement d’état de la même représentation ou émergence d’une nouvelle représentation comme nouvelle inscription, nouvelle fixation ? L’auteure soutient l’hypothèse, déjà discutée par elle en colloque, que « l’analyste peut devenir le dépositaire d’affects enfouis ou méconnus en provenance du patient. […] un trajet qui irait de la corporéité du patient vers une inscription dans l’inconscient et dans la corporéité de l’analyste […] un corps pour deux ». D’où l’idée d’une « occupation étrangère du territoire intime de l’analyste, transmise à l’analyste par des affects, des émotions, ou des sensations. Un informe externe-interne qu’il faut accueillir : une forme intrusive ou effractive d’identification projective ». Le pouvoir de l’affect transmis dans la relation de transfert, qui peut aller jusqu’à mettre en question le sentiment d’identité de l’analyste, est condition de la transformation et exigence du travail de contre-transfert.
Le livre se termine par une brève conclusion qui est de circonstance dans le temps du confinement lié à la pandémie : la nécessité et les difficultés de maintenir les exigences de la méthode psychanalytique.
Conclusion
Dans ce livre de style agréable, références littéraires et artistiques se conjuguent avec des citations bien choisies sans perdre le fil conducteur de la métapsychologie. Les affects sont envisagés dans les pratiques psychanalytiques contemporaines dont les cas limites, la psychosomatique et l’enfant. De brèves vignettes cliniques illustrent la place et l’évolution des affects dans la relation de transfert, et leurs avatars, dont notamment le rire et « le rire d’effroi » décrit par l’auteure. La théorisation, évitant les dérives contemporaines du « tournant émotionnel de la psychanalyse » et celles de la « neuropsychanalyse », trouve fondement dans l’œuvre de Freud et chez ses héritiers, surtout Green, théoricien des passions humaines.
Bernard Brusset est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.
Christian Gérard, Le père des premiers liens, Paris, In Press,2019.
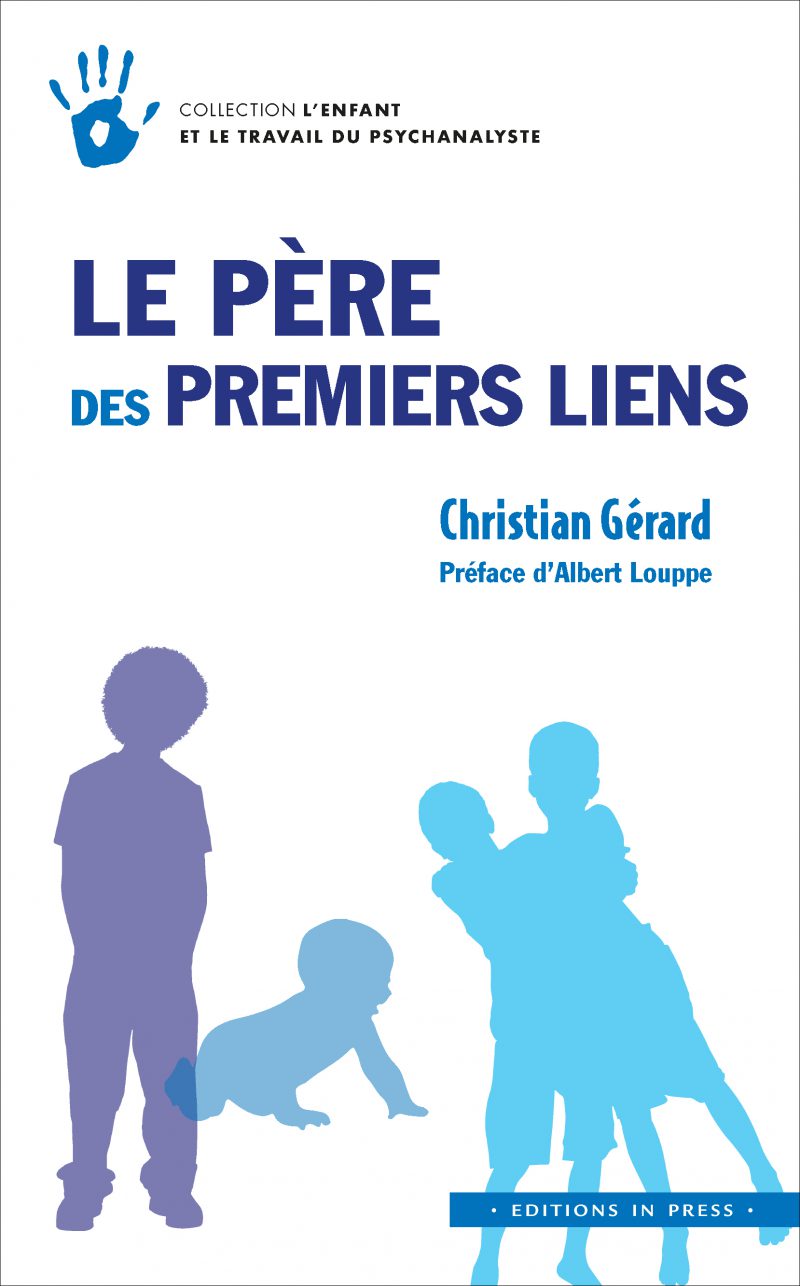 Cet ouvrage de Christian Gérard s’intéresse, d’un point de vue psychanalytique, au rôle joué par le père de la toute petite enfance dans l’organisation de la vie psychique et le devenir du sujet. Il précise, prolonge et illustre les réflexions déjà avancées par l’auteur dans plusieurs articles antérieurs, notamment dans Le père : un objet primaire ? (Gérard 2004), L’inhibition et ses liens avec le père primaire (Gérard, 2009) ou encore Les triangulations précoces (Gérard, 2010).
Cet ouvrage de Christian Gérard s’intéresse, d’un point de vue psychanalytique, au rôle joué par le père de la toute petite enfance dans l’organisation de la vie psychique et le devenir du sujet. Il précise, prolonge et illustre les réflexions déjà avancées par l’auteur dans plusieurs articles antérieurs, notamment dans Le père : un objet primaire ? (Gérard 2004), L’inhibition et ses liens avec le père primaire (Gérard, 2009) ou encore Les triangulations précoces (Gérard, 2010).
Si, comme le rappelle Gérard, la question du rôle du père dans les premières années de vie de l’enfant est aujourd’hui abondamment traitée dans la littérature psychologique, tant sur le plan clinique qu’en psychologie expérimentale, celle-ci est restée en revanche longtemps négligée dans la littérature psychanalytique, que ce soit chez Freud ou chez les auteurs post-freudiens. Ainsi, si le père occupe une place centrale dans l’œuvre du créateur de la psychanalyse, c’est avant tout en tant que père symbolique et œdipien. Chez ses successeurs, les liens précoces ont été davantage explorés, mais principalement du côté de la relation mère-enfant.
Loin de renier cet héritage, Christian Gérard explore et développe, dans une première partie de son livre, les conceptions psychanalytiques de ses prédécesseurs concernant la place du père et les processus psychiques précoces, pour mieux étayer et situer ses propres propositions théoriques. Ainsi, à la suite de Freud, l’auteur envisage qu’un vécu et des processus comparables à ceux décrits initialement vis-à-vis de l’objet maternel, tel que l’expérience de satisfaction, les étayages primaires, ou l’identification primaire, puissent advenir avec un objet différent de la mère, à savoir le père. À l’instar d’autres auteurs, tels que Melanie Klein, Donald R. Winnicott, Piera Aulagnier, ou Denise Braunschweig et Michel Fain, tout en précisant ici les spécificités de son point de vue, Gérard fait l’hypothèse qu’un psychisme autre que la mère peut être perçu précocement par l’infans.
Outre ces éléments bibliographiques, c’est aussi sur sa longue expérience de psychanalyste d’adultes et d’enfants que Christian Gérard s’appuie pour développer ses réflexions. Tout au long de l’ouvrage, de nombreuses vignettes cliniques, issues de sa pratique, mais aussi des littératures antique, classique et contemporaine, viennent ainsi illustrer et, par la même, expliciter son point de vue.
La thèse centrale de l’auteur est que le père primaire, en tant que père de la quotidienneté et en tant qu’objet primaire, joue, à côté et en articulation avec la mère, un rôle primordial dans la construction psychique du sujet et ce, notamment par l’intégration d’expériences primaires fondamentales pour son devenir, telles que les triangulations précoces, les symbolisations primaires et l’inhibition primaire.
Le père primaire, que l’auteur distingue du père œdipien, est à comprendre ici comme étant à l’articulation entre réalités externe et interne, espaces intersubjectif et intrapsychique. Père corporel, sensoriel et affectif du dehors, il est aussi le père objet primaire du dedans. Dès le début de la vie, et à l’instar de la mère, ce père sensoriel et affectif est à considérer, pour Gérard, à la fois comme un objet d’identification et comme un objet d’investissement libidinal, sans que ces deux types de liens ne puissent être distingués l’un de l’autre.
Plutôt que de s’intéresser à la prééminence éventuelle du rôle de l’un ou de l’autre des parents, Gérard met ici l’accent sur l’importance des triangulations précoces, dans une conception qu’il distingue de celle de l’Œdipe précoce de Melanie Klein. L’auteur fait l’hypothèse que l’infans, à partir des expériences sensorielles et affectives de son quotidien, est très tôt en mesure de percevoir une différence dans la pulsionnalité provenant de chacun de ses parents. Il percevrait ainsi précocement quelque chose de la différence des sexes, sans pour autant percevoir la relation sexuelle entre ses parents. Ces premières triangulations, dites préœdipiennes, dans lesquelles le père occupe une place essentielle, constituent pour Gérard un préalable à l’émergence des symbolisations primaires, symbolisations fondamentales, car organisatrices du Moi corporel, et à l’origine des premières différenciations dedans/dehors, contenant/contenu, ainsi que des premières articulations bon/mauvais. Cette activité de symbolisation primordiale serait à rattacher, selon Gérard, au processus précoce de freinage pulsionnel : la liaison de la pulsion à l’objet, en mettant fin à la mobilité de la pulsion, et en s’opposant à sa résolution, permettrait que se structurent les prémisses de la différenciation et de la rencontre avec l’objet.
En psychopathologie, certains tableaux de la clinique contemporaine, dans le champ des pathologies narcissiques et limites, pourraient s’expliquer par des défaillances dans la mise en place de ces processus primordiaux, notamment du fait de carences paternelles primaires. Ainsi, pour Gérard, lorsque le père objet primaire ne peut tenir une place suffisamment organisatrice d’une triangulation précoce de bonne qualité, les symbolisations primaires peuvent être atteintes ; une situation de confusion au niveau du moi, par défaillance de la différenciation contenant/contenu, apparaît. La mise à distance et le deuil des objets primaires sont empêchés. Une pathologie de l’inhibition primaire risque alors d’engendrer une défaillance des processus de refoulement, des processus œdipiens, de même que des inhibitions secondaires. Les tableaux cliniques qui en résultent, chez l’enfant et chez l’adulte, sont souvent invalidants, caractérisés par l’excitation sexuelle et psychomotrice, la passivité, ou l’inhibition. Plusieurs exemples cliniques sont ainsi donnés dans l’ouvrage.
Dans d’autres configurations, en regard d’une carence maternelle et d’une insuffisance de triangulation de la relation père-infant par la mère, c’est la relation au père primaire qui est surinvestie, avec parfois une dimension incestuelle, voire incestueuse. Dans les situations de pères mystérieusement endeuillés, une identification à l’objet du deuil du père peut favoriser des tableaux d’inhibition secondaire chez l’enfant devenu adolescent ou adulte.
C’est le cas du personnage de Sérieuse, dans le roman Le crime du comte Neville, d’Amélie Nothomb, cité par l’auteur (Nothomb, 2015). Cette adolescente de 17 ans, fille du comte Neville, et prise dans une relation avec sa mère décrite comme carentielle, a perdu tout élan vital depuis l’âge de 12 ans et demi. Elle disparaît dans la forêt. C’est son père qui est prévenu en premier, et c’est lui qui ira chercher sa fille. À l’occasion d’une fête organisée annuellement au château, et dont une édition précédente a coûté la vie à sa sœur Louise, Sérieuse propose à son père de l’assassiner, afin de l’aider à réaliser l’oracle d’une voyante rencontrée dans la forêt, prédisant qu’un crime aurait lieu durant cette réception. Finalement, la malédiction est brisée grâce à l’intervention d’une soprane à la voix mélodieuse, affective, sensorielle qui vient réveiller Sérieuse et éloigner de son projet mortifère. Pour Christian Gérard, Sérieuse, exposée à une carence affective dans le lien précoce à sa mère, va chercher chez son père ce qui n’a pu advenir dans la relation avec sa mère. C’est ici un père primaire en tant que père de la détresse infantile qui est sollicité. Identifiée à l’objet du deuil du père, sa sœur Louise décédée, elle se trouve dans une configuration précaire dont elle parvient à sortir grâce à l’intervention d’un tiers secourable, la soprane, rassemblant les qualités à la fois d’une mère primaire et d’un père primaire de qualité.
Cette rencontre heureuse n’est pas sans rappeler certains moments de cures analytiques, lorsque l’analyste est interpelé dans le transfert, à une place d’objet secourable, renvoyant à la relation du patient à ses premiers objets, et à la manière dont ceux-ci ont pris en compte la détresse infantile du sujet. L’auteur propose ainsi de distinguer un transfert maternel primaire, qui serait du côté de la contenance, de l’accueil et de la réceptivité, et du soutien du potentiel créatif du sujet, et un transfert paternel primaire, qui serait du côté de l’organisation, de la séparation et de la symbolisation primaire, au potentiel plus conflictuel. Il donne plusieurs exemples de moments issus de cures analytiques au cours desquelles des scènes du passé, parfois très précoces, émergent et se rejouent dans la scène transférentielle, permettant des remaniements dans les imagos parentales et souvent, un apaisement chez le patient.
C’est ce qu’illustre la vignette clinique issue de la cure de Charles, 50 ans, dirigeant d’entreprise venu consulter pour des angoisses et un fort sentiment de culpabilité suite à des relations sexuelles qu’il a eues récemment avec plusieurs de ses employées. Durant le travail analytique, dans un premier temps, c’est la fragilité de la configuration œdipienne qui apparaît au premier plan avec, d’un côté, un père éloigné physiquement et psychiquement, et de l’autre, une relation proche et conflictuelle avec sa mère, évoquant un lien sadomasochiste. Le père est longtemps dénigré jusqu’au jour où, au cours d’une séance, Charles est envahi par des émotions intenses à l’égard de son père, et à sa grande surprise se met à pleurer. Des éléments sensoriels relatifs à des souvenirs flous, rapportés à sa petite enfance, voient le jour, et font alors apparaître le père du patient sous les traits d’un personnage bienveillant, proche et chaleureux moralement et physiquement. Ces retrouvailles intérieures, affectives et sensorielles, du patient avec son père de la petite enfance, permettent une triangulation du lien avec sa mère, une requalification de l’affect, et une forme de soulagement de l’angoisse du patient.
Ainsi, bien au-delà de la seule question du père primaire, c’est un nouveau regard psychanalytique porté sur l’ensemble du développement précoce que nous propose dans cet ouvrage Christian Gérard. Cette perspective originale nous invite à élargir l’écoute clinique de nos patients aux différents âges de la vie en nous rendant attentifs, en deçà du registre œdipien, à celui des triangulations précoces et, en regard du lien primaire à la mère, au lien au père primaire. Il constitue ainsi un apport précieux à la clinique et à la théorie psychanalytiques, et ouvre la voie à différents thèmes de recherche potentiels pour l’avenir.
De manière intéressante, on peut remarquer que le livre ne contient aucune illustration clinique concernant un très jeune enfant, alors qu’on peut faire l’hypothèse que la plupart des processus psychiques mis en avant par l’auteur se situeraient, dans une perspective historique, dans la première année de vie de l’enfant. Ce parti pris nous semble témoigner de la démarche de Christian Gérard qui, bien qu’inscrivant le père objet primaire dans son articulation avec le père corporel, sensoriel et affectif de la réalité externe du jeune enfant, se positionne avant tout dans le champ de la réalité psychique et donc, dans une perspective d’après-coup. Au vu de l’importance des réflexions déjà initiées par l’auteur dans ce domaine, on peut néanmoins espérer que d’autres travaux viennent, à l’avenir, discuter et explorer les éventuelles articulations envisageables entre d’une part, la clinique et la psychopathologie du très jeune enfant et d’autre part, les propositions théorico-cliniques de Christian Gérard.
Références bibliographiques
Gérard C. (2004). Le père : un objet primaire ? Rev Fr Psychanal 68(5) : 1833-1838.
Gérard C. (2009). L’inhibition et ses liens avec le père primaire. Rev Fr Psychanal 73(2) : 369-384.
Gérard C. (2010). Les triangulations précoces: Un préalable à la scène primitive. Rev Fr Psychanal 74(4) : 1125-1139.
Nothomb A. (2015). Le crime du comte Neville. Paris, Albin Michel.
Germain Dillenseger est psychiatre, psychanalyste praticien inscrit à l’Institut de Psychanalyse de Paris.
Laurent Danon-Boileau, Textes sans sépulture. Écrits recueillis à la bibliothèque de Saint-Anne, Paris, Fario, 2021.
 Dans son avant-propos, Laurent Danon-Boileau déclare : « Ce livre n’est pas un ouvrage scientifique », et il incite le lecteur à l’aborder « sans l’éloignement d’un regard prétendument clinique ». De quoi s’agit-il donc ? De textes provenant d’observations médicales publiées entre 1850 et 1930. Et le préfacier de souligner : « La première de ces deux dates correspond au moment où la clinique se prend d’intérêt pour ce qu’elle nomme alors la “folie raisonnante” […] La deuxième marque la fin des observations précises, faisant place aux écrits des malades. » Ces Textes sans sépulture n’ont également pas d’acte de naissance, c’est dire que l’anonymat leur tient lieu de carte d’identité et qu’ils rejoignent les productions de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis 1945, l’Art brut. Un art, si l’on veut, brut de tout alliage, de toute histoire, de toute culture. Écrits orphelins, ils ont un réel pouvoir de captation qui tient, selon Danon-Boileau, en ce qu’ils traduisent symptômes et stigmates et, qu’en ce sens, ils dérangent, habiles à présentifier par « ruptures et débordements » leurs auteurs.
Dans son avant-propos, Laurent Danon-Boileau déclare : « Ce livre n’est pas un ouvrage scientifique », et il incite le lecteur à l’aborder « sans l’éloignement d’un regard prétendument clinique ». De quoi s’agit-il donc ? De textes provenant d’observations médicales publiées entre 1850 et 1930. Et le préfacier de souligner : « La première de ces deux dates correspond au moment où la clinique se prend d’intérêt pour ce qu’elle nomme alors la “folie raisonnante” […] La deuxième marque la fin des observations précises, faisant place aux écrits des malades. » Ces Textes sans sépulture n’ont également pas d’acte de naissance, c’est dire que l’anonymat leur tient lieu de carte d’identité et qu’ils rejoignent les productions de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis 1945, l’Art brut. Un art, si l’on veut, brut de tout alliage, de toute histoire, de toute culture. Écrits orphelins, ils ont un réel pouvoir de captation qui tient, selon Danon-Boileau, en ce qu’ils traduisent symptômes et stigmates et, qu’en ce sens, ils dérangent, habiles à présentifier par « ruptures et débordements » leurs auteurs.
De quelle souffrance s’agit-il, au reste ?
« Quand je suis dans le lit, c’est comme s’il n’y avait personne » (76)
« J’ai la sensation réelle de n’avoir plus de membres attachés à mon corps » (66)
« Mon corps est dépiauté pur par pur » (90)
« Mais on me vole les os de mon corps » (43)
« Il me semble qu’il n’y a plus rien en moi » (76)
« Corps-entonnoir », vide, trou noir, « paquet de douleur », « lente asphyxie », « destruction d’organes » tout est broyé car « la vie n’est plus en moi, ce n’est que de la mort vivante » (70).
Bien loin de plaintes liées à l’enfermement rudimentaire des hôpitaux psychiatriques, voire, comme certains l’ont soutenu, résultant des griffes propres à une société bourgeoise, le « politiquement correct » d’aujourd’hui (1961, 1978), la souffrance, ici, est celle de l’intime assailli. Dans ces mondes solitaires, il n’y a plus que « des semblants de personnes » et « des chiqués d’objets » (81).
En outre l’individu est coupable : « Je salis toute la France ! » (77), « Comme corps, je traîne quelque chose d’immonde qui souille tout » (30), « Ce sont des péchés originels à moi » (78).
On a également pu parler à ce sujet de complaisance anale (1984a). Certes, l’attrait pour tout ce qui sort du corps : selles, urine, eau, est bien présent, mais Danon-Boileau ne tombe pas dans de pareils lieux communs. Sa préface est claire : « Il est difficile de dire comment et pourquoi ces textes nous atteignent », et d’en venir promptement aux extraordinaires « trouvailles » verbales qui enchantent le linguiste.
Décalé, le langage est celui de l’écart, de la dissociation aberrante, de la fracture révélatrice, du dérèglement grammatical, chacun prompt à bousculer l’ordre de la phrase, à déguiser les mots par des montages insensés ou à les casser et les ouvrir en quelque sémantique frondeuse. Le verbe, ici, se joue de la mémoire : « on me goule » (87), on « lambéante la chair humaine » (87), là, jubile d’énumérer, d’inventer, de surenchérir, de travestir.
Passion de la parodie, incantation des mots, ludisme de l’apostrophe, hardiesse des suffixes et des préfixes agglutinants, on s’affranchit de tout, même de Dieu :
« Dieu est sublime, il a fécondé une virgule ! » (26)
Les textes regorgent de mots-valises, l’orthographe se délie et libère des formes effrontées, pseudolatines, pseudoceltiques, du pseudo « en grand remue-ménage » (91).
Connaisseur de l’enfance, L. Danon-Boileau ne pouvait qu’être vivement interpellé par la création textuelle dite « brute », souvent proche des inventions enfantines, joyeusement graves.
Singuliers, désinvoltes, toujours truculents, même audacieux, ces Textes sans sépulture offrent au lecteur plus d’un amusement.
Au plaisir de l’énumération volubile des chiffres et des nombres infinis, voire impossibles, contrevient le plaisir de la litote : « Le fond de la pensée, c’est le chien » (50). Soutient ces métaphores, ces hypallages, ces métonymies insolentes, encore un autre plaisir : celui de la phonation et des rimes internes : « Je suis crépusculaire, je serai autoritaire sans menacer, je deviendrai vivandière, je suis fille de ma terre, je creuserai sa fécondité avec ma ténacité de volontaire » (25). À ces perturbations, gaiement s’associent des anatomies fantasques : l’extraordinaire digestion d’une pomme de terre (73), une bouche et des dents bizarrement déplacées, préfigurant les Femmes de Picasso : « Je me fais l’effet d’avoir une tête comme si la bouche était dans le ventre et mes dents dans les fesses » (35) ; se combinent, enfin, des exhibitions perverses : « J’ai parfois l’impression de voir à travers mon ventre, de le voir transparent » (37), qui rappellent cruellement l’appareillage absurde du corps humain des dessins de Katharina (1977 et 1984b) chez qui le texte s’introduit frauduleusement dans le registre illusionniste du trait et qui fait que la dénotation tourne en fiction ! À ces dérogations formelles issues de procédures naïves s’ajoutent des carambolages temporels, des matériaux étranges, gazeux, glacés et glissants « comme ce parquet » (38), capables de se transformer en quelque repli marmoréen : « Parfois je suis comme patinée : c’est comme du marbre, on éprouve une sensation comme si on était coupée » (61).
Toutes ces géographies corporelles, improbables, rivalisent entre elles lorsque s’adjoint à l’écorce terrestre la profondeur minérale : « Je suis au centre de la Terre dans les mines […]. Je serai comète, je dois briller, briller, éclairer et j’ai l’impression de tomber dans un gouffre sans fond » (62) ; de plus : « On a inventé des salles d’opération souterraines pour défigurer les gens et on dit qu’ils reviennent de la guerre » (18).
Les errances d’organes comme les itérations subversives du globe terrestre trahissent, certes, malaises de la chair et solipsismes désabusés, cependant ils indiquent aussi parfois quelque pulsionnalité facétieuse : « Dans ma chemise, c’était rempli d’arbres » (27).
Tendus entre des imaginaires souvent railleurs et des vécus de suppliciés, ces textes sans généalogie, sans sépulture, condamnés au soliloque de la non-rencontre délivrent in fine un sentiment d’inquiétante étrangeté. En poursuivant la lecture de ces écrits où « j’entends mes parents pleurer » (61), chacun éprouvera autant l’attirance que l’effroi de l’archaïque car, dans ces mondes fictifs, mais lourds de vérité psychique,
« Ce qui m’a effrayé, c’est que tous ces pavés étaient vivants » (17),
« Les caves de Paris sont pleines d’enfants » (18),
et « Dieu ne veut plus pardonner » (62).
Grisé, le lecteur ne sortira pas indemne de ces pages arrachées à l’oubli des classeurs et des étagères empoussiérées. En effet celui-ci, « pour être à son aise, (il) place sa bouche dans le trou de mon estomac et ses yeux derrière les miens. De cette façon, il voit tout, entend tout et répète, quand il veut, toutes mes pensées » (57).
Références bibliographiques
Collectif. (1984a). Art et fantasme. Seyssel, Champ Vallon.
Danon-Boileau L. (2021). Textes sans sépulture. Paris, Fario.
Dubuffet J. (1967). Prospectus et tous écrits suivants. Paris, Gallimard.
Foucault M. (1961). Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Plon.
Gagnebin M. (1984b). L’irreprésentable ou les silences de l’œuvre (Katharina et Palanc). Paris, Puf, « Écriture ».
Gagnebin M. (2004). Authenticité du faux. Lectures psychanalytiques. Paris, Puf, « Le fil rouge ».
Gagnebin M. (2011). En deçà de la sublimation. L’Ego alter. Paris, Puf, « Le fil rouge ».
La Beauté insensée (1995). Catalogue de la Collection Prinzhorn. Palais des beaux-arts, Charleroi.
L’art brut (1977). Fascicule, n° 10. Lausanne.
Prinzhorn H. (1984c). Expressions de la folie. Dessins, peintures, sculptures d’asile. Paris, Gallimard.
Thévoz M. (1975). L’Art brut. Genève, Skira.
Thévoz M. (1978). Le langage de la rupture. Paris, Puf, « Perspectives critiques ».
Thévoz M. (1979). Les écrits bruts. Paris, Puf.
Murielle Gagnebin est psychanalyste, membre titulaire de la SPP, professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle, auteur de plusieurs essais sur l’art et la psychanalyse.
Jean-Michel Hirt, Le socle d’argile. Essai sur le père et la paternité, Paris, Ithaque, 2021.
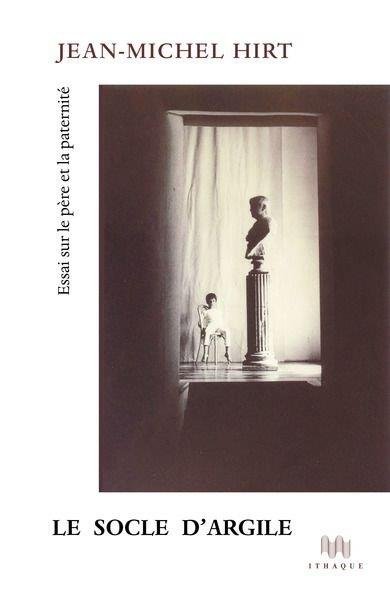
Ça commence et ça se terminera par une image, la très belle photo d’un fils prise par son père, l’artiste Cy Twombly, en 1965, image qui ouvre et clôt l’ouvrage, mais de deux façons puisque d’abord donnée à voir en couverture, elle sera mise en mots à la dernière page avec pour effet d’inciter à la regarder de nouveau afin de saisir ce qui nous y était demeuré invisible et désormais offert à l’œil par l’entremise d’une parole. Ça se poursuit comme un roman, une fiction à l’écriture nourrie de l’œuvre freudienne, de littérature et de cinéma, portée par une voix singulière, mais jamais solitaire tant y résonne l’accent de figures chères à l’analyste écrivain : Lou Andreas-Salomé, Jacques Lacan, Wladimir Granoff, Marie Moscovici, Nathalie Zaltzman. Pour qui connaît le travail de Jean-Michel Hirt, beaucoup est là signifié, et de cet essai en particulier ; à ceux qui ne le connaissent pas encore, l’invitation est lancée. L’art et la fiction y occupent toujours une place importante et ce recueil n’y fait pas exception, voire assume un pas supplémentaire en se passant d’académiques notes de bas de page ou de bibliographie, sans que rien ne soit concédé à l’exigence de la pensée.
À ce titre, cet Essai sur le père et la paternité est moins un livre de psychanalyse, au sens d’une démonstration métapsychologique ou d’un recensement de cas cliniques, qu’un écrit littéraire psychanalytique, autrement dit un texte intimement adressé à son lecteur et porté par une écriture qui donne à entendre un imaginaire, une histoire, soit une personne et ce qui l’anime, que ce qu’elle énonce soit réalité ou fiction. Avec la liberté de ton qu’on lui connaît et l’élégante sensibilité de son verbe, Hirt livre probablement ici son écrit le plus personnel et le plus engagé. Il en résulte une lecture rare, vivante et stimulante, qui sait gré à un auteur, pour qui converser constitue de longue date une situation réjouissante, de l’intelligence qu’il prête à son lecteur. Du reste, pouvait-il en être autrement avec celui qui place le dernier ouvrage de Freud, ce « roman historique » (Bildungsroman) qu’est L’Homme Moïse et la religion monothéiste, en position de clé de voûte de l’ensemble de l’œuvre du père de la psychanalyse et en incipit de son essai ? C’est rappeler d’emblée combien la psychanalyse a éminemment à voir avec la fiction, qui est même la nature de son discours, assujetti qu’il est au langage et aux histoires, rétif à toute certitude, ce dont témoignent les tentatives récurrentes pour le formaliser, voire l’immobiliser à la manière d’un dogme. Or cette mobilité, en étant celle de la matière qui nous occupe, s’offre à être en même temps la mobilité de ce qui peut en être dit, pour qui en prend le risque. Et c’est précisément d’une élaboration en appui sur ce point a priori si instable, si fragile, ce socle d’argile de L’Homme Moïse, objet de tant d’embarras pour les religieux, les historiens et bien des psychanalystes, dont va user Hirt comme d’un levier pour soulever la chape qui menace d’étouffer la psychanalyse aujourd’hui si elle refuse de s’interroger sur son devenir en évitant de se confronter à la réalité et à ses nouvelles configurations, dont témoignent non seulement ceux et celles qui viennent nous parler dans l’intime de nos cabinets, mais également ce dont nous sommes quotidiennement témoins : modifications sociétales de la sexualité, légitime remise en cause du patriarcat, retour à l’obscurantisme religieux ou emballement mortifère des effets de l’anthropocène sur le vivant. C’est là, rappelle Hirt, une responsabilité à laquelle la créativité de la psychanalyse freudienne ne saurait se soustraire si tant est qu’elle demeure, pour ceux qui s’en réclament, cette aventure culturelle qui noue originellement psychologie individuelle et collective et si elle ne se réduit pas au repli narcissique de la seule prise en charge thérapeutique, ce qui serait, pour reprendre les mots de M. Moscovici, citée par l’auteur (p. 154) « une mutilation de la psychanalyse, coupée […] de ‟ses avancées dans des territoires autres que strictement empiriques et familiaristesˮ ». Ce legs jamais définitivement acquis et qu’il incombe aux psychanalystes d’assumer pour que reste vivant le geste freudien, Hirt va montrer combien il doit à la figure du père instaurée par la religion monothéiste et à la charge psychique qu’implique la paternité, telle que dégagée par Freud dans L’Homme Moïse, c’est-à-dire articulée au renoncement pulsionnel qu’elle exige au bénéfice d’un gain pour la spiritualité (Geistigkeit) sur la sensorialité (Sinnligkeit).
Résumer un ouvrage en altère inévitablement le style, ce timbre propre à chacun qui n’est rien de moins que l’expression de la singularité d’une voix et de la sensibilité d’une pensée. Je m’y plierai toutefois pour faire entendre la proposition de l’analyste à ses contemporains. Paradigme du renoncement pulsionnel, la paternité, différenciée et dissociée du père, serait-elle le seul recours apte à contrer le déchaînement qui en chacun et dans le monde menace de conduire l’humain à une catastrophe dont l’imminence est pourtant annoncée ? Dans sa première partie, le livre interroge les conditions et les conséquences psychiques du passage du géniteur de la horde, tel que décrit en 1913 dans ce « mythe scientifique » qu’est Totem et Tabou, géniteur devenu père et dieu à la faveur de sa mise à mort puis de sa mise en mots par les fils, au père adoptant, promulgateur de la loi et représentant de la paternité qu’est Moïse, l’homme ; passage dont la trace instaure Les deux corps du père, titre de cette première partie, que sont la violence et la loi. À l’acte meurtrier des fils contre la bête humaine primitive que la religion monothéiste puis le droit vont s’employer à faire oublier en consacrant sa victime (p. 20), donc en constituant la fiction qu’est un père de sang, succède dans l’œuvre de Freud, et dans l’histoire de l’hominisation qu’il soutient, l’acte de parole d’un étranger, hors liens biologiques et témoignage des sens, qui reconnaît sa paternité par amour pour un enfant et endosse la charge psychique qu’elle implique vis-à-vis de lui, notamment le renoncement à sa toute-jouissance. C’est à ce titre que la paternité est ce progrès qui prouve la portée du renoncement pulsionnel comme un processus psychique. Si par un acte meurtrier, les fils créent le père et enracinent en eux la désirance nostalgique pour un dieu, c’est par un acte de renoncement à sa toute jouissance que le grand homme endosse la paternité. Tout dans l’expérience humaine, écrit Hirt (p. 38), vient conforter l’idée de Freud que le géniteur, chef de la horde primitive, sans interdit ni limite, est à la racine du père postérieur qui, par renoncements et sublimations, parvient – un peu – à dompter sa sexualité. La paternité serait la résultante de ces processus psychiques, une conquête reposant sur le langage, et non les liens du sang, se manifestant avec la parole d’un homme qui (se) reconnaît être le père de l’enfant et, ce faisant, tient le destin de l’enfant dans la trame de sa parole. Ce dont témoigne également l’expérience humaine, c’est que cette conquête qui aboutit à la dissociation du père et de la paternité n’est jamais définitivement acquise et qu’en tout père subsiste la démesure de son origine, quelle que soit la dissimulation dont il fait preuve. L’oscillation entre les deux corps du père, sa complexité et ses nuances, mais aussi ce qu’elle engage pour les fils et les filles, Hirt va l’explorer dans les trois champs indissociables qui permettent d’accéder à la réalité psychique des individus et des sociétés : l’écoute individuelle ; les œuvres de la culture, par la mise en forme des motions pulsionnelles qu’elles révèlent ; les Écrits des trois grandes religions monothéistes, si on consent à les aborder, non au nom d’une croyance, mais au sens de la vérité historique, cette fiction qu’il faut prendre au sérieux, et que recèlent ces manifestes de l’humain. Concernant ces deux dernières approches, je ne peux me résoudre à en réduire la richesse et laisse au lecteur le plaisir d’une découverte guidée par l’érudition généreuse de l’auteur. Notons simplement combien les œuvres littéraires de Melville, Stevenson, Jarry, Dostoïevski, Nabokov ou Sade et cinématographiques de Kubrick, Tarkovski, Chaplin, Powell, Laughton ou Antonioni font apparaître la tension que ces deux corps entretiennent autour de l’enfant à l’empan de la jouissance et du renoncement, quand les Écritures, qui nouent le plus étroitement Père et divinité en faisant du père, à qui est délégué le pouvoir d’aimer et de protéger sa progéniture, ce Lieu-tenant de Dieu, révèlent combien le sentiment de paternité articule indissociablement l’amour et la parole du père à la foi que le fils lui concède en retour ; en conséquence de quoi, répercussion clinique majeure que relève Hirt, la paternité est loin d’être la propriété d’un sexe, et même elle est souvent mieux exercée par une personne biologiquement étrangère à l’enfant […] C’est la parole d’adoption – même et surtout si l’enfant est la chair et le sang de son père – dont sera capable un homme ou une femme (p. 70). Où se trouve ouverte la voie à une paternité au féminin. J’accorderai une attention particulière à l’écoute des hommes et des femmes rencontrés par Hirt dans son exercice clinique, en particulier celle, rare, me semble-t-il, des prêtres catholiques, ces « pères » par vocation (p. 71). Elle met en évidence la tension qui naît de cette déclaration d’amour ne tenant qu’aux mots et échappant donc « aux sens », qu’est la paternité – et dans une certaine mesure la vocation cléricale, avec l’amour sexuel, dont le bannissement inscrit dans le célibat sacerdotal catholique, fruit d’une histoire rappelée par l’auteur, loin de réduire le sexe à une « chose » (Maurice Bellet) dont on pourrait faire l’économie, ne fait que révéler combien il constitue, en sa dimension érotique, une dimension bouleversante de l’humain qui travaille le corps et l’âme, des « pères » pas moins que des autres, ce que l’art et le réel ne cessent de nous rappeler. Hirt fait pleinement jouer ici ce qui distingue le savoir psychanalytique du philosophique et du religieux, c’est-à-dire sa connaissance du sexuel, ce hors-sens qui prive nos vies de toute maîtrise et si difficile à conjoindre avec le sentiment amoureux. En cela, les effets de l’ostracisation du sexe dans l’Église catholique montrent ce que n’est pas le renoncement pulsionnel, mais ce que produit la vaine tentative de répression de la pulsion. Vaine, car au nom de quoi ?
Est ici éclairé le risque d’une incompréhension majeure, y compris parmi les psychanalystes, si l’offre freudienne présentée dans l’Homme Moïse n’est pas entendue à sa juste mesure et si le saut qu’elle réclame, ce judicieux leap of faith de la langue anglaise, se trouve réprouvé. Loin de bannir le sexuel du corps et de l’esprit au profit de la croyance en une illusion, le renoncement pulsionnel et le gain pour la spiritualité qu’il octroie ne sont possibles qu’en appui sur la pulsionnalité au nom d’un projet pour l’humain qui engage une forme particulière de jouissance. Telle est l’audacieuse et féconde hypothèse au cœur de l’essai, dont Lou Andreas-Salomé et singulièrement les femmes analystes sont, pour Hirt, les plus sûres éclaireuses ; hypothèse qui sous-tend la seconde partie de l’ouvrage, Les actes de la paternité, à entendre comme l’engagement créatif et subversif qu’il incombe à la psychanalyse d’assumer pour continuellement, à la manière d’un levain, mettre au travail la civilisation, ce que Kulturarbeit signifie. De ces passionnants développements, je retiendrai trois aspects : le renoncement pulsionnel et la réalité spirituelle, l’apport de Lou Andreas-Salomé, le devenir de la psychanalyse. Hirt écrit : « À la veille de la Seconde Guerre mondiale […] Freud […] estimait que sans renoncement pulsionnel l’être humain est incapable de ‟progrès dans la spiritualitéˮ. Mais un contresens surgit immédiatement si l’on entend ce processus comme un renoncement au pulsionnel. Renoncer ne signifie pas se résigner. Il s’agirait plutôt de l’inverse : non pas un renoncement au pulsionnel, mais un renoncement au but immédiat de la pulsion, afin de mettre celle-ci au service d’une dimension autre de la réalité psychique, une dimension proprement spirituelle, relevant des puissances qui habitent l’âme de l’individu en son fond inchangeable (p. 142). Je ne reprendrai pas ici la démonstration métapsychologique, devant laquelle l’auteur ne se dérobe pas, notamment dans sa distinction avec la sublimation, mais en relèverai quelques traits. D’abord l’invitation à une compréhension dynamique du renoncement, où pulsionnel est à entendre comme adjectif, non pas renoncement à mais animé par la pulsion sexuelle. Un mouvement, l’opposé de la stase qu’est la résignation. S’adossant au Moïse de Michel-Ange, Hirt souligne que Freud ne le considère pas comme une force régressive, mais offensive, un déplacement que le génie du sculpteur met précisément en scène. Mais en vertu de quoi ? C’est le pas supplémentaire qu’il engage : en renonçant à sa satisfaction immédiate, la pulsion gagne en force, se psychise et accède à une qualité particulière de la réalité psychique, la réalité spirituelle, qui permet à l’humain de se projeter vers un au-delà de lui-même, un projet plutôt qu’un objet, de l’illusion d’une toute-jouissance solipsiste vers une autre forme de jouissance. Ce serait ce progrès dans la vie de l’esprit postulé par Freud. Trois pistes, parmi celles nombreuses offertes au lecteur : les jouissances et la déliaison, notamment dans leur fécondité ; l’au-delà de soi dans la prise en compte de l’autre et l’accès à la dignité humaine ; le choix revendiqué du maintien d’une traduction du côté de l’âme et de la spiritualité. Serait-ce pour conserver la trace d’une origine divine des opérations de l’esprit, liée à l’interdit de représentation et au décollement du sensible qu’il impose ? À cet endroit passionnant du corps sensible et sexué, de l’intellect et de l’âme, Hirt invite Lou Andreas-Salomé et célèbre dans le très beau chapitre qu’il lui consacre « La veuve du père », une pensée psychanalytique encore largement sous-estimée, mais dont l’audace, en matière de différence des sexes notamment, contribue non seulement à l’inscrire dans le geste freudien le plus authentique, mais annonce ce à quoi la psychanalyse est désormais confrontée : la mutation de la différence sexuelle (p. 139). De cette lecture créatrice que Lou a de Freud, Hirt restitue, entre autres, l’importance de la réponse qu’elle apporte, en tant que femme, à l’exigence freudienne de se familiariser avec l’inceste et qui apparaît dans le prolongement que son article « Ce n’est pas la femme qui a tué le père » donne au mythe fondateur, d’où il découle qu’en aimant, la femme bénéficie de l’acte commis, comme veuve, mère, sœur et amante et qu’elle donne au fils meurtrier la possibilité d’un accomplissement amoureux avec chacune, en une, s’il accepte la démesure de l’invitation. Ce déploiement de l’acte amoureux, tel que pensé et incarné par Lou, Hirt relève combien il doit au hors-champ qu’est le meurtre du père, et combien il représente une voie extrêmement novatrice pour penser les nouvelles sexualités. Je conclurai sur cette créativité, laissant la parole à Hirt quant au devenir de la psychanalyse et la responsabilité de chacun pour qu’elle conserve son ambition originelle, à la fois comme pratique et comme culture : La fragilité du père œdipien perçue par Freud, comme les limites de la métaphore paternelle disséquée par Lacan, ne signifie pas la caducité de ces constructions, mais la fin de leur domination et le partage avec d’autres façons d’assumer la fonction paternelle. Une situation propice à la redéfinition de la figure du père confrontée aux échéances auxquelles fait face désormais l’espèce humaine (p. 182). Un dernier mot, Bildungsroman, c’est aussi le roman d’apprentissage, celui qui ne peut s’écrire qu’à la fin du voyage et qui en éclaire le sens.
Martine Mikolajczyk est psychanalyste.
ARCHIVES
Fred Bush, Dear Candidate: Analysts from around the world offer personal reflection on Psychoanalytic Training, Education and the Profession, London and New York, Routledge, 2021
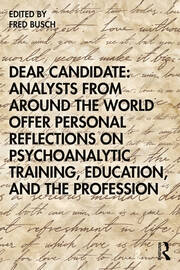 Ce livre court, de 160 pages, est fort original, son titre pourrait être traduit par : Cher analyste en formation : des Analystes du Monde entier vous offrent leurs réflexions sur le Cursus, l’Enseignement et le Métier.
Ce livre court, de 160 pages, est fort original, son titre pourrait être traduit par : Cher analyste en formation : des Analystes du Monde entier vous offrent leurs réflexions sur le Cursus, l’Enseignement et le Métier.
Organisé, préfacé et postfacé sous forme d’un post-scriptum, par Fred Bush[1], l’ouvrage est constitué de quarante-deux lettres d’analystes formateurs très reconnus du monde entier, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Afrique. Ces quarante-deux collègues s’adressent à un, ou à des candidats, sous forme d’une lettre. Les lettres sont courtes, entre deux et cinq pages au grand maximum. Leur visée est non seulement de conseiller, mais aussi de partager une expérience vécue avec l’analyste ou les analystes en formation.
Ces missives sont toutes très personnelles et le lecteur a le sentiment de partager chaque fois un moment d’intimité avec un analyste confirmé.
En exergue du livre, il nous est raconté qu’interrogée par Heinz Kohut sur les qualités essentielles pour devenir psychanalyste, Anna Freud aurait répondu que c’était à ses yeux l’amour de la vérité, vérité de la personne et vérité scientifique. Elle estimait que cette quête de vérité devrait être placée bien au-dessus du fait de découvrir des choses dérangeantes sur son monde intérieur soit sur l’appréhension du monde externe de tout un chacun.
Afin de donner envie de lire ce livre qui le mérite, j’ai fait un choix arbitraire, mais tous les choix ne le sont-ils pas ? Évoquer quarante-deux lettres superficiellement eût été fastidieux, en choisir deux ou trois, difficile.
Donc, plutôt que d’avoir à décider des trois plus « belles lettres » parmi quarante-deux, toutes intéressantes et originales, je les ai donc trouvées au hasard, en ouvrant le livre comme par inadvertance.
Je suis tombée sur les missives d’Otto Kernberg de New York, de Claudia-Lucia Borensztejn de Buenos Aires et de Gohar Homayounpour de Téhéran.
La lettre numéro 8 est celle de Otto Kernberg :
Ancien président de l’API, le professeur Otto Kernberg a beaucoup écrit, notamment sur les patients borderline et les désordres de la personnalité dont il est un spécialiste mondialement connu. En tant que président de l’API il s’est également intéressé de près à la formation de psychanalystes.
Un peu curieusement il commence par le conseil de chercher un « bon institut », pas trop petit, écrit-il. Et il a profondément raison. Pour avoir travaillé huit ans pour le comité des Nouveaux Groupes Internationaux (ING) de l’API, j’ai pu mesurer la nocivité des trop petites sociétés d’analyse où un ou deux « gourous » règnent, entourés de leurs « suiveurs ». Il arrive aussi que l’endogamie liée au petit nombre empêche le bon fonctionnement des instances en raison du cumul des fonctions.
À Paris nous avons la chance de pouvoir choisir entre trois sociétés composantes de l’API, et de choisir entre soixante superviseurs au sein de la SPP.
Mais dans des pays comme la Grèce ou la République tchèque, le futur candidat n’a d’autre choix que de s’adresser à sa société d’appartenance.
La seconde proposition concerne le choix de l’analyste. Ainsi que tout le monde le sait, la grande majorité des instituts de psychanalyse du monde fonctionnent selon le modèle de formation que l’API nomme « Eitingon », modèle de formation selon lequel la psychanalyse personnelle fait partie du cursus et doit être menée par un analyste formateur de cette même société.
Kernberg conseille au candidat de choisir avec soin, de préférence un analyste très reconnu et selon ses préférences personnelles, nous dirions plutôt, selon son cœur.
Il insiste ensuite, et ici aussi je suis pleinement d’accord avec Kernberg, sur l’importance des stages dans des services de psychiatrie adulte, car un analyste doit connaître la psychose, les maladies mentales lourdes et invalidantes.
L’auteur évoque aussi sur le choix des superviseurs. Il va même jusqu’à conseiller au candidat de se choisir, en dehors de son cursus, des superviseurs éventuellement d’ailleurs.
Je comprends le souci de Kernberg « d’internationaliser » la pratique psychanalytique. Je sais combien cela m’a personnellement enrichie, mais encore faut-il parler couramment l’anglais ou l’allemand, voire l’espagnol et le portugais…
De plus tous les instituts n’acceptent de valider une supervision à l’étranger quand bien même le superviseur serait une « célébrité ».
Or je suis moi tout à fait opposée aux supervisions à distance, par skype ou téléphone. Nous les acceptons à l’API selon un protocole établi (des séances en personne tous les deux mois) et ceci lorsque des circonstances particulières nous y obligent.
Kernberg me semble, dans cette missive aux candidats, privilégier les relations internationales et la pluralité des écoles. Il dit à un moment que les candidats devraient faire des « stages » dans d’autres sociétés. L’API favorise en effet cette pratique et nous avions avec Claude Smadja reçu dans notre supervision collective un collègue de Madrid et un américain de Washington. La Société hellénique a reçu deux « stagiaires » suisses.
Après avoir conseillé aux candidats de lire beaucoup de métapsychologie freudienne, mais aussi Melanie Klein, W.R. Bion, Heinz Kohut, Jean Laplanche, André Green et d’autres, il leur demande de s’intéresser aux disciplines proches comme la neurobiologie, les neurosciences, ainsi que Freud l’a fait en son temps, écrit-il. Mais à mon sens, et vu l’étendue actuelle du savoir dans le domaine scientifique, à trop s’éparpiller l’on risque de se perdre.
Enfin Kernberg leur recommande également de se former sérieusement à la psychothérapie.
Il conclut sur une note plus personnelle, écrivant que la richesse de leurs vies amoureuses et amicales contribuera à élargir leurs horizons et les aidera à « mieux entendre ».
Ses derniers mots sont « bonne chance ».
Après cette lettre, où l’on reconnaît bien les préoccupations de Kernberg, le sort a décidé de m’obliger à me pencher sur la lettre de Gohar Homayounpour, lettre numéro 27.
Actuellement il n’y a pas de société d’analyse en Iran, il y a un groupe de cinq jeunes psychiatres et deux psychologues qui se nomme : « Groupe Freudien de Téhéran » que je connais d’ailleurs pour leur avoir fait des cours en ligne sur la métapsychologie, durant un semestre[2].
Leur demande avait été relayée par Bush. Tout ce groupe a été formé par Homayounpour qui, elle, a suivi un cursus analytique aux USA et est devenue analyste formateur. Retournée en Iran, elle est également membre Direct (DM) de l’API. Elle a formé le petit groupe que j’ai rencontré. Sa lettre a donc la particularité d’être celle d’un formateur isolé dans un pays où il n’y a pas encore de société et pas d’autres psychanalystes.
Elle commence sa lettre disant que ses associations la mènent sur deux voies : l’après-coup de sa propre formation et ce qu’elle aimerait pouvoir transmettre à son « groupe Freudien de Téhéran ». Elle raconte l’avidité d’apprendre qui fut la sienne et sa soif constante d’échanges avec d’autres analystes et superviseurs. Comme Kernberg, elle souligne l’importance de se confronter à d’autres écoles de pensée et à d’autres instituts. Chaque société, et son ou ses instituts, a en effet sa particularité propre.
Je me permets ici quelques réflexions personnelles, car j’ai toujours trouvé que la SPP cultivait bien son propre jardin sans beaucoup s’intéresser aux analystes du monde. À ma connaissance, hors Janine Chasseguet-Smirgel et Green, peu de nos maîtres se sont confrontés à des audiences internationales ; peu prennent la peine de parler et publier en anglais. Nous avons à l’étranger la réputation d’être arrogants et peu enclins à nous exposer.
Homayounpour, elle, pense que c’est en se séparant de nos instituts d’origine et en s’immergeant dans d’autres courants de pensée que l’analyste en formation va trouver son identité ; elle défend ses idées avec passion, ce qui rend la lecture de sa lettre très agréable.
Elle évoque ensuite la situation atypique de l’Iran où pour devenir psychanalyste il faut s’exiler durant des années puis revenir. Elle pense avoir gagné son pari de former sur le plan théorique un petit groupe cohérent, dynamique et intéressé d’apprendre. Pour ce faire elle a depuis longtemps invité en personne, puis en ligne (en raison de la pandémie), des analystes connus du monde entier. Elle n’est pas sans noter que cela comporte un risque qui est celui de ne plus savoir quelle langue analytique on parle, elle utilise une expression anglaise « the risk of becoming Jacks of all trades and Masters of none ».
L’auteur parle ensuite, avec véhémence et fermeté du danger de trop s’éparpiller, de perdre notre véritable identité, elle souligne l’importance de se centrer sur le sens latent qui vise les fantasmes inconscients. Elle raconte qu’une société d’analyse américaine est allée jusqu’à embaucher un publicitaire pour les promouvoir.
Pour Homayounpour, et ici je la rejoins tout à fait, si nous continuons à vouloir « vendre de l’analyse comme du coca-cola », nous creusons notre propre tombe. Je suis en total accord, je crois que plus que jamais nous aurions intérêt à redevenir très élitistes. Si nous restons un plus petit nombre peu importe.
L’intérêt et la mode de l’analyse reviendront le jour où force sera de constater que nous offrons le seul traitement qui marche, car l’inconscient existe[3].
Cette très belle lettre, vivante et émouvante, se termine sur une prière aux candidats auxquels elle conseille de lire Freud et de le relire, attentivement.
J’en viens à la lettre numéro 36, qui nous arrive d’Argentine, de Buenos Aires.
L’auteur en est Claudia Lucia Borensztejn, ancienne présidente de l’Association argentine et auteur d’un dictionnaire de la psychanalyse en espagnol qui fait autorité en Amérique Latine.
La lettre de Borensztejn est une des rares qui débutent en s’enquérant de la santé psychique du candidat : « comment allez-vous ? Je pense à vous, comment vous sentez-vous dans votre cursus ? » « Avez-vous rencontré une atmosphère chaleureuse dans votre institut ? »
Elle s’adresse tant à ceux qui sont en début d’analyse qu’aux candidats déjà en supervision et leur demande de lire Freud et les auteurs postfreudiens.
L’auteur se souvient de ses années de formation ; pour elle le sentiment d’appartenance à un groupe lui avait donné un sentiment de sécurité et de confiance. Elle raconte qu’elle travaillait déjà dans des institutions publiques et élevait ses enfants, mais quand l’analyse est entrée dans sa vie, c’est devenu une façon de voir le monde.
Elle évoque ses années sur le divan et toutes les questions qu’elle se posait. À l’époque en Argentine la psychanalyse était très prisée, la liste de potentiels analystes en formation était longue, certains attendaient des années une place d’analyse de formation.
Borensztejn partage avec nous son enthousiasme et sa foi en l’action thérapeutique de la psychanalyse. S’adressant aux candidats imaginaires elle leur dit se retrouver en eux…
Mais le contexte social et sociologique a beaucoup changé depuis les années quatre-vingt et le changement de siècle. Si à l’époque les candidats n’avaient pas de mal à remplir leurs cabinets avec des analyses de quatre ou cinq séances hebdomadaires il n’en va pas de même aujourd’hui. Les crises économiques, l’Argentine en a vécu deux dramatiques, l’effondrement des classes moyennes, les progrès technologiques ont terriblement modifié le paysage psychanalytique.
De nos jours, on cherche des résultats rapides en peu de temps. J’avais moi-même écrit dans un article ancien que nous entrions dans les temps du « fast food et de la fast-analyse ».
Borensztejn considère, de plus, que l’étendue du savoir psychanalytique, psychiatrique et de la psychologie moderne, est devenue impossible à appréhender par un seul. Il nous faut donc faire des choix.
Par exemple, nous contenter de bien connaître l’œuvre de Freud tout en ayant quelques idées sur les grands courants postfreudiens.
Elle fait une distinction intéressante entre les candidats qui débutent leur formation théorique avant l’analyse et ceux qui viennent à la théorie après. Avec les premiers, l’analyste formateur doit donner de sa personne et partager ses émotions afin que les connaissances ne restent pas strictement intellectuelles. Pour les seconds, lire Freud fait partie intrinsèque de leur propre processus de transformation.
L’auteur parle aussi de l’intuition, indispensable dans le travail de l’analyste, mais dont je regrette personnellement qu’elle ne la définisse plus. À mon sens, l’intuition est un phénomène qui a suffisamment intrigué Freud pour l’amener à faire avec Sandor Ferenczi[4] des visites secrètes chez des voyantes célèbres. Ses conclusions sont qu’il existe une communication qui passe d’inconscient à inconscient en traversant la topique psychique.
Ce qu’il a d’ailleurs écrit dès 1915 dans les dernières pages de « L’Inconscient » (Freud, 1915e), mais qu’il cherchera à vérifier jusqu’en 1933.
Borensztejn va ajouter qu’elle conseille aux candidats de se confronter à l’écriture, ce que je ne peux qu’approuver. J’aurais moi envie de dire aux candidats : « Prenez tôt l’habitude d’écrire. » Écrire sur les patients est une façon de travailler dans l’après-coup des séances qui me semble cruciale.
L’auteur va, elle, terminer sa missive sur une note nostalgique. Elle se remémore les temps où l’efficacité des cures n’était pas le seul moteur des demandes, mais où analystes et candidats pouvaient se permettre de voir l’analyse comme une lente investigation des processus inconscients, la guérison venant « de surcroît », comme l’a dit Freud.
J’ai lu le livre rapidement, facilement et avec plaisir. Ceci ne veut en rien dire que cet ouvrage soit « léger ». Je le considère au contraire original, profond et important.
Mon léger regret est que seule la lettre d’Eva Schmid-Gloor de Zurich laisse entrevoir entre les lignes le « Modèle de Formation Français » défini par l’API.
En guise de conclusion, je finirai sur ce qui m’a manqué au travers de la lecture de ces quarante-deux écrits adressés à des candidats inconnus. Le premier serait qu’il n’y ait aucune allusion au psychodrame psychanalytique que nous pratiquons à la SPP, à double titre : comme thérapie pour certains patients, mais aussi dans une visée de formation des jeunes collègues qui y participent.
Et enfin je termine sur mon conseil à un candidat imaginaire de ne pas rester trop longtemps dans l’idéalisation de son institut et de ses maîtres, d’oser se confronter à eux, de défendre leurs positions cliniques et théoriques, afin de trouver sa propre identité analytique, son « style », sans jamais devenir un de ces « suiveurs » que j’ai souvent rencontrés.
Références bibliographiques
Freud S. (1922). Dreams and telepathy. SE 18 : 175-193.
Freud S. (1923). The ego and the id. SE 19: 12-66.
Freud S (1933). Dreams and occultism. “New introductory lectures”. SE 22: 31-57.
Freud S. (1941 [1921]). Psychoanalysis and telepathy. SE 18: 175-193.
Freud S. (1915). The Unconscious. SE 14: 159-209.
Marilia Aisenstein est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP et de la Société hellénique.
[1] Pour ceux qui ne le sauraient pas, Bush est un psychanalyste de Boston, auteur de quatre livres et d’une centaine d’articles et conférences.
[2] Le groupe de Téhéran ne dispose pas encore des œuvres complètes de Freud en farsi. Lors d’un de mes cours, je me suis aperçu que l’Abrégé et le « Complément métapsychologique » n’étaient pas traduits. Certains ne parlant pas l’anglais, il y avait une traductrice professionnelle lors de mes cours.
[3] Fondé en 2007 par G. Homayounpour, le groupe Freudien de Téhéran était initialement composé de huit membres, mais en compte aujourd’hui 146, répartis entre Téhéran et Mashhad.
[4] Brabant, Falzeder, Giamperi-Deutsch (dir.) (1992). The correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenzci, vol. 1, 1908-1914, P. T. Hoffer, translator. Cambridge, MA: Belknap Press
[1] F. Bush, Dear Candidate: Analysts from around the world offer personal reflection on Psychoanalytic Training, Education and the Profession, London and New York, Routledge, 2021.
Monique Bydlowski, Devenir mère, Paris, Odile Jacob, 2020.
 Le dernier livre de Monique Bydlowski, Devenir mère, comporte un sous-titre inscrit sur la page de garde de l’ouvrage, À l’ombre de la mémoire non consciente, qui correspond bien au thème central que défend l’auteure : « la force des souvenirs oubliés et l’irruption de la mémoire involontaire dans ces moments uniques de la gestation et de l’instauration des premiers liens avec le nouveau-né ».
Le dernier livre de Monique Bydlowski, Devenir mère, comporte un sous-titre inscrit sur la page de garde de l’ouvrage, À l’ombre de la mémoire non consciente, qui correspond bien au thème central que défend l’auteure : « la force des souvenirs oubliés et l’irruption de la mémoire involontaire dans ces moments uniques de la gestation et de l’instauration des premiers liens avec le nouveau-né ».
Ce livre est bien plus qu’un recueil, profondément remanié et actualisé, de tous ses précédents articles, ouvrages et travaux de recherche menés avec ténacité et conviction depuis quarante ans, concernant les mouvements psychiques propres à la maternité : le désir d’enfant, la transparence psychique de la femme enceinte, et l’infertilité. C’est aussi un des témoignages de l’évolution historique et scientifique de la société française depuis l’Après-Guerre en matière de soins psychiques. Monique Bydlowski, comme Serge Lebovici (auquel elle rend hommage) et tant d’autres, appartient à cette génération heureuse de psychiatres français qui ont beaucoup innové et attiré l’attention de la société sur la réalité psychique de l’être humain, à différents moments critiques de la vie : la naissance, l’enfance, l’adolescence, la parentalité, le couple, la famille, la maladie somatique, la vieillesse et la fin de vie. Cet intérêt particulièrement vif et fécond en France a concerné tous les champs de la santé mentale : la psychiatrie et ses institutions ; la psychologie, son enseignement à l’université et son implantation dans les hôpitaux publics ; et naturellement la psychanalyse. La France, avec la Grande-Bretagne, se distingue de tous les autres pays d’Europe, par la place que la société et la culture accordent aux phénomènes psychiques.
Certains de ces pionniers ne se sont pas contentés d’innover, ils ont aussi beaucoup communiqué, dans les médias et dans des livres destinés au grand public : savoir, savoir-faire, faire connaître. Ce livre en fait partie : riche en informations et accessible à tous, il est aussi une sorte d’héritage que nous laisse une psychiatre sensible et engagée tout entière sur le terrain clinique de la périnatalité, dans un souci constant de prévention et de soin de la psychopathologie de la mère et du nouveau-né, avant et après la naissance.
Première partie. De la grossesse aux premiers liens : un cheminement intérieur
Émaillés de réflexions anthropologiques à propos de la naissance en tant que « berceau de l’humain », ainsi que de renvois multiples à la littérature ou au cinéma, ces chapitres sont l’occasion de jeter un regard, avec un peu de hauteur, sur ces instants particuliers de la vie psychique.
Formée à la psychiatrie française classique, mais aussi au pragmatisme anglo-saxon grâce à son expérience de chercheuse en neurologie aux USA, Bydlowski s’est introduite dans les maternités parisiennes dans les années 70-80, en proposant une méthode sui generis : la consultation en binôme psychanalyste-gynécologue/obstétricien. Les demandes de soins psychiques venant des femmes enceintes ou infertiles, demandes qui passaient inaperçues auparavant, pouvaient ainsi émerger et être entendues.
Il faut se resituer dans ce contexte pour apprécier l’importance et l’originalité de son travail, car si aujourd’hui la présence du psychologue à l’hôpital est partout reconnue, nous avons tendance à oublier le chemin qu’il a fallu parcourir pour ouvrir ces portes, ces « postes », dont personne aujourd’hui ne nierait le caractère indispensable et irréversible. Il est donc intéressant de voir comment ces pionniers y sont arrivés. Bydlowski a dû être médecin-psychiatre d’abord, pour acquérir la confiance de ses collègues, soucieuse de la prévention des psychopathologies graves du post-partum, dépressions et psychoses ; il lui a ensuite fallu s’inventer « psychologue en institution » ante litteram, pour pouvoir être à l’écoute à la fois des soignants de tout rang et des patientes, en assurant les liaisons nécessaires. Et il lui a fallu choisir l’orientation psychanalytique, pour pouvoir mettre une sourdine à la réalité des faits médicaux et maintenir une écoute sensible à certains mouvements de l’inconscient : les représentations latentes des parents, les transmissions trans-générationnelles à l’œuvre, leurs traductions dans les gestes de soin corporel donnés par la mère à l’enfant… l’observation et la description de tous ces facteurs pouvant influencer plus ou moins favorablement les premiers liens mère-bébé ainsi que le devenir psychosomatique de l’enfant.
« L’enfant imaginé est supposé tout accomplir, tout réparer : deuil, solitude, destin. Il est ce que la femme la plus sincère dans son refus de maternité a un jour désiré. Il est l’enfant manquant à l’appel de celles qui, par plusieurs naissances, ont comblé leur désir de procréation, mais non leur désir d’enfant. Il est l’enfant suivant, dont rêve presque toute accouchée devant son nouveau-né vivant. »
Il est question, dans cette partie, du désir d’enfant et de ses achoppements du côté des mères (les différents désordres psychopathologiques et les somatisations pendant la grossesse, menaces d’accouchements prématurés et autres pathologies obstétricales), mais aussi du côté des hommes : identification à la femme, phobie de la paternité, déni du désir d’enfant…, en soulignant le rôle du père auprès de la mère, dès la grossesse et les premiers liens. Il est aussi question des vacillements qu’apporte toute naissance dans le devenir du couple.
Dans la rencontre mère-bébé et dans l’établissement des tout premiers liens, l’auteure souligne l’importance de la sensorialité (« Les premières identifications de l’enfant sont corporelles »), de la préoccupation maternelle primaire (Winnicott), de la rêverie maternelle (Bion), de l’empathie et de la capacité interprétative de la mère… Le point de vue assumé est ici celui du lien intersubjectif dans un but de prévention et de soin :
« Dans ce domaine sensible, la recherche du contexte affectif dans lequel peut apparaître un trouble du développement du bébé est un enjeu clinique et scientifique important, même si mêlant à tort causalité et faute, les résultats prennent malheureusement le risque d’être, à tort, culpabilisants. » Une perspective choisie de manière éclairée qui est en même temps une façon pour l’auteure d’exprimer sa propre préoccupation maternelle primaire à l’égard des nouveau-nés.
Deuxième partie. Le malheur des mères
Ici l’auteure aborde, sous un angle historique puis psychopathologique, les différents troubles sévères survenant dans le chaos du post-partum. Il est toujours surprenant de penser qu’il faut attendre le xixe siècle pour que l’on cesse de considérer les problématiques relatives à la naissance comme étant purement liées à la survie des mères et des enfants. C’est à Jean-Étienne Esquirol et à son élève Louis-Victor Marcé que l’on doit les premières descriptions psychiatriques de ces désordres, et ce n’est qu’à la seconde moitié du xxe siècle que l’on identifie et étudie les dépressions péri- et post natales, d’abord en Angleterre puis en France, c’est-à-dire dans des pays où il existe un système de santé social riche en professionnels de divers ordres et s’adressant à l’ensemble de la population, toutes classes sociales confondues, ce qui n’est pas le cas aux USA ou dans d’autres pays d’Europe. Bydlowski décrit ici une large palette de troubles : les états dépressifs, du blues normal à la dépression post-natale grave, jusqu’aux états suicidaires ; les états de deuil et mélancolie lors de la mort péri- et néo-natale ; de certains états maniaques et bouffées délirantes aiguës à la psychose puerpérale (beaucoup plus rare) ; des maternités précoces de l’adolescence aux dénis de grossesse ; et enfin les infanticides. La perspective envisagée ici est encore la prévention et le soin : « Si la mère va mal, soit profondément déprimée et psychiquement absente pour son enfant, soit submergée par des ruminations concernant un autre enfant précédemment perdu, soit juste stupéfaite d’un accouchement sans gestation préalable reconnue (déni de grossesse), soit enfin envahie de fantasmes terrifiants, dans tous ces cas de figure, cette jeune mère va éviter le contact corporel avec ce bébé qui l’effraie. » Sont décrits aussi les états d’anxiété extrême, où les interactions avec le bébé peuvent être au contraire trop stimulantes et discordantes.
Un très beau chapitre est consacré au deuil infini des maternités sans enfant : si les progrès de l’obstétrique l’ont rendu moins fréquent, il existe toujours, entre autres lors des IMG (interruptions médicales de grossesse) et il fait en général l’objet d’un silence assourdissant, un tabou qui redouble le deuil.
« La société est ainsi passée, pendant des siècles, à côté de la douleur des mères… » L’auteure n’oublie pas de prendre en considération les conditions socio-économiques des mères, qui peuvent être autant de facteurs aggravants supplémentaires faisant obstacle à la mise en œuvre des traitements psychiques. Elle ne cesse de rappeler l’urgence des soins dans certains de ces contextes, quand bien même ils seraient de courte durée, dans le but de requalifier narcissiquement la mère et lui donner confiance en ces capacités maternelles. Tels sont les enjeux des soins proposés dans un contexte institutionnel, par exemple lors d’hospitalisations conjointes mère-bébé en unités spécialisées à plein temps ou en consultations ambulatoires.
Monique Bydlowski rend hommage à Paul-Claude Racamier, initiateur en 1961 d’une conception psychodynamique et psychanalytique des troubles de la maternité. « On sait aujourd’hui qu’une naissance fait revivre à chaque parent, et tout particulièrement à la jeune mère, les moments conflictuels de sa petite enfance et les difficultés qui ont été celles de son propre attachement », écrit l’auteure, soucieuse de rechercher avec ces patientes les causalités psychiques des troubles, souvent traumatiques.
Troisième partie. L’infertilité féminine au xxe siècle
Cette dernière partie du livre est consacrée à l’infertilité féminine, cheval de bataille historique de Bydlowski. C’est dans ce contexte qu’elle a commencé des recherches ayant eu le grand mérite de dévoiler au corps médical, ainsi qu’aux femmes concernées, les liens étroits entre le soma et la psyché. On découvre dans ces chapitres la description clinique des souffrances psychiques de ces femmes qui rencontrent des obstacles à la réalisation de leur grossesse. On trouve ici une double perspective constante : 1) la divulgation : le souci de communiquer, par son activité clinique et d’enseignement au sein des institutions de soin, et par ses livres accessibles au plus grand nombre, l’importance de la vie psychique de la femme enceinte ou infertile, et l’intérêt de l’adresser à un psychanalyste, quelle que soit l’origine de son infertilité (organique ou psychologique, primaire ou secondaire à une naissance ou à un trauma) ; 2) le souci psychosomatique, c’est-à-dire la conviction profonde que l’on peut, dans tous ces cas, parvenir à mobiliser la vie psychique, et la nécessité de déplacer l’accent du soma à la psyché, à la recherche d’un meilleur niveau de mentalisation. Ce qui pourra déboucher de façon imprévisible, soit vers une maternité possible, soit vers un renoncement et un éventuel investissement sublimatoire.
Si certains passages de la première partie de ce livre, correspondant au début de ses recherches (le désir d’enfant, la dette de vie), peuvent évoquer une certaine idéalisation de la maternité, Bydlowski dénonce dans cette troisième partie l’hubris technologique qui a transformé de nos jours le « désir d’enfant » en une revendication : un prétendu « droit à l’enfant ». Le désir d’enfant se trouve ainsi en adéquation avec les exigences sociales et économiques du moment : études prolongées, impératifs professionnels, recherche d’un emploi, d’un logement, choix raisonné d’un compagnon… Ainsi, d’une part le retard à procréer est devenu la première cause de consultation pour infertilité, et d’autre part « des techniques toujours plus innovantes se profilent à l’horizon : greffe d’utérus étranger prélevé sur un cadavre ou sur une femme ayant renoncé à la fertilité ; prélèvement de l’utérus d’une femme ménopausée… » De quoi craindre les dérives contractuelles, commerciales, interdites en France, mais non dans d’autres pays d’Europe, concernant les dons de sperme et d’ovocytes (anonymes en France) et la GPA (gestation pour autrui, illicite en France). Dans ces deux derniers cas, l’anonymat ne manque pas de soulever la question du droit de l’enfant à connaître ses origines biologiques (revendiqué par certaines associations en France) et change le statut de la mère pour l’enfant : elle n’est plus semper certa, et après cette « adoption comportant un échange de matériel biologique », quel sera le retentissement psychique pour la mère et pour l’enfant ? « À ce manque éthique s’ajoute l’intense idéalisation de l’enfant moderne et de ses capacités : on fait fi de sa détresse originelle, de sa vulnérabilité ; on lui prête, sans réfléchir, une résilience à toute épreuve. »
Dans un chapitre consacré à ces maternités nouvelles sont évoqués les enjeux psychologiques et éthiques pour tous les protagonistes : les praticiens, les donneuses d’ovocytes, les mères porteuses, les « receveuses », ainsi que le devenir de l’enfant à naître, sur lequel plane pour l’instant, faute de recul suffisant, un impact psychologique que l’on ignore encore. « Les femmes stériles pourront être candidates à l’utérus artificiel quand il sera au point. La recherche va dans ce sens, vers la proposition d’une gestation et d’une naissance complètement extracorporelle. » Bydlowski dénonce cet acharnement technologique des praticiens qui aboutit à séparer complètement la procréation de la sexualité génitale : « Faut-il regretter que les praticiens du progrès aient renoncé au rôle compassionnel qui était celui des médecins d’autrefois ? » Face à cette ardeur médicale, nous pourrions tenter une hypothèse interprétative, concernant tous les protagonistes de ces aventures procréatives (médecins, patientes et chercheurs) ; la tentation semble grande pour eux de rendre réelle une théorie sexuelle infantile qui a rencontré un vaste succès dans l’histoire de notre civilisation : celle d’un enfant déniant la scène primitive et le rôle du père dans la tête de la mère et dans la conception, et préférant se penser le fruit d’une mère vierge. L’auteure ne consacre-t-elle pas un chapitre de son livre au regard de la Madone, à travers les peintures de la Renaissance ?
Certes, dans la perspective psychanalytique, urgence et brièveté du traitement ne sont pas compatibles avec les temps longs des transformations psychiques profondes. Mais la consultation en milieu hospitalier est une occasion précieuse, parfois unique, de faire surgir une demande de psychothérapie ou de cure. C’est aussi un moyen de permettre à des personnes d’un milieu socio-culturel moins favorisé d’avoir accès à la psychanalyse. C’est par l’inspiration psychanalytique de psychiatres comme Bydlowski, qui ont centré leur action dans les hôpitaux, que la psychanalyse a pu et pourra être plus largement connue et reconnue, et déployer ses potentialités de transformation et d’humanisation.
Daniela Avakian est psychanalyste, membre de la SPP.
Vassilis Kapsambelis, Le schizophrène en mal d’objet, Paris, Puf, « Le fil rouge », 2020.
 Vassilis Kapsambelis est psychiatre et psychanalyste, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, directeur du Centre de psychanalyse Évelyne et Jean Kestemberg de l’Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, et l’actuel directeur de la Revue française de psychanalyse. Il est l’auteur de très nombreux articles, dans diverses revues psychanalytiques et psychiatriques, et de plusieurs ouvrages, dont en particulier un Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique aux Puf.
Vassilis Kapsambelis est psychiatre et psychanalyste, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, directeur du Centre de psychanalyse Évelyne et Jean Kestemberg de l’Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, et l’actuel directeur de la Revue française de psychanalyse. Il est l’auteur de très nombreux articles, dans diverses revues psychanalytiques et psychiatriques, et de plusieurs ouvrages, dont en particulier un Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique aux Puf.
Sa double expérience de psychiatre de service public (essentiellement au sein de l’Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris dont il fut directeur général durant huit ans) et de psychanalyste, et son souci de la réflexion théorique et de la transmission l’ont amené à s’intéresser à la compréhension psychanalytique de la pratique psychiatrique, et au sein de celle-ci tout particulièrement à la relation thérapeutique avec les patients schizophrènes. Cette dernière est tout à la fois le cœur de la psychiatrie de service public, dont elle détermine nombre des pratiques (prise en charge de longue durée, nécessité de soins sous contrainte, dimension psycho-sociale), et un défi pour le psychanalyste, dont elle interroge les repères fondamentaux, le dispositif classique divan-fauteuil et le cadre conceptuel métapsychologique de la cure conçu pour la névrose n’étant plus pertinent pour ces patients, dépassant même en remises en cause celles posées par les cas dits « difficiles » (patients limites) auxquels s’intéresse la clinique psychanalytique contemporaine (André Green, René Roussillon).
C’est dire que le présent ouvrage, dans lequel il propose une forme d’aboutissement de sa réflexion théorico-clinique, présente à mes yeux deux intérêts majeurs pour les psychanalystes engagés dans le soin psychique :
– affirmer la valeur indépassable de la psychanalyse dans la pratique psychiatrique, alors même que la place de celle-ci est remise en cause de manière très préoccupante tant dans la formation des professionnels que des pratiques dans les services de soins, au profit de références plus médicales, comportementales et adaptatives, dans un contexte global de domination par les préoccupations économiques au détriment de la qualité des soins ;
– réciproquement, revivifier la réflexion psychanalytique en la confrontant au défi de conjonctures cliniques extrêmes, et en l’obligeant à se remettre en chantier.
Le livre de Kapsambelis me semble remplir ce double objectif de manière remarquable, puisqu’il y expose de façon convaincante, d’une part comment l’éclairage psychanalytique peut aider à soutenir des prises en charge souvent éprouvantes et menacées par le désinvestissement, tant des professionnels que des patients ; d’autre part en quoi l’élaboration théorique amène à repenser certains aspects cruciaux de la métapsychologie (avant tout la question de l’objet), susceptible d’enrichir en retour la réflexion psychopathologique et thérapeutique de manière globale.
C’est donc ce que je vais développer à présent.
Dès son Introduction, l’auteur précise ce sur quoi va porter sa réflexion : d’un côté, à la différence des conceptions non psychanalytiques des soins aux schizophrènes, la relation thérapeutique, et de l’autre la spécificité de la relation d’objet de ces patients.
Il introduit ainsi une différence cruciale entre ceux-ci et les « psychoses de l’enfant qui s’organisent sans tenir compte de l’objet ‟à l’extérieur du corps propreˮ (et peuvent poursuivre de cette façon tout au long de l’âge adulte), et les psychoses de l’adulte qui en tiennent bien compte, même si elles ne le font qu’à leur façon, fort éloignées de l’objet génital » (p. 8), à savoir délirer ou constituer un objet fétiche (psychoses froides). Le schizophrène « échoue aussi bien dans l’autisme […] que dans le délire ; il pratique mal aussi bien l’un que l’autre, et c’est ce double échec qui constitue à la fois son tourment, son originalité et sa chance » (p. 9). C’est la raison pour laquelle les troubles se déclarent à la puberté, c’est-à-dire lorsque la génitalité impose de nouveau de trouver l’objet « en dehors du corps propre ». Et c’est cette conflictualité majeure qui permet de comprendre ce qui va s’avérer nécessaire dans leur cure.
L’auteur aborde alors dans son premier chapitre, L’interposition objectale, la spécificité de la rencontre avec ces patients. « Comment peut-on « penser de façon psychanalytique » des traitements plus ou moins contraints ? » (p. 16), interroge-t-il d’emblée.
Face au dilemme du patient schizophrène, pris « entre la nécessité de l’investissement de l’objet et le sentiment de disparition du moi dans ce même mouvement » (p. 19), les soins qui en résultent consistent à « nous proposer à lui, et même [à] nous imposer à lui, comme objet à investir » (idem), c’est-à-dire aussi « à s’interposer entre lui et ses objets », dans ce qui « s’apparente à un acte de séduction ». Parler de séduction, plutôt que de « principe de réalité », comme on le fait habituellement, c’est souligner à quel point ce qui est en jeu est ici l’investissement de la part du thérapeute envers le patient, en miroir du conflit insoluble du patient pour investir ses objets. Il illustre alors cette question par quatre vignettes cliniques.
De celles-ci, il retire l’importance de la présence du thérapeute pour engager la relation, dont il souligne deux aspects, parler et agir en son nom propre, occuper une place de double.
La vertu du premier réside dans le fait qu’ainsi on confronte le patient à une réalité humaine qui d’elle-même se singularise et se présente comme partielle, partiale ; mais qui également explicite son engagement envers le patient. Ceci afin d’exorciser sa crainte d’une réalité externe englobante et envahissante, et aussi sa crainte de s’engager lui-même, en « prêchant d’exemple ».
L’intérêt du second, c’est cette fois de tenter de dépasser l’angoisse de l’objet du patient en introduisant dans la relation une dimension de réflexivité : l’autre est « comme » soi-même (réflexivité qui a sans doute manqué dans les relations premières).
Quand l’auteur parle de s’interposer entre le patient et ses objets, il faut alors comprendre qu’il s’agit de lui proposer une relation suffisamment aménagée, différente de la relation habituelle, visant à dépasser les apories auxquelles celle-ci le confronte, tout en lui permettant d’y faire une expérience « propédeutique » en vue d’y revenir.
L’auteur nous propose alors dans son chapitre deux, Objet, perception et réalité, de revenir à la métapsychologie freudienne pour mieux comprendre les particularités de la relation d’objet du patient schizophrène. Ce retour va s’avérer précieux, car il est possible d’éclairer les affres de celle-ci à partir des stades primaires de la relation d’objet. Il faut en effet, en suivant Freud, prendre en compte l’importance initiale de l’investissement pulsionnel dans la constitution même de l’objet, ce qui pour l’auteur rend inutile la distinction entre objet interne et objet externe : l’objet au sens psychanalytique n’existe qu’indissociablement interne et externe. De plus, il n’est lui-même appréhendé que doté d’une intentionnalité, d’une pulsionnalité propres. L’enjeu du développement psychique sera de désanimer, « assécher » progressivement cette pulsionnalité, du sujet comme de l’objet, afin d’accéder à une réalité « objective », indépendante de la bonne ou mauvaise volonté de l’un et de l’autre. C’est cette capacité d’« assèchement » qui fait défaut au patient schizophrène, et lui rend le commerce objectal aussi vital qu’invivable, car le menaçant d’envahissement et d’hémorragie narcissique : « L’essence même de la totalité des idées délirantes ne réside-t-elle pas dans la conviction du sujet qu’il se trouve dans le point de mire de l’investissement d’un autre que lui-même n’a jamais interpellé ? » (p. 78). Il développe alors l’idée selon laquelle « il serait tout à fait possible de décrire les pathologies psychotiques comme les manifestations d’un mésusage ou d’un échec de l’hallucination négative dans ce qu’elle a de nécessaire dans la rencontre avec l’objet » (p. 81), distinguant l’excès de l’hallucination négative, et son défaut, ce qu’il illustre par trois vignettes.
Dans son chapitre trois, La psychanalyse et les traitements des schizophrènes, l’auteur reprend à nouveaux frais la question de la dimension thérapeutique de la psychanalyse. Chez Freud et ses héritiers, cela aboutit à séparer les traitements psychiques en deux catégories, la cure analytique d’un côté, basée sur la neutralité de l’analyste, et toutes les pratiques plus ou moins infiltrées de suggestion de l’autre, où le thérapeute au contraire s’implique activement. Or l’auteur soutient que dans les pratiques psychothérapiques développées avec les patients schizophrènes (par des auteurs comme Paul-Claude Racamier, René Roussillon, Paulette Letarte, François Duparc) on se trouve dans une « troisième voie » : non pas un objet silencieux (la cure type), ni un sujet qui parle (la suggestion), mais un objet qui parle : « Ici, c’est l’objet en soi qui parle, l’objet en personne pourrait-on dire, dans un mélange inextricable de ce qu’est l’objet pour le patient dans l’ici et maintenant de l’échange, et de ce que le thérapeute imagine que cet objet est (ou n’est pas), ou était, ou pourrait être, ou aurait pu être, ou pourrait devenir » (p. 109). Il indique alors que pour lui le psychodrame réalise au mieux ce cadre qui permet que l’objet parle. Ceci parce que les co-thérapeutes parlent et agissent ; mais à partir de ce qu’ils imaginent que l’objet qu’ils jouent est, était, pourrait être, pourrait devenir pour le patient. Puis il précise : « Il [le psychodrame] est surtout – ce qui est le cœur de son intérêt – la mise en scène de nouvelles réalisations de ces récits ; il réalise, dans tous les sens du terme, de nouvelles expériences » (p. 112) ; et plus loin : « le psychodrame crée de la réalité, des réalités » (p. 116).
Il me semble que ce que l’auteur décrit ici, que l’on peut comprendre comme réponse aux difficultés de relation d’objet de ces patients, est d’offrir une expérience relationnelle aménagée, afin d’en atténuer la dimension menaçante. Dans celle-ci l’écart narcissico-objectal est réduit (puisque l’objet-thérapeute cherche à incarner ce qu’il sait de l’objet du patient), l’objet assume de s’imposer au patient à partir de sa pulsionnalité propre, tout en la « neutralisant » relativement, à travers la mise en jeu de la réflexivité d’une part, de la dimension ludique de l’autre. Ne retrouve-t-on pas ici un certain nombre des caractéristiques de « la mère suffisamment bonne » de Winnicott ?
Dans son chapitre quatre, La position érotomaniaque, également illustrée de vignettes cliniques, l’auteur reprend la question de la prise en charge du patient là où il l’avait laissée dans le chapitre un, pour décrire ce qui se passe dans un second temps, après l’engagement « imposé » dans les soins, quand la relation thérapeutique atteint une certaine stabilité (c’est-à-dire au-delà de toute une période où le patient aura pu mettre à l’épreuve la fiabilité du thérapeute et celui-ci survivre à ses attaques). Et il propose de qualifier cette nouvelle situation d’illusion objectalisante. L’expérience montre en effet que le patient accepte alors cette relation, comme si, « entre la peste qui consiste à subir le désir de l’objet à leur égard et le choléra qui nécessite qu’ils investissent eux-mêmes l’objet (l’enjeu majeur de la puberté), c’est encore la peste qui est préférable pour eux : les schizophrènes craignent leur propre investissement de l’objet bien plus que l’investissement de l’objet à leur égard » (p. 129). Il semble que le patient accepte d’être investi par le thérapeute, à la condition de ne pas se demander si lui-même partage ce désir d’investissement. L’auteur rapproche alors cette relation de la relation érotomaniaque, dans laquelle le sujet est convaincu d’être investi par l’objet.
Dans ces cures, cette dimension est revendiquée, recherchée, car elle permet de donner à la relation un rythme « de croisière », avec en particulier une atténuation de l’activité délirante, comme si celle-ci n’était plus nécessaire, la relation au thérapeute s’étant comme substituée à l’objet délire. Le devenir de cette relation érotomaniaque est marqué par l’idéalisation du thérapeute, et dans certains cas le besoin d’emprise envers lui, pouvant donner lieu à des manipulations de registre pervers. Elle confronte en effet patient et thérapeute à la question de la possibilité de séparation, du renoncement.
C’est l’objet du chapitre cinq, L’objet de l’objet.
L’auteur l’introduit par la présentation de quatre vignettes qui mettent en évidence, sous des modalités différentes, le même enjeu de séparation, en lien avec la prise de conscience de la place d’un objet pour leur objet (thérapeute ou famille), permettant un certain décentrement. Il en formule alors les modalités, à propos des objectifs de la cure de ces patients, dans le fait, pour le thérapeute, de passer de la fonction d’« objet-relais » (« relais d’une objectalité possible, praticable », p. 175) à celle d’ « objet-passeur » (« vers une objectalité satisfaisante, et raisonnablement stabilisée, sinon apaisée »). Objectif idéal, pas toujours facile à réaliser, comme l’auteur le dit dans un sourire : « Avec les patients schizophrènes, nous savons beaucoup mieux être des objets-relais que des objets-passeurs, ou alors des passeurs entre nous : de l’hôpital à la consultation, de la consultation à l’hôpital de jour, de l’hôpital de jour au Centre de psychothérapie… » (p. 176).
Le dernier chapitre, Une topique pour l’objet, propose, en aboutissement de ce riche parcours, une passionnante reformulation métapsychologique des interrelations entre moi, objet et sujet, ce dernier « n’[étant] rien d’autre que l’histoire et l’actualité des rapports entre le moi et l’objet » (p. 213). Surtout, l’auteur indique alors que l’on pourrait considérer que :
« – les psychoses traduisent un conflit entre le moi et l’objet ;
– les névroses un conflit entre le sujet et l’objet ;
– les états-limites un conflit entre le sujet et le moi » (p. 214).
L’enjeu m’en semble être en particulier ce qui sous-tend la distinction moi-sujet. Et celle-ci traduirait le souci de maintenir l’écart entre le fondement de la démarche freudienne dans son « matérialisme », et qui est de redonner toute sa dimension biologique, animale à la vie psychique (le moi), et la persistance de ce qui malgré tout distingue l’homme des autres animaux, à savoir sa capacité réflexive, et la juste mesure qu’il conviendrait d’en prendre, pour en faire le meilleur usage sans doute : lui reconnaître sa capacité d’introduire du jeu dans l’implacable Ananké, mais ne jamais oublier ses limites au risque de tomber dans l’idéalisation mortifère (le sujet).
C’est ce qu’en d’autres termes, me semble-t-il, l’auteur reprend dans sa conclusion, non sans rattacher cette spécificité humaine, en freudien conséquent, à la détermination biologique du décalage entre début de la vie et puberté.
J’espère avoir rendu compte dans cette recension de la grande richesse de ce livre, et de son intérêt pour la psychanalyse d’aujourd’hui, comme pensée vivante en lien avec des enjeux cliniques cruciaux, témoignant de cet « écart théorico-pratique » (Jean-Luc Donnet) qui est l’exigence et la grandeur de notre discipline.
Benoît Servant est psychanalyste, membre de la SPP.
Hélène Oppenheim, Le psychanalyste, le médical, la maladie, Paris, Campagne première, 2020.
 Nous sommes restés avec un très adroit Lire Sandor Ferenczi, un disciple turbulent (2010), et La pensée naufragée (2014, 3e éd.) d’Hélène Oppenheim. Nous la retrouvons aujourd´hui aux prises avec une problématique plus socio-culturelle, celle de la crise de la psychanalyse, dans son rapport à la culture médicale. La psychanalyse est toujours là en toile de fond, parfois plus directement impliquée, pour répondre à l’ambition du livre qui est de « contribuer à un regard nouveau sur certains aspects de notre clinique, de notre théorie et sur les modalités de la diffusion de la pensée psychanalytique dans la société ». C’est sans doute le second et le troisième chapitre qui présentent le plus d’originalité, traitant de manière rare de la place de la maladie et du médical dans la vie de l’analyste.
Nous sommes restés avec un très adroit Lire Sandor Ferenczi, un disciple turbulent (2010), et La pensée naufragée (2014, 3e éd.) d’Hélène Oppenheim. Nous la retrouvons aujourd´hui aux prises avec une problématique plus socio-culturelle, celle de la crise de la psychanalyse, dans son rapport à la culture médicale. La psychanalyse est toujours là en toile de fond, parfois plus directement impliquée, pour répondre à l’ambition du livre qui est de « contribuer à un regard nouveau sur certains aspects de notre clinique, de notre théorie et sur les modalités de la diffusion de la pensée psychanalytique dans la société ». C’est sans doute le second et le troisième chapitre qui présentent le plus d’originalité, traitant de manière rare de la place de la maladie et du médical dans la vie de l’analyste.
De l’hystérie au « social workers »
La trajectoire commence par un rappel des assises médicales et de la révolution que cette discipline connaît dans ses différentes spécialités, offrant un territoire ouvert à toutes les audaces, à partir de l’hystérie, elle-même présentée comme concept limite entre les différentes étiologies concurrentes d’une maladie désignée par Freud comme mixte (Breuer, Freud, 1895). À l’occasion, l’auteure nous rappelle une sorte de complaisance sociale apparue à l’occasion des premières indemnisations des accidents de travail, lesquels ont provoqué une véritable épidémie de « névrose de pension », comme construction politique et sociale. Oppenheim nous invite à relire l’œuvre freudienne en s’arrêtant de manière presque exhaustive sur les traces des mentions faites au médical et à la double appartenance de la psychanalyse, comme entre autres cette déclaration de 1923 : « La psychanalyse ne se situe pas en opposition à la psychiatrie en tant que psychologie des profondeurs […] elle est bien plutôt appelée à lui fournir l’infrastructure indispensable et à remédier à ses limitations actuelles. » L’auteure interroge la notion d’objet thérapeutique, dans les travaux de Freud sur la cocaïne, sa consommation et la dépendance, dont les effets seront mentionnés plus tard par Michael Balint dans une formule qui substitue le remède par la façon qu’a le psychanalyste de se prescrire. Notons un clin d’œil à la relation avec Otto Rank et au désaccord autour de la compréhension du rêve de l’homme aux loups, où, selon Rank, Freud n’aurait pas compris quelle était la véritable rangée de vieux (5-7) noyers, lesquels pour Rank n’étaient autres que les portraits des disciples de Freud accrochés entre la porte et la fenêtre. C’était bien pour lui un indice que Freud n’avait pas conscience de se prescrire, et qu’il a occulté sa mise en jeu transférentielle conduisant à préférer sa ligne interprétative, telle que nous la connaissons dans son bras de fer avec Carl Gustav Jung. C’est aussi avec beaucoup d’à-propos qu’est restitué le débat initié par le texte « L’analyse profane », où Freud prend parti pour une pratique non exclusive des médecins. Peut-être pourrions-nous regretter que soit passé sous silence le contexte français particulièrement tumultueux, où Sacha Nacht a pu militer jusqu’au discrédit contre des collègues non médecins, parfois avec des conséquences personnelles considérables (voir Eugénie Sokolnicka, pourtant l’une des fondatrices de la SPP). Cet accent de drame semble en effet revenir dans les accusations de discipline scientifiquement « impure », métissée de sciences humaines, parfois avec une violence caricaturale. Avoir été, comme nous le rappelle Oppenheim, une discipline qui a constitué le fondement de la psychiatrie après la Seconde Guerre mondiale ne lui aura pas épargné la nécessité de se redéfinir, par exemple au travers de son engagement dans la psychosomatique, singulièrement à la croisée du médical et du biologique. À l’étranger, nombre d’auteurs s’engageaient en ce temps-là dans une activité correctrice des névroses créées par les pressions de la civilisation, donnant naissance à tout le champ des social-workers ou même de la pédiatrie, soutenu par la valeur éducative de la psychanalyse (Balint avec les « groupes Balint », D.W. Winnicott et Françoise Dolto, diffusant des conseils sur les ondes des radios nationales).
Réel du corps, Réel de la maladie
Après ce très dense chapitre introductif, l’auteure aborde la question de la pratique analytique avec la maladie somatique et le médical. Ce, directement par l’évocation de la place de la maladie somatique rencontrée chez nos patients en cure, dans nos relations personnelles, enfin chez nous-mêmes, sujets à la survenue d’incidents somatiques plus ou moins notables et gênants. La maladie revêt des allures individuelles et collectives, avec des logiques étiologiques internes et externes, innées et acquises. Nous rentrons dans ce qui constitue une des particularités de la pratique de l’auteure, avec des patients traumatisés, crâniens et cérébro-lésés. Nous comprenons ainsi qu’elle porte une véritable expertise dans l’équation clinique traitant avec la maladie, de sorte que ses interrogations quant à l’accessibilité de ses patients à la cure classique ou la capacité de l’analyste à rester analytique raisonnent avec force. Elle cite Nathalie Zaltzman : « J’ai remarqué qu’autant dans certaines analyses, celles des névrosés surtout, je n’ai aucune difficulté à me souvenir des épisodes somatiques, même anodins, survenus dans l’histoire d’un patient, avant et pendant l’analyse, autant lorsque l’analyse se déroule sur fond d’une maladie grave, passée ou actuelle, où un pronostic de mort à plus ou moins brève échéance a été explicitement posé par le corps médical, je refoule cette information […]. » (1998). Cet oubli serait pour elle la garantie d’une « autonomie respective des compétences : médicale et analytique ». Oppenheim marque là son désaccord en ce qui concerne son expérience de l’oubli. Il a de multiples raisons ne pas maintenir le patient prisonnier de son handicap ou de sa maladie et ne pas livrer le patient à ce que Daniel Oppenheim appelle « la barbarie du biologique ». L’auteure pose des questions essentielles : « Pourquoi un tel évitement des effets du Réel du corps, de l’impensable du biologique, de l’origine et de la mort ? Effets contre-transférentiels ? Absence d’élaboration théorique qu’il faudrait un jour combler ? ». Cela avant de nous inviter à considérer la place de la maladie dans la séance et ses enjeux subjectifs. Du transfert sur l’institution et l’analyste, à la narration compulsive du détail des souffrances, les figures de la parole sur la maladie en cure sont multiples, presque infinies si l’on considère ses transpositions. Dans ces situations, elle cherche aussi à mettre au cœur de sa pratique « la causalité psychique inconsciente », telle que Jacques Lacan l’a définie : « L’inconscient nous montre la béance par où la névrose se raccorde à un Réel, Réel qui peut bien lui, n’être pas déterminé » (1973, p. 25). Ce chapitre est l’occasion d’une rencontre intime avec le processus interne de l’analyste : « Je suis attentive au vécu spécifique de la maladie, aux conflits psychiques qu’elle remobilise, à ceux parfois sans lien apparent avec elle et qui peuvent émerger dans un détail. […] la maladie somatique, handicap ou la mort possible, la violence qui en découle, infiltrent le transfert […]. Cela met au travail avec une intensité particulière la question du semblable et de l’étranger en soi pour le psychanalyste comme pour le patient et leur représentation de la vie et de la mort » (p. 76). La maladie grave se joue donc sur plusieurs espaces, toujours dans une topographie qui lui est propre : institutionnelle et médicale, mais aussi familiale, tout en rupture et en continuité. Quelques cas cliniques parviennent à nous faire ressentir les seuils atypiques de la pratique analytique, comme celui d’Henry, pour qui la colère installée dans le transfert lui permet de rester en vie.
Être dépositaire du savoir médical
L’auteure soutient la thèse d’une spécificité de l’écoute analytique prise dans sa formation initiale de médecin psychiatre, créant bon gré mal gré une réceptivité hypertrophiée aux informations provenant du champ médical. Elle s’inscrit de fait dans le contre-pied à la célèbre recommandation de W.R. Bion d’aborder chaque séance sans mémoire, sans désir, sans connaissance. Quelles en sont les conséquences pratiques ? Oppenheim nous donne un exemple : « Les moindres détails de l’expérience de la maladie et d’un éventuel handicap tels qu’ils s’inscrivent dans le corps du patient, dans son sentiment d’identité, dans son parcours médical et parfois médico-social, sont importants pour approcher son univers psychique. Dans l’après-coup de la réanimation, un patient parle d’un vécu hallucinatoire répété où on lui tire la langue sur une vitre. Je fais le lien avec l’évaluation de la conscience en réanimation (les soignants demandent au patient de serrer la main, de tirer la langue, etc.) et l’architecture du service où il était hospitalisé (les vitres des cloisons des chambres). Ce vécu disparaît. » Certes ce vécu disparaît, mais entendre le récit du patient dans son registre sexualisé et infantile, d’une exhibition forcée, abusive et peut-être discrètement excitante, auraient pu alimenter le transfert et ses effets récursifs sur la subjectivation de la maladie, escomptant ainsi produire d’autres effets. Il en va souvent de même au sujet de la vérité historique de manière plus générale et la place qui lui est conférée dans l’espace de la cure, jusqu’au défi de la fonction de « Construction en analyse », le testament technique de Freud. La violence de la maladie somatique se présente donc avec son histoire accueillie dans une sorte de protocole qui semble différer de l’écoute en égal suspens classique, au vu d’éléments parasites, dont une atteinte des fonctions cognitives dans le cas de patients cérébro-lésés, avec une parole malade de son substrat cérébral défaillant. Dans ces conditions, comment rester dans le champ de la « causalité psychique inconsciente », se demande l’auteure, tout en montrant à quelle hauteur se situe la difficulté contre-transférentielle : « fascination, horreur, pitié, culpabilité, peur, sentiment d’impuissance, désir de ‟sauverˮ le patient à tout prix, doute sur mon idéal et ma compétence professionnels, honte ». L’acte analytique est interrogé plus en profondeur dans son rapport inhabituel au corps que des auteurs comme Ferenczi, Balint, Winnicott et Michel Sapir n’ont pas oublié dans les théorisations de leur pratique. Un cas clinique d’une patiente ayant traversé un long coma nous invite à considérer comment la cicatrice de la trachéotomie représente l’expérience du coma que l’entourage de la patiente cherche à oublier. Oppenheim nous fait entendre que la demande de cette patiente était plutôt sur le modèle de La Consultation thérapeutique et l‘enfant dont parle Winnicott et que les séances représentaient un moment de communication et d’« expérience mutuelle ». Nous savons que les intersubjectivistes se sont étayés sur l’ambiguïté de Winnicott, qui ne définit pas le cadre et qui en légitime un certain écart, effaçant temporairement l’asymétrie des protagonistes. Mais ce n’est pas ici le parti de l’auteur, ce dont elle nous convainc sans peine par quelques intéressantes vignettes cliniques qui suivent. Nous ne pouvons proposer un résumé de celles-ci pour leur rendre justice, mais la diversité des pratiques dans lesquelles elles s’inscrivent présente un rare éventail : du cabinet libéral au service de réanimation pour accueillir analytiquement les premiers temps de la sortie du coma.
Résonances de la maladie dans la cure
Être malade, une éventualité inconfortable pour le patient ou l’analyste, touché comme tout autre par le déclin. Oppenheim recourt au récit de Max Schur, sur le rapport de Freud à la mort, récit qui rappelle le parcours d’un homme malade d’un cancer du palais depuis 1920. Elle fait l’hypothèse intrigante que « le silence de l’analyste, qui a traversé tant de générations, prend-il aussi son origine dans les effets de la maladie de Freud, le silence devenant un idéal introjecté (parmi les analystes) qui maintint Freud dans une position de ‟Maître silencieuxˮ, oubliant que l’économie des mots visait pour lui surtout à s’économiser la douleur physique de parler ? »
Deux exemples en particulier, ceux de Harry Guntrip et Margaret Little, dans leurs « écrits de vieillesse » touchent vivement à la question de leur maladie propre, mais aussi de la maladie de leur analyste, Winnicott en l’occurrence. La célèbre relation que Little entretient avec lui est un parfait exemple de l’interrelation entre le registre de la maladie du corps et l’usage d’un transfert incestueux qui fait brèche dans la possibilité de rétablir un cadre. Comment en effet dépasser le fait qu’elle lui diagnostique avec pertinence un infarctus, lui sauve la vie, et gagne ainsi le droit de l’appeler chaque soir pour s’assurer qu’il est vivant. Le paradigme de la maladie banale, mais handicapante de l’analyste est une opportunité pour l’auteur d’envisager la place du corps et de la voix dans le processus analytique : l’analyste s’affichant avec le sentiment d’un corps d’occasion quand le corps lâche et qu’il est malade, écrit-elle. L’expérience de l’analyste malade qui maintient sa présence dans les cures pourrait générer une dette qui se contracte à l’égard de l’analyste héroïque, au nom de la continuité de la relation analytique. Mais l’impasse peut aussi arriver quand surgit la destructivité crue de la confrontation à l’analyste vieillissant et allant vers la mort, parent défaillant intolérable.
Oppenheim cherche ensuite à resserrer la focale sur les enjeux épistémologiques du champ de la psychanalyse. L’expérience de la prise en charge de patients cérébro-lésés étaye ses élaborations qui encouragent et interrogent une ouverture vers d’autres disciplines telles que les neurosciences. Le dernier chapitre entérine cette préoccupation permanente d’incursions extraterritoriales au champ analytique, en rendant compte d’une démarche plurielle, orientée en direction des analystes, mais aussi et surtout, des soignants et associations de familles ainsi que de patients. Depuis les conférences que Freud a données à la Clark University, la chaire de psychanalyse que Ferenczi tenait à l’école de médecine de Budapest, les premiers psychanalystes et leurs successeurs se sont préoccupés de transmettre et de diffuser la psychanalyse dans la société. Comme pour Winnicott, il s’agirait de « faire de la psychanalyse quand on peut, sinon de faire autre chose ».
L’entreprise de ce livre est convaincante dans ses hypothèses et dans la façon de les argumenter théoriquement et cliniquement, ce jusqu’à la postface écrite pendant la première vague de la covid, parfaite illustration du propos et du titre.
Piotr Krzakowski est psychologue, psychanalyste, membre de la SPP.
Évelyne Chauvet, Laurent Danon-Boileau et Jean-Yves Tamet (dir.), Garder au cœur le désir de l’été. Récits de réinventions de soi, Paris, In Press, 2020.
 Certes, « la vie n’est pas facile !… » insistait Freud devant les auditeurs de sa XXXIe leçon en 1932… « poussé par le ça, entravé par le surmoi, rejeté par la réalité, le moi lutte pour venir à bout de sa tâche économique, qui consiste à établir l’harmonie parmi les forces et les influences qui agissent en lui et sur lui… » (Freud, 1933a [1932]/1984, p. 108). Établir ou rétablir l’harmonie… c’est bien le projet des directeurs de cet ouvrage que d’offrir aux lecteurs la possibilité d’explorer « le mystère obstiné de cette lutte […] et la redécouverte des plaisirs infimes du quotidien… [quand] les circonstances s’acharnent à nous faire perdre le goût de l’instant » (ibid., p. 11).
Certes, « la vie n’est pas facile !… » insistait Freud devant les auditeurs de sa XXXIe leçon en 1932… « poussé par le ça, entravé par le surmoi, rejeté par la réalité, le moi lutte pour venir à bout de sa tâche économique, qui consiste à établir l’harmonie parmi les forces et les influences qui agissent en lui et sur lui… » (Freud, 1933a [1932]/1984, p. 108). Établir ou rétablir l’harmonie… c’est bien le projet des directeurs de cet ouvrage que d’offrir aux lecteurs la possibilité d’explorer « le mystère obstiné de cette lutte […] et la redécouverte des plaisirs infimes du quotidien… [quand] les circonstances s’acharnent à nous faire perdre le goût de l’instant » (ibid., p. 11).
Ces textes, rassemblés en 2019, résonnent bien sûr particulièrement dans la période encore incertaine que nous traversons où la réalité met à mal nos certitudes, notre confiance, nos espoirs, voire nos projets. Ils mettent cependant en lumière, quoi qu’il en soit des atteintes portées et subies inéluctablement, les ressources diverses de chacun pour faire face, se relever, résister et retrouver en soi la capacité de se réinventer, de garder au cœur le désir de l’été.
25 auteurs[1] ont relevé ce défi, venus d’horizons divers : ils sont luthier, plasticien, poète, linguiste, historien, cinéaste, philosophe, enseignant, danseur, art-thérapeute et/ou psychanalyste, mais surtout écrivains : ils ont le goût de l’écriture, de la langue et trouvent dans l’exercice du récit des ressources propres, n’en doutons pas, qui entraînent le lecteur dans leur sillage.
Car l’ambition de cet ouvrage est bien, comme le sous-titre l’annonce, de nous proposer des Récits de réinventions de soi. Des récits, des histoires, des contes à découvrir l’un après l’autre ou au hasard de la page, guidés par le regroupement suggéré en cinq chapitres : Le temps estival, Arabesque des signes, Présence du corps, La chair de la musique, Pénombre du regard – ou en se promenant entre les thèmes, attirés par un titre, une évocation suscitant des associations personnelles, une couleur particulière…
L’enjeu au cœur de ces récits, qui sont autant de courtes nouvelles, est avant tout celui de l’écriture, des retrouvailles en soi d’une créativité un moment éteinte, assoupie ou inaccessible et du travail de l’écrivain autour de la mise en forme d’une histoire comme de la recherche du mot juste pour transmettre ce jaillissement informel du désir d’écrire.
Chaque récit en témoigne, retrouver le désir, l’élan vers la vie, la vitalité d’Éros, son « obstination » (p. 11) pour durer, poursuivre le chemin, construire sa route après l’épreuve ou les épreuves. Alors, laissons-nous aller aux plaisirs de la lecture…
Paris, au cœur de l’été… l’ennui, la morosité, « la perte du goût d’écrire » que la fin d’un amour a engendrés… Et soudain, au bout de l’errance dans la ville désertée, la rencontre avec un écrivain, avec Nabokov, et La vraie vie de Sébastian Knight, avec cette « voix inattendue, étrangère » qui ouvre les portes de l’émotion et de cette passion, « cette frénésie qui donne envie de lire tout d’un auteur ». Il y faut aussi ces connivences complices d’inconnus croisés au hasard qui confirment que l’aventure est là et le désir d’écrire à nouveau surgissant…
Paris, au cœur de l’été… Cette femme a choisi la solitude dans cette ville aimée pour « lutter contre une maladie inattendue et sournoise ». Peu à peu, toutefois, nostalgie, regrets, peurs envahissent l’atmosphère et il lui faut bien reconnaître le manque, mais quel manque ? Les mots de sa fille en villégiature au soleil résonnent alors « tu nous manques, mais c’est bien quand même ! » Ces mots réveillent en elle l’adolescente qu’elle a été faisant « l’expérience profonde que du manque peut naître vibration et plaisir ». Le manque est là mais « elle vit et c’est bien ! »
Paris, au cœur de l’été… le vol des martinets au-dessus du Sacré-Cœur et « leurs cris filés qui font résonner le ciel » réveillent « les traces énigmatiques de blessures enfouies et les images d’un passé perdu ». Mais, si menacent alors l’angoisse, la nostalgie, et même la mélancolie, leurs vols traçant « des lignes éphémères dans le bleu empourpré du jour » et leur « cri qui dessine une présence qui estompe la solitude » tracent la certitude de continuer à « voir, sentir, exister à coup sûr ».
C’est aussi sur une île bretonne, loin de Paris, de la tristesse et des pensées moroses, que la pratique, l’expérience de la photographie de « toutes petites choses » raniment « l’émerveillement du quotidien ».
Paris encore, quand la mort d’un être aimé ramènent les souvenirs de partage, la mer comme le goût des récits, le « plaisir du texte parlé » et de la poésie, enfin l’« optimisme pour rien » qui sourd de la profondeur d’une amitié, de cet envol vers l’ailleurs et vers l’enfance…
L’enfant, dans la prison d’une famille condamnée à la médiocrité, trouve dans la corvée quotidienne d’une descente à la cave les ressources inattendues de la liberté de penser, rêver, imaginer… Dans une solitude habitée d’ombres et de senteurs palpables, il découvre la richesse d’une « nuit intérieure » qui va construire l’homme qu’il deviendra, sensible à la « tendresse désarmante… de ce qui reste d’enfance en nous », et plus encore à cette communauté des êtres qui portent en eux une part de cette nuit « jamais perdue » puisqu’« elle est la nuit partagée ».
L’enfance menacée, encerclée par la guerre, celle d’Algérie ici, pèse tout son poids de mélancolie sur l’homme d’aujourd’hui qui cherche à travers le retour des souvenirs, le poids des mots et son « parcours d’écriture », le contrepoids nécessaire au retour de l’espoir.
L’enfance près d’une grand-mère cinéphile, fascinée par Julia Roberts, offre à la jeune femme dépressive sa « seule planche de salut : la salle obscure de cinéma » ! Et bien plus, à cette Nanni qui s’écrie « Tu sais, moi, je l’aime la vie ! » elle doit d’avoir poursuivi ce chemin : écrire, en historienne, sur le cinéma…
Dans l’enfance, « les brûlures de l’humiliation laissent des traces indélébiles » mais aussi l’énergie de dépasser ces blessures grâce à la rencontre de ceux qui l’ont « guérie de la haine », ont cru en elle et fait « le cadeau de pouvoir estimer tout être humain ».
À l’adolescence, c’est la rencontre d’une professeure de russe qui sauve la jeune fille d’un trouble identitaire qui lui fait souhaiter mourir… en l’adoptant comme seconde mère elle s’ouvre à la richesse d’une autre culture, de la littérature et peu à peu à la nécessité pour elle d’écrire, poussée par « la naissance d’une langue maternelle » qu’un secret de famille a obscurcie.
Histoire de corps, histoire de cure… À la catastrophe d’un accident qui brise le corps répond le lent parcours d’une reconstruction où apparaît le chagrin ineffable de la perte d’un homme et les recours à la poésie, la musique, l’écriture encore, et l’écoute, la présence de celle qui, ici, écrit son histoire et ses efforts pour « ne pas s’abîmer dans la perte. Sans fin ».
Histoire de cure, histoire de corps… À la douleur du corps jeté d’un quatrième étage, à la défiguration et aux multiples reconstructions répond la douleur psychique qui, elle, ne cède pas et perpétue les atteintes pour ranimer la souffrance du corps, indispensable « pour ne pas penser », chercher cette « source de tranquillité éphémère pour un repos de l’âme ». Il faut alors toute l’attention, la patience, la constance d’une analyste engagée pour que, dans l’intimité de la relation, se dessine « une nouvelle vie ».
Quand le corps n’en peut plus, que seul le regard affirme la vie psychique encore là, comment mener ces dernières conversations qui relient le passé au présent et tentent avec tendresse de ranimer encore et encore une vie qui s’éteint ?
Car on ne peut, comme l’axolotl, rester à l’état larvaire sans jamais devenir adulte … sauf peut-être au théâtre où mille vies nous sont proposées, « l’humanité en train d’émerger de la nuit ». Le théâtre, pour « recouvrer la capacité à vivre nos nombreuses réalités, à les faire jouer ensemble sans rester fixés à l’une d’elles »…
Le théâtre et Peter Brook, le théâtre et Louis Jouvet… Un enfant de 3 ans joue au ballon dans le couloir de l’entrée avec son père jusqu’au moment où la balle silencieuse s’arrête au milieu du couloir… L’enfant saisit alors fugacement ce premier indice de ce que son père est aveugle… Scène inaugurale de la mission qui lui échoit « en héritage de lui décrire le monde », qu’il met en œuvre dans sa vie de cinéaste et metteur en scène d’un hommage à Louis Jouvet.
Et la musique, bien sûr, « fondement à la culture de la région » de son enfance que redécouvre cet homme chargé d’ateliers dans un hôpital psychiatrique où il invente, à rebours des ateliers à médiation, de ne « faire rien » et crée ce que les patients bien vite appellent « le parloir ». Supporter ce « faire rien aux côtés de… » ne va pas de soi, le contact avec la folie, la souffrance psychique, l’angoisse le poussent à chercher des ressources, à investir à titre privé… la musique ! Ou plutôt il se prend de passion pour la vielle et devient apprenti luthier ! Luthier reconnu aujourd’hui, il rend hommage à ce que cette pratique de la vielle, « double figure de mort et de vie, source d’inspiration de toute musique », a enrichi sa pratique clinique, lui permettant « de traiter ce vécu d’impuissance, d’inutilité et d’incompréhension [pour] lui donner sens et le rendre créatif ».
La musique et le chant… Hommage à Elizabeth Söderström, célèbre cantatrice suédoise des années 80, le récit d’une master class de chant qui va rendre à « une vie que l’ennui a décoloré une tension qui lui restitue un sens » et infléchir le destin des jeunes artistes que cette rencontre va marquer pour la vie…
Eh bien, dansons maintenant ! À celle qui, enfant, voit sa grand-mère danser, rayonnante et heureuse, puis sa mère dansant radieuse et épanouie, reviendra de « danser pour céder, pour accueillir son vrai poids », pour transmettre à d’autres enfants ce moment de saisissement où « l’autre se connecte à son corps, à son “vrai poidsˮ », se rapprochant de l’état de l’enfant qui joue dans un « intense accomplissement vital ».
Car « l’enchantement de l’enfance ne meurt jamais ». Feuilleter les albums de photos de l’enfance ranime l’espérance, car s’il est vrai que le monde d’alors s’effondre dans la violence et dans la barbarie, l’enfant de cette mémoire en noir et blanc vit l’enchantement des découvertes, le « parfum des mandarines » autant que la neige et les éclats d’étoiles du sapin de Noël, loin, très loin des déchirements du monde.
Les rêves d’Ann en écho aux fracas du monde ? Des rêves qui réveillent l’enfance et des parents attentifs : « Ne t’inquiète pas, on va trouver une solution… il faut garder espoir et continuer… » ? Des rêves transformés en cauchemars dans la solitude glacée de leur abandon, qui ramènent les « hurlements dehors » et les « cris stridents de la foule en furie » ? Des rêveries alors, penser à la mer, au bercement des vagues… Mais de là, de cette enfance, est-ce de là que viennent ces « humeurs noires et profondes », ces « forces sombres qui forcent la porte » ? Ann cherche qu’en faire ? Les chasser comment ? Rêver encore, « imaginer, s’en jouer, s’enjouer » et leur donner un lieu « puis se poser en face pour les regarder les yeux dans les yeux, ensuite les laisser parler… ». Car du combat en nous d’Éros et de l’autre force, « celle du toujours moins », le rêve, les rêveries sont de solides « contre-feux » ! Car la vie, injuste et cruelle, est « obstinée […] elle sait aimer » !
Quand le regard d’une mère disparue se dissout dans l’oubli, l’angoisse d’y perdre son existence même menace… Pour lutter contre cette mélancolie, pour « refonder cette conviction perdue sans raison qu’elle ne me voyait plus », retrouver des photographies ne suffit pas, il faut chercher le regard de sa mère sur les choses du monde, d’abord, sur les « objets concrets que ma mère aurait pu regarder avant de me regarder moi ». Consignés dans un petit carnet, ils font renaître le regard de la mère qui se retourne alors « en souriant pour dire : “Ah, tu étais là, mon grand…ˮ » Mais le carnet s’égare et revient cet « abattement infini » du retour de la perte… sauf que le carnet n’est pas loin, ramassé par la jolie jeune fille de la boulangerie… à qui il offrira le carnet comme viatique pour ses prochains voyages…
Le rêve, précis, d’une petite fille qui disparaît ranime la perte douloureuse d’une mère aimée et conforte l’idée que, comme chez Soulages, « dans le noir du deuil il y a aussi cette lumière particulière »… « post tenebras lux » disait aussi son père !
La peinture, la couleur, les sons… L’intention est bien de redonner sens aux sensations que le groupe d’hommes enfermés dans la concrétude de leur prison ont oubliées… Les toupies polychromes alliant le jeu à la couleur leur ont rendu leur voix.
Et les images, les vidéos, les films, sorte de pont entre cette femme et un homme admiré qui va disparaître laissant une œuvre de bâtisseur, un échange qui confirme combien cet homme fut un révélateur « acteur fondamental de [son] évolution artistique et professionnelle ». Tourner « la vie, la belle la drôle » pour se détourner de l’émotion et « déjouer la tristesse ».
Julia Kristeva s’interroge dans sa remarquable préface sur « l’obstination de la beauté ». Ce qui est certain ici, c’est que les auteurs de ces textes, nouvelles, contes ou notules nous offrent, pour garder au cœur le désir de l’été, les plaisirs infinis de la lecture…
Isabelle Martin Kamieniak est psychologue, psychanalyste, membre titulaire de la SPP.
[1] P. Autréaux, G. Abatzoglou, A. Barral, P. Bonilo, C. Chabert, E. Chauvet, J.-L. Chauvet, V. du Chéné, S. Cognet, L. Danon-Boileau, C. E. Delmas, A. Farge, A. Franck, A. Gutmann, A. Jeanin, J. Kristeva, M.C. Lanctôt Bélanger, C. Laurent, A. Maupas, D. Mazéas, J. Rajak, J.-N. Roy, J.-Y. Tamet, M. Tonus, N. Zorn.
Ana de Staal et Howard B. Levine (dir.), Psychanalyse et vie covidienne. Détresse collective, expérience individuelle, Paris, Ithaque, 2021.
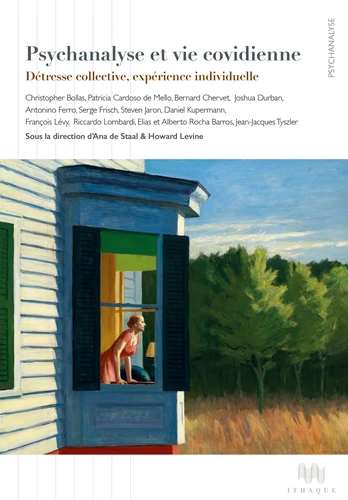 L’ennemi invisible
L’ennemi invisible
Si la nuée porte l’orage, la psychanalyse, elle, le réclame « pour conjurer, écrivait naguère André Green dans sa préface aux Entretiens psychanalytiques de Bion, le péril d’une lente décadence ». À cet égard, la mise en crise de nos vies, occasionnée par la pandémie de la Covid-19, est peut-être la tragique déflagration capable de mettre le feu aux poudres des pensées de notre « être analytique » – l’expression est de Serge Frisch –, et des scènes de son apparition, la cure, son cadre et les institutions auxquelles cet être se prête. C’est le moment de nous rappeler que de l’effroyable boucherie de la Grande Guerre Freud a su faire usage en élaborant après-coup la pulsion de mort et en s’interrogeant sur la signification du renoncement pulsionnel, de sa nécessité pour la civilisation. Et la Seconde Guerre mondiale n’a-t-elle pas été à l’arrière-plan de la complexité des constructions de Lacan comme de Bion ?
Le livre collectif, Psychanalyse et vie covidienne, sous la direction d’Ana de Staal et d’Howard B. Levine, paru chez Ithaque, veut être l’amorce des débats nécessaires au sein de la mouvance psychanalytique la plus large. Ses articles, rédigés par une quinzaine de psychanalystes de nombreux pays et différents courants, sont organisés autour de cinq thèmes : le contexte psychique et culturel de cette crise mondiale, les réflexions théoriques et cliniques qu’elle génère, les remaniements du cadre analytique qu’elle implique, les aménagements qu’elle exige, les témoignages liés aux effets de la pandémie sur les patients et les thérapeutes. Les deux organisateurs de cette recherche, dans une note de présentation de l’ouvrage, insistent à juste titre sur l’invisibilité de la menace virale qui pèse sur tous, avec ce côté agent secret que le nom de code de son appellation renforce : « Un ‟déficit de figurationˮ, pour ainsi dire, contamine les gens en même temps que ce malin virus. » Le tableau d’Edward Hopper, Cape Cod Morning, qui a été choisi pour la couverture, témoigne de cette solitude à laquelle chaque personne est assignée derrière sa vitre ou son masque face à l’ennemi invisible.
La conséquence immédiate des ravages infligés par le virus à nos habitudes de travail est illustrée par Levine grâce à la métaphore du « feu de forêt potentiellement traumatique ». Mais c’est à un départ de feu très concret, à proximité du cabinet d’Ana de Staal, chez son voisin, que celle-ci est confrontée ; obligée d’interrompre brutalement une séance, elle et son patient sont en danger et cette réalité imprévisible et impitoyable fait d’eux des alliés solidaires contre l’incendie. Inévitable modification du cadre s’il en est, mais qui résonne dans l’ensemble des contributions, même si celle-ci a lieu chez les uns et les autres dans des conditions apparemment moins dramatiques. Mais nous avons tous vérdifié que l’espace de la séance, son dispositif divan-fauteuil, mais aussi les rapports avec les patients ont été mis à mal par les confinements et les restrictions imposés par les mesures barrières. La conclusion de son article décrit bien l’enjeu psychique du temps présent : « Par conséquent, ce qui nous guette […] ce n’est pas tant la déconfiture du cadre à la faveur d’un changement de support, mais le bouleversement plus profond de nos mondes internes dans un contexte extérieur (cadre externe) devenu trop instable, trop incertain, et qui contrarie soudain toute prétention à la préservation (déjà assez difficile) de l’espace mental transitionnel et de sa capacité de fiction. L’intolérance à toute forme de symbolisation (et de pensée, par conséquent) devient de plus en plus criante. « En effet, la pandémie actuelle est le signe avant-coureur de ce que va devoir être une psychanalyse à l’ère de l’anthropocène. »
Tel un sous-marin qui pour échapper aux poursuites de l’ennemi descend de plus en plus dans les profondeurs de la mer – et les marins perçoivent, non sans crainte, les signes de la fragilité de leur habitacle devant les craquements sinistres du blindage et les fuites d’eau inopinées – le cadre de la cure, sa contenance dirait Bion, a été l’objet d’attaques extérieures qui l’ont malmené. « Nous sommes immergés, écrivent Alberto et Elias Rocha Barros, dans un monde constitué par le coronavirus : notre nourriture en est imprégnée, nous l’inhalons et l’exhalons, notre physiologie en a été modifiée […], et il exerce une énorme pression sur nous (nos tympans ont pratiquement explosé tant nous sommes plongés dans des profondeurs abyssales). »
D’où la rafale de questions posées par tous les auteurs des contributions du livre. Quels enseignements tirer des multiples ajustements auxquels l’impossibilité de s’en tenir au setting traditionnel a donné lieu, que ce soit le recours intensif au téléphone ou à l’écran de l’ordinateur (la téléanalyse accompagnant le télétravail), ou même l’interruption sine die du processus analytique ? Que se passe-t-il lorsque les protagonistes d’une cure – et leurs mondes intérieurs – sont soumis à de si violentes secousses ? Qu’arrive-t-il dès que la réalité psychique est effractée par la réalité extérieure ? Comment l’analyste trouve-t-il sa place quand le traitement psychique oscille entre le traumatisme et la sidération ? Comment, dans le désarroi, comme l’explique Bernard Chervet, sont apparus « de nouveaux mots […], néologismes (déconfinement, présentiel, distantiel) [et des] modifications du sens des mots (distanciation sociale pour ne pas dire physique) avec l’espoir de maîtriser cet autre du trauma. »
L’un des auteurs, Antonino Ferro, considère que « La tranquille répétition du cadre […] a été remise en question et [il] pense que ce cataclysme peut nous aider à être mieux équipés pour contenir des pensées jusqu’alors impensables. » Rejoignant la pensée de Green cité plus haut, il estime que « le défi covidien », comme le nomme Joshua Durban dans son article, permet de remettre en cause « une certaine calcification qui a ralenti à la fois [la] progression et [l’]évolution de la psychanalyse ». Bien entendu, tout reste à faire, ce livre ne fait que présenter un premier état des lieux au début de la pandémie ; il devrait être suivi d’un autre lié à la durée de cette épreuve internationale, aux modifications de la pratique analytique qu’elle induit, à la pérennité des changements opérés, afin de mesurer, comme l’écrit Steven Jaron, « combien le bouleversement dans lequel ce changement nous a plongés est profond et durable ».
Que devient l’être analytique confronté au double défi de la covid dans son âme donc dans son corps, quand il se voit contraint de se servir d’outils techniques de communication pour établir une relation thérapeutique ? De tels outils ne sont pas neutres et à suivre le patron de Google, Eric Schmidt, « Hormis les virus biologiques, rien ne peut se répandre aussi rapidement que les plateformes technologiques, avec une telle rapidité, efficacité et agressivité. »
Autre aspect révélé par cette crise sanitaire, l’importance décisive de la réalité psychique et de sa capacité à métaboliser l’invasion des injonctions extérieures. La place du fantasme et de son éventuelle « défection » interrogée par Jean-Jacques Tysler est un chantier qui réclame beaucoup d’attention : « Ce qui s’est propagé partout avec le coronavirus, c’est précisément ce à quoi nous avons eu affaire depuis plusieurs années avec les enfants de migrants et leurs parents précarisés : pas exactement de simples séquelles traumatiques, mais un déficit de la capacité à enchanter fantasmatiquement le monde. »
Le sursaut d’inventivité qu’il appelle de ses vœux rejoint l’invitation pressante de Serge Frisch : « Il est souhaitable, voire urgent, que toutes les sociétés [d’analyse] ouvrent un débat interne sur leur conception du cadre analytique et des implications de son éventuelle application à géométrie variable, tout comme une réflexion sur le sens que les membres donnent à leur société.[…] la priorité sera d’instaurer des espaces de réflexion sur l’essence de la psychanalyse, sur la définition et la préservation de l’identité psychanalytique, sur les structures institutionnelles et sur son insertion culturelle dans la société. »
Il semble déjà loin le temps où un psychanalyste en formation, candidat à la validation d’une cure supervisée, se voyait refusé par son jury à cause d’un certain nombre de séances par téléphone auxquelles son patient, en raison de ses déplacements professionnels, avait dû procéder. Le moment serait-il venu, à la faveur des bouleversements de la pratique clinique, d’affronter les pathologies institutionnelles qui stérilisent la créativité de la pensée analytique au nom de la religiosité de ceux qui s’érigent en gardiens du temple ? Évoquant « l’élite au pouvoir » dans les institutions analytiques, Riccardo Lombardi la décrit comme « une élite qui présente généralement des critères d’homogénéité absolue, résultant d’un pacte tacite d’appartenance à une classe privilégiée, dans un système hiérarchique rigidement pyramidal où l’appartenance est affichée par l’exécution vide de ‟rituels sacrésˮ ».
N’est-il pas temps de se rendre compte que la situation inouïe que nous traversons vient ajouter son poids aux autres questions posées à la psychanalyse par les évolutions culturelles, que ce soit les questions liées aux problématiques du genre, de la filiation et des formes nouvelles de la vie sexuelle ? Alors que, d’accord avec Levine, « La pandémie de Covid-19 met en évidence et interroge notre déni ‟normal » de la fragilité de la vie », n’est-il pas l’heure de mettre à profit « l’extraordinaire potentiel de transformation du psychisme » que relève Patricia Cardoso de Mello, afin que selon le vœu du poète, Hölderlin, « « Les jours se mêlent dans un ordre plus audacieux » ?
Enfin, comment faire avec les attentes des patients à l’issue de cette catastrophe et comment ne seraient-ils pas en droit de revendiquer des modifications du cadre qui, par exemple, tiennent compte de leurs nouvelles conditions de travail à distance ? « Actuellement, souligne Serge Frisch, dans de nombreuses situations […] ce n’est plus l’analyste qui veille au maintien du cadre, puisque le patient décide d’où il prend contact ; il y a une emprise du patient sur les prérogatives de l’analyste. »
Dans deux articles témoignant de cette alliance entre la psychologie individuelle et la psychologie collective à laquelle Freud tenait absolument, à l’ouverture du livre, Christopher Bollas et Michael Rustin, proposent de situer cet événement planétaire dans le cadre politique, social et clinique des sociétés occidentales, de leur fuite en avant dans le déchaînement de ce que Bollas épingle comme le « capitalisme du ça » et les périls selon Rustin liés au « développement inégal » à l’intérieur de chacune. Tous deux convergent vers le concept bionien de « contenant » et l’effondrement actuel « de nombreuses structures ‟contenantesˮ, ainsi que des habitudes et des capacités psychiques qui en dépendent. » Et ce n’est pas la moindre des surprises que de découvrir qu’ils sont conduits à s’interroger à nouveaux frais sur ce que peut signifier aujourd’hui le renoncement pulsionnel, « entre liberté et contrôle », capable, écrit Bollas, de favoriser « cette relation d’amour interne […] qui nous permet de nous sentir heureux, comme elle nous conduit à une forme évoluée de conscience ».
Il reste à souhaiter que les lecteurs trouveront dans le foisonnement d’idées de cet ouvrage des raisons d’espérer en la créativité psychanalytique et de partager la conviction de Riccardo Lombardi : « Il s’agit d’un moment intense et productif pour la psychanalyse ; même s’il est peu commode et fatigant, il aura sans doute un impact transformateur important sur nos identités d’analystes et notre façon de considérer notre science, menant à des développements encore imprévisibles. »
Jean-Michel Hirt est psychanalyste, membre de l’APF, professeur des universités
Howard Levine, Transformations de l’irreprésentable, Paris, Ithaque, 2019.
 Dans ce beau livre, Howard Levine, médecin, psychanalyste superviseur à l’Institut de psychanalyse du Massachusetts et professeur à l’Institut psychanalytique de la Nouvelle-Angleterre (EUA) nous plonge aux limites de l’analysable en tentant une synthèse des différents modèles analytiques contemporains articulés autour des états irreprésentables. D’emblée, ce qui frappe dans sa démarche dépliée en six chapitres est l’élargissement de l’horizon analytique porté par son attention au processus et relié à un modèle métapsychologique, articulant théorie et pratique. Notons, entre parenthèses, que les références françaises sont loin d’y être absentes, notamment avec André Green, Piera Aulagnier, mais aussi César et Sara Botella, Michel de M’Uzan, et René Roussillon.
Dans ce beau livre, Howard Levine, médecin, psychanalyste superviseur à l’Institut de psychanalyse du Massachusetts et professeur à l’Institut psychanalytique de la Nouvelle-Angleterre (EUA) nous plonge aux limites de l’analysable en tentant une synthèse des différents modèles analytiques contemporains articulés autour des états irreprésentables. D’emblée, ce qui frappe dans sa démarche dépliée en six chapitres est l’élargissement de l’horizon analytique porté par son attention au processus et relié à un modèle métapsychologique, articulant théorie et pratique. Notons, entre parenthèses, que les références françaises sont loin d’y être absentes, notamment avec André Green, Piera Aulagnier, mais aussi César et Sara Botella, Michel de M’Uzan, et René Roussillon.
Sa réflexion, consacrée initialement à la théorie freudienne de la représentation et à l’extension de la technique analytique, est sous-tendue par la question imparable du lieu et des degrés d’inscription de ces états non encore organisés, pré ou proto-psychiques, découlant de zones de déchirure du tissu psychique, heureusement dénommées par Antonino Ferro de « landes psychiques ». Levine interroge la nécessaire compréhension de ces inscriptions et la verbalisation de leur impact dans une trajectoire régressive allant des inscriptions psychiques jusqu’aux pré ou proto-inscriptions relevant probablement de ce passage soma-psyché dont ont parlé Green et l’École psychosomatique de Paris. D’emblée, il se situe dans une métapsychologie du processus, plutôt qu’une métapsychologie des contenus, dont ont parlé également Green, les Botella Michel Ody et certains analystes de l’Ipso, rejoignant ainsi les inter-subjectivistes américains, les bioniens, ainsi que les post-bioniens italiens et d’Amérique latine. Chez tous ces auteurs, ce sont les mouvements transformationnels et catalyseurs émergeant de l’interrelation qui comptent. Évoquant le passage de Freud dans Constructions dans l’analyse (1937), cité par les Botella (2007), Levine le reprend au titre de l’impact de l’activité de l’analyste dans le développement psychique du patient.
La question est d’importance, elle implique une clinique de co-construction, ces éléments découlant d’une expérience traumatique peuvent être appréhendés dans une proximité à l’affect plus qu’à l’idéation, et à une fonction du langage articulée à des états émotionnels dans lesquels les mots sont vecteurs de décharge et d’action d’« enactement » (p. 21), sorte de marqueur externe d’un acte de figurabilité, grâce auquel ce qui n’est pas représenté acquiert une forme idéationnelle (Roosevelt Cassorla, 2013).
Selon Levine, l’analyste devrait aider le patient à créer un inconscient dynamique par la transformation des traces en entités représentatives, ce qui suppose l’interpénétration de la dyade. Il se réfère au passage du modèle traditionnel à celui transformationnel de Bion, ou encore à celui des Botella engendrant une mutation d’un modèle de l’absence d’un sens caché à découvrir à celui d’un univers où la création prédomine sur la découverte.
Il faut rendre grâce à Levine d’avoir cette sensibilité aux vécus d’annihilation et du sens de son existence même (p. 42), de même qu’à son propre contact avec des zones que je désignerais comme éminemment traumatiques à partir desquels la tâche de l’analyste peut consister à accomplir un travail de représentation psychique en soutenant, voire en créant, une signification, plus que son décodage.
Après avoir défini les pulsions comme concept frontière d’enregistrement pré ou proto-psychiques de troubles somatiques, il souligne la qualification bionienne des émotions en éléments bêta, donc non encore intégrées au registre psychique. Quant aux « données de la réalité psychique (elles) ne sont pas discernables par l’observation empirique des données sensorielles, mais par une fonction du moi appelée intuition » (Bion, 1970). Cette prise en compte décentre là aussi l’intérêt porté sur les contenus psychiques vers le développement de la capacité de contenir, créer et penser des pensées, attestant de cette métapsychologie du processus.
Abordant la psychosomatique en lien avec les états non représentés, Levine se réfère à Green (1997) qui, sous la double influence de Winnicott et de Bion, met en avant la communication affective. À dire vrai, Bion ne la réserve pas exclusivement aux états psychosomatiques et borderline, comme le fait Green, mais semble l’étendre à tout processus analytique, conception identique à celle de Herbert Rosenfeld (1987, 1989). À l’image des post-kleiniens et bioniens, Green, influencé par ses prédécesseurs, soulignait leur besoin de partager leur expérience (Green, 1997, p. 200-201).
N’oublions pas qu’il est important de considérer qu’un certain nombre d’émotions non contenues se transforment en tempêtes affectives (Levine, p. 50), et ici, à nouveau, se traduit l’héritage de Bion (p. 60), également repris, sur ce point, par Michael Feldman. Levine ne manque pas de nous montrer que « l’affect, les émotions et l’impulsion (les actions) constituent le fil rouge reliant la psyché au soma » (p. 58).
Il nous rappelle que, pour Bion, ce qui a lieu dans le cabinet de consultation est une situation affective (Bion, 1970, p. 118) (p. 60). Considérant les émotions comme des éléments bêta ou objets des sens parallèles à des impressions des sens (Bion, 1962), il note que Bion disqualifie une partie des émotions en tant qu’éléments psychiques, car les éléments bêta ne peuvent être pensés, toutefois, dit-il, il en situe une autre partie au niveau de K. c’est-à-dire dans quelque chose qui peut être connu (ressenti) et ainsi expérimenté. Au niveau affectif, un terme devrait, selon lui, qualifier ce qui relève de l’expérience psychique, avec une partie potentiellement connaissable et en même temps un enracinement dans des sensations corporelles :
« À un niveau d’inscription au-delà de la sensation, de la saturation idéationnelle complète ou de l’accès à la connaissance consciente » (p. 61).
Cette approche est particulièrement détaillée et claire. Sa démonstration s’appuie en partie sur Aulagnier (1986, p. 110), pour laquelle les émotions représentent « la partie émergée de cet iceberg qu’est l’affect (et qui renvoie) à un vécu ». Définition précieuse s’il en est. Levine s’en sert pour désigner les sentiments en tant que partie visible de l’iceberg, et l’affect pour désigner sa totalité (Levine, 2016b). Ceci instaure la partie la plus profonde de l’iceberg, que nous dénommons affect, en réalité somatique relevant du corps, inscrite sans représentation psychique. Les émotions formant selon lui, une ligne de traçage qui fait pont entre soma et psyché, corps et esprit.
Sollicitant à nouveau Aulagnier (1986, p. 110-118), il se réfère à la définition de Sara Flanders à propos de l’originaire comme ce moment du développement :
« Dans lequel le vécu qui est enregistré ou inscrit même s’il est causé par un objet externe est ressenti comme s’il ne venait pas d’un objet, mais d’une série de changements dans les états corporels (qui se déroulent) dans une psyché auto-référencée » (Flanders, 2015, p. 1407).
Le primaire sera considéré en tant qu’étape suivante où la différenciation objet/soi permet la reconnaissance de l’objet et donc de scénarios fantasmatiques inconscients. Un éprouvé de notre corps (originaire) occupe la place qui sera ensuite occupée par la mère (primaire). Si nous revenons avec lui à l’originaire, il le définit en tant que sensoriel. « Il persistera tout au long de la vie comme un niveau fondamental de l’expérience » (p. 64). Levine sollicite à nouveau Aulagnier selon laquelle :
« L’émotion (reflète et) modifie l’état somatique et ce sont ces signes corporels qui s’offrent au regard de l’autre, qui émeuvent celui qui en est témoin et déclenche une même modification en son propre soma » (Aulagnier, 1986, p. 110).
Affirmation là aussi d’importance, Levine apporte ici aussi une précision très intéressante sur la nature des pensées, qui pour lui sont des idées investies d’émotions. C’est pourquoi les vraies pensées sont constituées d’idées investies d’affect et de sens, et non issues de mentalisations clivées.
Et le langage dans tout ça ? Le mot peut produire un effet émotionnel, dit-il, comme, nous le montre Sandro Panizza (2016, p. 1) chez celui qui parle et celui qui écoute (p. 65-66). Il rappelle que la conception de Bion des objets de la psychanalyse, à savoir les émotions, les états psychiques, l’inconscient sont des qualités psychiques, mais qu’en tant que telles, précise-t-il, citant Bion, « elles sont ineffables et ne sont pas disponibles à la perception à travers les modalités sensorielles » (Bion, 1970, p. 64-65).
Évoquant le dernier Bion, Levine interroge le repérage de la vérité des qualités psychiques, véritables éléments secondaires eu égard à la chose en soi, concept kantien réfutant la métaphysique, en l’occurrence ici, l’état psychique. Entre eux se loge un espace énigmatique pouvant être rempli par une série de formes idéationnelles ad hoc, mais approximatives. Il conviendrait donc de se fier à l’intuition en tant que fonction du moi, largement inconsciente. Permet-elle la vérité ? Et qu’entendre par réalité psychique comme expérience, interroge-t-il ?
Il propose une différenciation de l’expérience entre O, Expérience existentielle brute et C, partie de l’expérience connaissable et traduisible par des mots, ainsi qu’une distinction entre l’Expérience E et l’expérience e qu’il est possible de connaître. Qu’il s’agisse de perception, sensation, mouvement pulsionnel, affect, etc., il existe une forme idéationnelle énigmatique, en marche d’émergence et propre au contexte, soit le lien émotionnel ou son absence entre le couple analytique.
L’action thérapeutique qui s’y exprime relève de la Situation épistémologique fondamentale selon laquelle tout stimulus interne ou externe que ce soit une pulsion, une sensation, une perception, est une présence à la source d’un affect ou d’un trouble sensoriel devant être liés, dès lors, à un contenant adapté et/ou transformé, conception de Freud de la pulsion comme concept limite, puisant son origine dans le soma, d’où une pression, et une perturbation sensorielle sur le chemin de la représentation de chose puis de mot, et ce par le mot. Or il n’y a rien dans le ça bouillonnant qui puisse contenir une idée, ce qui maintient le caractère énigmatique, en devenir d’émergence. Or le self se « Construit en fonction de la nature et du type d’ajustement et de miroir que l’objet premier propose » (Roussillon, 2008, p. 126).
Il est à coup sûr symbolisant. Dans une note particulièrement utile et claire, Levine reprend son développement de l’affect et du sentiment (émotion) (notons ici l’équivalence sentiment/émotion) (p. 60-61) en les différenciant. L’affect renvoie en partie au somatique, proto et pré-psychique non encore représenté psychiquement (part d’O non représenté en C). Le sentiment ou émotion est psychique et est représenté. Il constitue la part d’O connaissable ou qui l’est devenue en transformation en C. Le sentiment, bien que représenté, car « éprouvable », n’est jamais, selon Levine, saturé ou défini et contient cet espace transitionnel énigmatique.
C’est l’autre sujet qui apportera l’action transformatrice selon Roussillon, cité à nouveau par Levine. Inclut-elle les deux membres du couple ? La réduction de la tension apporte la possibilité de la connaissance, à ce niveau de « défrichement de la psyché » (p. 80). Comment ne pas citer ici Ferro (1996) et ses travaux, dans lesquels se dessine une trajectoire d’exemples de perturbations sensorielles non encore mentalisées ou éléments bêta, dont certains seront transformés en « briques » de pensée jusqu’à leur transformation en « dialectes » narratifs : récit de la rencontre avec un amoureux, d’un fragment de film, etc. C’est ainsi que ces perturbations sensorielles pourront « trouver une maison » et « un discours narratif dans tout bout d’histoire (narrème) possible approprié (p. 81) ». Levine rappelle que Bion recourait au mythe et propose d’adjoindre à l’interprétation l’aura d’une inflexion narrative et d’une métaphorisation, agents polysémiques d’une perlaboration en mouvement. C’est ainsi qu’il nous confronte au concept bionien de conjecture imaginative, qui définit une réalisation apportant ce qui est potentiel et émergeant (p. 83).
En clôture de son livre, Levine rappelle combien le centre de l’action thérapeutique et de la technique analytique s’est déplacé. Il m’apparaît important de souligner sa démarche originale croisant les différents modèles théoriques analytiques. Le plus fréquemment, c’est un modèle exclusif qui s’impose et ne tarde pas à s’institutionnaliser. Nous pouvons donc recenser chez lui le modèle kleinien qui se propose la dissolution des clivages, notamment, allié à celui freudien de la récupération de contenus perdus sous l’action du refoulement, et aux défenses inhérentes aux traumas. S’y adjoint aussi la construction avec les patients de leur capacité à « rêver » – ce qui est plus contemporain –. Modèle comme il le dit à deux voies (2012) : « Qui se focalise sur le mouvement oscillatoire entre le pré – ou le proto-psychique et le psychique ; entre le vide et l’investissement ou entre l’investissement et le désinvestissement ; entre l’inscrit encore non représenté et le représenté (dans le sens freudien du terme), psychiquement. »
Références bibliographiques
- Aulagnier P. (1985). Naissance d’un corps, origine d’une histoire. Dans Mc Dougall J, Gachelin, G. (dir.). IVe Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence. Paris, Les Belles Lettres.
- Bion WR. (1974). L’attention et l’interprétation. Paris, Payot.
- Bion WR. (1962/1979). Aux sources de l’expérience. Paris, Puf.
- Botella C. et S. (2007). La figurabilité psychique. Paris, In Press.
- Cassorla R. (2013). Reflections on non-dreams-for two, enactment and the analyst’s implicit alpha-function. Dans Levine et L. Brown (dir.). Growth and turbulence in the container/contained. Hove, London and New-York, Brunner-Routledge-Routledge.
- Ferro A. (1996). In the analyst’s consulting room. London, Routledge.
- Flanders S. (2015). On Piera Aulagnier “Birth of a body, origin of a history”. Int J Psycho-anal 96: 1403-1515.
- Green A. (1997). On private madness. London, Karnac.
- Levine H. (2012). The colourless canvas: Representation, therapeutic action and the creation of mind. Int J Psycho-anal 93 : 607-629.
- Levine H. (2014). Beyond Neurosis: unrepresented states and the construction of mind. Rivist Psicoanal 60(2) : 277-294.
- Levine H. (2016b). The fundamental epistemological situation. Psychic reality and the limitations of classical theory. Abraham Lecture, Institut psychanalytique de Berlin.
- Panizza S. (2016). The generative word (inédit) et Panizza S. (2016). L’interpretazione nella psicoanalisi contemporanea: l’efficacia. Milano, Franco Angeli.
- Rosenfeld H. (1987/1989). Impasse et interprétation. Paris, Puf.
- Roussillon R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, Puf.
- Roussillon R. (2008). Le jeu et l’entre-je(u). Paris, Puf.
Béatrice Ithier est psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de la SPP,
Membre de la Société Psychanalytique Italienne (SPI, Pavie),
reconnue psychanalyste de l’enfant et de l’adolescent par l’IPA.
Jacqueline Schaeffer, Qu’est la sexualité devenue, Paris, In Press, 2019.
 Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Jacqueline Schaeffer, interroge les évolutions des pratiques sexuelles dans leur articulation avec la sexualité infantile, « celle qui constitue le seul repère spécifique de la psychanalyse » (p. 12).
Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Jacqueline Schaeffer, interroge les évolutions des pratiques sexuelles dans leur articulation avec la sexualité infantile, « celle qui constitue le seul repère spécifique de la psychanalyse » (p. 12).
La première partie, intitulée « Que reste-t-il des scandales soulevés par Freud ? », s’inaugure avec une invitation de Bernard Golse à réfléchir sur l’influence des évolutions sociétales et biotechnologiques sur la sexualité infantile et la sexualité des enfants. L’auteur fera d’emblée la différence entre le sexuel infantile, la sexualité infantile, et la sexualité des enfants. Selon lui, « l’évolution des théories, des sociétés et des biotechnologies ne modifie guère le sexuel infantile en tant que tel », alors qu’elle peut influencer la sexualité infantile et surtout la sexualité des enfants. Abordant la question de la scène primitive au regard de l’adoption et de l’homoparentalité, l’auteur s’interroge sur les possibilités pour l’enfant de se donner à lui-même une représentation de ses origines familiales. Il souligne l’importance du questionnement sur la scène primitive dans l’activité de représentation.
De la sexualité infantile, on passe tout naturellement à sa relecture au moment de la puberté et à son corollaire psychique, l’adolescence. Maurice Corcos nous invite à une traversée de cet âge, où « la sécurité de base et l’estime de soi acquises dans la prime enfance vont massivement être mises à l’épreuve de la pubescence ». L’auteur cite fort à propos Hélène Deutsch, pour qui ce qui se produit à l’adolescence, c’est « un éclatement de l’idéal du moi, sous le choc de la sexualité, de la culpabilité relative à la masturbation, de l’accroissement de la sévérité du surmoi dirigée contre le moi et de la réaction masochique de ce dernier » (p. 30).
À partir de la sexualité infantile, avec son potentiel pervers polymorphe, il est naturel de s’interroger sur les perversions sexuelles et leur devenir actuel. Gérard Bonnet nous propose, pour clore cette première partie du livre, un aperçu de l’évolution de cette notion, qui semble avoir disparu des diverses nosographies, jusqu’à son abandon progressif au profit de conceptions éthiques et comportementales, les perversions dangereuses étant rejetées du côté de la délinquance. Les psychanalystes, suivant la voie tracée par Freud, s’efforcent de maintenir la notion de perversion sexuelle. Pour la psychanalyse, qui rejette les jugements moraux, la perversion sexuelle constitue une entité psychique précise. Elle manifeste, avec l’hystérie, l’assujettissement de l’être humain aux pulsions les plus primaires.
Dépasser les jugements moraux, c’est ce que la psychanalyse s’est efforcée à faire quant à la masturbation. Dans son excellent article consacré à cette question, qui inaugure la deuxième partie du livre, intitulée « Que sont devenus les tabous et interdits du temps de Freud », Philippe Vallon souligne les enjeux fantasmatiques de cette activité autoérotique et sa place dans les travaux de Freud et de Tausk. Jugée responsable, au xixe siècle, de pathologies somatiques telle la tuberculose, la masturbation n’en sera pas pour autant dédouanée de son potentiel pathogène par Freud, qui en fera la responsable de troubles psychiques, telle la neurasthénie. L’aspect pathogène de la masturbation, que la psychanalyse considère comme un évènement psychique, serait lié au fantasme plutôt qu’à l’acte lui-même, car le fantasme en question touche à l’interdit majeur de notre civilisation : l’inceste. Suivant les idées de Freud, Viktor Tausk complète, dans son article de 1912, les conceptions psychanalytiques de cette question, en y introduisant deux notions qui prendront de l’importance dans l’évolution de la théorie : le narcissisme et une instance qui deviendra le surmoi.
Partant des mouvements contestataires de mai 68 et des revendications féministes qui les ont accompagnés, Nedra Ben Smaïl propose de nous intéresser au tabou de la virginité, tel qu’il existe dans la culture arabo-musulmane. Ce sont curieusement les références à sa culture qui nous ont semblé les plus dignes d’intérêt, notamment celles des notes de bas de page, nous entraînant dans un parcours étymologique passionnant, décrivant, par exemple, l’équivalence entre « mon premier enfant » et « ma virginité », entre « défloration » et « accouchement » (p. 69). Le texte lui-même donne, en revanche, l’impression d’une certaine confusion, due probablement au mélange de différents champs : sociologique, politique, religieux avec une démarche psychanalytique relevant du placage théorique utilisant des concepts lacaniens. Le texte aborde ensuite la question de la reconstruction chirurgicale de l’hymen, dont l’auteur fait un véritable acte de vengeance contre les hommes.
Ouvrant sur quatre vignettes cliniques, l’article de Mi-Kyung Yi envisage les troubles de la sexualité humaine à travers l’impuissance et la frigidité. Citant la formule provocatrice de Laplanche (« Le fiasco est l’honneur de l’homme »), l’auteur souligne que la sexualité « est chez l’homme une psychosexualité, jamais à l’abri des défaillances » (p. 82). « Au fond, écrit-elle, c’est la passivité inséparable de l’expérience du plaisir sexuel que les troubles comme impuissance et frigidité incitent à interroger » (p. 85). Abordant l’histoire de la notion de frigidité, l’auteur signale que ce terme était, à l’origine, réservé aux hommes, l’absence de plaisir étant la norme pour les femmes. Ce n’est qu’au siècle passé que l’on assiste au glissement sémantique qui attribue le terme de frigidité aux femmes éprouvant peu ou pas de plaisir au cours du rapport sexuel, laissant aux troubles sexuels de l’homme le nom d’impuissance. C’est Karl Abraham qui établira, en décrivant les diverses formes de la tendance castratrice féminine, le lien entre les deux troubles de la sexualité : la visée inconsciente de la frigidité serait, selon lui, « de prouver à son partenaire comme à elle-même la non-valeur des aptitudes sexuelles de l’homme » (p. 88).
Le même Abraham sera, aux côtés d’Ernest Jones, Max Sachs et Hans Eitingon, l’avocat de l’interdiction de l’accès des homosexuels à la pratique de la psychanalyse. Dans son article consacré à l’homosexualité, Laurie Laufer rappelle de façon très pertinente les positions défendues très tôt par Freud. Pour ce dernier, « le choix d’objet homosexuel est présent dans la vie psychique normale » (p. 97)[1]. Il s’agit d’une variation de la fonction sexuelle. L’homosexualité ne doit intéresser le psychanalyste dans sa pratique que lorsqu’elle révèle des conflits névrotiques. Comment, à partir d’une position aussi affirmée et étayée théoriquement, en est-on arrivé à des positions d’exclusion ? L’auteur décrit la façon dont une partie des psychanalystes ont épousé les vues de l’establishment social et politique. Elle interroge ainsi « le rejet par la psychanalyse elle-même de ses propres discernements » (p. 106).
Cette deuxième partie s’achève sur un amusant dialogue entre Julia Kristeva et Philippe Solers intitulé « L’infidélité – Amour, Fidélité, Infidélité ». Le lecteur y trouvera une réflexion sur ces notions quelque peu délaissées, fleurant bon le « il est interdit d’interdire » de mai 1968. Les deux protagonistes tentent de définir – ou redéfinir – la relation amoureuse, qui est, selon eux, « ce mélange subtil de fidélité et d’infidélité » (p. 114). La fidélité serait ce « sentiment » qui remonterait « à l’enfance et à son désir de sécurité » (p. 116). Ce dialogue, rafraichissant et nostalgique, évite néanmoins des questions directement liées au sujet abordé : le renoncement, le sentiment de culpabilité.
Ouvrant la troisième partie du livre, intitulée « Les temps modernes de la sexualité », René Roussillon nous invite à écouter la polymorphie de la sexualité dans la cure. Il interroge « les enjeux de l’écoute d’un manifeste directement en lien avec la sexualité » (p. 128), mais aussi la possibilité qu’un contenu manifeste sexuel cache du non-sexuel. La psychanalyse, signale-t-il, disjoint sexuel et sexualité et « elle reconnaît une part de sexuel en dehors des manifestations de la sexualité. À l’inverse, elle peut aussi souligner la présence d’enjeux non-sexuels dans la sexualité elle-même » (p. 129). Évoquant la sexualité infantile, l’auteur souligne les liens étroits entre le sexuel et la question du plaisir. Mais le plaisir est aussi ce qui préside à l’appropriation subjective, liée au narcissisme secondaire et donc aux auto-érotismes, la visée appropriative du narcissisme étant essentielle pour le « travail d’intériorisation de la sexualité » et pour « l’introjection de l’expérience subjective » (p. 135). René Roussillon insiste, enfin sur la valeur « messagère » du sexuel et de la pulsion, sur laquelle repose la conception psychanalytique de la relation transféro-contretransférentielle.
Dans l’article suivant, François Richard aborde la question de la relation entre sexualité et pornographie sur internet. L’auteur est ici en terrain connu, ayant écrit un ouvrage intitulé L’actuel malaise dans la culture. Ce malaise, écrit-il, « se transforme en confusion dès lors que l’intériorité ne garantit plus le lien intime, parce qu’elle est traversée par les représentations et le flux du monde extérieur » (p. 141). La voie courte de la réalisation rapide des motions pulsionnelles aboutirait à une « désexualisation de la pulsion dans son exercice même » (p. 142).
Dans son article, intitulé « Le taylorisme sexuel à l’épreuve de la psychanalyse », Vincent Estelon souligne fort à propos que, « en dépit de ces changements manifestes, la clinique analytique rappelle que certaines problématiques psychologiques traversent le temps sans trop bouger. Sur le plan psychique, ajoute-t-il, la liberté sexuelle est toujours difficile à conquérir » (p. 154). Interrogeant le côté addictif de la sexualité, il signale que, comme avec les drogues, « la sensation est venue prendre la place de l’affect » (p. 155). L’auteur se demande si « la dépendance toujours renouvelée à des objets actuels peut être lue comme une tentative de s’affranchir de la fixation à un objet plus ancien qui hypothèque la vie amoureuse de l’adulte » (p. 158).
Avec l’article de Frédéric Tordo, intitulé « Technosexualité, trans@sexualité et néo-sexualité », nous voilà de retour dans ce que Joyce McDougall appelait déjà « néo-sexualités ». L’auteur crée pour traiter de la « sexualité par l’interface des machines » le néologisme de trans@sexualité, à distinguer de la transsexualité. Il s’agit, dans ces nouvelles pratiques sexuelles, d’un véritable « processus d’hybridation » (p. 168), à l’origine de « l’émergence de nouvelles sensorialités et de nouvelles sensualités, voire de la production de zones d’excitation inédites » (p. 169). Mais s’agit-il là d’une sexualité « nouvelle » ou de nouvelles expressions d’un sexuel qui reste inchangé ? Le lecteur pourra relever quelques contradictions : c’est ainsi que l’auteur explique qu’il s’agit de « plaisirs de la peau, comme aux temps originaires de la découverte de la sexualité » (p. 169) et que la technologie ne vient qu’interfacer la rencontre avec l’autre.
La troisième partie de cet ouvrage s’achève sur un article de Janine Mossuz-Lavau, intitulé « Les nouvelles lois de l’amour. Le droit de quelques délits et crimes sexuels ». Il relate l’évolution de la législation qui accompagne, depuis un demi-siècle, les changements sociétaux. Il s’agit, d’une part, de la prise en compte par le législateur du besoin de protection des sujets les plus vulnérables, comme les enfants et les mineurs de 15 ans, et de l’autre, de la transcription dans la loi des évolutions de la société, comme par exemple l’harmonisation de l’âge de la majorité sexuelle à 15 ans, qu’il s’agisse des rapports hétérosexuels ou homosexuels.
L’évolution de la législation sur le viol est à ce titre remarquable, avec la reconnaissance du viol conjugal et du harcèlement sexuel. Il est de même de la pédophilie, dont l’auteur signale que le terme même « ne figure pas dans le Code pénal » (p. 185), mais qui sera l’objet d’une série de lois jusqu’en 2007. Quant à la question de l’inceste, l’auteur signale que le terme même ne figure dans aucun texte de loi avant février 2010.
La quatrième et dernière partie de cet ouvrage, intitulée « Qu’est la différence des sexes devenue », commence par la question – inévitable – des relations de la psychanalyse avec la question du genre. Dans son article consacré à ce sujet, Jean-Baptiste Marchand remarque que bien qu’elle ait plus de soixante ans, la question « Qu’est-ce que le genre ? » continue de se poser. Dans le champ de la psychanalyse, l’auteur rappelle que Freud n’a jamais cessé de souligner le caractère insaisissable du masculin (männlich) et du féminin (weiblich). Il évoque les travaux de Robert J. Stoller, premier psychanalyste à proposer une théorie du genre, ainsi que la controverse entre Colette Chiland et Jean Laplanche. Dans sa conclusion, l’auteur souligne la spécificité de la psychanalyse dans le débat concernant le genre et la différence des sexes : là où les travaux sur le genre et le sexe s’intéressent à ceux-ci dans leurs dimensions biologique, sociale ou psychologique « concrète », la psychanalyse s’y intéresse aux niveaux intrapsychique, fantasmatique, inconscient et pulsionnel.
Le männlich et le weiblich et leur relation occupent les trois derniers articles du livre.
Dans son article intitulé « L’amour au masculin », Jacques André souligne que « l’amour de la mère, entendu dans les deux sens que permet la formule, occupe sans l’ombre d’un doute une position princeps » (p. 209), à l’origine d’une empreinte, « gravée dans le marbre ».
Pour l’auteur, c’est l’angoisse de castration qui rend compte de certains avatars de la sexualité des hommes. Il en est ainsi du « fiasco », terme introduit par Stendhal et qui désigne les petites ou grandes défaites sexuelles, dans des situations où « se conjuguent à l’excès désir et interdit » (p. 213). À la fin de l’article, il évoque une des figures à l’origine du fiasco, le respect, qui « signe le refoulement des amours incestueuses et la religiosité devant le premier objet » (p. 220). Et de citer Freud : « Pour devenir vraiment libre et de ce fait aussi heureux (l’homme) doit avoir surmonté le respect pour la femme et s’être familiarisé avec la représentation de l’inceste avec la mère et la sœur » (p. 219). C’est à ce prix qu’il évitera le clivage entre la maman et la putain et qu’il pourra concilier le sexuel et le tendre.
C’est ce même clivage que Jacqueline Schaeffer reprendra dans son article « Le sexe féminin, entre tabou et interdit ». «Entre la maman et la putain, écrit-elle, une figure de femme reste oubliée, refoulée ou réprimée : la femme érotique, la femme sexuelle » (p. 229). Contre cette femme-là, « autre, impure, castratrice » (p. 222), il s’agit de mettre en place des défenses, des tabous : tabou du voir, tabou du sang. Face à ces tabous, l’auteur énumère les diverses transgressions, dont la principale serait la jouissance sexuelle, le scandale du féminin étant le masochisme érotique. Et de conclure : « Autant dans les domaines social, politique et économique, le combat pour l’égalité entre sexes est essentiel à mener constamment, autant il est néfaste, préjudiciable dans le domaine sexuel, s’il tend à se confondre avec l’abolition de la différence des sexes » (p. 238).
C’est cette même question de la différence des sexes qu’interroge Michel Schneider, dans son article « La guerre des sexes n’aura plus lieu », qui marque la fin du recueil. Dénonçant la « rivalité mimétique entre les hommes et les femmes » (p. 241), l’auteur évoque « ce qui les oppose et les réunit : la tendre et délicieuse guerre des sexes » (p. 241). Pour éviter cette « guerre », il faut, comme le disait Freud en 1914, se débarrasser « de l’embarrassante sujétion sexuelle ». Parmi les moyens contemporains de s’en débarrasser, l’auteur évoque le remplacement, dans le langage du mot « sexe » par « genre » et la pornographie, qui, par l’hypervisibilité et la saturation, « détruit le fantasme érotique en substituant au jeu des désirs et des corps un monde virtuel où il n’y a pas de rapport physique entre les sexes » (p. 242). Michel Schneider n’hésite pas à prendre des positions à contre-courant des tendances actuelles, dénonçant, par exemple, les prises de position de certains psychanalystes, qui « appellent à se défaire du dogme paternel ou de la tyrannie de la différence des sexes, ou encore soutiennent l’homoparentalité » (p. 245). Il dénonce la « conception contemporaine d’une sexualité sans conflit ni intra ni interpsychique » (p. 246).
Ce livre aborde donc les multiples questions de la sexualité telles qu’elles se posent à travers les pratiques sexuelles actuelles et les discours les accompagnant. Il présente le grand intérêt de réaffirmer l’intérêt que porte la psychanalyse à ces questions, liées à la permanence de la sexualité infantile chez l’adulte et à ses divers modes d’expression, directement liés à l’évolution des sociétés dans leurs diversités culturelles. La lecture en est agréable et prenante, malgré le caractère parfois inégal des différents articles. Le lecteur y trouvera matière à réflexion et appréciera l’éclairage précis, parfois cru, que les différentes parties de cet ouvrage portent sur le devenir actuel de la sexualité.
Roland Havas est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.
[1] S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, cité par l’auteur.
Marilia Aisenstein, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, Paris, Éditions d’Ithaque, 2020.
 Une grande partie du plaisir que procure la lecture du nouveau livre de Marilia Aisenstein, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, provient de ce qu’elle fait alterner des récits cliniques toujours saisissants avec des résumés de textes romanesques. Littérature et clinique s’éclairent mutuellement, et donnent facilement à voir les idées nouvelles que l’auteur apporte à la théorie psychanalytique.
Une grande partie du plaisir que procure la lecture du nouveau livre de Marilia Aisenstein, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, provient de ce qu’elle fait alterner des récits cliniques toujours saisissants avec des résumés de textes romanesques. Littérature et clinique s’éclairent mutuellement, et donnent facilement à voir les idées nouvelles que l’auteur apporte à la théorie psychanalytique.
Mariilia Aisenstein fait partie des psychanalystes psychosomaticiens qui ont entrepris d’utiliser les idées de Benno Rosenberg pour mieux comprendre leurs patients. Comme le rappelle Michel Fain, dans une annexe au livre de M. Aisenstein, et intérêt des psychosomaticiens pour l’œuvre de Rosenberg est ancien, mais n’a pas été partagé par tous. Il remonte à un colloque de 1963-1964 à l’Institut de psychosomatique (Fain, 2000, p. 95). Rosenberg nous avait étonnés en soutenant que le masochisme est « gardien de la vie » : Freud n’avait-il pas introduit la notion de pulsion de mort à propos des phénomènes cliniques de la résistance, et du besoin de souffrir ? (Rosenberg, 1991, p. 20). Le masochisme n’était-il pas la cause principale des échecs des patients dans leurs vies, et une résistance majeure à l’analyse ? (Nacht, 1938, 1948). Mais il ne s’agissait là que du masochisme moral et du masochisme pervers. Rosenberg avait en vue la troisième variété de masochisme décrite par Freud dans Le problème économique du masochisme, le « masochisme primaire érogène ». Le masochisme primaire érogène résulte de la liaison de la pulsion de mort par la libido à l’intérieur de l’organisme. Il est en effet « gardien de la vie » parce qu’il empêche la pulsion de mort de détruire l’organisme de l’intérieur (Freud, 1924c/1973, p. 290-291). Rosenberg avait appliqué cette idée du « masochisme gardien de la vie » aux états psychotiques qu’il attribuait à « un dysfonctionnement important du masochisme primaire, du noyau masochique du moi » (op. cit., p. 87-90). Il avait aussi proposé une explication très intéressante du « travail de mélancolie » que Freud décrit brièvement dans Deuil et mélancolie (Freud, 1917e [1915]/1968, p. 169), par la « détachabilité de l’objet » (p. 99-120). À côté du masochisme gardien de la vie, Rosenberg a aussi décrit un « masochisme mortifère », dans lequel l’excitation devient impossible à décharger. L’objet est alors progressivement abandonné. L’absence de relation objectale bloque la pulsion de vie, et la vie fantasmatique du sujet s’en trouve entravée. Le sadisme est alors introjecté de façon massive et retourné contre le sujet. Le prototype de ce masochisme mortifère est la « psychose froide » décrite par Évelyne et Jean Kestemberg et Simone Decobert (Kestemberg É., Kestemberg J. et Decobert S., 1972) à propos de l’anorexie mentale, ou le mérycisme, étudié par Fain, Léon Kreisler et Michel Soulé (Kreisler L., Fain M. et Soulé M., 1974).
M. Aisenstein prolonge l’œuvre de Rosenberg dans deux directions : d’une part, elle l’étend à la compréhension des patients psychosomatiques ; d’autre part, elle fait un pas de plus vers les origines. Alors que Rosenberg pose le masochisme comme originaire, M. Aisenstein place la douleur encore en amont de ce masochisme primaire.
Dans le titre du livre, la douleur s’intercale entre le désir et la pensée. Mais quand elle en vient à sa conclusion, elle se demande si elle ne met pas plutôt la douleur à l’origine du désir comme de la pensée (p. 93). En effet, selon elle, les premières représentations psychiques naissent de la nécessité de représenter la douleur, « devenue souffrance » (p. 32). Cette première représentation prend nécessairement la forme d’un fantasme inconscient masochiste. Le désir naît donc de la douleur. « La structure du désir est d’essence masochique » (p. 37, p. 43). Le désir, l’attente de la satisfaction, serait impensable sans « un investissement masochique du déplaisir, une dimension masochique de l’existence, qui permette l’investissement de l’hallucination du plaisir » (p. 23).
Mais par ailleurs, la psychanalyse ne fait pas de séparation nette entre le corps et l’esprit. Elle est fondamentalement « moniste » (quand on parle du « dualisme » freudien, on n’a en vue que le dualisme des pulsions) (p. 66). Pour Freud, « la pensée n’est qu’un substitut du désir hallucinatoire… » (Freud, 1900a/2003, p. 482). Il faut donc désirer pour pouvoir penser, de même qu’il faut vivre sa douleur pour pouvoir désirer (p. 94).
En est-il nécessairement ainsi ? Le désir est non seulement supportable, mais plaisant, parce qu’il se déplace sur de nouveaux objets substitutifs, et s’assigne de nouveaux buts, pas tous masochistes. Le premier de ces déplacements est la satisfaction hallucinatoire du désir, décrite par Freud. Certes, répond M. Aisenstein, mais cette capacité de déplacement et de condensation du désir dépend de la qualité des soins maternels. Et sans le masochisme primaire, les mots et les gestes de la mère suffisamment bonne ne suffiraient pas. Il faut que l’attente soit investie masochiquement pour que l’enfant prenne plaisir à attendre (p. 36). C’est ce noyau masochiste primaire qui fait défaut dans la clinique psychosomatique (p. 52).
Contrairement aux patients névrosés, les malades somatiques graves, que M. Aisenstein traite psychanalytiquement, ne se plaignent pas de l’impossibilité de réaliser leurs désirs. Ils se contentent d’éviter de désirer, en se protégeant contre les objets qui pourraient les exciter. À 32 ans, Carla a déjà été opérée d’un cancer du sein et a fait deux accidents vasculaires cérébraux. C’est une sportive professionnelle, qui n’a pas de vie sentimentale, et qui est tombée malade quand elle a dû arrêter son entraînement physique intensif à la suite d’une fracture. Au bout d’un an de psychothérapie, elle rapporte un premier rêve : « un paysage de neige, ni froid ni chaud ». Elle révèle alors qu’elle a perdu le sens du froid et du chaud depuis ses premières règles à l’âge de 12 ans. Son analyste lui fait remarquer qu’elle a été anesthésiée. Carla parle alors pour la première fois de la mort de son père, survenue au même moment, ainsi que des mauvais traitements qu’elle a subis de sa mère, qui la battait, et recevait ses amants en sa présence. Il faut lire le livre d’Aisenstein pour suivre le processus analytique passionnant qui commence à partir de cette séance. Il a fallu que la douleur anesthésiée de Carla se transforme en souffrance, et en représentations masochistes pour que le processus démarre (p. 37-41).
Dans certains cas, les douleurs anesthésiées d’une patiente accèdent à la représentation par le biais de la « perception inconsciente » des affects de l’analyste par la patiente. Une des patientes de M. Aisenstein, psychotique et diabétique insulinodépendante, accède à des sentiments de tristesse liés à la longue maladie de son grand-père, dont elle n’avait jamais parlé jusque-là, lorsque, le même jour, l’analyste est inquiète pour l’un de ses proches. La patiente a eu la perception inconsciente de l’inquiétude vitale de son analyste (p. 41-42). Cette notion de « perception inconsciente » a souvent été soulignée par Pierre Marty. Il disait des patients opératoires que leur inconscient n’émet pas, mais que cela ne l’empêche pas de recevoir (p. 42).
Sans doute M. Aisenstein a-t-elle aussi pensé que la patiente avait eu la perception interne d’avoir le feu au derrière.
Marilia Aisenstein ne croit pas que Freud ait eu raison de nommer « féminin » le masochisme pervers. Ce dernier se rencontre chez des sujets qui ne parviennent à la jouissance qu’en s’identifiant à des femmes maltraitées (Freud, 1924, p. 289). Mais si elle ne croit pas au « masochisme féminin », elle pense qu’il existe tout de même un « masochisme au féminin », qui serait responsable de l’endurance des femmes et de leur meilleure résilience. La raison en serait que chez les femmes la tension d’excitation serait plus souvent plaisante érotiquement, alors que les hommes investissent davantage la décharge. Les femmes s’identifieraient plus souvent à leur père en même temps qu’à leur mère, elles seraient davantage bisexuelles que les hommes (p. 44-46).
Cette endurance des femmes, qui font souvent en effet deux journées de travail, l’une au bureau et l’autre à la maison, fait bien l’affaire des hommes. Elle disparaîtra peut-être dans une société où les hommes auront partagé leur pouvoir avec les femmes.
Mais dans le monde où nous vivons, il semble que seules les femmes souffrent de fibromyalgie, une maladie nouvelle, faite de tensions musculaires douloureuses, avec un abaissement du seuil à partir duquel une sensation proprioceptive est perçue comme douloureuse. La fibromyalgie survient souvent après un traumatisme psychique : deuil, rupture affective, échec professionnel. Elle frappe toujours des femmes très actives, qui cherchent sans cesse à en faire davantage. Cette hyperactivité évoque les processus autocalmants. M. Aisenstein donne une observation remarquable d’une de ces patientes et de son entrée dans le processus analytique (p. 49-50).
Très différents des patients somatiques sont les patients qu’une intervention chirurgicale mineure fait basculer au seuil de l’hypocondrie délirante, comme l’Homme aux loups après qu’un chirurgien a eu porté atteinte à son précieux nez « typiquement russe » – et si différent du nez juif de Freud (Brunswick, 1928, p. 274). De même, M. Aisenstein découvre le colossal investissement narcissique et objectal dont était porteur le grain de beauté sur la joue de sa patiente O., dont l’ablation avait provoqué chez elle une désorganisation complète.
Elle compare ce trouble à celui qui atteint le héros du roman d’Emmanuel Carrère, La moustache. Après s’être coupé la moustache, le héros de Carrère se heurte à l’incrédulité de sa femme et de ses amis qui lui affirment qu’il ne s’est rien coupé parce qu’il n’avait jamais eu de moustache. Il finit par s’amputer la lèvre supérieure puis par se trancher la gorge (p. 53-60).
M. Aisenstein retrouve le masochisme mortifère décrit par Rosenberg dans les divers aspects de la destruction de la pensée chez l’individu et dans la civilisation. Sa lecture du roman de Jonathan Littell, Les bienveillantes, a remis en question ce qu’elle avait pensé jusque-là de la démentalisation. Comment concilier le haut niveau culturel du héros des Bienveillantes, Maximilian Aue, et sa participation aux crimes collectifs commis par les nazis sur le front de l’Est ? Littell décrit Aue et son ami Voss comme « psychiquement vivants », et non comme démentalisés (p. 82-83). Le roman de Littell illustre le paradoxe de la « modernité » du IIIe Reich : débarrassé des juifs et des autres races inférieures, le Reich du IIIe millénaire devait voir l’avènement de la Civilisation.
Comment comprendre ces « sublimations de mort » dans lesquelles l’art et la pensée se mettent au service de la destructivité ? Certes, toutes les sublimations s’accompagnent d’une désintrication pulsionnelle, parce qu’elles ne portent que sur les pulsions sexuelles. La pulsion de mort ainsi libérée peut se porter contre l’artiste ou contre son œuvre (Freud, 1923b/1981, p. 259). Mais cette explication est trop générale. L’hypothèse de M. Aisenstein est « qu’il s’agit d’une déliaison qui agit à l’encontre de tout élément humain, opérant ainsi un malentendu ou un mésusage de la notion de ‟civilisationˮ ». Ainsi, « la notion de civilisation est coupée de l’être humain » (p. 83). Un tel mésusage de la notion de civilisation peut s’observer partout, y compris dans les cures psychanalytiques, quand les analystes font passer l’idéal de la cure avant le souci de leur patient (p. 84, et p. 92-93).
Comment peut-on en venir à une telle soumission à des idéaux barbares ? M. Aisenstein compare la soumission aux ordres des responsables de crimes collectifs et la phobie du fonctionnement mental propre à la pensée opératoire. Dans les deux cas, une soumission démentalisante avec dilution du surmoi se met en place. Comme J-B. Pontalis, elle voit dans le personnage de Herman Melville, Bartleby le scribe, un résistant radical, le héros de l’affirmation négative, celui qui « préfère ne pas ».
Je crains que la question de la soumission aux idées reçues ne dépasse de beaucoup le champ de la psychanalyse. Freud nous rappelle à la modestie quand il écrit :
« Chaque individu pris isolément participe donc de plusieurs âmes des foules, âme de sa race, de sa classe, de sa communauté de foi, de son État, etc., et peut par surcroît accéder à une parcelle d’autonomie et d’originalité » (Freud, 1921c/1981, p. 198).
Marilia Aisenstein a la générosité de partager avec nous la parcelle d’originalité particulièrement étendue que sa culture psychanalytique et littéraire lui a fait acquérir.
Références bibliographiques
- Aisenstein M. (2020). Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique. Paris, Éditions d’Ithaque.
- Kreisler L., Fain M. et Soulé M. (1974). L’enfant et son corps. Paris, Puf.
- Fain M. (2000) À propos du masochisme érogène primaire. Dialogue imaginaire avec Benno Rosenberg. Dans Aisenstein M. (2020) : Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique. Paris, Éditions d’Ithaque.
- Freud (1900a/2003) L’interprétation du rêve. OCF.P, IV. Paris, Puf.
- Freud S. (1917e [1915]1968) Deuil et mélancolie. Métapsychologie. Paris, Gallimard.
- Freud S. (1921c/1981). Psychologie des foules et analyse du moi. Essais de psychanalyse. Paris, Payot.
- Freud S. (1923b/1981) Le moi et le ça. Essais de Psychanalyse. Paris, Payot.
- Freud S. (1924c/1973). Le problème économique du masochisme. Névrose, psychose et perversion. Paris, Puf.
- Kestemberg E., Kestemberg J. et Decobert S. (1972). La faim et le corps. Une étude psychanalytique de l’anorexie. Paris, Puf.
- Mack Brunswick R. (1928/1981). En supplément à « L’histoire d’une névrose infantile » de Freud. Traduit par M. Bonaparte. L’homme aux loups par ses psychanalystes et par lui-même. Paris, Gallimard, Paris.
- Nacht S. (1938). Le masochisme. Paris, Le François.
- Nacht S. (1948). Les manifestations cliniques de l’agressivité et leur rôle dans le traitement psychanalytique. Rapport présenté à la XIe Conférence des Psychanalystes de Langue Française. Rev Fr Psychanal 12(3) : 313-365.
- Rosenberg B. (1991) ? Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie. Paris, Puf, « Monographie de la Revue française de Psychanalyse ».
Gilbert Diatkine est psychiatre, psychanalyste, membre Titulaire Formateur de la SPP.
Catherine Chabert, Les belles espérances. Le transfert et l’attente, Paris, Puf, « Le fil rouge », 2020.
 Après Maintenant il faut se quitter, un livre qui traitait du temps de la séparation et des affects spécifiques d’angoisse et de douleur associés, Catherine Chabert nous propose un livre passionnant sur l’attente, ses expressions, et ses effets psychiques reconnaissables à leurs traces conscientes et inconscientes révélées par l’analyse. Avec Les belles espérances, elle prolonge ses travaux théorico-cliniques antérieurs sur les dépressions, les deuils d’objet, objets premiers ou objets de l’histoire, et elle élargit son champ de recherches aux problématiques liées aux pertes d’idéaux ou aux pertes d’environnement, en donnant une place particulière aux illusions et déceptions, et aux oscillations entre les affects d’espoir et de désespoir qui rythment la temporalité de l’attente.
Après Maintenant il faut se quitter, un livre qui traitait du temps de la séparation et des affects spécifiques d’angoisse et de douleur associés, Catherine Chabert nous propose un livre passionnant sur l’attente, ses expressions, et ses effets psychiques reconnaissables à leurs traces conscientes et inconscientes révélées par l’analyse. Avec Les belles espérances, elle prolonge ses travaux théorico-cliniques antérieurs sur les dépressions, les deuils d’objet, objets premiers ou objets de l’histoire, et elle élargit son champ de recherches aux problématiques liées aux pertes d’idéaux ou aux pertes d’environnement, en donnant une place particulière aux illusions et déceptions, et aux oscillations entre les affects d’espoir et de désespoir qui rythment la temporalité de l’attente.
C’est à Alexandre Dumas qu’elle pense en ouverture de son livre, en reprenant deux mots prononcés par Edmond Dantès à la fin du célèbre roman : « Attendre et espérer ». Mais c’est Charles Dickens qui inspire son titre, avec la substitution de belles à grandes ce qui indique d’emblée la place positive et vitale réservée dans cet ouvrage à l’illusion et au rêve, et à leur nécessaire mise en jeu pour soutenir les ambitions et les désirs face aux réalités de la vie. On y reconnaît l’empreinte winnicottienne, mais Chabert apporte une dimension personnelle, car il s’agit pour elle des illusions qui permettent que l’attente soit féconde et transformatrice, de celles qui sont alimentées par les pulsions de vie et maintiennent l’excitation nécessaire à la mobilité psychique et à la créativité, et non des fantasmes grandioses, omnipotents ou maniaques qui enferment le sujet dans des figurations archaïques aliénantes. Mais la référence à Dickens condense bien d’autres significations. Car l’espérance mise au pluriel, « les espérances », une expression poétique très pertinente pour son propos, éloignent du religieux, de la pensée magique, ou de l’illusion utopique, et donnent accès à toutes les singularités des histoires psychiques en attente de réalisation de souhaits. Dans ce sens, l’évocation des deux héros romanesques de Dumas et de Dickens qui s’efforcent d’attendre leur heure, dans le contexte d’une temporalité à durée indéterminée, montre l’importance psychique vitale que Chabert donne à l’endurance qu’elle décrit en partage pour les deux partenaires de la cure.
Le sous-titre de l’ouvrage, « Le transfert et l’attente », nous transporte directement au cœur de la cure, où Chabert souligne comment l’attente, indissociable du transfert, l’est aussi du contre-transfert. Elle consacre un chapitre entier au contre-transfert, dont elle rappelle qu’il fut peu étudié par Freud. Elle en élabore les enjeux inconscients dans leurs rapports avec l’attente et en fait une voie privilégiée vers l’interprétation. Je la cite : « Je pense que l’interprétation ne relève pas seulement d’une mise en sens à l’écoute du discours du patient et que le contre-transfert de l’analyste implique dans sa résonance inconsciente, non seulement sa propre expérience analytique, mais aussi ses cheminements métapsychologiques qui offrent une contribution essentielle à l’attente dans ses composantes contre-transférentielle » (p. 99). Pour elle, dans toutes les cures, y compris dans les cures de névrosés, c’est le contre-transfert comme manifestation de l’implication subjective de l’analyste, qui permet d’atteindre les zones de dépression, de fragilité narcissique, ou de mélancolie.
Ainsi, le sous-titre aurait bien pu être : « L’attente, le transfert et le contre-transfert », tant la participation psychique personnelle de l’analyste est grande dans l’ensemble de son élaboration de la clinique. Elle écrit : « Il est impossible de séparer le transfert et le contre-transfert : en présentant une cure, l’analyste s’expose lui-même autant que le patient dont il parle » (p. 143), analyste en personne, et analyste en fonction étant indissociables. De fait, comme elle le souligne justement, l’inquiétante étrangeté concerne aussi le contre-transfert, le « familier-inquiétant » étant convoqué dans le croisement tranféro-contre-tranférentiel ». Ainsi plus qu’un travail d’analyste en séance, le grand mérite de ce livre est de nous faire partager le travail d’une analyste en dialogue avec elle-même et ses propres mouvements internes.
Jusqu’aux dernières lignes du livre, à travers des histoires cliniques très variées, Chabert nous livre avec générosité les différents registres d’implication de son écoute d’analyste : une écoute impliquée dans toutes ses dimensions, affective, empathique, personnelle ; une écoute lestée par de longues années d’expérience et leur théorisation, réélaborées au fil du temps, en différents moments d’après-coup. Cette écoute, aux multiples entrées, nourrit son contre-transfert qui est pleinement partie prenante du processus analytique. Nous parcourons ainsi avec elle ses cheminements élaboratifs et perlaboratifs avec ses patients, chacun étant concerné par l’attente, l’espérance, le doute, ou parfois le désespoir.
Nous ne serons alors pas étonnés que Chabert insiste particulière sur le travail spécifique de perlaboration, différencié de l’élaboration, dont l’attente, la patience et la persévérance sont les principaux fondements. « La perlaboration, attente patiente de l’analyste [est] indispensable pour que le travail du transfert puisse trouver ses effets », écrit-elle (p. 34). Nous lui devrons un éclairage précieux sur ce concept peu développé par Freud, et pourtant si important pour l’analyse des résistances et l’appréciation du juste moment de leur interprétation.
Attente, espoir et transfert sont donc noués au contre-transfert dès le début des cures relatées. Leur présence conflictualisée et nuancée sera confrontée au principe de réalité et au travail de deuil, dans tous les récits cliniques qui mettent analysant et analyste face aux affects d’impatience et à la nécessité de renoncer, ainsi qu’aux résistances qui exigent le respect de la temporalité longue des détours. Ces récits sont habités par la passion faisant de certaines patientes de véritables héroïnes le temps de leur cure. « Passion », parce que la charge pulsionnelle et sa flamboyance, pour reprendre la métaphore du feu chère à l’auteur, suscitée ou réveillée par le transfert, est un souci majeur pour Chabert, qui a toujours été attentive à cette force et à la massivité de l’investissement.
Avant tout, nous dit-elle dans ce livre, c’est l’incarnation transférentielle, dans l’urgence de l’excès pulsionnel en attente d’objet, qui constitue la voie essentielle pour initier les déplacements d’investissement qui permettront le rééquilibrage économique et l’émergence de représentations. Chabert soutient les transferts à côté comme elle les nomme, petits pas de côté, détours parmi d’autres, investissements latéraux nécessaires pour diffracter les forces pulsionnelles du transfert afin d’accéder secondairement aux représentations qu’elles recèlent. Elle fait ainsi de l’incarnation un détour indispensable et urgent malgré sa temporalité paradoxale en tension entre « l’immédiateté impérieuse et la contrainte de l’attente ».
Pour Chabert, l’attente elle-même peut être traitée comme un détour, comme « un frein à l’emballement libidinal » par la mobilisation de la pulsion de mort qui alors peut se mettre au service du refoulement : « les pulsions de mort ne se définissent pas seulement dans leur valence destructrice irréversible, mais aussi dans l’usure nécessaire à l’oubli et au refoulement », écrit-elle (p. 43).
Tous les récits cliniques sont marqués par la présence réflexive de l’analyste dans le présent des séances et s’imbriquent dans les réflexions théoriques qu’ils ont suscitées dans l’après-coup, ce qui donne au texte un rythme continuellement balancé entre le récit des souffrances confiées, et les pensées ou théorisations qu’ils ont induites. Dans toutes les cures, le fil de l’infantile est toujours présent, comme l’amour fou idéal, totalitaire et persécutant. Souvent l’attente n’est plus seulement liée à un objet désiré, mais devient source d’une compulsion de répétition excitante qui se vivra dans le transfert.
Parmi tous ses patients, Chabert va donner une place particulière à Élodie, qui commence et termine le livre. Telle une héroïne de roman, Élodie devient en effet dans le chapitre en deux temps qui lui est consacré, un personnage. L’émotion gagne le lecteur au récit fait de la séance initiant sa cure quand Élodie, ignorant ce qu’elle en attendait, interroge : « Le mouchoir, c’est pour pleurer ? » Magnifique entrée en analyse pour une jeune femme perdue de ne savoir où projeter son « espérance d’enfant perdue ». Nous lisons son histoire analytique comme le récit d’une vie faite de passions et d’illusions, de déceptions répétées et d’attentes renouvelées, le tout se nouant autour d’un transfert d’amour intensément idéalisé avec son analyste qui supporte d’incarner toutes les figures grandioses ou détestables, projetées sur elle. L’analyse, pour Élodie, nous dit Chabert, est une attente qui ne s’identifiera et ne se chargera de son véritable contenu qu’avec l’irruption des affects de détresse et d’abandon, et l’émergence de la figure de l’enfant mort, du fantasme d’infanticide, et seulement quand surgiront les premières larmes, les premiers sanglots. L’enfant qu’Élodie a perdu recoupe l’enfant perdue qu’elle a été. Elle devient dans ce livre la représentante paradigmatique en quelque sorte de l’espérance de tous ceux qui viennent à l’analyse. Nous retrouvons à travers une attente espérante, un thème cher à Chabert : la cure permet que l’enfant perdu soit retrouvé, afin que puisse s’engager un véritable travail de deuil et de séparation.
Avec Eléna, l’affect de détresse n’est pas lié à l’attente, mais à sa fin, celle-ci étant synonyme de fin de l’espoir de retrouver l’objet aimé disparu. L’attente de l’analyse devient alors, paradoxalement, l’espoir d’une attente infinie dans un espace de dédifférenciation autorisé. En mettant l’accent sur la particularité de l’attente d’un entre-deux sans fin, l’auteur fait de la situation analytique un espace-temps qui autorise à sur-investir le champ transitionnel, lequel secondairement révèlera sa fonction de couverture du « entre-eux-deux » de la scène œdipienne. La situation analytique devient « un lieu pour l’attente » (p. 35), l’attente n’étant pour l’auteur qu’une variante de l’entre-deux. Là encore, nous reconnaissons ses affinités avec Winnicott et découvrons l’enrichissement qu’elle apporte à la transitionnalité dans sa fonction économique.
Hanna et Athenaïs sont joliment désignées comme deux « Pénélopes » en attente, dont nous sommes invités à suivre les « deux destins pulsionnels » marqués par les passions œdipiennes enfouies dans un fond mélancolique. Hanna, « Cendrillon sans rêves », était noyée dans ses plaintes masochistes, cherchant un père à séduire, un père tant attendu et tant désiré, mais surtout un père qui la batte comme dans son souvenir hautement érotisé qui en arrière-plan masquait un objet maternel secrètement aimé. Comme pour Athenaïs, « la déception par l’objet fut une expérience traumatisante dans la mise en route du mouvement mélancolique ». Même destin mélancolique et masochiste pour Antonia qui souffre du « rien à attendre ». Au cœur de sa souffrance, l’espoir est totalement absent, car le retournement actif de l’idéalisation passionnée vers une « idéalisation négative » défensive occupe le centre de son univers psychique.
Dans d’autres cas, c’est la dénégation qui protégera de la conscience des affects de perte, ou, comme pour Romain, le déni et la solution bisexuelle d’un non-choix qui permettra de « tromper l’attente » et d’ignorer la perte et la castration.
Et du côté de l’analyste ? À travers ces quelques récits de cure évoqués parmi d’autres que les lecteurs découvriront, où transfert et attente sont associés, pourraient se dégager deux orientations à l’attente de l’analyste : l’attente du meilleur tempo pour interpréter, et l’attente du moment décisif de l’émergence de l’affect. L’on voit bien combien affects et temporalité sont indissociables dans l’économie psychique. La mise en attente de l’afflux de représentations associatives ou intuitives qui surgissent contre-transférentiellement s’impose parfois. À propos de ces représentations d’attente, Chabert écrit : « Elles dérèglent le régime de la force [et] permettent l’approche vers les représentations refoulées … ces productions conscientes si utiles pour l’analyste et pour le patient justement parce qu’elles permettent de freiner, voire d’empêcher la précipitation. Elles provoquent un suspens indispensable dans les émergences directes de l’inconscient tout en établissant des connexions avec elles » (p. 21). C’est leur fonction de régulateur économique, une fonction pare-excitante, qui est ainsi privilégiée avant qu’elles puissent accompagner un mouvement dynamique et un dévoilement de sens.
Quant au deuxième versant de l’attente de l’analyste, Chabert le désigne clairement : son attente de l’écoute du processus transférentiel est peut-être avant tout l’attente de l’affect. Dans tous les cas relatés, son attention aux affects, aux moments où ils parviennent à se tracer une route vers la conscience, est constante. De fait, l’affect, « intermédiaire entre acte et parole », constitue pour elle « le signal d’une représentation non encore advenue ». Affect-signal ou signal d’affect, qui appelle les mots qui les nomment, pour que s’inscrive le temps de l’enfance.
La reconnaissance de l’absence de l’autre, son attente, ou l’acceptation de son non-retour, causes de la souffrance, entraînent un afflux d’affects associés aux souvenirs de l’objet. Pour Chabert, il est nécessaire de suivre « les traces de la mémoire qui recouvrent les traces de l’objet ». C’est sur ce point de croisement entre affects et mémoire que se situe ce très beau chapitre qu’elle consacre à la « mémoire qui nourrit l’attente », « la mémoire, comme promesse du passé », à travers un hommage à François Gantheret et à ses travaux sur « les trois mémoires » : « attendre indéfiniment ce qui n’a pas été ; attendre le retour de ce qui a été ; attendre enfin, toujours, ce qu’on n’a pu recevoir ». Chabert nous engage alors dans une réflexion sur l’attente déçue, un vécu qui traverse toute analyse, « cette voie qui mène de la reconnaissance de la douleur et de la trace de l’objet à la perception de son absence, sans pour autant qu’elle signifie la perte de son amour » (p. 87).
La lecture des Belles espérances nous rappelle combien le travail analytique est parfois héroïque pour trouver « le chemin des souvenirs perdus ». Avec talent, Chabert réussit à nous faire partager son propre cheminement de pensées associatives, personnelles, culturelles, artistiques, toujours entrecoupées de réflexions théoriques, où sont présents, côte à côte, des souvenirs, des traces d’échanges avec des collègues, de travaux anciens, ou de lectures d’auteurs qui l’auront marquée. Analyste en personne et analyste en fonction se lient sans se confondre, ce qui donne une représentation précieuse du travail contre-transférentiel de séance. Mais il faut dire que Chabert a une capacité certaine à faire vivre l’intimité de deux psychismes en travail, à nous transmettre leurs points de rencontre ou de confrontation face à l’altérité, particulièrement dans ces contextes de passion transférentielle. La forme associative entre clinique et théorie, un champ nourrissant l’autre, donne un texte vivant, chargé de subjectivité, qui se permet d’exposer « un mode d’être analyste », avec ses intuitions, ses doutes, ses taches aveugles, son observation subtile de ses propres mouvements en regard de ceux de ses patients, croisements et entrecroisements qui ne perdent pas de vue l’écart et la différence. D’où parfois la fulgurance de l’interprétation énoncée, retenue, ou en attente.
Ajoutons pour finir un mot de la qualité de l’investissement de l’analyse par l’analyste, il est indéniable que Chabert en fait un point fort pour l’aboutissement du travail clinique et de pensée. En dépit des déceptions, de la désidéalisation dans la pratique ou dans la vie institutionnelle, écrit-elle, les liens de l’analyste à l’analyse résistent : « Peut-être que cet attachement est indéfectible, que la passion pour la théorie entretient une sublimation conséquente et que l’attraction pour la pratique se renouvelle régulièrement : le feu ne s’éteint pas, parce qu’il est entretenu par le contre-transfert dans chaque moment déceptif, chaque moment heureux dans l’analyse » (p. 159).
Évelyne Chauvet est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.
Jean-François Chiantaretto, La perte de soi, Paris, Éditions Campagne première, 2020.
 L’auteur fait la synthèse de son parcours de recherche centré sur la présence d’un « témoin interne » dans l’« interlocution interne » par laquelle tout sujet se constituerait en un mouvement qui mène vers l’écriture, ce qu’il a formulé en 1999 à partir du Journal d’Anne Franck, ce monologue intérieur devenu dialogue avec une foule de lecteurs – et la prolonge dans une approche des pathologies limites qui éclaire la problématique de tout être humain confronté à un moment ou à un autre à une défaillance du Nebenmensch primordial. Cette souffrance originelle induirait chez le clinicien un étrange dessaisissement. Jean-François Chiantaretto n’utilise pas le terme d’identification projective, car il préfère, je crois, en rendre le sens profond en utilisant les variétés d’expression de la langue française. Il forge des locutions métaphoriques pour rendre sensible l’autodisparition à lui-même de l’interlocuteur parental primordial, incorporée par l’enfant. Cette hypothèse issue d’une relecture de Freud à partir de Sàndor Ferenczi et de D.W. Winnicott permet de se représenter la situation existentielle où le Je confronté à la disparition de l’Autre trouve en lui-même les ressources de l’écriture de soi, dans une solitude désespérée finalement féconde, que certaines cures analytiques montrent à l’œuvre.
L’auteur fait la synthèse de son parcours de recherche centré sur la présence d’un « témoin interne » dans l’« interlocution interne » par laquelle tout sujet se constituerait en un mouvement qui mène vers l’écriture, ce qu’il a formulé en 1999 à partir du Journal d’Anne Franck, ce monologue intérieur devenu dialogue avec une foule de lecteurs – et la prolonge dans une approche des pathologies limites qui éclaire la problématique de tout être humain confronté à un moment ou à un autre à une défaillance du Nebenmensch primordial. Cette souffrance originelle induirait chez le clinicien un étrange dessaisissement. Jean-François Chiantaretto n’utilise pas le terme d’identification projective, car il préfère, je crois, en rendre le sens profond en utilisant les variétés d’expression de la langue française. Il forge des locutions métaphoriques pour rendre sensible l’autodisparition à lui-même de l’interlocuteur parental primordial, incorporée par l’enfant. Cette hypothèse issue d’une relecture de Freud à partir de Sàndor Ferenczi et de D.W. Winnicott permet de se représenter la situation existentielle où le Je confronté à la disparition de l’Autre trouve en lui-même les ressources de l’écriture de soi, dans une solitude désespérée finalement féconde, que certaines cures analytiques montrent à l’œuvre.
La survivance post-traumatique rend intelligible « l’incorporation par l’infans de la disparition de l’autre primordial à lui-même, dans la voie ouverte par Ferenczi » (p. 14). L’écriture testimoniale de la Shoah de Irme Kertész, référence essentielle pour Chiantaretto, atteste que la perte de soi peut ouvrir un chemin vers une renaissance de soi. Chez Kertész, l’auto-effacement génère une écriture salvatrice, comparable au retranchement dans son intériorité de l’analyste, lorsqu’il est attaqué dans sa pensée par les fonctionnements limites de certains patients. La capacité à être seul en présence de la mère sur le modèle winnicottien dialectise « investir et pas investir le patient » (p. 20), sans risquer de se perdre dans les identifications de celui-ci.
J’ai proposé pour ma part d’énoncer l’interprétation à partir d’un lieu où elle ne sera pas confondue avec la voix des imagos transférentielles archaïques terrifiantes. Chiantaretto le dit à sa façon : « Quelqu’un écoute, en l’analyste et au-delà de l’analyste, quelqu’un écoute tout à la fois le patient et l’analyste » (p. 21), malgré l’insistance des patients à rester « fidèles à eux-mêmes à travers la haine désespérément transférée dans l’autre » pour trouver une confirmation de leur propre culpabilité recouverte par celle qui est imputée à leur interlocuteur. Les nuances de formulation cherchent le mot exact qui se dérobe, l’auteur porte le travail de mélancolie jusqu’à un détachement qui n’est pas renoncement : l’analyste se laisse aller, mais pas trop, à « ses propres dispositions à l’effacement » (p. 28) qui lui permettent de se parler à lui-même pendant la séance, et, grâce à cela, de parler autrement que ne l’attend le patient. La littérature est convoquée, mais il s’agit d’un ouvrage clinique et même technique – au fil d’une discursivité qui progresse en spirale, englobant des théories métapsychologiques, des idées sur le rapport à l’écriture et des propositions techniques sur le maniement de l’interprétation.
Johann Wolfgang Goethe : « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder. » Exégèse : « Dans la mise en place du surmoi, on fait pour ainsi dire l’expérience d’un exemple de la manière dont le présent se transpose en passé » (Freud, 1940a [1938]/2010, p. 305). Chiantaretto commente : lorsque nous transposons notre présent en identification à Freud lui-même s’identifiant à Goethe, nous répétons la difficulté de Freud qui a été privé d’analyste et condamné à une auto-analyse sans fin, envieuse des écrivains capables de montrer le refoulement sans avoir à le lever. Didier Anzieu, dans Beckett et le psychanalyste, met en scène les différents niveaux de transferts et d’interlocutions qui s’enchevêtrent entre lui, l’écrivain et W.R. Bion, l’analyste de Samuel Beckett. Cette architecture charpente une écriture sans prétention littéraire, mais où est représentée l’expérience de se perdre. Freud a revendiqué la place d’unique inventeur de la psychanalyse, se situant en détenteur exclusif du pouvoir de définir qui est psychanalyste et qui ne l’est pas – ce qui est devenu le propre de chaque société de psychanalyse et même de chaque psychanalyste. Chacun d’entre nous cherche, avec ses analystes et superviseurs, ce que Freud trouvait dans l’écriture, ce qui induit une fascination dans notre commentaire infini du texte freudien et corollairement un besoin de le re-problématiser – je ne crois pas déformer la pensée de Chiantaretto – en l’explicitant ainsi.
L’autobiographie constitue un de ses thèmes récurrents de recherche. Il repère dans l’Amour des commencements de Jean-Bertrand Pontalis l’influence de Jean-Paul Sartre : « Ce que je redoute toujours, c’est d’être réduit à un présent qui ne donnerait rien, à un présent muet – muet comme une carte d’identité, comme une pierre tombale. Les mots tuent quand ils nous désignent. » « On croirait lire une phrase de L’Être et le Néant », observe Chiantaretto, qui semble préférer le style d’Anzieu qui restitue la complexité des processus psychiques dans une auto-analyse par création littéraire interposée. Le dédoublement narratif par Anzieu, entre son journal de sa lecture de Beckett et sa reprise autoanalytique redoublant après-coup cette lecture, rend compréhensible la notion d’« altérité interne », souvent utilisée de façon nébuleuse. Chez tout analyste le « décalage entre ses affects contre-transférentiels et son propre transfert » (p. 62) fait que l’« auto-théorisation [est] par nature défaillante, pour nécessaire qu’elle soit » ; pour le dire autrement (l’auteur ne cesse de page en page de redire un peu autrement), « le contre-transfert est creusé par le transfert de l’analyste, dont le cœur est un inanalysé en attente d’analyse » (p. 64), comme Freud était en manque d’analyste à qui adresser son auto-analyse et donc forcément dans l’incapacité de s’accorder à l’attente de Ferenczi. Ce trauma aurait affecté le mouvement psychanalytique tout entier, on le voit dans la fréquente « tentation de se faire l’analyste de son analyste » (p. 65), et aussi, ajouterai-je, dans la propension tout aussi fréquente de modifier Freud tout en prétendant lui être fidèle.
Cette hypothèse assez radicale de l’auteur sur un biais originel dans la psychanalyse mérite qu’on s’y arrête, mais aussi qu’on la nuance. Par exemple, en concevant un espace entre analyse et auto-analyse : l’écriture de soi, l’échange épistolaire entre analystes, la poursuite des processus auto-analysants entre différentes tranches d’analyse, et, prolongeons, la coexistence d’une cure en cours et d’une auto-analyse ultra-subjective, nos paroles aux participants à un séminaire, nos publications destinées à nos collègues, analystes, superviseurs, peut-être nos patients, au fond à nos parents. Ferenczi aurait pris progressivement la mesure de l’impossibilité pour Freud analyste d’accueillir son transfert et donc vécu « une solitude accompagnée par la présence psychique défaillante de l’autre » (p. 80). Mais l’empêchement était aussi du côté de Ferenczi plongé dans une élaboration d’emblée divergente de celle de Freud, lequel perçoit de son côté la nuance entre fin et terminaison : « Si j’ai dit que la cure était finie, je ne pensais pas qu’elle était terminée » (Lettre à Ferenczi du 24 octobre 1916), à quoi Ferenczi avait déjà répondu, lors d’une interruption, qu’il pouvait continuer « en faisant de l’auto-analyse par écrit. Cela a bien marché : je m’imaginais que je vous parlais » (à Freud le 25 octobre 1914). La résilience de l’existence humaine à la défaillance de l’autre introduit à un débat entre les deux hommes : « Vous appelez projection de l’ombre de l’objet sur le Moi narcissique ce que je préfèrerais, moi, appeler introjection » (Ferenczi à Freud le 25 février 1915). Cet échange semble anticiper la notion contemporaine de subjectivation.
Le transfert de Ferenczi est manifeste tandis que le contre-transfert de Freud se tient en retrait. Winnicott avait noté la « tentative de la part d’un analyste de pousser le travail de sa propre analyse plus loin que n’a pu le faire son analyste à lui » (1947, p. 50), lorsqu’il est confronté à des patients qui aspirent à établir avec lui une relation symbiotique. L’analyste est attaqué, son altérité niée, pour que rien ne change et que perdure une douleur d’exister, recouvrant un vide. Cette difficulté, dit Chiantaretto, et je le suivrai sur ce point, est surmontable si l’analyste admet que son expérience intérieure est devenue la cible du patient parce que celui-ci cherche à transporter sa précarité psychique chez son interlocuteur, en particulier sous l’espèce d’une culpabilité, en résulte, ajouterai-je, chez l’analyste le trouble de ne pas savoir si elle est légitime ou la résultante d’une identification projective. Du reste il n’est pas obligé de l’accepter, quoique se décider à l’endosser n’est pas sans procurer le réconfortant sentiment du travail bien fait ! Dans cette conjoncture, l’analyste alarmé intensifie compulsivement ses interprétations pour lutter contre la confusion des espaces psychiques – la notion d’archaïque n’est pas utilisée, je crois délibérément, pour donner à la langue toute sa puissance d’évocation – au risque qu’elles soient alors trop lestées de réactions contre-transférentielles à l’opposé d’une technique paisible et contenante, ancrée dans un psychisme suffisamment bien analysé. « Le contre-transfert ne peut pas être abordé indépendamment de son creusement parce qu’il faut bien nommer le transfert de l’analyste » (p. 103) : la plénitude en excès du contre-transfert recouvre souvent en effet une subjectivité affectée de négativité, mais une discussion pourrait ici s’ouvrir avec Chiantaretto, car le contre-transfert a une part de spécificité propre.
Les patients limites parviennent à contacter leur vrai self par la traversée d’une dépression transférentielle en colère contre « la carence de l’analyste utilisée comme une carence passée » (Winnicott, 1955, p. 189) – l’analyste se sent vulnérable tout en maintenant une attitude professionnelle, là où le patient voudrait prouver une symétrie, légitimer son agressivité et exiger un repentir, ce à quoi l’analyste peut se sentir proche de céder tant il se sent alors insuffisant, jusqu’à ce que survienne un regain de créativité psychique.
L’auteur évoque à plusieurs reprises une patiente qui s’écroule par terre, sanglotant avec des spasmes sans parler. L’analyste sidéré éprouve une lutte entre deux types de scène interprétative, « une détumescence appelant mon regard » et « une scène sans personne ». Il n’était pas possible d’interpréter, mais seulement d’accompagner un récit mal subjectivé « comme si elle ne pouvait vivre qu’en se voyant intraitable » (p. 129) dans un lien thérapeutique qui réduit l’analyste à un autre secourable. Chiantaretto trouve le concept de l’effacement de soi en l’autre qui manqua à Ferenczi parce qu’il dispose de son hypothèse sur la dimension testimoniale de l’écriture.
Kertész pense Auschwitz à partir de la rémanence de sa destructivité dans le psychisme de l’individu contemporain. Le nazisme a poussé à son extrême la haine de la culture émergeant de la culture elle-même. Cela n’est possible, dit Freud, que selon une projection primaire où le moi attribue sa propre violence à l’autre. Kertész est fondé à affirmer que le monde actuel est imprégné par le mal issu d’Auschwitz, on le constate ces temps-ci dans l’essor inquiétant du complotisme par exemple (Richard, 2020). Si Auschwitz reste indescriptible, est-il possible de construire un chez-soi spirituel ? À partir de ce questionnement radical, Chiantaretto suggère de persévérer dans « un mode de survivance consistant à s’auto-investir dans la relation aux autres comme irrémédiablement voué à disparaître des pensées de l’autre » (p. 183) – ce qui à certains égards définit l’éthique du psychanalyste. L’auteur complexifie le propos de Winnicott lorsqu’il souligne qu’aucun être humain n’a d’emblée un contact assez plénier avec son fonctionnement psychique pour exister de façon à la fois suffisamment riche et apaisée. Cette négativité est finalement heureuse parce qu’elle génère une endurance, et bientôt une créativité, c’est du moins ma façon de le comprendre.
Chiantaretto repère l’incidence des formes nouvelles du malaise dans la culture dans les cures : une « compulsion à tout dire, où il s’agirait en somme d’épuiser le transfert » (p. 211) induit en retour chez l’analyste une suractivité interprétative tandis que « le patient n’en finit pas de s’investir comme sujet incestué et supposé savoir ce qui lui est arrivé ». Nombreuses sont les personnes qui arrivent aujourd’hui en effet chez le psychanalyste avec une théorie traumatique d’eux-mêmes. Des exemples cliniques donnent à penser que pour l’auteur la voie à suivre est celle du respect de cette protestation initiale. En acceptant le patient comme il est, l’analyste peut se donner les moyens de ramener son cauchemar vers le travail du rêve.
Références bibliographiques
- Anzieu D. (1992). Beckett et le psychanalyste. Paris, Mentha.
- Chiantaretto J.-F. (2020). La perte de soi. Paris, Campagne première.
- Freud S. (1992). Correspondance avec S. Ferenczi II. Paris, Calmann-Lévy.
- Freud S., (1996). Correspondance avec S. Ferenczi III. Paris, Calmann-Lévy.
- Freud S. (1940a [1938]/2010). Abrégé de psychanalyse. OCF.P, XX : 225-305. Paris, Puf.
- Kertész I. (1993/2009). L’Holocauste comme culture. Arles, Actes Sud.
- Pontalis J.-B. (1986). L’Amour des commencements. Paris, Gallimard.
- Richard F. (2020). Les logiques du complotisme, site internet de la Société psychanalytique de Paris.
- Winnicott D.W. (1947/1969). La haine dans le contre-transfert. De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris, Payot.
- Winnicott D.W. (1955/1969). Les formes cliniques du transfert. De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris, Payot.
François Richard est membre titulaire formateur de la SPP.
Gérard Szwec, Au bout du rouleau. Récits cliniques, Paris, Puf, 2021
 Ce travail récent de Gérard Szwec illustre de façon féconde et émouvante la cohérence et la fermeté de son engagement psychanalytique en psychosomatique, en face de cas graves.
Ce travail récent de Gérard Szwec illustre de façon féconde et émouvante la cohérence et la fermeté de son engagement psychanalytique en psychosomatique, en face de cas graves.
Sa connaissance approfondie des notions élaborées par la génération précédente des psychosomaticiens de l’École de Paris, jointe à la clarté de sa référence freudienne, le classe parmi eux comme un artisan de la réflexion sur l’articulation des deux topiques freudiennes, capable d’éclairer, non seulement la difficulté des traitements de ces patients, mais aussi les difficultés de bien des cures d’aujourd’hui. Comme dans sa belle préface Catherine Chabert le rappelle, les patients psychosomatiques n’ont pas le monopole de « l’usure du fantasme », du refus de la passivité, de la rétention des affects ; les élaborations de Szwec sur le rôle de la négation dans la construction de la pensée, celui de l’auto-sadisme dans les procédés auto-calmants, ou de la fonction pare-excitante de la pulsion de mort, nous intéressent ici particulièrement : on sent qu’elles naissent à partir de l’expérience clinique du transfert et du contre-transfert de l’analyste.
« Sex machine »
Après avoir rappelé ce qui distingue le corporel du somatique, Szwec, à propos d’une sorte de « galérien » de l’éjaculation, étudie finement son fonctionnement mental avant que chez cet éjaculateur précoce de toujours la survenue d’un cancer d’un testicule l’amène à interrompre le traitement sans plus d’information de sa part. Son langage et ses relations avec son entourage peu avant la découverte du cancer amènent chez ce patient, au préconscient très fragile, à faire l’hypothèse de la réduction de ses capacités d’expression inconscientes à l’action et à l’actualité, sans autres capacités de liaisons des représentations. Et Szwec propose ici une théorie de la somatisation cancéreuse chez ce patient : « Privé de possibilités régressives psychiques, un système défensif déjà précaire s’est trouvé brutalement désorganisé. Ce système reposait sur une éjaculation précoce s’apparentant à une névrose d’échec et un comportement masturbatoire révélateur d’une dictature de la quantité » (p. 40). Sans estime suffisante de lui-même dans sa relation avec sa femme, blessé par l’atteinte narcissique que lui inflige le coït, ce patient pratique une masturbation qui n’est plus qu’« un moyen de rendre inerte sa pensée ». Ce système s’est effondré lorsque s’est présentée l’idée d’un certain rapprochement entre sa femme et son patron, le confrontant à l’expression traumatique de ses tendances passives.
Une des conséquences de ce fonctionnement opératoire est ainsi un désengagement de la relation objectale où la poussée dynamique pulsionnelle est remplacée au-delà du principe de plaisir par la poussée vers la déliaison de la pulsion de mort.
Telle est ici trop sommairement résumée la rigueur et la précision de la clinique de l’auteur, rendant, je crois, compte au mieux des avancées de la psychosomatique psychanalytique d’aujourd’hui.
Suivent ensuite des « réflexions sur l’épuisement activement recherché » qui prolongent les travaux de Szwec sur « Les galériens volontaires » (Szwec, 2014). Que signifie la méconnaissance du signal de fatigue, quelquefois observable dès le début de la vie ? Par exemple, chez les bébés insomniaques, le sommeil du bébé repu et satisfait (Michel Fain) n’est pas le même que celui de celui qui s’endort après avoir épuisé sa tension intérieure par ses hurlements. Le rêve ne peut devenir le gardien du sommeil que dans des conditions d’acceptation de régression jusqu’à l’instauration du narcissisme originaire autosuffisant, avant la constitution d’un objet maternel distinct de soi, écrit Szwec. L’accès au repos suppose une capacité à reproduire mentalement les expériences de satisfaction vécues au contact de la mère. Chez l’enfant insatisfait, le rêve échoue à lier la catastrophe de l’insatisfaction, il aboutit au cauchemar qui réveille et à la peur de sa reproduction. L’épuisement devient le seul moyen d’abaisser les tensions d’excitation, des conduites répétitives motrices que l’auteur décrit dans de courtes vignettes cliniques, chez des adultes incapables de se reposer.
« La peau sur les os »
L’observation dramatique d’une anorexie de la toute première enfance, avec un risque vital, met en valeur le cadre maintenu par Szwec, durant un traitement complexe, entre onze mois et trois ans et trois mois.
« Nina est une belle petite fille éveillée et souriante, mais la sonde gastrique qui sort par une narine rappelle que ce n’est que grâce à cette prothèse qu’elle peut donner cette apparence au lieu de celle, difficile à supporter, d’un bébé qui se laisse mourir de faim » (p. 54).
Née après douze fausses couches et un garçon, hospitalisé lui aussi précocement pour une anorexie, cette fillette née avec un poids de naissance normal refuse d’emblée la tétée, n’accepte que très peu le biberon et perd du poids. Vont se succéder, fibroscopie, biopsie duodénale, sonde gastrique, puis alternances multiples de cathéter central, et de gavage en fonction de complications nombreuses. À six mois, elle est ensuite suivie avec sa mère en hospitalisation à domicile avant que les pédiatres, devant l’inconnu du diagnostic et la dimension oppositionnelle de l’anorexie, ne comptent, pour lever le symptôme, sur la séparation d’avec une mère qui lui propose tout le temps de manger. Ces moyens se succèdent sans effet sur la courbe de poids avec des complications multiples amenant une équipe pédiatrique peu encline à penser à une anorexie mentale à demander une consultation à onze mois.
Szwec retient en particulier son absence d’angoisse vis-à-vis de lui et une ébauche de jeu. Il apprend, thème qui se révèlera important dans la famille de la mère, que cette dernière a perdu sa mère trois ans auparavant d’un cancer au terme d’une cachexie, cette grand-mère autrefois obèse est valorisée pour ce fait.
Décrite comme déprimée à l’hôpital, Nina se montre animée et joueuse, durant les séances, avec son père en particulier quand il est là. Sa mère ne peut faire autrement que de ne parler que de ses difficultés et de ses échecs pour nourrir sa fille. Les séances sont l’occasion d’une plainte interminable à propos de maladies infantiles dont le risque pour elle est toujours l’amaigrissement.
Pendant quelques semaines, Nina grignote de son propre chef un quignon de pain et plus tard s’endort en fin de séance dans les bras de sa mère, rompant cette fois avec son insomnie et sa stratégie pour se passer d’elle.
Le caractère phobique de l’anorexie s’affirme, Nina tente d’éviter les situations où sa mère persiste à la gaver à la maison. Celle-ci fait l’aveu que, sans l’hôpital, elle ne pourra pas s’empêcher de faire du forcing alimentaire, elle craint de faire du mal à sa fille.
Dès la sortie de l’hôpital, à quatorze mois, l’anorexie amène à une ré-hospitalisation dans un état très grave, la mère et les somaticiens demeurent animés par les mêmes stratégies, le refus évident de nourriture est minimisé. Le même chaos se poursuit, compliqué par une septicémie, une dépression sévère, de quinze à dix-sept mois où commence une amélioration mise en relation par Szwec avec une lente mobilisation des fonctions maternelles. Il parvient à aborder avec elle, à travers l’angoisse d’abandon de sa fille, sa propre angoisse d’abandon par sa propre mère. Nina améliore la maîtrise de cette angoisse sur un mode actif et ceci fait surgir un secret de famille. Tandis que des identifications bisexuelles précoces se manifestent chez Nina, se lève chez sa mère le souvenir des préférences de ses parents pour leur fils, et la blessure qu’il occasionne. Les menaces d’abandonner Nina à l’hôpital, proférées par les parents, cessent lorsque l’analyste, sans toucher à leur sadisme assez inouï, leur montre qu’ils tentent d’éviter leur perception de cette angoisse chez leur petite fille.
Lorsqu’elle sort de l’hôpital à vingt-deux mois, Nina dit « toute seule », elle marche, et reste cependant très maigre et anorexique un long moment, ce qu’elle met en scène dans ses jeux avec Szwec.
Les conduites de forcing de la mère se déplacent un peu, sur la tétine dans la bouche par exemple. Cette répétition dénote chez elle un état traumatique persistant en fait depuis la période des fausses couches itératives.
Nina ne commencera à manger avec profit qu’à partir de trois ans.
Sa mère consulte toujours beaucoup de médecins, mais c’est maintenant pour elle-même, ce n’est qu’à ce prix qu’elle peut relâcher sa pression alimentaire sur Nina.
Suivent des commentaires passionnants où Szwec utilise non seulement son expérience de psychosomaticien et d’analyste, en particulier avec les enfants, montrant comme il sait concilier neutralité et lucidité. Pour lui, l’anorexie perturbe l’élaboration de la distinction du familier et de l’étranger et le clivage kleinien de l’objet. La conduite déviante se substitue au refoulement et s’oppose à la constitution des représentations concernant la mère. La dépression précoce est sans doute le révélateur du débordement des capacités de mentalisation. Sans considérer cette situation comme un syndrome de Münchausen, Szwec l’en rapproche du fait de la maltraitance.
« Percer un trou plutôt que le contempler… »
En utilisant une série de vignettes cliniques, Szwec décrit ici des chemins qui conduisent les patients, à partir de quelques actings à tonalité sado-masochiques, à des fantasmes sadiques.
Les rêves typiques, en particulier d’examen, suggèrent, au cours de la cure, la crainte de ne pas se conformer au protocole, de laisser voir une faille capable de déclencher le sadisme, renvoyant à une scène primitive sadique, à la castration, contre laquelle la levée d’un mouvement sadique constitue une défense « anti-hystérique » assez courante. Une régression sadique anale peut aussi mener à la scène primitive, ainsi dans le contexte d’une relation d’emprise réciproque à tonalité sadique avec sa mère, la patiente Beyoncé voit le retard à ses séances disparaître lorsqu’elle peut rêver les aspects sadiques anaux de la scène primitive.
Ou bien, il existe une difficulté à relier sadisme et scène primitive. Théo s’enferme ainsi dans le silence et se mure dans les séances, comme dans la vie en cas de conflit, ainsi enfermé comme dans les toilettes contre les intrusions maternelles qu’il redoute et désire. Puis, il maintient une dimension narcissique phallique importante.
Szwec s’intéresse ici aux incidents de séance apparemment anodins ayant une composante sadique discrète. Il montre l’intérêt du repérage dans ces situations de la répétition des conflits infantiles, signant la possibilité de manque de moyens psychiques lorsque l’on a affaire, plus qu’à une névrose de transfert organisée, à de simples réactions transférentielles.
De façon plus générale, l’apparition de fantasmes témoigne d’un progrès de la mentalisation et l’auteur rappelle ici une des observations de son livre consacré aux galériens volontaires (Le cas Rocky).
« Rêve et trauma : l’œil du dragon »
Il s’agit ici d’explorer, chez un enfant gravement malade, ce qu’on peut saisir de l’articulation du travail nocturne du rêve avec celui diurne du jeu, du dessin, du langage.
Le premier rêve raconté de cet enfant de six ans, après six mois de traitement, est un cauchemar. Rêves et associations ressemblent à la production onirique d’un adulte. Il dessine et met tout en histoires sur le mode de contes que l’analyste écrit sous sa dictée (alors que son père fabrique des jouets, et joue avec eux des spectacles pour les enfants).
Après la perte et l’énucléation d’un œil, une tentative de maîtrise du trauma, par la répétition à travers des déplacements divers, échoue d’abord avant l’élaboration au bout de plusieurs mois des théories infantiles qui mettront plusieurs années à atténuer un peu la dimension traumatique. Longtemps les tentatives d’interprétation se révèlent prématurées et le travail du rêve se révèle impuissant. Dimitri fait parfois suivre son récit d’un dessin ou d’un jeu avec les figurines, comme pour compléter sur un autre mode la régression formelle du mot à l’image, mais celle-ci fait rarement appel à une symbolique personnelle capable de donner naissance à un processus associatif. Szwec se montre toujours attentif à voir, au-delà des aspects manifestes, les raisons latentes des particularités dynamiques et économiques sous-jacentes du fonctionnement mental, de première importance dans la tactique et la stratégie du traitement. La suite du récit étudie ainsi finement les relations de l’activité onirique et du trauma, tout au long de la garde partagée et de l’installation de la mère dans un couple plus stable, source d’excitation nouvelle et d’une défense maniaque transitoire.
Les animaux sont utilisés pour passer du trauma au sadomasochisme, dans un effort de liaison de la pulsion de mort, mais les récits interminables se prolongent en des sortes de contes inventés au fur à mesure de l’élaboration secondaire, retardant, sans la supprimer, une fin à nouveau infiltrée par le traumatisme.
Ce travail débouche sur un jeu de retrouvailles des « plus anciens souvenirs », l’élaboration de l’enfant débouche sur le fantasme d’une scène de séduction par un adulte, animée par le transfert. La nouvelle grossesse de la mère joue son rôle, commentée avec la même qualité par Szwec. Les notations conclusives montrent que l’absence de rêves n’est donc pas une caractéristique obligée d’une mauvaise mentalisation, mais que chez Dimitri la plupart d’entre eux sont des cauchemars.
L’utilisation excessive du récit peut être liée à une difficulté dans la régression formelle, mais aussi être une formation défensive donnant satisfaction à l’entourage.
« Une enfant chauve au seuil de l’adolescence »
La pelade décalvante de Mélanie qui lui a fait partager surtout sa peine, quelquefois sa joie et aussi sa colère, nous est racontée par Szwec de façon émouvante.
Précédée de plusieurs épisodes moins intenses à l’occasion de la mort d’un oncle peu connu de l’enfant, cette pelade totale à 12 ans a suivi la mort d’un grand-père. L’invocation classique d’un choc traumatique comme cause de la pelade n’est intéressante que si le contexte est pris en compte : si difficultés de deuil il y avait, c’était plus tôt chez la mère de Mélanie, très éprouvée à l’occasion de la mort de cet oncle, période durant laquelle l’enfant a fait l’expérience d’un certain abandon psychique. Szwec pense à ce sujet que les capacités identificatoires très profondes de Mélanie avec sa mère ne sont pas sans rappeler un système de type allergique. Elle semble avoir fonctionné, sans passer par les organisateurs classiques, dont l’angoisse de l’étranger, jusqu’à ce décès à l’âge de 4 ans et demi.
La clinique très fine de Szwec lui permet de repérer chez elle, qui ne manifeste aucun signe de sortie de la latence, un nombre important d’épisodes ayant eu une valeur traumatique. Il ressent dans le transfert le caractère peu rassurant de l’entourage familial et remarque la répression quasi consciente chez elle de l’hostilité envers les sources d’excitation.
Lorsqu’elle accède à la jalousie, elle organise des conflits avec sa mère et des manifestations phobiques, ses vœux inconscients de mort sont aménagés cette fois par un refoulement. La névrose de transfert paraît pleinement installée et les conflits deviennent reliables à une problématique œdipienne douloureuse. Elle rêve ainsi d’une scène de séduction où elle a ses cheveux, scène considérée ici comme donnant un sens à la pelade, alors incluse dans une chaîne de représentations, capable de lier le traumatisme de sa survenue.
Nous abandonnerons ici, pour des raisons de place, ce récit d’une évolution favorable, poursuivie par Szwec « avec des hauts et des bas » jusqu’à l’adolescence, pour citer seulement quelques-unes de ses remarques conclusives : le caractère traumatique de la survenue de la pelade elle-même peut durablement masquer le traumatisme initial, réalisant une sorte de cercle traumatique.
La rareté de la pelade dans la littérature sur la névrose traumatique est frappante. Constituerait-elle une sorte de protection contre ce désordre somatique ? Ce que Freud pourrait laisser entendre lorsqu’il note le peu de compatibilité entre elle et l’existence d’une lésion, d’une blessure.
« Absence de négation, rage destructrice et déséquilibres psychosomatiques »
Ce chapitre porte sur la difficulté à s’opposer à l’autre, à pouvoir dire « non » chez des patients qui ont tendance à somatiser. Après avoir rappelé le travail de Freud, Szwec va évoquer l’exemple d’un garçon de 19 mois dont les comportements de refus parfois accompagnés d’un spasme de sanglot inquiètent beaucoup ses parents d’autant que s’y ajoutent, une certaine anorexie, des troubles du sommeil et une hyperactivité importante. Déménageur infatigable, à la consultation il ne supporte aucune restriction à son activité, les « non » de ses parents déclenchant finalement une crise de rage. Cette expression violente par le corps s’observe chez des enfants qui n’ont pas les moyens psychiques d’utiliser la négation. Or ce rouage essentiel du fonctionnement mental a un rôle protecteur pour le soma.
Le spasme du sanglot en est un exemple, la défaillance du refoulement, préalable nécessaire à la négation, est sans doute en jeu et conduit l’enfant à se précipiter dans l’inconscience.
L’anorexie précoce du bébé, souvent rapportée à des évènements nutritionnels, est une manifestation d’opposition bien en deçà de la négation, sans angoisse de l’étranger, et ce déplacement du conflit sur l’aliment n’est pas favorable à la mentalisation. Le patient choisi fait partie des bébés « non câlins », il veille à se dégager de sa mère lorsqu’elle le prend dans les bras et refuse toute relation passive avec elle. Son agitation est auto-calmante, ni érotique, ni dirigée vers quelqu’un, elle cherche à supprimer toute pensée sur la relation.
Et pour terminer, Szwec compare ces cas, qui évoquent un refus par le corps, aux situations de déplaisir du fait de la carence du refoulement. Ces enfants utilisent plutôt la répression que « la névrose de l’enfant sage » où le refoulement se trouve renforcé par la répression et va dans le sens d’une disposition aux traits de caractère, à l’inhibition et aux troubles somatiques.
Ce travail métapsychologique approfondi et original se termine par une vue longitudinale de l’évolution des idées qui ont conduit les psychosomaticiens de l’École de Paris à leurs positions actuelles : « La psychosomatique, quelques débats après ». Il est de la même qualité que le reste du livre et a l’avantage d’être écrit par quelqu’un qui a fréquenté personnellement les fondateurs et travaillé avec plusieurs d’entre eux.
Après avoir exposé le modèle que Pierre Marty avait proposé dans ses premiers livres personnels, et qui reste un long moment au centre des débats de ce groupe de psychosomaticiens, Szwec se fait l’écho des auteurs américains. Tous ces travaux se situent dans une logique d’étiquetage tel que l’établit la nosographie médicale, comme d’ailleurs ceux qui suivront en France après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années cinquante.
C’est peu après cette période que Szwec décrit le « virage de l’École de Paris » qui a marqué ces dernières décennies la psychanalyse française. Il s’agit d’une rupture avec « la médecine Psychosomatique, et avec les tentatives d’interpréter la maladie ou le symptôme en lui trouvant un sens inconscient » (p. 189).
La découverte d’une altération, d’une défaillance ou d’une altération des processus mentaux inconscients chez les malades somatiques ne pouvait qu’éloigner les possibilités d’établir une psychosomatique commune aux psychanalystes et aux médecins. Szwec s’en explique, avant d’examiner de façon approfondie les points de vue de Marty, qui ont longtemps constitué le socle de la psychosomatique, en les confrontant à ceux de Michel Fain et Denise Braunschweig. Une certaine diversité de points de vue a longtemps coexisté en psychosomatique à propos, en particulier de la fonction maternelle, de la pulsion de mort et de la façon de se référer aux deux topiques freudiennes, avec Michel de M’Uzan, Christian David et Catherine Parat, auquel s’est joint un moment plus tard André Green dans son intérêt pour les cas limites. Il semble que la cohérence et l’étendue de l’œuvre de Fain, dans son articulation avec la métapsychologie freudienne, soit actuellement la référence principale au cours d’un débat qui se poursuit aujourd’hui avec la contribution appréciée de ce beau livre de Gérard Szwec.
Références bibliographiques
Szwec G. (2014). Les galériens volontaires. Paris, Puf.
Gérard Lucas est pychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.
Quatre recensions de livres parues dans la « Revue des livres » du numéro « Traduire ». Bonnes (re)lectures!
Jacques Press, L’expérience de l’informe, par Laurent Danon-Boileau.
Jean-Claude Rolland, Langue et psyché. Instantanés métapsychologiques, par Irina Adomnicai.
Jacqueline Schaeffer (dir.), Qu’est la sexualité devenue, par Roland Havas.
Elsa Schmid-Kitsikis, Émoi sensoriel, plaisir sensuel. Le monde secret de l’éprouvé, par Françoise Seulin.
Jacques Press, L’expérience de l’informe, par Laurent Danon-Boileau
 Comment accueillir ce qui ressortit à l’expérience de l’informe, telle qu’on peut la vivre dans la cure, notamment la cure des patients qui relèvent de l’abord psychosomatique ? Comment faire avec ce qui n’a pu être transformé par le sujet et qui exige défensivement la répétition à l’identique au fil des semaines et des années dans une recherche désespérée de liaison ? Comment faire quand la maladie somatique est là comme conséquence (c’est la position des psychosomaticiens de l’École de Paris) ou comme substitut (c’est la position de Press) de l’effondrement psychique ?
Comment accueillir ce qui ressortit à l’expérience de l’informe, telle qu’on peut la vivre dans la cure, notamment la cure des patients qui relèvent de l’abord psychosomatique ? Comment faire avec ce qui n’a pu être transformé par le sujet et qui exige défensivement la répétition à l’identique au fil des semaines et des années dans une recherche désespérée de liaison ? Comment faire quand la maladie somatique est là comme conséquence (c’est la position des psychosomaticiens de l’École de Paris) ou comme substitut (c’est la position de Press) de l’effondrement psychique ?
Le souci de Press est de montrer que ce qui est demeuré informe et non transformé exige pour être finalement travaillé une contenance vivante de l’objet de transfert incarné par l’analyste. Vivante c’est-à-dire dépourvue de rétorsion, mais aussi d’a priori et de prêt à penser défensif. La démarche de Press, qui s’appuie sur la longue expérience de psychanalyste psychosomaticien, provoque la réflexion du lecteur. En effet, après avoir reconnu sa dette à l’égard de ceux qui l’ont formé (les membres fondateurs de l’École de psychosomatique de Paris, Marty, Fain, David et de M’Uzan, mais aussi Green et Pontalis, pour ne citer que des contemporains), et après avoir synthétisé de manière remarquablement claire l’apport conceptuel qu’il doit à chacun, comme les liens qu’il peut établir entre des théorisations d’apparence divergente, l’auteur s’en prend aux dérives dogmatiques auxquelles peut donner lieu toute théorisation, quelle qu’en soit la pertinence. Car pour lui si le travail de cure peut amener le sujet à donner forme à l’informe, à transformer ce qu’il n’est pas parvenu à métaboliser au fil de son histoire psychique, s’il doit finalement réintégrer ce que Freud désignait du terme de ‟fuerosˮ, c’est que l’analyste accepte de ne pas savoir et de se confronter à l’inconnu qui surgit – sachant faire preuve alors d’ une authentique ‟capacité négativeˮ, vertu où John Keats lisait la source essentielle de toute créativité, notamment celle de Shakespeare. Il s’agit en effet de ne pas tenter de se déprendre de la terreur que l’informe suscite en faisant recours à une théorisation trop claire reposant souvent sur une vision carentielle de la psyché de l’analysant. Pour Press ce n’est qu’au prix d’un dessaisissement de ses certitudes que l’analyste peut faire advenir l’informe dans le transfert, seul lieu où il trouvera à se transformer et à devenir enfin source de créativité. De fait, si l’objet primaire défaillant n’a pas permis au sujet d’élaborer ce qui en lui est dès lors resté informe, c’est précisément que cet informe ne rentrait pas dans le formatage étroit que cet objet primaire exigeait du sujet. La tragédie du faux-self n’est pas autre chose.
L’essentiel des exemples cliniques de Press est centré autour d’un mode particulier de tyrannie de l’informe que l’on pourrait nommer le mode ‟blancˮ. Chez les patients qui en sont affectés, les manifestations sont peu bruyantes, mais elles contraignent le sujet à une répétitivité sans écart, à un refus de tout éprouvé comme de tout mouvement associatif. Ici, on aura évidemment reconnu les caractéristiques de la pensée opératoire. Mais s’écartant cette fois de Marty, Press ne parlera pas de carence du préconscient. Il postule au contraire chez le patient l’existence d’un mouvement de défense par inhibition du préconscient. De cette défense, le sujet ne parviendra à se défaire que s’il fait confiance à un analyste vivant, c’est-à-dire un analyste qui ne redoute pas l’advenue de l’informe et ses effets de stupeur. Tant que le travail d’analyse est pensé comme un soin consistant à dispenser au patient ce qui lui manque et dont l’analyste dispose, aucune transformation ne peut advenir. Le patient ne peut que demeurer sous l’emprise d’une compulsion de répétition par laquelle il cherche désespérément à lier ce qui ressortit à la menace de l’informe. Désespérément, car cet échec lui est également nécessaire. En effet, si ce qui vient de l’informe finissait par se lier, le sujet serait alors violemment projeté dans un univers pulsionnel sans concession. Il deviendrait immédiatement le siège d’une conflictualité intolérable. Dans les bons cas, malgré tout, c’est précisément cette liaison qui finit par se faire dans l’espace de la cure quand la fiabilité de l’objet a pu être suffisamment expérimentée par le patient. Pour Press, surgissent alors des mouvements violents, mais nécessaires à la transformation de l’informe qui s’ensuit.
Cette analyse particulièrement honnête de la défense contre-transférentielle par le trop théoriser est décisive. Cette défense est une menace à laquelle nous devons tous faire face en cas d’inquiétude forte dès lors qu’un patient se montre trop répétitif, trop peu affecté ou trop peu associatif.
Il me semble toutefois que la position d’ensemble de Press repose sur un postulat auquel je ne suis pas sûr d’adhérer. Il consiste à penser que si la psyché d’un sujet souffre de la pression de l’informe, tout est à penser chez lui dans cette perspective. Plus optimiste, j’incline à penser que même chez des patients cloués au sol par le poids de l’informe et du traumatique, il y a toujours un secteur minimalement accessible au jeu et au plaisir du fonctionnement mental – bref, un secteur qui permet la mise en circulation de petites quantités de libido dans un jeu partageable. C’est en cela que la pratique de l’art de la conversation est décisive, et les psychosomaticiens de l’École de Paris y insistent. À l’inverse toutefois, je ne suis pas certain que la cure analytique puisse toujours permettre chez un patient la réélaboration ou la transformation de matériaux jusque-là demeurés informes. Il me semble surtout qu’elle lui permet d’investir autrement les différents modes processuels dont il dispose. Pour le dire vite, si je pense qu’il existe chez certains patients un secteur aconflictuel tragiquement placé sous la dépendance tyrannique de l’informe (c’est celui qui intéresse Press dans cet ouvrage) je pense aussi qu’il y a chez tout sujet un secteur, si fragile soit-il, où une certaine conflictualité demeure. S’il n’existait pas – ou si le patient n’avait pas l’intuition qu’il existe en lui – pourquoi viendrait-il nous trouver ? Pour qu’un patient puisse investir ce second secteur, il faut qu’il puisse faire dans la cure l’expérience d’une conflictualité non dévastatrice, d’une pulsionnalité par petites quantités, dans le jeu partagé que constitue l’art de la conversation notamment, associé peut-être à un certain humour et à un certain « plaisir du fonctionnement mental ». Le patient peut alors faire l’expérience d’une mise en jeu de la pulsion qui ne soit pas un naufrage. Il se pourrait d’ailleurs que ce soit en prenant appui sur cette expérience heureuse que la douloureuse transformation de l’informe devienne envisageable dans le registre du traumatique.
Comme on le voit, la lecture de ce livre juste et profond stimule la réflexion et provoque la controverse intérieure. Avec Press, assurément, mais aussi avec soi-même. Ainsi, je me suis demandé si ma conviction que tout patient conserve un secteur soumis au principe de plaisir n’était pas liée à la terreur que m’inspirerait l’informe et que je ne m’avouerais pas. De fait, lorsqu’un patient se cogne répétitivement aux murailles qu’il a érigées contre l’informe en lui, la séduction bien tempérée de la conversation et du « plaisir du fonctionnement mental » semble longtemps de peu de secours. Et pourtant je me souviens d’avoir joué avec des enfants autistes chez qui l’informe occupait une place considérable. Et un jeu partagé de fort-da, contrairement à un jeu de fort-da solitaire, n’est pas simplement l’effet d’une compulsion de répétition.
Laurent Danon-Boileau est psychanalyste, membre titulaire formateur à la SPP, professeur honoraire en linguistique à Paris-Descartes.
Jean-Claude Rolland, Langue et psyché. Instantanés métapsychologiques, par Irina Adomnicai
 Dans un livre dense et inédit, traversé par la passion de penser la chose inconsciente, Jean-Claude Rolland revisite l’œuvre freudienne pour interroger de façon novatrice les questions concernant le fonctionnement de l’inconscient et la spécificité du processus analytique. À quel destin la cure analytique contraint-elle la parole de l’analysant, lorsque, détournée de sa fonction référentielle par le transfert, elle conduit le couple analytique sur des terres psychiques inconnues ? Par quelles voies l’activité de parole, telle qu’elle s’exerce dans l’intimité de la séance, devient-elle susceptible d’amener l’analysant vers cette « guérison psychanalytique », à la fois crainte et désirée ? Une hypothèse métapsychologique audacieuse est avancée d’emblée : la langue reçue par l’individu de sa communauté, associée aux images mentales qu’il produit lui-même, ordonnerait l’esprit en différentes strates. La plus primitive d’entre elles, qualifiée de « troisième langue », est supposée constituer la substance même de Psyché. Aussitôt ce postulat formulé, une question ne manque de se poser : quelle place occupent dans le fonctionnement psychique ces ingrédients que sont, d’une part l’image et la sensorialité en général, de l’autre la langue et la parole qu’elle permet ? Pour y répondre, Rolland n’établit pas de hiérarchie entre langage et image, mais s’emploie surtout à montrer ce qui les lie, tout autant que ce qui les délie. Dynamique au sein de laquelle les activités imageantes et verbales de l’esprit vont relayer la première répétition transférentielle, invisible et muette, d’un passé aboli. Elles en assurent la reprise sur deux scènes : la scène du visuel où la consistance et la sensualité de l’image s’offre à l’accomplissement de désir ; la scène de la parole dont le pouvoir d’abstraction, de négation et de jugement autorise le renoncement. À travers de nombreux exemples cliniques l’auteur démontre comment le passage de la « représentation de chose », pour lui l’image, à la « représentation de mot », assure à la cure psychanalytique son efficacité, son pouvoir de transformation. L’apport du langage y apparaît essentiel. Car cet échange à huis clos, qui a lieu entre analyste et analysant grâce aux mots prononcés, comme d’ailleurs au silence, arrive à exprimer, à l’insu des protagonistes, de l’inconnu. Une langue muette ou que l’on croyait morte prend vie, à travers l’infans qui parle. C’est le moment de vérité où l’ordre du discours se met à vaciller et à perdre de son pouvoir. Suffisamment en tout cas pour que la « parole associative » n’obéisse plus au processus secondaire et « ouvre la mémoire au-delà des souvenirs ».
Dans un livre dense et inédit, traversé par la passion de penser la chose inconsciente, Jean-Claude Rolland revisite l’œuvre freudienne pour interroger de façon novatrice les questions concernant le fonctionnement de l’inconscient et la spécificité du processus analytique. À quel destin la cure analytique contraint-elle la parole de l’analysant, lorsque, détournée de sa fonction référentielle par le transfert, elle conduit le couple analytique sur des terres psychiques inconnues ? Par quelles voies l’activité de parole, telle qu’elle s’exerce dans l’intimité de la séance, devient-elle susceptible d’amener l’analysant vers cette « guérison psychanalytique », à la fois crainte et désirée ? Une hypothèse métapsychologique audacieuse est avancée d’emblée : la langue reçue par l’individu de sa communauté, associée aux images mentales qu’il produit lui-même, ordonnerait l’esprit en différentes strates. La plus primitive d’entre elles, qualifiée de « troisième langue », est supposée constituer la substance même de Psyché. Aussitôt ce postulat formulé, une question ne manque de se poser : quelle place occupent dans le fonctionnement psychique ces ingrédients que sont, d’une part l’image et la sensorialité en général, de l’autre la langue et la parole qu’elle permet ? Pour y répondre, Rolland n’établit pas de hiérarchie entre langage et image, mais s’emploie surtout à montrer ce qui les lie, tout autant que ce qui les délie. Dynamique au sein de laquelle les activités imageantes et verbales de l’esprit vont relayer la première répétition transférentielle, invisible et muette, d’un passé aboli. Elles en assurent la reprise sur deux scènes : la scène du visuel où la consistance et la sensualité de l’image s’offre à l’accomplissement de désir ; la scène de la parole dont le pouvoir d’abstraction, de négation et de jugement autorise le renoncement. À travers de nombreux exemples cliniques l’auteur démontre comment le passage de la « représentation de chose », pour lui l’image, à la « représentation de mot », assure à la cure psychanalytique son efficacité, son pouvoir de transformation. L’apport du langage y apparaît essentiel. Car cet échange à huis clos, qui a lieu entre analyste et analysant grâce aux mots prononcés, comme d’ailleurs au silence, arrive à exprimer, à l’insu des protagonistes, de l’inconnu. Une langue muette ou que l’on croyait morte prend vie, à travers l’infans qui parle. C’est le moment de vérité où l’ordre du discours se met à vaciller et à perdre de son pouvoir. Suffisamment en tout cas pour que la « parole associative » n’obéisse plus au processus secondaire et « ouvre la mémoire au-delà des souvenirs ».
L’interprétation analogique, outil théorico-pratique novateur, en soutient l’expérimentation métapsychologique. En proposant un rapprochement, voire une coïncidence entre un fait actuel, d’apparence parfois anodine, et la trace laissée par un événement d’enfance, Rolland arrive grâce à ce type d’interprétation à débusquer aussi bien les figures de l’inconscient que les signifiants du ça. C’est le moment où, nous explique-t-il, l’ordre du discours perd son pouvoir considérable d’organiser les processus de pensée même les plus sophistiqués, et laisse alors se dévoiler un autre pouvoir, celui de la langue érigée en instance. Hommage à Lacan, même si Rolland ne fait pas sienne la formule « l’inconscient est structuré comme un langage » (à noter le comme de l’analogie) et soutient, à l’encontre de ce dernier, que l’inconscient est exclu du système linguistique. Pour reconnaître que c’est le jeu antagoniste des pulsions qui nous commande, avec la sexualité infantile anarchique et souveraine, comme principe dé-régulateur. Retour donc à Freud, pour en renouveler la lecture et proposer de « nouveaux fondements » à la psychanalyse. À L’Interprétation du rêve, où ce dernier soulève la question de la nécessité pour l’analyste de se doter d’une opération de pensée qui lui permette de déchiffrer les couches archaïques du psychisme des patients. Avec « l’interprétation analogique », Rolland répond au vœu freudien, démontrant de façon quasi expérimentale que le pouvoir de guérison de la cure psychanalytique tient à un « effet physique » : le renouvellement incessant des images produit par le travail du rêve ranime la parole issue de la mémoire inconsciente, qui active l’opération de conversion permettant à l’appareil de l’âme de se restructurer. Pour introduire le changement métapsychologique qu’il s’apprête à opérer, Rolland reprend la lettre à Fliess du 6 décembre 1896 et entend re-façonner la notion de « trace mnésique » de sorte que, ravivée par « l’affect primordial », elle institue le langage en support de la mémoire. Une mémoire à laquelle seule l’expérience de la cure sera, dès lors, à même de donner accès. Car cette « autre strate de la mémoire qui est la langue », et c’est là une hypothèse forte de l’auteur, se trouve être aussi le lieu où s’inscrivent les traces mnésiques. C’est ainsi que langue et mémoire ordonnées en plusieurs strates, dynamisées par une « opposition essentielle » entre « la mémoire sensorielle primaire et la mémoire bâtie autour du matériel sémantique », vont alimenter la transmission originaire de la langue par la mère à l’enfant. Trois états de la langue sont relevés par l’auteur, dont il est conseillé aux analystes de cibler l’écoute : la langue narrative (qualifiée de mondaine), la langue mémorielle (dont la fonction cathartique contribue au désenclavement de l’objet interne et à son excrétion dans un substitut du monde réel), la troisième langue située au plus profond de l’appareil de langage, « à l’endroit précis où l’inconscient jouxte le préconscient ». À travers des exemples cliniques édifiants, Rolland décrit le mode de travail de cette troisième langue, qui « ordonne et articule ses signifiants selon leur aptitude à identifier et à déplacer les objets conservés dans l’inconscient ». Sous l’effet du transfert, l’interprétation analogique rend audible cette troisième langue laquelle, du fait de sa proximité physique avec l’inconscient, est saturée de négativité. Seule l’énonciation est dans ce cas à même de réduire la négation opérée par le refoulement, et permettre ainsi la reconnaissance de l’objet porté ou déguisé par le symptôme ou le transfert. Dans un développement aussi passionnant que riche d’enseignements, Rolland rapproche la troisième langue des tropes, ces figures de style qui accueillent et traitent les pensées indésirables. Grâce à ces « opérateurs sémantiques accomplissant une tâche physique », la méthode analytique accède aux niveaux latents de la langue, à son inconscient. Freud concevait la pensée inconsciente dans la plus étroite relation avec l’économie psychique et les besoins de l’éconduction. Rolland démontre que l’économie psychique est directement redevable du jeu des voyelles et des consonnes animant la troisième langue, jeu qui favorise l’écoulement d’une partie de l’énergie de l’âme. « Y aurait-il une activité de parole propre à l’exercice de la psychanalyse ? », se demande-t-il, pour y répondre en affirmant que la « parole inchoative » serait cet outil spécifique pour l’abord du langage archaïque. Parole inchoative qui, du fait qu’elle relève du moi inconscient, crée un lien intermédiaire entre monde intérieur et monde extérieur, et permet ainsi à l’interprétation de s’inscrire également dans une physique de l’inconscient. Car si la langue d’image est capable de contenir de grandes quantités d’énergie, ce qui la rend susceptible de se convertir, entre autres, en symptôme corporel, sa traduction en mots la décompose, lui ôte son énergie, la désexualise. Étape nécessaire à la négociation de l’affect, dans la mesure où le mot n’admet que de « petites quantités ». Sans oublier que déjà, dans les Études sur l’hystérie, Freud faisait remarquer que l’une des voies possibles pour qu’une image disparaisse, c’est que sa matière soit convertie en matière verbale. En approfondissant la position freudienne, Rolland soutient que l’image primaire est une représentation sans écart avec la trace sensorielle qui l’inspire. Et pourrait, en conséquence, être le support d’une mémoire inconsciente à laquelle seul le discours donnerait, indirectement, accès. Au sein de la méthode psychanalytique, formule encore Rolland, l’image et la parole assurent ensemble la « lente » et « besogneuse » émergence des figures œdipiennes abolies. Surtout que pour la pensée analytique, la relation à l’objet œdipien prévaut sur la relation à l’objet réel. Et s’il est vrai que la parole inchoative travaille au traitement de l’affect œdipien, c’est parce que l’activité des moi des deux acteurs étant suspendue, la parole inchoative (dans les associations du patient et dans le discours intérieur de l’analyste) retrouve sa prééminence, et le processus primaire peut accomplir sa tâche de convertir la libido en discours. Rolland insiste sur le fait que le moi et la langue ne disposent pas des mêmes outils, bien qu’ils poursuivent le même but, la défense contre les pulsions. Si le moi dénie ce qu’il rejette, c’est-à-dire l’abolit, la langue, elle, le nie, c’est-à-dire le transforme. Alors, lorsqu’on laisse s’installer une interlocution, dans laquelle les deux moi de l’analyste et de l’analysant se démettent de leur autorité et laissent leurs deux langues interagir, se produit un véritable travail de remémoration et d’ouverture à l’inconscient : c’est à ce moment « qu’un signifiant parle à un autre signifiant » (Lacan), « qu’une douleur parle à une autre douleur » (Rolland). C’est aussi l’occasion pour l’auteur de nous montrer, exemples cliniques personnels ou de supervision à l’appui, que le travail analytique avec des patients psychotiques et limite devient possible, à condition que cette nécessité contre-transférentielle qui exige de l’analyste, au contact de son patient, de tolérer le réveil de sa propre mémoire infantile, soit respectée. En mettant au centre de sa réflexion la conviction que le monde intérieur est fait de cette double matière, la langue reçue et l’image subjective, Rolland se saisit de deux textes freudiens, qu’il interprète pour en faire progresser la portée métapsychologique. D’abord, « Constructions dans l’analyse », où Freud affirme, contrairement à ce qu’il avait soutenu dans « L’Analyse profane », l’analyste et le patient « ne causent pas ensemble », qu’ils se situent chacun sur une scène différente, « l’un se remémorant avec peine son passé et l’autre […] reconstruisant ce même passé ». Rolland relève qu’à ce moment « l’interprétation se confond avec la construction et voit dans ce fait, une avancée de Freud du côté de la prise en compte de la structure invisible du discours », « l’état hybride » de ce discours où psyché et langage mêlent leurs matériaux, étant alors identifiés comme n’obéissant plus aux lois générales de l’échange verbal. Puis, L’Esquisse. Pour en soutenir sa lecture, Rolland part du constat clinique qu’il y a une étroite dépendance des mouvements de parole chez les deux interlocuteurs, l’histoire de l’un se reconfigurant sur les signifiants de l’autre. Opération rendue possible par la topique hétérogène du moi inconscient, qui facilite la transposition de l’image de soi, par réflexion, dans l’image de l’autre. Les appareils psychiques de l’analyste et de l’analysant se transforment alors réciproquement. L’énonciation s’avère être la condition de cette transposition de l’objet depuis l’introjection mélancolique, vers une réelle objectalité. Ainsi, sous le scalpel métapsychologique de Rolland, la notion freudienne d’Hilflosigkeit élargit sa définition, jusqu’à inclure « la compréhension de la relation de parole que les hommes entretiennent entre eux ». Le moi du locuteur, toujours décalé par rapport à l’activité de sa parole, est dépendant de l’écoute de son interlocuteur, seul susceptible de lui restituer ce que la surdité de son moi tend à lui dérober. En pensant au Freud de L’Esquisse, Rolland suggère que le Nebenmensch pourrait être la représentation de l’analyste et propose de voir dans cette « infirmité du sujet parlant […] la forme la plus subtile de la détresse originaire, comme […] dans l’interprétation une sorte d’activité spécifique ». Et s’il y a, comme ce dernier le pense, un inconscient de la langue, qu’elle porterait dans son épaisseur ce qu’elle ignore elle-même, nos représentations, notre pensée, notre langage, nos rêveries, ne nous condamneraient-ils pas à un incessant jeu de fort-da, dont il incomberait alors à l’analyse d’en guérir la mélancolie ? Une certitude pourtant, avec ce livre visionnaire, lecture incontournable de la rentrée, Rolland change notre regard sur la méthode psychanalytique, et en revigore la métapsychologie et la technique.
Irina Adomnicai est psychanalyste, membre formateur de la SPP.
Jacqueline Schaeffer (dir.), Qu’est la sexualité devenue, par Roland Havas
 Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Jacqueline Schaeffer, interroge les évolutions des pratiques sexuelles dans leur articulation avec la sexualité infantile, « celle qui constitue le seul repère spécifique de la psychanalyse » (p. 12).
Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Jacqueline Schaeffer, interroge les évolutions des pratiques sexuelles dans leur articulation avec la sexualité infantile, « celle qui constitue le seul repère spécifique de la psychanalyse » (p. 12).
La première partie, intitulée « Que reste-t-il des scandales soulevés par Freud ? », s’inaugure avec une invitation de Bernard Golse à réfléchir sur l’influence des évolutions sociétales et biotechnologiques sur la sexualité infantile et la sexualité des enfants. L’auteur fera d’emblée la différence entre le sexuel infantile, la sexualité infantile, et la sexualité des enfants. Selon lui, « l’évolution des théories, des sociétés et des biotechnologies ne modifie guère le sexuel infantile en tant que tel », alors qu’elle peut influencer la sexualité infantile et surtout la sexualité des enfants. Abordant la question de la scène primitive au regard de l’adoption et de l’homoparentalité, l’auteur s’interroge sur les possibilités pour l’enfant de se donner à lui-même une représentation de ses origines familiales. Il souligne l’importance du questionnement sur la scène primitive dans l’activité de représentation.
De la sexualité infantile, on passe tout naturellement à sa relecture au moment de la puberté et à son corollaire psychique, l’adolescence. Maurice Corcos nous invite à une traversée de cet âge, où « la sécurité de base et l’estime de soi acquises dans la prime enfance vont massivement être mises à l’épreuve de la pubescence ». L’auteur cite fort à propos Hélène Deutsch, pour qui ce qui se produit à l’adolescence, c’est « un éclatement de l’idéal du moi, sous le choc de la sexualité, de la culpabilité relative à la masturbation, de l’accroissement de la sévérité du surmoi dirigée contre le moi et de la réaction masochique de ce dernier » (p. 30).
À partir de la sexualité infantile, avec son potentiel pervers polymorphe, il est naturel de s’interroger sur les perversions sexuelles et leur devenir actuel. Gérard Bonnet nous propose, pour clore cette première partie du livre, un aperçu de l’évolution de cette notion, qui semble avoir disparu des diverses nosographies, jusqu’à son abandon progressif au profit de conceptions éthiques et comportementales, les perversions dangereuses étant rejetées du côté de la délinquance. Les psychanalystes, suivant la voie tracée par Freud, s’efforcent de maintenir la notion de perversion sexuelle. Pour la psychanalyse, qui rejette les jugements moraux, la perversion sexuelle constitue une entité psychique précise. Elle manifeste, avec l’hystérie, l’assujettissement de l’être humain aux pulsions les plus primaires.
Dépasser les jugements moraux, c’est ce que la psychanalyse s’est efforcée à faire quant à la masturbation. Dans son excellent article consacré à cette question, qui inaugure la deuxième partie du livre, intitulée « Que sont devenus les tabous et interdits du temps de Freud », Philippe Vallon souligne les enjeux fantasmatiques de cette activité autoérotique et sa place dans les travaux de Freud et de Tausk. Jugée responsable, au xixe siècle, de pathologies somatiques telle la tuberculose, la masturbation n’en sera pas pour autant dédouanée de son potentiel pathogène par Freud, qui en fera la responsable de troubles psychiques, telle la neurasthénie. L’aspect pathogène de la masturbation, que la psychanalyse considère comme un évènement psychique, serait lié au fantasme plutôt qu’à l’acte lui-même, car le fantasme en question touche à l’interdit majeur de notre civilisation : l’inceste. Suivant les idées de Freud, Viktor Tausk complète, dans son article de 1912, les conceptions psychanalytiques de cette question, en y introduisant deux notions qui prendront de l’importance dans l’évolution de la théorie : le narcissisme et une instance qui deviendra le surmoi.
Partant des mouvements contestataires de mai 68 et des revendications féministes qui les ont accompagnés, Nedra Ben Smaïl propose de nous intéresser au tabou de la virginité, tel qu’il existe dans la culture arabo-musulmane. Ce sont curieusement les références à sa culture qui nous ont semblé les plus dignes d’intérêt, notamment celles des notes de bas de page, nous entraînant dans un parcours étymologique passionnant, décrivant, par exemple, l’équivalence entre « mon premier enfant » et « ma virginité », entre « défloration » et « accouchement » (p. 69). Le texte lui-même donne, en revanche, l’impression d’une certaine confusion, due probablement au mélange de différents champs : sociologique, politique, religieux avec une démarche psychanalytique relevant du placage théorique utilisant des concepts lacaniens. Le texte aborde ensuite la question de la reconstruction chirurgicale de l’hymen, dont l’auteur fait un véritable acte de vengeance contre les hommes.
Ouvrant sur quatre vignettes cliniques, l’article de Mi-Kyung Yi envisage les troubles de la sexualité humaine à travers l’impuissance et la frigidité. Citant la formule provocatrice de Laplanche (« Le fiasco est l’honneur de l’homme »), l’auteur souligne que la sexualité « est chez l’homme une psychosexualité, jamais à l’abri des défaillances » (p. 82). « Au fond, écrit-elle, c’est la passivité inséparable de l’expérience du plaisir sexuel que les troubles comme impuissance et frigidité incitent à interroger » (p. 85). Abordant l’histoire de la notion de frigidité, l’auteur signale que ce terme était, à l’origine, réservé aux hommes, l’absence de plaisir étant la norme pour les femmes. Ce n’est qu’au siècle passé que l’on assiste au glissement sémantique qui attribue le terme de frigidité aux femmes éprouvant peu ou pas de plaisir au cours du rapport sexuel, laissant aux troubles sexuels de l’homme le nom d’impuissance. C’est Karl Abraham qui établira, en décrivant les diverses formes de la tendance castratrice féminine, le lien entre les deux troubles de la sexualité : la visée inconsciente de la frigidité serait, selon lui, « de prouver à son partenaire comme à elle-même la non-valeur des aptitudes sexuelles de l’homme » (p. 88).
Le même Abraham sera, aux côtés d’Ernest Jones, Max Sachs et Hans Eitingon, l’avocat de l’interdiction de l’accès des homosexuels à la pratique de la psychanalyse. Dans son article consacré à l’homosexualité, Laurie Laufer rappelle de façon très pertinente les positions défendues très tôt par Freud. Pour ce dernier, « le choix d’objet homosexuel est présent dans la vie psychique normale » (p. 97)[1]. Il s’agit d’une variation de la fonction sexuelle. L’homosexualité ne doit intéresser le psychanalyste dans sa pratique que lorsqu’elle révèle des conflits névrotiques. Comment, à partir d’une position aussi affirmée et étayée théoriquement, en est-on arrivé à des positions d’exclusion ? L’auteur décrit la façon dont une partie des psychanalystes ont épousé les vues de l’establishment social et politique. Elle interroge ainsi « le rejet par la psychanalyse elle-même de ses propres discernements » (p. 106).
Cette deuxième partie s’achève sur un amusant dialogue entre Julia Kristeva et Philippe Solers intitulé « L’infidélité – Amour, Fidélité, Infidélité ». Le lecteur y trouvera une réflexion sur ces notions quelque peu délaissées, fleurant bon le « il est interdit d’interdire » de mai 1968. Les deux protagonistes tentent de définir – ou redéfinir – la relation amoureuse, qui est, selon eux, « ce mélange subtil de fidélité et d’infidélité » (p. 114). La fidélité serait ce « sentiment » qui remonterait « à l’enfance et à son désir de sécurité » (p. 116). Ce dialogue, rafraichissant et nostalgique, évite néanmoins des questions directement liées au sujet abordé : le renoncement, le sentiment de culpabilité.
Ouvrant la troisième partie du livre, intitulée « Les temps modernes de la sexualité », René Roussillon nous invite à écouter la polymorphie de la sexualité dans la cure. Il interroge « les enjeux de l’écoute d’un manifeste directement en lien avec la sexualité » (p. 128), mais aussi la possibilité qu’un contenu manifeste sexuel cache du non-sexuel. La psychanalyse, signale-t-il, disjoint sexuel et sexualité et « elle reconnaît une part de sexuel en dehors des manifestations de la sexualité. À l’inverse, elle peut aussi souligner la présence d’enjeux non-sexuels dans la sexualité elle-même » (p. 129). Évoquant la sexualité infantile, l’auteur souligne les liens étroits entre le sexuel et la question du plaisir. Mais le plaisir est aussi ce qui préside à l’appropriation subjective, liée au narcissisme secondaire et donc aux auto-érotismes, la visée appropriative du narcissisme étant essentielle pour le « travail d’intériorisation de la sexualité » et pour « l’introjection de l’expérience subjective » (p. 135). René Roussillon insiste, enfin sur la valeur « messagère » du sexuel et de la pulsion, sur laquelle repose la conception psychanalytique de la relation transféro-contretransférentielle.
Dans l’article suivant, François Richard aborde la question de la relation entre sexualité et pornographie sur internet. L’auteur est ici en terrain connu, ayant écrit un ouvrage intitulé L’actuel malaise dans la culture. Ce malaise, écrit-il, « se transforme en confusion dès lors que l’intériorité ne garantit plus le lien intime, parce qu’elle est traversée par les représentations et le flux du monde extérieur » (p. 141). La voie courte de la réalisation rapide des motions pulsionnelles aboutirait à une « désexualisation de la pulsion dans son exercice même » (p. 142).
Dans son article, intitulé « Le taylorisme sexuel à l’épreuve de la psychanalyse », Vincent Estelon souligne fort à propos que, « en dépit de ces changements manifestes, la clinique analytique rappelle que certaines problématiques psychologiques traversent le temps sans trop bouger. Sur le plan psychique, ajoute-t-il, la liberté sexuelle est toujours difficile à conquérir » (p. 154). Interrogeant le côté addictif de la sexualité, il signale que, comme avec les drogues, « la sensation est venue prendre la place de l’affect » (p. 155). L’auteur se demande si « la dépendance toujours renouvelée à des objets actuels peut être lue comme une tentative de s’affranchir de la fixation à un objet plus ancien qui hypothèque la vie amoureuse de l’adulte » (p. 158).
Avec l’article de Frédéric Tordo, intitulé « Technosexualité, trans@sexualité et néo-sexualité », nous voilà de retour dans ce que Joyce McDougall appelait déjà « néo-sexualités ». L’auteur crée pour traiter de la « sexualité par l’interface des machines » le néologisme de trans@sexualité, à distinguer de la transsexualité. Il s’agit, dans ces nouvelles pratiques sexuelles, d’un véritable « processus d’hybridation » (p. 168), à l’origine de « l’émergence de nouvelles sensorialités et de nouvelles sensualités, voire de la production de zones d’excitation inédites » (p. 169). Mais s’agit-il là d’une sexualité « nouvelle » ou de nouvelles expressions d’un sexuel qui reste inchangé ? Le lecteur pourra relever quelques contradictions : c’est ainsi que l’auteur explique qu’il s’agit de « plaisirs de la peau, comme aux temps originaires de la découverte de la sexualité » (p. 169) et que la technologie ne vient qu’interfacer la rencontre avec l’autre.
La troisième partie de cet ouvrage s’achève sur un article de Janine Mossuz-Lavau, intitulé « Les nouvelles lois de l’amour. Le droit de quelques délits et crimes sexuels ». Il relate l’évolution de la législation qui accompagne, depuis un demi-siècle, les changements sociétaux. Il s’agit, d’une part, de la prise en compte par le législateur du besoin de protection des sujets les plus vulnérables, comme les enfants et les mineurs de 15 ans, et, de l’autre, de la transcription dans la loi des évolutions de la société, comme par exemple l’harmonisation de l’âge de la majorité sexuelle à 15 ans, qu’il s’agisse des rapports hétérosexuels ou homosexuels.
L’évolution de la législation sur le viol est à ce titre remarquable, avec la reconnaissance du viol conjugal et du harcèlement sexuel. Il est de même de la pédophilie, dont l’auteur signale que le terme même « ne figure pas dans le Code pénal » (p. 185), mais qui sera l’objet d’une série de lois jusqu’en 2007. Quant à la question de l’inceste, l’auteur signale que le terme même ne figure dans aucun texte de loi avant février 2010.
La quatrième et dernière partie de cet ouvrage, intitulée « Qu’est la différence des sexes devenue », commence par la question – inévitable – des relations de la psychanalyse avec la question du genre. Dans son article consacré à ce sujet, Jean-Baptiste Marchand remarque que bien qu’elle ait plus de soixante ans, la question « Qu’est-ce que le genre ? » continue de se poser. Dans le champ de la psychanalyse, l’auteur rappelle que Freud n’a jamais cessé de souligner le caractère insaisissable du masculin (männlich) et du féminin (weiblich). Il évoque les travaux de Robert J. Stoller, premier psychanalyste à proposer une théorie du genre, ainsi que la controverse entre Colette Chiland et Jean Laplanche. Dans sa conclusion, l’auteur souligne la spécificité de la psychanalyse dans le débat concernant le genre et la différence des sexes : là où les travaux sur le genre et le sexe s’intéressent à ceux-ci dans leurs dimensions biologique, sociale ou psychologique « concrète », la psychanalyse s’y intéresse aux niveaux intrapsychique, fantasmatique, inconscient et pulsionnel.
Le männlich et le weiblich et leur relation occupent les trois derniers articles du livre.
Dans son article intitulé « L’amour au masculin », Jacques André souligne que « l’amour de la mère, entendu dans les deux sens que permet la formule, occupe sans l’ombre d’un doute une position princeps » (p. 209), à l’origine d’une empreinte, « gravée dans le marbre ».
Pour l’auteur, c’est l’angoisse de castration qui rend compte de certains avatars de la sexualité des hommes. Il en est ainsi du « fiasco », terme introduit par Stendhal et qui désigne les petites ou grandes défaites sexuelles, dans des situations où « se conjuguent à l’excès désir et interdit » (p. 213). À la fin de l’article, il évoque une des figures à l’origine du fiasco, le respect, qui « signe le refoulement des amours incestueuses et la religiosité devant le premier objet » (p. 220). Et de citer Freud : « Pour devenir vraiment libre et de ce fait aussi heureux (l’homme) doit avoir surmonté le respect pour la femme et s’être familiarisé avec la représentation de l’inceste avec la mère et la sœur » (p. 219). C’est à ce prix qu’il évitera le clivage entre la maman et la putain et qu’il pourra concilier le sexuel et le tendre.
C’est ce même clivage que Jacqueline Schaeffer reprendra dans son article « Le sexe féminin, entre tabou et interdit ». « Entre la maman et la putain, écrit-elle, une figure de femme reste oubliée, refoulée ou réprimée : la femme érotique, la femme sexuelle » (p. 229). Contre cette femme-là, « autre, impure, castratrice » (p. 222), il s’agit de mettre en place des défenses, des tabous : tabou du voir, tabou du sang. Face à ces tabous, l’auteur énumère les diverses transgressions, dont la principale serait la jouissance sexuelle, le scandale du féminin étant le masochisme érotique. Et de conclure : « Autant dans les domaines social, politique et économique, le combat pour l’égalité entre sexes est essentiel à mener constamment, autant il est néfaste, préjudiciable dans le domaine sexuel, s’il tend à se confondre avec l’abolition de la différence des sexes » (p. 238).
C’est cette même question de la différence des sexes qu’interroge Michel Schneider, dans son article « La guerre des sexes n’aura plus lieu », qui marque la fin du recueil. Dénonçant la « rivalité mimétique entre les hommes et les femmes » (p. 241), l’auteur évoque « ce qui les oppose et les réunit : la tendre et délicieuse guerre des sexes » (p. 241). Pour éviter cette « guerre », il faut, comme le disait Freud en 1914, se débarrasser « de l’embarrassante sujétion sexuelle ». Parmi les moyens contemporains de s’en débarrasser, l’auteur évoque le remplacement, dans le langage du mot « sexe » par « genre » et la pornographie, qui, par l’hypervisibilité et la saturation, « détruit le fantasme érotique en substituant au jeu des désirs et des corps un monde virtuel où il n’y a pas de rapport physique entre les sexes » (p. 242). Michel Schneider n’hésite pas à prendre des positions à contre-courant des tendances actuelles, dénonçant, par exemple, les prises de position de certains psychanalystes, qui « appellent à se défaire du dogme paternel ou de la tyrannie de la différence des sexes, ou encore soutiennent l’homoparentalité » (p. 245). Il dénonce la « conception contemporaine d’une sexualité sans conflit ni intra ni inter-psychique » (p. 246).
Ce livre aborde donc les multiples questions de la sexualité telles qu’elles se posent à travers les pratiques sexuelles actuelles et les discours les accompagnant. Il présente le grand intérêt de réaffirmer l’intérêt que porte la psychanalyse à ces questions, liées à la permanence de la sexualité infantile chez l’adulte et à ses divers modes d’expression, directement liés à l’évolution des sociétés dans leurs diversités culturelles. La lecture en est agréable et prenante, malgré le caractère parfois inégal des différents articles. Le lecteur y trouvera matière à réflexion et appréciera l’éclairage précis, parfois cru, que les différentes parties de cet ouvrage portent sur le devenir actuel de la sexualité.
Roland Havas est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP
[1] S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, cité par l’auteur.
Elsa Schmid-Kitsikis, Émoi sensoriel, plaisir sensuel. Le monde secret de l’éprouvé, par Françoise Seulin
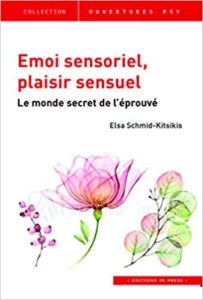 Comment ne pas être sensible à la beauté, la légèreté et la douceur du graphisme de la couverture du riche ouvrage qu’Elsa Schmid-Kitsikis nous donne à voir, pour nous plonger dans le monde secret de l’éprouvé, celui de l’émoi sensoriel et du plaisir sensuel, au cœur du travail du psychanalyste. La complexité psychique, dans ses liens à la temporalité, aux traces de la mémoire corporelle sera visitée et explorée à travers la sensorialité, la sensualité, le plaisir, la douleur, la sexualité, dans leurs liens aux notions complexes de perception et de représentation.
Comment ne pas être sensible à la beauté, la légèreté et la douceur du graphisme de la couverture du riche ouvrage qu’Elsa Schmid-Kitsikis nous donne à voir, pour nous plonger dans le monde secret de l’éprouvé, celui de l’émoi sensoriel et du plaisir sensuel, au cœur du travail du psychanalyste. La complexité psychique, dans ses liens à la temporalité, aux traces de la mémoire corporelle sera visitée et explorée à travers la sensorialité, la sensualité, le plaisir, la douleur, la sexualité, dans leurs liens aux notions complexes de perception et de représentation.
Son livre, associant ses propres expériences personnelles à sa clinique, propose avec une grande finesse une réflexion théorico-clinique sur le statut psychique de la sensualité et de la sensorialité en les différenciant ou en les associant dans le parcours de la construction psychique du sujet, de ses liens précoces à l’environnement et avec l’objet.
Notons aussi que cet ouvrage a une valeur pédagogique, car Schmid-Kitsikis n’hésite pas à redéfinir de nombreux concepts, prenant à cet égard soin des lecteurs d’horizons divers. Elle cite de très nombreux auteurs que je ne pourrai bien évidemment pas reprendre, s’appuyant bien sûr principalement sur les écrits de Freud.
Très bien construit, ce livre est divisé en quatre grandes parties, le statut psychique de l’éprouvé, puis sentir, ressentir, une filiation reconstituée, ensuite les artisans de la vie sensorielle et enfin clinique du plaisir sensuel et de ses dérivations.
Dans la première partie, l’auteure pose les bases anatomophysiologiques et les enjeux conceptuels à partir desquels elle va développer ses réflexions et ses hypothèses. J’ai fait le choix de présenter plus en détail cette partie essentielle de mon point de vue.
Elle commence par différencier les cinq sens en montrant que seuls les récepteurs tactiles concernent la totalité du corps et, à l’exception de la vision, toutes les modalités sensorielles fonctionnent in utero. Si à la naissance ces dernières participent aux processus de liaison du fonctionnement psychique, la vision, elle, aura souvent un rôle de dénominateur commun. Quant à l’odorat et le goût, ils ont très tôt une fonction psychique dans les liens précoces à la mère, mais cette association est soumise aussi à l’expérience relationnelle et culturelle. Dans nos cultures, ils sont surtout liés aux éprouvés de plaisir, de déplaisir et à la jouissance. Enfin seule l’association du vu et de l’entendu donne un espace et un temps pour l’émergence de fantasmes et particulièrement celui de scène primitive.
Elle définit ensuite les concepts liés à ce « monde secret du sensible ». La perception associée au fait de ressentir ou à la notion d’image qui renvoie aux névroses actuelles, caractérisées par l’absence de participation de l’inconscient, et de traces mnésiques infantiles.
Mais la perception est considérée de nos jours comme le fruit d’un travail psychique et non plus comme un vécu passif. La perception par les organes et la perception endo-psychique peuvent être toutes deux en lien avec le sensoriel. Mais la perception n’est pas que contenu sensoriel, elle est aussi en lien étroit avec la théorie de la pulsion et du désir.
La représentation a souvent renvoyé à des sens divers dans l’œuvre de Freud, qui distingue essentiellement la représentation de chose et la représentation de mot. Schmid-Kitsikis insiste sur le fait que le caractère d’immédiateté de la perception n’est qu’un leurre, car il est en fait la conséquence d’un processus de négation, négation de la perte de l’objet de satisfaction hallucinatoire pour la perception, et négation de l’absence de l’objet réel investi, pour la représentation.
Puis elle définit et distingue hallucination et hallucinose, l’hallucinatoire étant un processus constant de la vie psychique. Citant Bion, elle note que « le double sens du verbe sentir, permet d’anticiper un processus hallucinatoire. Pour le patient psychotique, l’hallucination est substitut du rêve, et, citant toujours Bion, elle explique que les attaques destructrices de certains patients sont à comprendre comme une lutte contre le fantasme de scène primitive. Enfin il convient d’intégrer l’hallucinatoire comme processus en deçà du représentationnel et du perceptif.
Elle continue par la définition des concepts de pulsion et excitation qui émergent de sa pratique et montre l’importance du corps psychique en lien avec les émois ressentis ou recherchés par le sujet, soit pris dans une excitation sensorielle, soit poursuivant la recherche d’un état hallucinatoire par l’investissement de certains sens procurant plaisir ou déplaisir. Ainsi certains états de détresse ne peuvent s’expliquer qu’en termes énergétiques, de débordement et de décharge.
Schmid-Kitsikis va distinguer l’émoi et l’affect, ce que Freud ne distingue pas vraiment. L’émoi serait un trouble pulsionnel, un mouvement qui fait sortir quelque chose de sa place ou de l’état où il était auparavant. Ainsi les premiers émois sont ceux des mouvements, troubles ou impressions sensorielles au contact avec l’objet. L’émoi, à distinguer de l’affect, pourrait donc en être séparé, ou celui-ci pourrait même être exclu dans des cas de sidération psychique par exemple ou de déqualification, lorsque le sujet est submergé par les sensations. Pour Freud, seules les représentations sont inconscientes, mais pas les affects. Chez le nourrisson, cette distinction est très utile, car même s’il est soumis à un amalgame pulsionnel sans distinction des sens, la distinction qui va naître entre plaisir et déplaisir sera déjà un mouvement qui lui permettra d’apprécier ce qu’il ressent.
Freud s’est lui-même interrogé sur le statut de la sensorialité, ou perception sensorielle. Il souligne l’immédiateté de la sensation. Mais il convient d’introduire l’expérience du sujet, nous dit Schmid-Kitsikis, et la perception pourra alors être soit sensation pure par son immédiateté soit une qualité psychique plus complexe, un pouvoir représentationnel et mnésique.
Ainsi il convient de distinguer deux éprouvés de sensation, l’un contenu complètement dans l’émoi et l’autre à valeur potentielle représentationnelle en lien avec l’histoire du sujet.
Mais l’excitation, quand elle submerge le corps, peut créer aussi un clivage entre sensation et sensualité. Qu’en est-il alors de l’éprouvé du plaisir sans celui de la douleur ? Mais si la sensualité est coupée des sensations, ne risque-t-elle pas de se pervertir et devenir objet elle-même de jouissance, s’interroge l’auteure ?
Force est de constater qu’il y a peu de définitions de la sensualité dans la littérature, comme si la sensorialité l’incluait. C’est à partir de sa clinique que Schmid-Kitsikis a commencé à s’intéresser à la sensualité. Selon elle l’expérience de la sensualité naît avec l’auto-érotisme primaire, et sa carence maintient l’enfant dans l’excitation et l’adolescent dans un vécu de catastrophe face à toute forme de pénétration, relationnelle et sexuelle.
« L’investissement psychique de la sensualité permet la mise en mémoire des expériences corporelles, en lien avec le souvenir hallucinatoire de l’expérience de satisfaction. »
La sensualité, soumise aux mouvements régrédients sur le trajet de l’hallucinatoire, comme le rêve, est en lien avec la sensorialité, elle mène à la relation objectale.
Ainsi, « La sensorialité et la sensualité constitueraient les deux ferments de la sexualité infantile […] La sensualité se révèle propice au fonctionnement de la sexualité dans ses liens au corps et au désir inconscient. »
Elle s’intéressera ensuite à l’intérêt que porta Freud à l’odorat et son lien à la sexualité dans ses recherches partagées avec Fliess, comme en témoignent leurs échanges épistolaires, en particulier à propos du cas Emma ou le cas de Miss Lucy R., à travers lesquelles se pose le problème du refoulement ou plutôt peut-être celui d’un évitement devant le déplaisir d’odeurs nauséabondes.
Le statut que Freud donne à la vue et l’ouïe diffère, car ils intègrent une distance ce qui leur donne un pouvoir métaphorique que n’ont pas les autres sens du fait de leur trop grande proximité pulsionnelle qui empêche un travail de représentation et de fantasme.
« La perception est rendue psychique par son inscription dans le pulsionnel et dans le désir inconscient grâce au lien à l’objet et à son expérience traumatique celle du manque, celle de la différence des sexes. » La sexualité infantile se nourrit ainsi des éprouvés, des émois, et de la sensualité.
L’auteure définit la sensualité comme une expérience de la sensorio-perception favorisant le désir sexuel, comme lien du corps avec le désir inconscient. Elle permet la constitution des zones érogènes qui canalisent l’excitation et ouvre le chemin de la jouissance et du plaisir. Elle fait partie du processus du lien à l’objet. Elle a une position limite entre le monde du dedans et le monde du dehors, soumise aux mouvements de régrédience donnant accès à l’hallucinatoire. Elle très en lien avec l’activité sensorielle qui fait émerger les fantasmes de la sexualité infantile. Ainsi l’objet serait saisi par les sensations avant d’être perçu, puis la perception permettrait une distance donnant accès à l’activité de représentation.
Au fil des chapitres, Schmid-Kitsikis continue d’approfondir sa théorisation sur le sensuel, le plaisir sensuel et l’émoi sensoriel, tout en se référant toujours avec beaucoup de finesse à son expérience clinique, ce qui donne vie à ses développements et apporte une grande richesse. Elle avance l’idée que « l’objet de la sensualité est un objet sensoriel qui nécessite un contenant corporel et une motion à la recherche d’un plaisir dans la jouissance ». C’est la recherche d’un contact et d’un mouvement engageant tous les sens. Son association à l’expérience sexuelle permet d’enrichir la sensorialité imaginative, limite entre activité hallucinatoire et activité fantasmatique, celle qui permet l’élaboration de la sexualité infantile. Lorsque l’excitation envahit le sujet et submerge le corps, une défense s’impose, celle d’un clivage entre sensation et sensualité qui peut exposer les éprouvés sensoriels au vécu traumatique, nous dit-elle. La sensualité s’inscrit ainsi dans un mouvement de décondensation de l’excitation, mais elle peut dans certains cas, dans ses désirs sur le chemin de la figurabilité psychique, devenir fétichisation, stéréotypie psychotique ou encore obscénité. Dans les meilleurs cas, elle inscrit la sensorialité dans le corps comme prémices de l’auto-érotisme. L’absence d’une expérience sensuelle précoce du bébé avec la mère peut rendre difficile l’introjection d’éprouvés, tels que la jouissance. Mais quand un lien sensuel a pu s’instaurer, alors le vécu d’un geste ou d’un toucher corporel, par exemple, ne se transformera pas en compulsion d’agir ou en pénétration déstructurante allant jusqu’à une rupture identitaire. Elle donne un autre exemple, celui de la passion qui, engageant la sensorialité du sujet, peut aboutir au déni de l’espace de rêverie et à l’investissement d’une sensorialité morcelée. Pour l’auteure, « l’ensemble émoi-affect est un révélateur important des conditions psychiques de l’histoire relationnelle du sujet ».
Pour Freud dans le cas du déplaisir qu’il nomme « autre chose », le ressenti se déchargerait, alors que celui de plaisir chercherait à devenir conscient. Cette « autre chose » se comporterait « comme une motion refoulée », avec une compulsion à la répétition. La résistance à cette décharge ou à cette compulsion rendrait « cet ‟autre choseˮ conscient sous forme de déplaisir ».
L’auteure se demande si la sensation exclut toute participation d’un affect, ou si ici l’affect est réduit à un simple émoi. Le retournement sur la personne de l’affect de douleur n’entraînerait-il pas une déqualification de l’affect en sensation de douleur ?
Quant à la sensualité, elle garantirait aux auto-érotismes primaires une possibilité de ressourcement pulsionnel, une inscription dans la temporalité pour accéder au plaisir, une inscription de la sensorialité dans le corps, et dans le processus qui mène à l’objet.
S’appuyant sur différents auteurs et cas cliniques, Schmid-Kitsikis fait donc l’hypothèse que la sensualité lie la sensorialité au désir, en se situant dans le processus qui mène à l’auto-érotisme. Elle devient alors source de désirs sensoriels et d’activités de perception.
La défaillance d’une expérience sensuelle avec la mère donne des sensations éprouvées comme brutales ne permettant aucune forme d’introjection d’une jouissance.
Je développerai moins les parties suivantes essentiellement historiques, très riches, mais que je laisserai au lecteur le plaisir de découvrir. L’auteure les expose avec beaucoup d’érudition, rendant justice à beaucoup d’auteurs.
Elle mettra en lien son sujet de recherche avec la pensée des philosophes de l’Antiquité, montrant leur intérêt pour le corps et ses sensibilités. Il s’agira de Sapho, Socrate, Platon et Aristote.
Puis dans les « Artisans de la vie sensorielle », elle montre l’influence de l’Antiquité sur Freud et ses écrits et les découvertes qu’il fait grâce à Fliess sur le lien entre affect et sensation.
« Dans le fil rouge reconnu, questionné, contesté », Schmid-Kitsikis va citer un grand nombre d’auteurs qui ont nourri sa formation à la pensée freudienne et piagetienne et qui sont en lien avec le sujet de son livre. Ainsi elle développera la pensée d’Henri Wallon, de Jean Piaget, de Wilfred R. Bion, de Donald W. Winnicott et enfin de Didier Anzieu.
Je m’attarderai plus sur le dernier chapitre concernant la « clinique du plaisir sensuel et de ses déviations », lorsque l’éprouvé sensuel est menacé, entre débordement et perversion.
La clinique des éprouvés pose la question complexe des prémices du plaisir, ce qui le provoque ou le dénature, nous dit l’auteur. La sensualité prendrait corps à la naissance de l’auto-érotisme primaire, son absence, sa déficience ou un trop grand investissement créeraient chez l’enfant soit une attente soit une surexcitation. L’intégration de la sensualité au moment du développement de l’auto-érotisme primaire préparerait à l’érotisme objectal dans le meilleur des cas. Freud note souvent l’ambiguïté topique des sensations plaisir et douleur, désignant à la fois des états corporels et affectifs. À noter alors l’importance des mécanismes de liaison à l’objet et ses avatars traumatiques. Dans un contexte relationnel déficient, la sensualité peut devenir fétichisation. Son excès peut devenir fétichisation de la jouissance en excluant la sensorialité et en maintenant l’excitation. Un excès de sensorialité diminue l’accès à la jouissance en déniant tout affect, ce que l’auteure nomme « orgasme sensoriel ». Pour illustrer le sensuel et sa perversion, et avec beaucoup de finesse, elle prendra pour exemple le roman de Süskind dont Grenouille est le héros.
À la lecture de ce livre, nous pensons aussi à la fonction symbolisante de la relation transféro-contre-transférentielle lors de l’émergence dans la cure de traces archaïques sensorielles et clivées, en attente d’une articulation avec les différentes strates de la vie psychique. Ces traces s’éprouvent parfois en premier dans le contre-transfert de l’analyste. C’est lui qui pourra alors aider le patient à les transformer en représentation de chose et en représentation de mot pour tenter de les symboliser.
Schmid-Kitsikis a consacré son livre à la complexité psychique de l’éprouvé avec ses manifestations diverses, surgissement, effacement, déviation, plaisir ou déplaisir, aux prémices du désir en lien avec la perception, l’hallucinatoire et la représentation, et au tissage remarquable entre sensorialité et sensualité, ce qu’elle a réussi avec beaucoup de sensibilité, de talent et d’érudition. Elle nous offre de nouvelles perspectives pour penser la psychanalyse et en ce sens son livre apporte avec générosité une précieuse contribution à la psychanalyse contemporaine.
Françoise Seulin est psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.
Une lecture
Monique Bydlowski, Devenir mère, par Gilbert Diatkine
 Dans son dernier livre, Devenir mère. À l’ombre de la mémoire non consciente, Monique Bydlowski rassemble l’expérience clinique acquise au cours de trente années de travail comme psychanalyste dans la Maternité de l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Elle y a participé aux consultations données par les obstétriciens à des femmes dont la grossesse se déroule mal, ou à des femmes qui souhaitent avoir un enfant et n’y parviennent pas. Elle intervient au cours de ces consultations en relevant certains éléments dans le discours de la consultante qu’elle nomme des « traces signifiantes ». Elle attire ainsi l’attention d’une femme qui consulte pour des difficultés physiques sur leurs relations avec leur vie psychique. Elle leur propose alors une consultation en l’absence de l’accoucheur, qui débouche parfois sur une psychothérapie (Bydlowski, 2020,p. 193).
Dans son dernier livre, Devenir mère. À l’ombre de la mémoire non consciente, Monique Bydlowski rassemble l’expérience clinique acquise au cours de trente années de travail comme psychanalyste dans la Maternité de l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Elle y a participé aux consultations données par les obstétriciens à des femmes dont la grossesse se déroule mal, ou à des femmes qui souhaitent avoir un enfant et n’y parviennent pas. Elle intervient au cours de ces consultations en relevant certains éléments dans le discours de la consultante qu’elle nomme des « traces signifiantes ». Elle attire ainsi l’attention d’une femme qui consulte pour des difficultés physiques sur leurs relations avec leur vie psychique. Elle leur propose alors une consultation en l’absence de l’accoucheur, qui débouche parfois sur une psychothérapie (Bydlowski, 2020,p. 193).
Les « traces signifiantes » et le transfert
Les « traces signifiantes » que relève Monique Bydlowski renvoient directement aux désirs inconscients associés au projet d’enfant. Certaines de ces traces sont langagières, comme la date de la conception et celle de la naissance, ou le prénom choisi pour l’enfant, d’autres sont corporelles. Ce sont les aspects du corps de l’enfant qui se prêtent aux projections que ses parents font sur lui (ibid.,p. 51). Le simple fait de relever une trace signifiante suffit souvent à provoquer une levée du refoulement. Si une psychothérapie s’engage ensuite, elle est fondée sur l’acceptation par le thérapeute « d’être pour un temps le support du transfert » (ibid., p. 205), mais il n’est jamais question dans ce livre d’interpréter ce transfert. Le transfert est seulement utilisé pour obtenir, dans le peu de temps que laisse l’évolution d’une grossesse, un effet cathartique limité, mais souvent spectaculaire, dû à la faiblesse particulière du refoulement, qui existe chez les femmes aux prises avec une grossesse difficile, que Monique Bydlowski nomme « la transparence psychique » (ibid., p. 28).
La transparence psychique
Monique Bydlowski a été frappée par la facilité avec laquelle ces femmes enceintes en grande difficulté retrouvaient des souvenirs très anciens et des fantasmes secrets. La transparence psychique peut être rapprochée de la « préoccupation maternelle primaire » décrite par Winnicott (Winnicott, 1956), mais elle en diffère parce que Winnicott s’intéresse à des grossesses normales, et parce que loin d’être transparentes au regard de l’analyste, ses patientes se replient sur elles-mêmes et communiquent peu avec l’analyste (ibid., p. 78, p. 172). En outre la préoccupation maternelle primaire est une capacité de la mère à interpréter les manifestations du bébé, et non à se laisser interpréter elle-même par un analyste (ibid., p. 91). Elle est en cause dans le « blues » de la jeune accouchée (ibid., p. 114), un phénomène normal, à distinguer des dépressions post-partum proprement dites (ibid., p.107, p. 112).
La transparence psychique est composée de deux termes : d’une part, une ouverture à l’écoute d’un tiers neutre et bienveillant ; d’autre part une levée des résistances à la remémoration des souvenirs infantiles. Elle s’observe dès les premières semaines de la grossesse (ibid., p. 79). Elle s’explique par le fait que le contre-investissement des souvenirs refoulés est déplacé au profit de l’investissement de cet objet psychique nouveau : l’enfant à naître (ibid., p. 82). Grâce à la transparence de la grossesse, le narcissisme maternel peut opérer une alliance thérapeutique avec un thérapeute, et les fantasmes jusque-là refoulés peuvent perdre leur charge émotionnelle et se dissoudre au fil des entretiens (ibid., p. 85, p. 199). La transparence psychique se poursuit après l’accouchement, toujours grâce à l’hyperinvestissement de l’enfant (ibid., p. 90).
Monique Bydlowski rapporte de nombreux exemples de psychothérapies aux effets thérapeutiques remarquables :
Laure retrouve en quelques entretiens le souvenir de sa dureté à l’égard de sa mère au moment de la mort de son père. La répétition d’une série de grossesses qui s’étaient terminées par des avortements spontanés ou des morts à la naissance s’enraye alors, et elle accouche d’une fille le jour anniversaire de sa mère, dont elle donne le prénom à sa fille (ibid., p. 62).
De même, dès sa première rencontre avec Monique Bydlowski, Mme B. se souvient qu’elle se fantasmait comme la petite fiancée de son père, le jour même où celui-ci est mort d’un accident quand elle avait 10 ans. Elle prend conscience de la culpabilité inconsciente qu’elle gardait du lien entre son fantasme incestueux et la mort de son père. Quelques mois plus tard, elle est enceinte (ibid., p. 177).
La dette de vie
À côté de la « transparence psychique », un autre concept important de Monique Bydlowski est celui de « dette de vie », à laquelle elle a consacré un autre livre (Bydlowski, 1997). Normalement, tout être humain, homme ou femme, s’acquitte de la dette qu’il doit aux parents qui lui ont donné la vie en mettant un enfant au monde. Certains hommes sont capables des sacrifices les plus extraordinaires pour s’acquitter de cette dette, comme le Comte F…, le héros de La Marquise d’O… de Kleist, qui prend les plus grands risques pour reconnaître l’enfant qu’il a fait à la Marquise d’O… en la violant (ibid., p. 35). Mais ce sont surtout pour les mères que la « dette de vie » prend une grande importance. Certaines femmes préfèrent avorter plutôt que de payer cette dette à leur mère. Dans La femme sans ombre,de Hoffmansthal, l’ombre représente la dette que l’héroïne doit à sa propre mère, et qu’elle rachète à une pauvresse (ibid., p. 58, p. 174, p. 209). Accepter d’être enceinte, c’est accepter cette ombre, c’est-à-dire accepter de voir son corps se déformer et s’abîmer au cours de la grossesse, comme la mère l’a accepté auparavant pour donner naissance à la femme (ibid., p. 59). Souvent, les mères ne peuvent s’acquitter de leur dette de vie, car elles veulent rester éternellement jeunes et continuer à s’identifier à une mère forte, à laquelle il ne manque rien, et donc à qui elles n’ont rien à rendre.
Ce refus de payer sa « dette de vie » est pour Monique Bydlowski lourd de conséquences pour l’enfant :
« Faute de la reconnaissance de cette dette, l’enfant est grevé d’hypothèque – ce terme renvoyant à la fragilité du nouveau-né, à sa prématurité, à son maintien en couveuse » (ibid., p. 174).
Monique Bydlowski confirme ainsi l’intuition de départ qui l’a conduite à passer de la psychiatrie des adultes à la maternité : bien des pathologies psychiatriques des patients adultes trouvent peut-être leur source dans des projections péries et néo-natales précédant leur venue au monde (ibid., p. 9).
La mère de la mère doit donc être à la fois faible et idéalisée. Ce paradoxe est illustré par le tableau de Léonard, La Vierge, l’enfant Jésus et Sainte Anne (ibid., p. 176). Une mère « faible », c’est la mère tendre du début de la vie, qui est cachée par la rivale œdipienne forte (ibid., p. 179). Parfois cette mère faible n’est retrouvée qu’après que la mère réelle est morte, ce qui explique que certaines femmes n’ont d’enfants qu’après la mort de leur mère. Mais certaines autres femmes restent toute leur vie « amatrides », c’est-à-dire incapables de reconnaître leur dette à l’égard de leur mère (ibid., p. 183).
Bien que Monique Bydlowski insiste surtout sur la nécessité de retrouver une « mère faible » (au sens où elle l’entend), elle montre qu’il faut aussi que l’image du père soit investie pour pouvoir faire un enfant (ibid., p. 208), mais tout a déjà été dit sur le désir des filles de recevoir un enfant du père.
Les dates extraordinaires
Un des apports les plus étonnants de Monique Bydlowslki est d’avoir remarqué la fréquence extraordinaire avec laquelle des enfants naissent à des moments hautement significatifs de la vie des parents, comme l’anniversaire d’un décès, ou de la naissance d’un proche (ibid., p. 27, p. 54). Par exemple Marie retrouve en cours de grossesse le souvenir d’avoir eu le sentiment douloureux d’avoir tué lentement sa mère, qui a souffert de troubles gynécologiques depuis la naissance par le siège de la patiente, et est morte d’un cancer de l’utérus. Elle conçoit son enfant le jour anniversaire du décès d’un premier enfant mort-né, lui-même conçu le jour anniversaire de la mort de sa mère (ibid., p. 63).
Si l’inconscient ignore le temps, les pulsions du Ça sont peut-être branchées sur les horloges biologiques du corps, celles qui règlent la durée d’une grossesse, les cycles de la fécondité et ceux de notre sommeil (ibid., p. 75).
Discussion
Ce livre tire son importance de tout ce qu’il nous apprend sur les difficultés psychiques des femmes infertiles et de celles dont la grossesse se passe mal. Il nous intéresse aussi par les problèmes qu’il ouvre à la discussion :
- Peut-on vraiment dire que toutes les maladies mentales s’inscrivent dès la naissance ? N’est-ce pas méconnaître l’importance des remaniements après-coup qui donnent un nouveau sens à des difficultés qu’on aurait pu juger comme mineures au moment où elles se sont produites ?
- La mère minoé-mycenienne des origines est-elle vraiment la mère tendre du début de la vie ou plutôt sa représentation initiale Ce serait faire peu de cas de l’importance des fantasmes archaïques qui se développent ultérieurement et jouent un rôle si important dans les cures
- La place minime laissée à l’interprétation du transfert n’est-elle pas une conséquence de la brièveté forcée de ces cures ?
- Cette brièveté à son tour n’est-elle pas une conséquence inévitable de la division indispensable du travail institutionnel entre gynécologie, obstétrique, néonatologie, pédiatrie du nourrisson, et pédiatrie générale ? D’une discipline à l’autre, les pathologies et les thérapeutiques changent du tout au tout. En quelques mois, mères et enfants font des voyages transcontinentaux, et passent des frontières qui les mènent dans des pays où l’on parle des langues différentes
- Dans les maternités, malgré tous les efforts faits pour les y introduire, les pères jouent un rôle forcément réduit. Un exemple frappant de cette réduction du rôle des pères est la façon dont Monique Bydlowski raconte La marquise d’O… Dans sa version, le Comte F. veut surtout s’acquitter de sa dette de vie, et transmettre sa généalogie à un enfant. Mais le roman de Kleist est centré sur le problème du viol de la Marquise d’O… par le Comte F. La violence des rapports entre hommes et femmes, les fantasmes sadiques et masochistes ont-ils vraiment aussi peu de place dans les difficultés des femmes enceintes ?
Toutes ces questions ne doivent pas nous faire oublier tout ce que la lecture de ce livre peut nous apprendre et qui va plus loin que le seul domaine clinique. L’expérience accumulée par Monique Bydlowski l’amène aussi à poser tous les problèmes éthiques et politiques posés par les nouvelles manières de procréer. L’hôpital Béclère, où elle a travaillé, est celui où a été conçue Amandine, le premier bébé issu d’une fécondation in vitro. Monique Bydlowski y a fait des recherches sur le don d’ovocytes (ibid.,p. 220) et sur la gestation pour autrui (ibid., p. 230). Elle réfléchit à ce que serait un monde où existerait l’utérus artificiel (ibid., p. 237). Cette utopie – pour l’instant ? – ne fait que pousser à son paroxysme les conséquences de la transformation du désir d’avoir un enfant en « droit à l’enfant ».
Gilbert Diatkine est psychanalyste, membre de la SPP.
Références bibliographiques
Bydlowski M. (1997) La dette de vie. Itinéraire psychanalytique de la maternité. Paris, Puf.
Bydlowski M. (2020). Devenir mère. À l’ombre de la mémoire non consciente. Paris, Éditions Odile Jacob.
Winnicott D.W. (1956/1969). La préoccupation maternelle primaire. De la pédiatrie à la psychanalyste. Paris, Payot.
4 Recensions de livres parues dans la « Revue des livres » du numéro « Quelle liberté ? ». Bonnes (re)lectures!
Raymond Cahn, Hors des sentiers battus : un parcours psychanalytique, par Bernard Brusset.
Julia Kristeva, Dostoïevski, par Kalyane Fejtö.
Jean-Claude Lavie, Le sexe dans la bouche, par Corinne Ehrenberg.
Richard Rechtman, La vie ordinaire des génocidaires, par Benoît servant.
Raymond Cahn, Hors des sentiers battus : un parcours psychanalytique, par Bernard Brusset
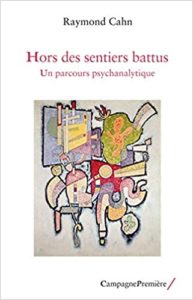 Ce dernier livre de Raymond Cahn présente de manière simple ses apports les plus significatifs à la psychanalyse, notamment au sujet des psychoses définies comme processus de désubjectivation. Il reprend certains de ses articles les plus importants de manière à donner tout son relief à l’originalité de son parcours. Celui-ci se caractérise par l’articulation claire de la clinique et de la théorisation. D’où le témoignage de nombreux récits commentés des expériences de sa pratique, quels que soient l’âge, le sexe ou la pathologie.
Ce dernier livre de Raymond Cahn présente de manière simple ses apports les plus significatifs à la psychanalyse, notamment au sujet des psychoses définies comme processus de désubjectivation. Il reprend certains de ses articles les plus importants de manière à donner tout son relief à l’originalité de son parcours. Celui-ci se caractérise par l’articulation claire de la clinique et de la théorisation. D’où le témoignage de nombreux récits commentés des expériences de sa pratique, quels que soient l’âge, le sexe ou la pathologie.
Le préambule met d’emblée en valeur deux adjonctions à la métapsychologie qu’il propose : la subjectalisation et la subjectivation, notions qui seront explicitées dans un chapitre ultérieur. Il résume ensuite les grands thèmes de sa réflexion : la troisième topique (la nouvelle conception de l’écoute, du contre-transfert, de l’interpsychique), la violence et les pulsions agressives (leur accroissement contemporain), les avatars du narcissisme et le malaise dans la culture, le contenant et la problématique de l’identité, et enfin la souplesse du cadre et la liberté de penser.
Quatre grandes divisions organisent le livre : 1) « Ce qui nous gouverne et ce que nous en faisons » : reprise, réflexion faite, de la présentation de son rapport au congrès en 1990. Ensuite : 2) « Une nouvelle approche ». 3) « L’adolescence », et 4) « Art et psychanalyse » (avec à chaque fois un exergue bien inspiré témoignant de la vaste culture de l’auteur, et une bibliographie succincte en bas de page).
1) La question du sujet prend nécessairement sens en fonction de ce qui le détermine, l’entrave, le contraint. Contrairement à la centration philosophique sur le sujet de la conscience et aux thèses de Lacan sur l’aliénation spéculaire et sur l’évanescence du sujet entre deux signifiants, Cahn précise d’emblée, dans la théorie de l’origine du sujet, c’est-à-dire de la « subjectalisation », l’importance des expériences précoces dans l’interrelation entre l’enfant et la mère-environnement : « Que l’on utilise le modèle de Winnicott ou celui de Bion, c’est la capacité de rêverie de la mère qui transmet la qualité psychique de l’expérience ; la pulsion porte en elle la créativité, à la condition que le monde lui permette cette co-création, et, par là même, que les représentations du monde co-créent ce que la psyché, dans Son ipséité radicale, crée seule. » Il ajoute : « Je ne vois pas d’autre possibilité d’en rendre compte autrement qu’à travers ces formulations impossibles… »… celle du transpsychique et non de l’intersubjectif, celle d’une « genèse commune, partagée, en même temps que l’illusion omnipotente, créatrice de soi et du monde, de la psyché ». Il ajoute : « Que ce noyau autoréférentiel originaire soit trouvé-créé ou effet de l’identification primaire, il a source dans la circularité déterministe et la confusion du transpsychique au fondement du processus de subjectivation. »
À défaut d’instauration du refoulement primaire, avant la séparation entre l’objet et un sujet émergent, l’alternative est entre la continuité suffisante dans la discontinuité et le chaos. Le danger permanent de perte du sens, d’annihilation psychique est combattu, sur le modèle de l’acte, par le fonctionnement paranoïde, le trouble de penser, le dysinvestissement de l’objet. Cet ailleurs du moi, qui constitue son origine et le noyau du sujet, est à l’origine de tels états. Il demeure inaccessible au protocole classique de la cure. Dans les diverses formes d’identifications projectives, le thérapeute peut tenter de relier par le travail de sa psyché l’interaction affective dans laquelle il se trouve pris, de manière à donner issue à la compulsion de répétition en évitant les pièges de la suggestion, de la défense et de la relation duelle. Cahn fait intervenir à ce sujet « la notion de déprise en contrepoint de l’agrippement du patient à ses objets archaïques, ré-ouvrant une marge, un espace ménagé pour le Je de la parole, de la représentation, d’un jeu possible dans l’entre-deux des mondes interne et externe ».
Ce processus de subjectivation « conjoint la présence et l’impact déterminants du passé, et le projet, la possibilité même d’être livré au possible qui pousse le sujet en avant, en dépit et du fait même de ses entraves… ».
Cahn décrit ensuite le malaise de la culture contemporaine comme « crise des valeurs, crise des liens où le roi est nu, les personnages parentaux ou leurs substituts sociaux discrédités, désacralisés, des êtres ordinaires, des hommes sans qualité, mais surtout sans valeur(s), de moins en moins en mesure de reconnaître et de poser des limites, entre les sexes, entre les générations, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux ». Il ajoute : « En deux mots, non psychanalytiques, mais que j’assumerais et intégrerais sans vergogne au sein de la métapsychologie si j’en avais le loisir, car traversant instances et qualités psychiques : la tradition et la transcendance. Le drame des temps présents étant la crise de la tradition et la remise en question, voire la disparition, de la transcendance… »
Après ces prises de position bien affirmées, le sous-chapitre suivant reprend un article de 1975 qui explicite les fondements théoriques de la pratique originale de l’hôpital de jour du Cerep sur « le processus thérapeutique en institution pour jeunes psychotiques », dont la conception de la psychose : « Le psychotique n’est donc pas sujet de son histoire ou de son désir. Lui font ainsi défaut un préconscient, un espace personnel suffisants pour lui permettre l’utilisation d’une aire potentielle ainsi que des capacités suffisamment autonomisées de fantasmatisation, de symbolisation et d’intégration nécessaires au processus psychothérapique classique. Il vit ses pulsions et les objets comme des dangers internes et externes submergeants qu’au mieux il parviendra à maîtriser au prix de mécanismes gravement invalidants. » L’objectif thérapeutique de la « restitution subjectale » requiert dans les relations « l’attention, la disponibilité, l’inventivité, la capacité d’être soi dans la relation vraie », mais aussi la participation du groupe des soignants, par exemple en psychodrame psychanalytique. L’analyse est omniprésente tout en excluant la pratique de l’interprétation avant qu’elle ne devienne possible par le thérapeute individuel de l’adolescent. Elles portent électivement sur les conditions de la symbiose originaire en deçà de la différenciation sujet-objet dans les liens précoces tels que les actualise l’adolescence. Référence est faite à ce sujet à l’idée novatrice de Green (souvent cité) selon laquelle, face à la compulsion de répétition, l’analyste doit donner la réponse qui n’a pas été donnée à l’origine : « La réponse par le contre-transfert est celle qui aurait dû avoir lieu de la part de l’objet. » Cahn ajoute : « … y compris par son travail imaginatif propre, fabriquant et reconstituant les liens permettant de retrouver ce sens disparu parce qu’inassumable, à travers les fragments de réalité psychique dispersés, séparés les uns des autres. »
Référence est faite également à Bettelheim au sujet des pratiques de l’Orthogenic School de Chicago, mais dans un fonctionnement institutionnel bien différent et sans l’exclusion accusatrice des parents qui, ici, sont au contraire associés au travail d’élaboration des vécus précoces de l’adolescent. L’attention portée à l’institution, aux modes de relation et aux phénomènes de groupe, permet la prise de conscience des phénomènes d’induction de la problématique du patient chez les thérapeutes : ils sont révélateurs des vécus pathogènes précoces ainsi actualisés et rendus connaissables. Ces considérations sont fort illustratives des processus de subjectivation dans la prise en charge institutionnelle ici envisagée dans ses diverses dimensions : une théorisation qui a beaucoup intéressé les spécialistes de l’adolescence comme le montrent de nombreuses publications.
Le deuxième sous-chapitre, intitulé « les leçons d’une cure », est le récit de la cure réussie d’une patiente psychotique délirante. Il définit les conditions de la réparation des effets des traumas narcissiques précoces liés à l’emprise parentale pathogène. L’auteur en tire une conclusion illustrative de la thèse qu’il défend : « … pour Freud le contre-transfert est précisément l’instrument pour exclure toute participation personnelle alors que, pour Ferenczi c’est précisément le contre-transfert qui constitue un instrument essentiel à considérer comme efficace et donc, tout naturellement inclus dans le processus. Deux conceptions qui s’opposent l’une à l’autre. On souhaiterait, et c’est peut-être un des buts de ce travail, qu’elles s’articulent l’une à l’autre, plutôt que de faire un choix entre elles. » Ainsi conçue la psychothérapie est une variante de la psychanalyse (comme le montrait son livre de 2002 : La fin du divan).
Les illustrations cliniques permettent de comprendre, dans une certaine mesure, comment cette participation personnelle de l’analyste n’exclut pas nécessairement le principe de neutralité, mais le relativise. Il ne s’agit pas seulement du contre-transfert, mais de l’analyse de celui-ci. D’où, dit l’auteur, « la nécessité impérative d’une analyse personnelle suffisamment approfondie ». Là est bien la différence avec ceux qui pensent que « le tournant relationnel de la psychanalyse » abolit tout souci de neutralité (comme A. Ferro par exemple) : débat d’actualité…
Au sous-chapitre numéro trois, sont ensuite définies les notions de subjectalisation et de subjectivation, la première, étroitement tributaire de l’objet primaire aux origines, étant la condition de la seconde. Notre auteur écrit : « … doit être considéré comme échec de la subjectalisation ce qui, du monde dans lequel s’insère et vit le sujet, ne lui a pas été reconnu ou rendu déchiffrable de son être, de ses pulsions propres, de son identité, de sa place dans la succession des générations, ou ce qui, des objets qui l’environnent, lui est intolérable, sur le mode de l’intrusion, de la séduction, du manque, du rejet, ou de l’incohérence – et donc non métabolisable, non transformable, non appropriable, le laissant pris dans un rapport aliéné à l’objet par l’excès de l’excitation, son absence ou sa destructivité et la perte du sens. » Les conséquences en sont ensuite définies : « Ainsi, du désaveu à la forclusion en passant par le clivage entre représentation et affect, entre conduites et intériorité ou, à l’inverse, la différenciation insuffisante entre intérieur et extérieur, se déploieront toutes les figures de la pathologie de la subjectivation, de la psychose à la psychosomatose. » Il ajoute : « La dimension économique s’y avère particulièrement importante, éclairant les possibilités plus ou moins réduites ou encore opérantes d’un remaniement de telles organisations, et le passage de tel type d’organisation à tel autre. » Raymond Cahn précise que, pour lui, le modèle de la fonction objectalisante du Moi décrite par Green, est corrélative de la différenciation et de la « subjectalisation » qui est la condition de la subjectivation logiquement postérieure.
« Le sujet passé au peigne fin » reprend un article intitulé : « Subjectalité et métapsychologie du moi », in Autour de l’œuvre d’André Green, Enjeux pour une psychanalyse contemporaine (2005). Il comporte une discussion des thèses de Green dont il est très proche, notamment dans la critique des options de Lacan. Il en vient à formuler sa conception de la genèse de la subjectalisation : « Ainsi les conditions de la subjectalisation reposent-elles sur les deux dimensions fondamentales que constituent la créativité radicale de la psyché et la nécessité absolue de l’autre, générant synchroniquement et diachroniquement, à travers leur inter influence ou leurs apports mutuels, de nouvelles modalités du travail psychique dont la particularité, précisément, est de rendre indécidable la part qui revient à chacun de ces deux pôles. L’un et l’autre contiennent la possibilité de leur propre dépassement élaboratif au sein du processus d’auto-évaluation du soi. » L’auteur procède ensuite à une nouvelle réflexion au sujet de sa propre conception du « sujet inter-instanciel » et du processus de subjectivation.
Le sous-chapitre 5 donne une illustration clinique des conditions d’apparition de la fonction symbolique et du langage chez un enfant mutique de 3 ans et demi, dont, à partir de Winnicott, la théorie du jeu.
Le chapitre II décrit la nouvelle approche qu’il promeut. Dans l’héritage de Ferenczi, la théorie des effets des traumatismes, l’implication de l’analyste dans le processus analytique et l’analyse des contre-transferts. Dans l’héritage de Winnicott, le « trouvé-créé » de l’activité transitionnelle de l’enfant dans les rapports originaires avec la mère-environnement. Dans la psychose, elle suppose une théorie de l’objet et de l’emprise narcissique ainsi qu’une définition du cadre, du divan au face à face. Les cas cliniques d’Hélène, de Sébastien et surtout celui d’Iphigénie illustrent clairement cette théorisation ouverte.
Dans le chapitre III, après avoir montré dans la problématique de l’adolescence l’adéquation des modèles théoriques de l’après-coup de l’Œdipe, de l’espace transitionnel et de l’inquiétant étranger (selon Freud, 1919), l’auteur souligne l’intérêt de la notion de position dépressive, et il en vient à comparer les trois figures de Télémaque dans la Littérature : Télémaque, fils d’Ulysse, pour Homère, le Télémaque jeune homme idéal de Fénelon et celui d’Aragon s’achevant en apothéose suicidaire. Ce Télémaque déchaîné (était présent, mais censuré dans l’œuvre de Fénelon). Il est « déchaîné au moins dans son imaginaire d’où surgissent les pires violences, les pires humiliations, à l’égard de lui-même et de ceux qui l’avaient humilié ». Sont ici convoqués les notions freudiennes de masochisme primaire érogène (« dans le plaisir de la douleur et dans celui suscité par les obstacles et l’effort pour les surmonter ») et celui de l’intrication-désintrication des pulsions libidinales et des pulsions agressives ou destructrices. Pour l’auteur, le masochisme primaire érogène n’est pas constitutionnel comme dans l’hypothèse de Freud, mais il est compris en prenant en compte le temps et le rôle fondamental, dans les premières années, de l’objet-environnement dont les carences et les empiètements entraînent la prédominance des pulsions violentes (cf. ses écrits antérieurs sur les « déliaisons dangereuses »). À défaut de formations réactionnelles et de sublimations, la désintrication pulsionnelle peut aussi déterminer des suicides que rien ne laissait prévoir, ou encore la violence meurtrière. Chez de tels sujets en proie à la désespérance absolue, « la rencontre avec des idéologues fanatiques donne enfin à un tel vécu, non seulement une explication, mais une ouverture, un projet qui les mobilisent tout entiers. » Ainsi, le fanatisme, la radicalisation donnent un sens à leur vie. (On se souvient que Raymond Cahn avait publié, dans Le Monde du 8 janvier 2016, une étude du djihadisme).
Avec le chapitre IV (« Art et psychanalyse »), il s’agit de la curiosité et de la quête mystique, notamment dans la Kabbale. L’universalité des thèmes inconscients « se voit illustrée de manière particulièrement saisissante à travers le luxuriant foisonnement des productions kabbalistiques ». La signification allégorique classique du Cantique des cantiques comme relation privilégiée de Dieu et de son peuple, devient « un acte d’amour entre Dieu et sa part féminine dans une hiérogamie dont la figuration traverse l’ensemble de la production kabbalistique… » Mais Raymond Cahn va plus loin en écrivant que le thème de la coexistence en Dieu de la plénitude infinie et de l’abîme et du néant « … pourrait pointer, dans la vision bisexuelle du Parent originaire, l’impensable, l’irreprésentable de la jouissance féminine et du corps féminin, susceptible de s’ordonner en fonction de l’irreprésentabilité de la mort ».
La partie terminale du livre, intitulée « Les racines communes de la création et leur différenciation », rend compte des rapports entre subjectivation et créativité : l’artiste est poussé « à faire exister à travers une œuvre ce qui n’était que perception à la fois confuse et exquise d’émois et de sensations d’un monde externe et d’un monde interne saisis dans une seule et même réalité psychique ». Il en est de même dans le projet de subjectivation de l’analysant. Il vise à la réalisation par laquelle il « s’approprie (il fait sien), en même temps qu’il fait exister, une réalité jusqu’alors dissimulée et inédite ». Ainsi, le développement du self et celui du langage sont ordonnés au principe freudien du but de la psychanalyse, soit, dans la traduction qu’il a choisie : « C’est là même où était le ça que le je doit advenir. »
Le livre se termine par l’idée de la fécondité du processus de subjectivation que vise à réparer et à favoriser cette pratique psychanalytique sans divan « hors des sentiers battus », théorisée, explicitée et ardemment défendue par ce livre.
Bernard Brusset est psychiatre, psychanalyste, membre de la SPP.
Julia Kristeva, Dostoïevski par Julia Kristeva, par Kalyane Fejtö
 Dans son nouvel ouvrage publié dans la collection « Les auteurs de ma vie » de l’édition Buchet Chastel[1], Julia Kristeva nous offre une traversée passionnante de l’œuvre de Dostoïevski en deux parties. La première consiste en une large présentation, véritable cheminement à travers les thèmes marquants de l’œuvre et la deuxième partie est une anthologie composée d’extraits choisis faisant écho aux thèmes traités dans la présentation. À travers ce parcours, le lecteur est invité à se frayer sa propre voie dans l’œuvre foisonnante de Dostoïevski, « sans craindre de dépasser les bornes, ni de vivre à la dernière limite » (p. 8). Cette question de la limite est comme nous le verrons un axe important de la lecture de Kristeva qui, forte de ses multiples champs d’expertise, fait ressortir la profonde modernité de l’auteur russe.
Dans son nouvel ouvrage publié dans la collection « Les auteurs de ma vie » de l’édition Buchet Chastel[1], Julia Kristeva nous offre une traversée passionnante de l’œuvre de Dostoïevski en deux parties. La première consiste en une large présentation, véritable cheminement à travers les thèmes marquants de l’œuvre et la deuxième partie est une anthologie composée d’extraits choisis faisant écho aux thèmes traités dans la présentation. À travers ce parcours, le lecteur est invité à se frayer sa propre voie dans l’œuvre foisonnante de Dostoïevski, « sans craindre de dépasser les bornes, ni de vivre à la dernière limite » (p. 8). Cette question de la limite est comme nous le verrons un axe important de la lecture de Kristeva qui, forte de ses multiples champs d’expertise, fait ressortir la profonde modernité de l’auteur russe.
En effet, Kristeva éclaire le caractère visionnaire de l’écriture de Dostoïevski à plusieurs égards. D’abord, elle explore sa portée politique en montrant que la « réinvention » du roman polyphonique » témoigne d’un pari « sur la puissance de la parole et du récit » (p. 7) dans un monde où le nihilisme et l’intégrisme amorcent leur montée inexorable. Car selon elle, « Ses personnages extravagants, oscillant entre monstruosité et insignifiance ‟d’insectesˮ, pressentaient déjà la matrice carcérale de l’univers totalitaire qui se révéla par la Shoah et le Goulag » (ibid.). Visionnaire, Dostoïevski l’est également d’un point de vue clinique, car, comme le met en évidence Kristeva, son exploration des passions humaines anticipe les développements psychanalytiques et en particulier ceux qui concernent les états limites. Si l’article de Freud de 1928 insistait sur la dimension névrotique de la culpabilité œdipienne liée au meurtre du père, la lecture de Kristeva considère des domaines plus enfouis : celui du « sous-sol », du clivage, et insiste sur la difficulté des personnages femmes et homme à élaborer le « féminin » en eux.
Son interprétation insiste sur le pouvoir déstabilisant de la lecture de Dostoïevski. Lire Dostoïevski c’est accepter de nous laisser transporter aux limites, tout comme nous acceptons de l’être en écoutant nos patients. Lire Dostoïevski, c’est « vivre dans le texte ce bousculement des normes et des lois jusqu’à l’effacement de ‟l’ultime limiteˮ », jusqu’à « perdre pied ».
Les trois temps de la découverte de l’œuvre
L’histoire d’une rencontre importante avec un auteur comporte souvent plusieurs phases initiées par des contextes et des liens particuliers. Pour Kristeva, la lecture de Dostoïevski a été marquée par trois hommes.
En premier lieu, et l’anecdote est profonde, Kristeva nous apprend avoir découvert Dostoïevski en s’opposant à son père : « Mon père m’en déconseilla sévèrement la lecture », dit-elle en précisant que ce dernier la poussait vers la culture française. « Évidemment, comme d’habitude, j’ai désobéi aux consignes paternelles et j’ai plongé dans Dosto. Éblouie, débordée, engloutie » (p. 10). Cette « plongée » est dès le début inscrite sous le signe de la conflictualité entre l’univers russe et français, d’une transgression subjectivante, du dépassement des « bornes » paternelles. Mais la conflictualité engage également l’idéologie dominante qui « brocardait l’‟obscurantisme religieuxˮ de l’écrivain ‟ennemi du peupleˮ » (p. 9). Si l’auteur, bulgare d’origine, a fait de la France sa nouvelle patrie, suivant en cela les conseils paternels, elle montre aussi la fonction d’une forme de « désobéissance » pour se construire subjectivement. Par la suite, étudiante en philologie française et littérature comparée, Kristeva lut Dostoïevski en français et commença à éprouver la portée de son langage.
Mais le second temps fort de sa découverte fut la seconde édition de l’ouvrage de Mikhaïl Bahktine : Problèmes de la poétique de Dostoïevski,qui annonçait la période de dégel et de ce fait « devenait un phénomène social, un symptôme politique » (p. 13). La lecture de Bahktine qu’elle fit avec la complicité d’un « ami et mentor », Tzvetan Stoyanov, « célèbre critique littéraire, anglophone, francophone, et évidemment russophone », a profondément et durablement marqué sa pensée. Bahktine a en effet souligné l’importance du dialogue « devenu, selon Dostoïevski, structure profonde de la manière d’être au monde, ‟toute chose est à la frontière de son contraireˮ » (p. 14). Dans les romans, le narrateur, tiers externe, laisse la possibilité à d’autres voix opposées de s’exprimer, et ne prend jamais position pour l’une d’entre elles. Le caractère « polyphonique » de ses romans en constitue l’originalité radicale ainsi que le sérieux carnavalesque : « Bahktine nous avait convaincus que Dostoïevski s’était frayé une voie inouïe : ni tragédie,ni comédie,mais tout en empruntant à la satire latine médiévale et renaissante, plus corrosive que le dialogue socratique, sans être pour autant cynique »(p. 16). Kristeva souligne aussi que dans un contexte où l’idéologie soviétique gangrénait la pensée, « la dimension carnavalesque » donnait accès à une expérience intérieure qui apparaissait comme un « contrepoids » essentiel au carcan ambiant.
Le troisième temps, après son arrivée à Paris, fut marqué par la lecture de Freud. Bien que « Dostoïevski et le parricide » soit centré sur le point de vue œdipien, Kristeva rappelle que cet article est écrit au moment où Freud « est en train de modifier sa conception de l’appareil psychique : le refoulement, l’Œdipe et la névrose ne suffisent pas ; dans Au-delà du principe de plaisir (1920), Thanatos surgit à l’œuvre en dédoublant Éros. C’est le « travail du négatif », appelez-le négation, déni,ou forclusion, qui spécifie l’être parlant » (p. 20). L’œuvre de Dostoïevski se révèle dans ce cadre de pensée où une place est attribuée à ce qui fait vaciller le sens et où l’on se risque à explorer les sous-sols de la névrose et de ses mécanismes : « On appellera ce lieu où la névrose s’effrite et où les démons dostoïevskiens affluent : ‟clivageˮ, ‟coupureˮ, ou ‟refente du sujetˮ » (p. 21). Dostoïevski est alors présenté comme un « psychanalyste avant la lettre » qui « réussit à percer le brouillard des fantasmes névrotiques dans lequel le maintenaient ses écrits pré-sibériens, en découvrant leur sous-sol :le clivage lui-même – le seuil ultime du rejet primaire, le centre vide de la schize, la refente du sujet » (p. 22). Contrairement à Freud, qui considérait la croyance de l’auteur russe comme « une position de repli », « un point faible[2] », Kristeva affirme que « Son optimisme et sa glorification de l’énergie pensante[…] sont incompréhensibles sans sa foi (vera en Russe) christique dans le Verbe incarné. Ses romans sont christiques, son christianisme est romanesque » (p.23). Dostoïevski et avec lui tous les grands artistes constituent d’« insolents défis dans le hors-temps du temps. » (p. 23).
Itinéraire dans l’œuvre de Dostoïevski
Après avoir retracé les étapes de sa découverte de Dostoïevski, Kristeva chemine dans l’œuvre en explorant plusieurs lignes thématiques et en soulignant l’entrecroisement entre les événements de la vie de l’auteur et son processus d’écriture.
En premier lieu, elle souligne le tournant que représentent ses neuf ans d’emprisonnement en Sibérie, dont quatre années de bagne. Cette expérience a fait émerger « un nouveau narrateur : le criminel de droit commun », héros de son ouvrage La maison morte (p. 24), ouvrage dans lequel « l’univers concentrationnaire du xxe siècle se profile déjà ». Ainsi dit Kristeva, « Il ne suffit pas de se dédoubler, comme un narrateur planqué dans les ombres de ses personnages ; il est possible de se réunir avec la pulsion de mort universelle, vide absolu ourlé de certitude, mais qui devient une joie. La joie de pouvoir la jouer-déjouer : de l’écrire » (p. 25). Elle montre que dans son ouvrage suivant, les Carnets du sous-sol, « une autre écriture s’élabore » dans laquelle l’écrivain explore le clivage : « Dans la structure du récit lui-même s’annonce une espèce de nouveau savoir – ni gai ni désolé, mais poignant et ardent –, celui du clivage,le centre vide du dédoublement, l’état limite où s’éclipsent le sujet et le sens. Que le clandestin a découvert à force de se guérir par l’écriture » (p. 27). L’écriture de Dostoïevski, expérience vitale marquée par son vécu épileptique, révèle ce que les recherches psychanalytiques s’attacheront à élucider ultérieurement : « Ces états limites de déliaison, refente, coupure sont devenus accessibles à la recherche analytique seulement au siècle suivant la disparition de l’auteur. Dostoïevski s’en est approprié l’expérience psycho-sexuelle dans un geste de survie, qui réinvente le roman de la pensée habitée par le clivage » (p. 28).
Par la suite, avec Crimes et châtiments (1867), l’accent est mis sur le meurtre de la mère qui soulève la problématique du féminin dont Kristeva souligne les différents aspects. Rodion le criminel et Sonia la prostituée sont unis par une même souffrance. « Sonia devine que Rodion a sabré, hâché la ‟choseˮ féminine en lui. Le féminin menaçant : la mère dominatrice, experte dans l’emprise par l’argent (l’usurière) qui lui tient lieu d’érotisme ; et la mère déprimée, rétive, pétrifiée en mère morte (Liza) » (p. 32). Or c’est également « la faillite du père » qui « engendre la féminité souffrante de sa fille Sonia Marmeladova, dans laquelle l’anti-héros va se reconnaître, et dont ils essaient de se libérer ensemble » (p. 33). Lien amoureux, lien transférentiel qui se révèlent dans le dialogue entre ces deux être où « ça se devine ».
Kristeva souligne alors l’importance de « l’homoérotisme »dans le processus de subjectivation. Ainsi analyse-t-elle la rencontre du Prince Mychkine et du criminel Rogogine dans L’idiot : « Les deux jumeaux mâles » qui « s’étreignent à distance, à travers le mythe charnel d’une Nastassia Filippovna qu’ils s’arrachent ou qu’ils sauvent, solidaires et rivaux » et qui « ne s’apaisent que dans leur effondrement christique, l’assassin Rogogine rendu à sa folie se laissant enfin caresser par la tendresse idiote de l’enfant absolu, le Prince » (p. 35). L’homoérotisme des deux hommes renvoie à ce que Kristeva nomme « l’homoérotisme primaire », défini comme « une expérience incontournable : capacité créatrice primaire de retrouvailles avec soi par une projection-identification avec quelqu’un du même sexe ». Historiquement, l’homoérotisme prend le relais de la « reliance maternelle » et précède l’identification avec le père aimant de la préhistoire individuelle. Ainsi « l’homoérotisme évite l’inceste et oriente la pulsion destructrice dans une quête affective du même dans l’autre. »Il est donc, selon Kristeva, « au fondement de la subjectivation, au sens fluctuant de cette expérience » (p. 35-36).
À cet homoérotisme structurant s’oppose l’obsession de la mort, car « L’homme dostoïevskien est hanté par son cadavre vivant », et le suicide apparaît comme une possibilité de révolte contre les lois de la nature. « Apothéose de la mêmeté omnipotente, qui nourrit le narcissisme négatif des frères, ce nihilisme va culminer dans le suicide raisonné de Kirilov (Les démons, 1872) » (p. 38). Mais en dehors du suicide, une autre solution consiste à chercher « l’idée réelle », c’est-à-dire « la substance, l’élément de l’érotisme selon Dostoïevski» (p. 40). Or Kristeva montre bien la manière dont la dimension corporelle apparaît dans l’écriture. Le corps « se déploie entre les plis du langage, l’érotisme chez Dostoïevski n’ignore pas le corps, mais le dissémine », si bien qu’« il se dilue dans la confusion des sexes ; guette l’explosion du féminin en soi hors de soi ; s’épuise en indifférence ; se consume en criminel ou en joueur » (p. 41).
Les figures de femmes sont également bien présentes dans les romans : femmes « hors-sexe », femmes « phallique » fières et frondeuses, femmes séductrices, femmes qui encouragent au meurtre, mères courages et mélancoliques, mères « folles » ou porteuses d’un discours antisémite exprimant en creux la position idéologique de l’auteur : « En érigeant le culte du peuple russe comme peuple ‟théophoreˮ, l’auteur se heurte immanquablement au temple de la Bible, et se fait complice des appels au meurtre de ce rival absolu, les Juifs devenus des étrangers superflus, des boucs émissaires » (p. 49). « Fières, souffrantes, dominantes, assassinées, les femmes de Dostoïevski ne sont pas seulement ‟en fonction de l’hommeˮ […] Elles révèlent aux hommes leurs propres abîmes méconnus et réprimés, elles inspirent aussi leur irréconciliable érotisme, leur solitude au féminin : à partager plus tard ou jamais. Femmes battues par le vortex des ‟ilsˮ, elles sont des îles » (p. 52-53).
Loin d’être un pionner dans la lutte féministe, Dostoïevski n’en décrit pas moins à travers ses personnages les « inépuisables ruses de la sexualité féminine »(p. 55), et à quel point le couple est marqué par son impossibilité même. Il ne craint pas d’explorer le rapport de l’homme au crime et à la perversion jusqu’à la plus sombre d’entre elles : la pédophilie. Tandis qu’Ivan Karamazov dénonce la maltraitance infantile et clame l’innocence des enfants, Stravoguine dans Les démons se confesse de la jouissance d’assister à la « fièvre sadomasochiste d’une mère et sa fille » qui mène au suicide de cette dernière : « Il sait qu’elle va se tuer, l’épie froidement, et laisse faire, en écoutant le silence de mort des moucherons. » Kristeva rappelle ici que Dostoïevski avait à plusieurs reprises « fanfaronné » en proclamant tout haut avoir violé une petite fille. Mais cette provocation sera mise en lien avec le souvenir de Dostoïevski d’avoir assisté à un viol mortel d’une petite fille lorsqu’il était enfant… C’est ainsi que Dostoïevski se plaît à déjouer les bornes en faisant « fructifier les transgressions par l’abondance du dire » et par la « jouissance de l’écriture » (p. 65).
Pour terminer, Kristeva insiste sur les différentes figures de père et sur le rapport père-fils qui fera l’objet principal des deux derniers romans de Dostoïevski, L’adolescent,et Les frères Karamazov. Le premier roman porte sur « le besoin de croire absolu qui constitue tout adolescent » et annoncera la thématique du parricide « auquel mènent nécessairement les passions charnelles », et que le second ouvrage développera. Avec Les frères Karamazov «s’amorce pour de vrai la résurrection des pères mis à mort par et dans la transformation des fils » (p. 69). Kristeva consacre des pages très denses à cet ultime ouvrage polyphonique et conclut sur l’importance de l’érotisme maternel comme condition de survivance au meurtre du père : « Aux lecteurs errants dans cette polyphonie d’entendre que c’est en se coulant dans l’énergie de l’érotisme maternel que le fils survit au meurtre du père. Et que le ‟Sodomeˮ de Dimitri aspire et assume aussi bien l’insoutenable hystérie du désir féminin que le vouloir souverain de la féminité » (p. 78).
En suivant le fil de la polyphonie romanesque, Julia Kristeva explore donc toute la profondeur psychique à laquelle Dostoïevski nous donne accès par la puissance de son processus sublimatoire, et montre à quel point son écriture nous fait vivre les contradictions et les tensions qui traversent ce « champ de bataille » qu’est la réalité. Ainsi Kristeva achève-t-elle son cheminement par ce vœu : « Quand les répercussions de ce champ de bataille nous échappent, puissions-nous relire Dostoïevski. Proliférants dialogues qui ne sont pas un moyen, mais LE but. Le seul encore possible ? Nous approchons, avec leurs indécidables tensions, comme le centre d’une beauté qui nous constitue et qui saurait, peut-être, nous survivre. »
Kalyane Fejtö est psychanalyste, membre de la SPP.
[1] La collection « Les auteurs de ma vie » invite de grands écrivains contemporains à partager leur admiration pour un classique, dont la lecture a particulièrement compté pour eux.
3. On connaît la phrase tranchante de Freud : « Dostoïevski n’a pas su être un éducateur et un libérateur des hommes, il s’est associé à leurs geôliers ; l’avenir culturel de l’humanité lui devra peu de chose. Qu’il ait été condamné à un tel échec du fait de sa névrose, voilà qui paraît vraisemblable. Sa haute intelligence et la force de son amour pour l’humanité auraient pu lui ouvrir une autre voie, apostolique, de vie. »
Jean-Claude Lavie, Le sexe dans la bouche, par Corinne Ehrenberg
 Jean-Claude Lavie nous a quitté juste avant la parution en librairie de son dernier ouvrage intitulé Le sexe dans la bouche ; c’est aussi le titre d’un des chapitres qui a pour ambition de rappeler qu’en psychanalyse le sexe se manifeste par la bouche de qui l’évoque de façon directe ou détournée. En effet, « le signifié est affaire d’entendement, le signifiant est affaire d’écoute ». Lavie porte un coup très dur à la scientificité de la psychanalyse dans la mesure où force est de constater que les analystes ne sont pas tous sensibles au même signifiant : « Il en résulte que le signifiant qui est au cœur de l’écoute analytique se révèle être en même temps le plus perfide ennemi de la scientificité de la psychanalyse, pour l’indétermination de sens qu’il consent. »
Jean-Claude Lavie nous a quitté juste avant la parution en librairie de son dernier ouvrage intitulé Le sexe dans la bouche ; c’est aussi le titre d’un des chapitres qui a pour ambition de rappeler qu’en psychanalyse le sexe se manifeste par la bouche de qui l’évoque de façon directe ou détournée. En effet, « le signifié est affaire d’entendement, le signifiant est affaire d’écoute ». Lavie porte un coup très dur à la scientificité de la psychanalyse dans la mesure où force est de constater que les analystes ne sont pas tous sensibles au même signifiant : « Il en résulte que le signifiant qui est au cœur de l’écoute analytique se révèle être en même temps le plus perfide ennemi de la scientificité de la psychanalyse, pour l’indétermination de sens qu’il consent. »
Lavie avait un ennemi déclaré, l’objectivation ou pire la chosification qu’il dénonçait dans la façon dont les analystes témoignaient de leur pratique de la cure. Il soutient que celui ou celle que notre esprit constitue comme patient est forcément réduit à être « une construction imaginaire conçue par notre façon personnelle d’entendre et d’intégrer son attente inconsciente ».
Pour s’en prémunir lui-même, il a trouvé un style, son style, car même si le rêve de chaque psychanalyste qui « théorise » sa pratique est de forger un concept qui pourrait lui garantir une existence au-delà de la sienne, son ambition se heurte à une réalité assez déconcertante quand il s’aperçoit que le sens et la portée des mots, ceux des analysants autant que ceux de l’analyste, dépendent moins de qui les prononce que de qui les entend et ne va guère au-delà : « Ce que les adeptes de Freud, depuis les plus illustrent, jusqu’à vous et moi, peuvent s’autoriser à formuler se limite donc à de simples connotations, exercices de style parfois des plus intéressants parfois, pourrais-je dire, des plus anecdotiques au regard de l’intangible singularité de la méthode. »
L’ouvrage comprend une série de textes dont le fil rouge est la pratique de la psychanalyse. Le premier texte est à lire comme une nouvelle de science-fiction : ce début déroutant est destiné à « éloigner de ce texte les savants, les sérieux, les profs pour que seuls ne restent ici que ceux qui n’ont rien de mieux à faire qu’à vivre en se demandant pourquoi ils le font, car pour ceux-là se demander pourquoi ils me lisent est une question plus facile à poser que pourquoi ils vivent ». Le ton est donné !
La panthérapie est présentée par son créateur comme une « utopique fulgurance », une thérapie universelle censée opérer en une seule séance ! Alors que nombre d’analysants se désespèrent de la longueur des analyses qui contrevient à l’air du temps, Lavie imagine, dans une « utopique fulgurance », une cure ultra brève.
Lavie ne le sait que trop bien, lui qui s’est confronté tout au long de sa vie de psychanalyste aux résistances de ses analysants, les hommes ne veulent pas changer : « On ne peut craindre un traitement que si c’est malgré soi qu’il vous modifie. Si bien des gens s’engagent dans une psychanalyse, sans trop savoir en quoi cela consiste, c’est parce qu’ils ne soupçonnent pas qu’ils puissent en être radicalement changés… Ils croient que c’est l’effet sur eux de ce qu’ils pourront comprendre, donc maîtriser, qui leur permettra de se corriger, alors que c’est ce qui va les faire réagir à leur insu aux sollicitations de la situation qui les réformera. Sans qu’ils s’en doutent, c’est de se mesurer à la règle de tout dire qui va être principalement à l’œuvre. »
Un des intérêts de la nouvelle vient du fait que Lavie se trouve en place de « patient », façon pour lui de nous rappeler que l’analyste, bien qu’ayant fait lui-même une longue analyse voire plusieurs, n’en n’est pas moins soumis aux formations de l’inconscient et à ses effets de résistance. Il imagine que l’immédiateté promise de la « guérison » aurait sur lui l’effet d’une interprétation sauvage : elle lui soufflait que lui non plus, il ne voulait pas changer. C’est alors pour lui l’occasion de montrer à quel point « nous sommes les esclaves des liaisons qui nous constituent au prix de symptômes parfois pénibles mais rassurant par leur pérennité identifiante », autrement dit « toute psychanalyse serait un parcours de rêve si elle ne réveillait une aversion pour le changement ».
Cette nouvelle thérapie, on découvre qu’elle permet à Lavie de reformuler dans un langage ordinaire la plupart des concepts fondamentaux de la psychanalyse et de les rendre très accessibles au lecteur.
Prenons les résistances dans le transfert et les résistances de transfert : « Votre hostilité envers cette cure est un peu son moteur ; elle est l’équivalent d’une phobie de la nouveauté ; elle révèle en vous un rejet préalable et permanent de toutes les potentialités inconnues que vous recelez, donc de tout ce que vous pourriez être, à commencer par ce que vous avez envie d’être et que vous retenez. Cette cure vous fera discerner les freins qui vous constituent dans cette expérience ; si vous ne sentez aucune opposition, il ne se passera rien. Ce sont vos réticences ou vos peurs qui vont être l’agent de vos changements. »
Si la cure appelée Panthérapie diffère notablement d’une cure analytique, toutes les deux ont ceci en commun qu’elles plongent le patient dans une réalité virtuelle.
Une fois endossé l’équipement qui permet d’entrer dans la réalité virtuelle (comme lorsque le patient s’allonge sur le divan), le patient entre dans une réalité virtuelle (comme dans un transfert imaginaire) et se trouve devant une multitude de portes (comme Joseph K., le personnage principal du roman Le Procès de Franz Kafka) sur lesquelles est écrit : « Réservé à ceux qui osent. » S’ensuit un labyrinthe où l’on suit avec une certaine appréhension la progression du patient qui va traverser nombre d’angoisses en relation avec la loi et les interdits, les identifications, l’inquiétante étrangeté, le narcissisme, le transfert et sa place dans les institutions.
La nouvelle ne manque pas d’humour surtout quand Lavie attire l’attention du lecteur sur la seule différence de cette cure instantanée avec la psychanalyse : l’absence de psychanalyste !
Il nous rappelle également avec force (celle du transfert de chaque analyste sur le père fondateur) que l’apport génial de Freud est d’avoir rapporté la portée des paroles qui lui était adressée à la dynamique actuelle de leur énonciation.
Dès lors, « Écrire à la chair mère », deuxième texte de l’ouvrage me semble avoir été suscité par ces rappels essentiels et par les lettres de son ami Wladimir Granoff à sa mère. Ces lettres à la mère lui ont inspiré un certain nombre de réflexions sur la dépendance affective aux personnages de son histoire passée, comme « un véritable écrit du cœur ».
Cet écrit du cœur consiste néanmoins à transformer la dépendance première à la mère en dépendance actuelle : « Qu’aurais-je encore au présent à exiger d’elle ou à lui refuser ? Qu’est-ce qui en moi exigerait une mise à jour de notre relation ? »
Désigner la mère comme la destinataire potentielle d’une lettre viserait à la chosifier en en faisant une figure s’agitant devant soi, une personne à son service. Cela cacherait son empire sur soi passé et réactualisé par l’adresse.
Or l’imago maternelle dont le pouvoir est puissant et déterminant n’est pas la mère : c’est la mère dans l’enfant et sa fonction dans le drame œdipien qui va structurer son psychisme et lui permettre de prendre stature humaine. « Cette mère-là n’est pas facile à joindre encore moins par courrier. »
Ainsi l’objet « mère » n’a pas que de qualités comme pourrait en avoir un objet « observé », c’est la saisie analytique qui les lui confère ; elles n’existent que grâce à la méthode qui les met en évidence.
Il en va de même pour le symptôme, c’est l’écoute analytique qui lui attribue des caractéristiques névrotiques puisque la théorie psychanalytique a été conçue par Freud pour rendre compte de son expérience.
C’est là, comme nous le rappelle vigoureusement Lavie, toute la difficulté de l’enseignement de la psychanalyse : « Enseigner comment penser sans enseigner quoi penser. »
Il est possible de lire ce livre comme une suite d’aphorismes qui met la pensée du lecteur à l’épreuve d’être à même de penser contre lui-même, ou plutôt contre son « savoir » dès lors qu’il s’entretiendrait dans l’illusion qu’il en détient un, indépendamment de son écoute.
À ceux qui sont las des concepts psychanalytiques égrenés dans les échanges scientifiques, qui les trouvent usés à force de ressassements, à ceux-là je conseille vivement la lecture de ce livre.
Corinne Ehrenberg est psychanalyste, membre de l’APF.
Richard Rechtman, La vie ordinaire des génocidaires, par Benoît Servant
 Richard Rechtman est psychiatre, psychanalyste et anthropologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a créé et dirige depuis 1990 le dispositif de consultations spécialisées pour réfugiés cambodgiens au sein du Centre Philippe-Paumelle de Paris. À partir de cette expérience clinique, il poursuit depuis de nombreuses années une réflexion sur l’intentionnalité génocidaire chez les « petits exécutants » de la dictature khmère rouge, qui a donné lieu à de nombreuses publications (dont un article pour la Revue française de psychanalyse, « Faire mourir et ne pas laisser vivre », in 2016/1, « Pourquoi la guerre ? »). Le présent ouvrage approfondit cette thématique, en l’enrichissant d’ouvertures tant vers les débats passés sur la « banalité du mal » et la soumission à l’autorité, que vers les interrogations récentes sur la radicalisation meurtrière de Daech. Il en arrive ainsi à une question cruciale : s’il y a sans doute de multiples explications qui permettent de comprendre comment des gens « ordinaires » peuvent, dans certaines circonstances, accepter de devenir génocidaires, quels ressorts particuliers font pourtant que d’autres, dans le même contexte, les refusent au contraire, parfois au péril de leur vie ?
Richard Rechtman est psychiatre, psychanalyste et anthropologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a créé et dirige depuis 1990 le dispositif de consultations spécialisées pour réfugiés cambodgiens au sein du Centre Philippe-Paumelle de Paris. À partir de cette expérience clinique, il poursuit depuis de nombreuses années une réflexion sur l’intentionnalité génocidaire chez les « petits exécutants » de la dictature khmère rouge, qui a donné lieu à de nombreuses publications (dont un article pour la Revue française de psychanalyse, « Faire mourir et ne pas laisser vivre », in 2016/1, « Pourquoi la guerre ? »). Le présent ouvrage approfondit cette thématique, en l’enrichissant d’ouvertures tant vers les débats passés sur la « banalité du mal » et la soumission à l’autorité, que vers les interrogations récentes sur la radicalisation meurtrière de Daech. Il en arrive ainsi à une question cruciale : s’il y a sans doute de multiples explications qui permettent de comprendre comment des gens « ordinaires » peuvent, dans certaines circonstances, accepter de devenir génocidaires, quels ressorts particuliers font pourtant que d’autres, dans le même contexte, les refusent au contraire, parfois au péril de leur vie ?
La double pratique de psychiatre psychanalyste et d’anthropologue de Richard Rechtman me semble en elle-même très intéressante : l’anthropologie ne constitue-t-elle pas aujourd’hui l’une des sources majeures de renouvellement de la pensée clinique (en contrepoint à l’impérialisme des neurosciences), que l’on pense à l’évolution de la famille, de la sexualité et de la vie amoureuse, à l’envahissement par les technologies numériques, aux transformations du travail ou de l’État-providence ? Ces différents exemples nous rappellent en effet que la vie psychique ne se comprend pas sans référence à l’insertion du sujet dans une culture et un tissu social et affectif, qui en retour déterminent en grande partie ce que les sujets considèrent à une époque donnée comme relevant de soins psychiques.
Mais l’intérêt du point de vue anthropologique est ici élevé « au carré », puisque si la violence d’État est en elle-même un phénomène social et non individuel, la question lancinante que soulève l’ouvrage est celle de l’acceptation par un grand nombre de personnes de participer à des massacres d’individus sans défense et non menaçants, sans adhésion idéologique et avec pour seule motivation d’effectuer le travail demandé. Ce qui taraude l’auteur semble bien être le constat de l’indifférence envers une transgression démultipliée de l’interdit du meurtre que ne justifie aucun danger vital, n’explique aucune passion haineuse, et dont seul pourrait rendre compte un conformisme lâche. Mais on sent derrière cette insistance de l’auteur sur le caractère « ordinaire » de ces vies de génocidaires une dénonciation violente du pouvoir de l’État sur ses sujets ; plus précisément de l’intériorisation de ce pouvoir dans la soumission d’individus que n’obligent aucune menace ou contrainte physique (thème sur lequel on peut reconnaître l’héritage de la pensée de Michel Foucault).
Dans cette influence de l’idéologie de l’État sur ses « petits exécutants », l’auteur relève une constante de l’ensemble des situations évoquées, au-delà du Cambodge des Khmers rouges (Shoah, Rwanda, ex-Yougoslavie, Daech, mais aussi armée américaine au Viet Nam) : la condition pour qu’ils puissent ainsi tuer en masse sans état d’âme autre que la fatigue ou la difficulté « matérielle » que cela représente, c’est la perte préalable d’humanité des victimes pour les bourreaux, et donc l’indifférence envers leur meurtre : le Juif pour les nazis, les Tutsis pour les Hutus, les Bosniaques pour les >Croates et les Serbes, les mécréants pour les radicalisés de Daech, les Nord-Vietnamiens pour les soldats américains.
Or cette condition préalable rendrait inutile d’attribuer au génocidaire une quelconque satisfaction sadique, faisant de lui un « monstre ». Ainsi l’auteur met-il de côté les réflexions d’Elias et surtout de Freud sur la « régression » dont témoigneraient les temps de guerre : « La théorie freudienne n’avait pas prévu que ces ‟hommes monstresˮ ne représenteraient qu’une infime minorité de ceux qui participèrent et participent de nos jours aux crimes de masse. Des individus bien plus ordinaires qui n’ont même pas besoin de mobiliser des motions archaïques, des pulsions sadiques, ou leur pulsion de mort, pour commettre au quotidien et sans état d’âme des meurtres de masse, des massacres de civils sans défense, des assassinats de familles, de villages et de populations entières » (p. 81).
Commentant le travail d’Hannah Arendt sur « la banalité du mal » à propos du procès d’Eichmann, l’auteur pense qu’il est peut-être plus important de se pencher sur les exécuteurs, ainsi que l’a fait Christopher Browning dans son travail sur les réservistes de la police allemande qui ont procédé à des exécutions de masse des Juifs en Pologne (« Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne »). Celui-ci soutient « que la situation compte bien plus que l’histoire antérieure et personnelle de chaque participant […] [L’]inversion des normes morales, la compartimentation de la société qui permet de répartir les populations dans des groupes totalement hermétiques, et enfin la soumission à l’autorité » (p. 101 sq). Sur ce dernier point, l’auteur rappelle l’expérience bien connue de Milgram auprès d’étudiants amenés, par obéissance, à pratiquer des sévices sur de faux sujets d’expérience.
Mais plutôt que parler d’« hommes ordinaires », ce qui tenterait de rendre compte du basculement d’un individu vers le meurtre de masse d’un point de vue de sa psychologie individuelle, l’auteur préfère mettre l’accent sur « la vie ordinaire » des génocidaires, en le considérant comme un « fait social total », au sens classique de la sociologie durkheimienne ou maussienne.
« Alors que les travaux que j’ai présentés dans les précédents chapitres cherchaient tous à expliquer pourquoi des hommes étaient capables de tuer d’autres hommes sans défense, par centaines, et sans motifs personnels, je propose d’appréhender les conditions sociales et individuelles qui permettent à des hommes d’être globalement indifférents à la mort des autres » (p. 132). L’auteur indique ici que la plupart d’entre eux auraient pu, « sans grand risque pour leur vie », refuser, mais ne le firent pas. Or, pour lui, cette indifférence est avant toute chose, « politique et sociale.[…] [elle] s’inscrit dans une organisation sociale complexe où l’administration de la vie sociale est entièrement régie par la séparation et l’élimination physique d’une partie de la population » (p. 137). Après l’ancienne prérogative du pouvoir régalien, faire mourir et laisser vivre, auquel s’est substitué le biopouvoir contemporain, faire vivre et laisser mourir, tel que l’a décrit Michel Foucault, les régimes génocidaires appliquent eux le faire mourir et ne pas laisser vivre (puisque la mort est produite soit par meurtre direct soit par le fait de laisser les victimes sans nourriture et sans soins).
Dans le chapitre « Administrer la mort », Richard Rechtman revient sur les débats sur la qualification des massacres de masse au Cambodge par les Khmers rouges : génocide, autogénocide, génocide de classe, opposant en particulier le désir de l’État de soumettre une partie de la population dans un but politique (comme en Chine lors de la révolution culturelle), et sa volonté d’extermination. Or dans ce dernier cas, « les méthodes de gestion et d’élimination des différentes populations considérées comme des ennemis du pouvoir sont le plus souvent identiques. […] Administrer la mort consiste d’abord à recruter au sein des groupes les plus disponibles. […] catégorie fluctuante […] qui se caractérise par la facilité avec laquelle ces hommes et ces femmes vont accepter, plus ou moins volontairement, plus ou moins spontanément, d’apporter leur concours à la mise en œuvre de l’élimination systématique d’une partie de la population. Le seul trait commun que l’on retrouve [chez eux] c’est justement leur indifférence » (p. 167).
Ces notions constituent le cœur de la thèse de l’auteur dans cet ouvrage, le nœud de ses interrogations, et, me semble-t-il, de sa profonde révolte. Celle-ci se laisse percevoir dans la suite du chapitre lorsqu’il détaille la manière dont les génocidaires cherchent, dans leur « gestion » des cadavres, à déshumaniser leurs victimes (le traitement des dépouilles étant au contraire au fondement de la culture). Il nous présente en effet un tableau très saisissant du contraste (devrions-nous dire du clivage ?) entre l’indifférence des exécuteurs, véritables « fonctionnaires » de cette administration génocidaire, et l’énormité de la violence que constitue, par-delà les souffrances infligées et la mort donnée, le déni de l’humanité des victimes. Comment ne pas faire le lien entre les deux, à travers la perte d’humanité des bourreaux eux-mêmes avant tout ? Or l’insistance de l’auteur sur leur indifférence me semble mettre en exergue le rôle de l’État, « l’organisation sociale » qui conduit au faire mourir et ne pas laisser vivre. C’est bien parce que la transgression de l’interdit du meurtre s’autorise de l’autorité de l’État que les exécuteurs pourraient garder cette indifférence.
Pourtant l’auteur ne souhaite pas exonérer ces derniers de leur responsabilité ; il regrette même que dans les procès qui ont suivi, on n’ait poursuivi que les hauts responsables, et laissé tranquilles les premiers (note p. 69).
Le détour par le témoignage de Fernand Meyssonier (p. 183 sq), bourreau de la République française en Algérie durant la guerre d’indépendance, est bien là éloquent pour illustrer comment le meurtre légal ne peut se perpétrer que dans des conditions précises et bien balisées. Seules celles-ci permettaient de conserver une forme d’humanité.
Or c’est bien ce qui n’est plus respecté par les pouvoirs génocidaires, ce qui fait que les responsables en sont poursuivis pour « crime contre l’humanité ».
Et c’est ainsi que j’interpréterai donc cette tension perceptible dans l’argumentation de Richard Rechtman entre responsabilité de l’État, et responsabilité individuelle, dans les génocides. Il me semble qu’il veut souligner d’une part, dans la lignée de Michel Foucault, le pouvoir virtuel de tout État, parce qu’il vise l’assujettissement et l’imposition des normes, d’une violence symbolique dont le signe le plus marquant est toujours l’exclusion d’une partie de la communauté, et la passivité, voire la complicité du plus grand nombre, au nom de la préservation du groupe (voir l’importance du voisinage : p. 200 sq) ; d’autre part la possibilité pour quelques individus, très minoritaires, de s’opposer néanmoins à cette violence, au risque d’y perdre leur place, et donc souvent leur vie. Dilemme qui traverse l’histoire française récente, de l’occupation allemande à la guerre d’Algérie, mais dont témoigne aussi le long déni des intellectuels de gauche sur les crimes communistes, et encore aujourd’hui le prestige d’un Alain Badiou (pourtant soutien des Khmers rouges jusqu’à leur chute) auprès des jeunes générations.
Bien qu’il insiste au long de l’ouvrage sur l’absence de risque à dire non pour les exécuteurs cambodgiens (ce qui renforce l’idée du pouvoir de soumission symbolique de l’État), il en est tout autrement dans ce qu’il aborde dans sa conclusion : la situation de jeunes hommes fuyant leur pays pour ne pas se soumettre aux exigences de Daech ou des taliban de participer à leurs exactions. On peut toutefois se demander si la comparaison est vraiment légitime, tant les situations semblent différentes, et s’interroger par ailleurs sur les enjeux que l’auteur soulève implicitement. Car il pose la question à ce sujet du refus de l’État françaisd’accorder le statut de réfugiés politiques à ces jeunes hommes, ce qui, associé à la dénonciation du laisser mourir les migrants aux frontières de l’Europe (p. 139), devient une interpellation à l’égard de notre possible indifférence.
L’auteur insiste tout au long de l’ouvrage sur la place secondaire de l’idéologie qui sous-tend les politiques génocidaires, du point de vue des exécuteurs. N’est-ce pas réduire un peu vite la compréhension des totalitarismes du xxe siècle, qualifiés parfois de « religions séculières », et dont on a pu à bon droit, me semble-t-il, interpréter les violences meurtrières comme découlant de ce que, ne répondant pas aux aspirations du peuple qui les avaient portés au pouvoir, ils se trouvaient réduits à « changer le peuple » ? La partie du peuple vouée à disparaître n’est-elle pas toujours peu ou prou le bouc émissaire auquel on attribue le retard à l’avènement du bonheur promis, et qu’il faut donc sacrifier ?
Au terme de cette recension, ne nous faut-il pas reconnaître qu’il est sans doute extrêmement difficile d’expliquer des situations aussi terrifiantes ? Chacun, en fonction de son angle d’approche, n’est-il pas tenté de privilégier un des facteurs possibles (psychologique, politique, anthropologique) ? Notre volonté d’analyser néanmoins ce qui menace nos valeurs les plus fondamentales témoigne sans doute, heureusement, de notre espoir de trouver un point d’appui pour combattre ces dérives monstrueuses.
Benoît Servant est psychanalyste membre de la SPP.
Florian Houssier, Freud adolescent, par Delphine Bonnichon
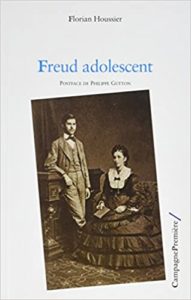
Ce livre de deux cent six pages comporte, outre la bibliographie, un index des noms propres, et une postface de Philippe Gutton qui resitue l’apport de cet ouvrage autour de la pensée du processus adolescent.
D’emblée, en se positionnant comme historien de la psychanalyse, alliant ici deux facettes – celle du psychanalyste et celle de l’archéologue-historien –, Florian Houssier précise son objectif tout en maintenant sa volonté ferme de conserver une perspective scientifique : « partir de la biographie [de Freud] pour, ici et là, pointer les reflets de son adolescence sur ses futures théorisations » (p. 9) et ainsi ouvrir un véritable triptyque entrelaçant clinique, théorie psychanalytique et biographie. L’idée étant que l’œuvre du père fondateur de la psychanalyse ne peut être que « biographico-créée » (p. 12). C’est dire l’importance des interactions ici mises en lumière entre l’histoire de vie du sujet que fut Freud notamment au décours de son adolescence et ses productions telles que la création de la psychanalyse comme théorie, mais aussi comme pratique. Il s’agit ainsi de remonter la filiation, notamment autour de la psychanalyse de l’adolescence, de s’y inscrire et de la penser pour éviter d’en être le jouet, l’ignorance se faisant souvent le terreau de la compulsion de répétition. Si le fantasme d’auto-engendrement, fantasme omnipotent convoqué par la traversée adolescente, peut apparaître séduisant bien que mortifère, s’inscrire dans une filiation apparaît plus dynamique. Pour ce faire, l’adolescence de Freud sera retracée et étudiée à partir de plusieurs textes clés tels que les cas cliniques de jeunes déployés dans Études sur l’hystérie (1895), ainsi que le cas de Dora (Cinq psychanalyses, 1905), son ouvrage sur les rêves (L’interprétation des rêves, 1900) et ses lettres de jeunesse (1871-1881), notamment celles adressées à son meilleur ami de l’époque, Eduard Silberstein. Or Houssier souligne que les nombreuses biographies de Freud tendent à laisser percevoir une relative méconnaissance de son adolescence se profilant alors, tel un point aveugle, méconnaissance doublée d’un certain aplanissement, voire d’une banalisation, non sans résonance d’ailleurs avec les propres défenses de Freud autour de ce qu’a pu impulser sa puberté en termes de mise à distance. Cela est d’autant plus étonnant qu’à y regarder de plus près l’adolescence de Freud apparaît comme un des temps les plus douloureux de sa vie. Houssier termine ce préambule en retraçant les éléments clés constitutifs du processus adolescent tel qu’il a pu être pensé par les psychanalystes plus contemporains (Pierre Mâle, Évelyne Kestemberg, Philippe Gutton, Annie Birraux, Jean Jacques Rassial, Jeanne Lampl-de-Groot), à partir de leur présence discrète dans l’œuvre freudienne, et ce avec l’idée sous-jacente qu’un œil averti percevra plus aisément la vivacité des enjeux conflictuels du processus adolescent. Il évoque notamment les notions de traumatisme, d’après-coup, d’inquiétante étrangeté, d’idéal et de désidéalisation, ainsi que la question des vœux meurtriers et incestueux dont il s’agit de se dégager, soit autant de notions centrales dans le champ de la clinique adolescente qui se verront ici mises au travail autour de l’adolescence de Freud.
Dans le premier chapitre, il s’agit d’établir les bases, en termes biographiques, les plus saillantes sur lesquelles l’adolescence de Freud a pu se construire. Si nous n’entrons pas encore pleinement dans le sujet de ce livre – l’adolescence de Freud –, Houssier en pose les jalons. Il retrace l’enfance émaillée de pertes et de séparations de Freud, le tout dans un climat familial accaparé par le deuil. Son père, Jacob, perdit en effet ses deux premières femmes après avoir eu des enfants avec la première. Peu avant la naissance de Freud, le grand-père paternel, Schlomo, mourut. Alors qu’il avait onze mois, le frère cadet de Freud, Julius, décéda. À ce cortège de pertes s’ajoutent de multiples absences de la mère qui environ tous les deux ans mit au monde un bébé, et ce jusqu’aux dix ans de Freud. Enfin, ses premières années furent marquées par la disparition soudaine de sa nourrice renvoyée pour vol.
Mais Sigismund est aussi l’enfant préféré de sa mère qui le dénomme « mon Sigi en or », ce qui va susciter pour le jeune garçon des rêves de grandeur et nourrir son ambition. Si Freud s’emploie par la suite à séduire sa mère en devenant le grand homme qu’elle espère, il va aussi par sa réussite adresser un message fort et empreint d’ambivalence à son père.
Aux nombreuses séparations que Freud eut à traverser, son père Jacob en ajouta une qui fit éclater le monde uni qu’il connaissait jusqu’alors. Jacob ayant reçu en héritage de la part de son propre père un commerce, il ne parvint pas à le maintenir viable, fit faillite, ce qui imposa un déménagement de Freiberg à Vienne alors que Freud a trois ans. Ce faisant, il perd son meilleur ami et neveu John. Il ne reviendra dans sa ville natale qu’à l’âge de quinze-seize ans, invité par la famille Fluss qu’il idéalisera puisque le père Fluss réussit précisément là où son père a échoué et qu’il connaîtra son premier amour adolescent : Gisela Fluss. Ces deux éléments, l’échec paternel et les séparations qu’il va impliquer pour Freud, teinteront d’ambivalence marquée et d’une dimension passionnelle l’ensemble de ses relations amicales homo-érotiques à venir. S’il s’agira pour Freud de surpasser le père, en réussissant là où il a échoué, laissant percer les fantasmes de meurtre du père, ce mouvement se double d’une tentative de restauration d’une image de père dés-idéalisée et humiliée. Face à ce père vécu comme fragile et déchu, Freud s’éprend de figures héroïques historiques auxquelles il aime s’identifier, ouvrant la voie à ce qui deviendra une véritable passion : la lecture, qui lui permet également de garder un lien de filiation avec cette figure paternelle en partageant l’amour des livres. Il se positionne également, en tant qu’aîné, comme figure suppléante prenant un rôle de pilier soutenant et abritant l’ensemble de la fratrie en collaboration avec son frère cadet Alexander dont il a lui-même choisi le prénom, tout comme il est intervenu pour s’opposer au mariage de sa sœur Anna.
Dans le second chapitre, nous entrons pleinement dans l’adolescence de Freud. Ce dernier couvre les années collège et lycée de Freud en abordant deux grands axes : son évolution autour de la scolarité ouvrant une voie royale à la sublimation dans laquelle il tend à s’engouffrer ; ses amitiés homo-érotiques et son lien à la figure paternelle avec laquelle il s’agit d’en découdre. Il vit l’adolescence comme un moment d’errements, de difficile détachement de la sphère familiale, de transformation douloureuse, mais aussi de rencontre, voire de plongée dans la culture et les sciences avec l’idée qu’elles lui permettront d’accomplir une véritable mission.
Au collège, puis au lycée, Freud accapare peu à peu la place de premier de la classe, passant ce faisant d’une attitude de rébellion à une attitude de leader ambitieux et méritant. Ayant de l’avance, il se sent toutefois en décalage au plan de la maturité physique avec ses camarades. Déjà, Freud se sent prêt à sacrifier sa vie pour défendre une cause et des idées, et se trouve en attente d’un destin qu’il veut grandiose. Derrière ses envies de rébellion qu’il contient pointe l’ambivalence vis-à-vis des figures d’autorité et parentales, partagé qu’il est entre l’identification à un grand homme qui refuse de se soumettre pour devenir un conquérant tel son héros Hannibal, et la culpabilité vis-à-vis de sa famille qui vit dans la misère tandis que lui ne se prive de rien. Dès sa treizième année, Freud dépeint une vie monacale, plongé qu’il est corps et âme dans les livres et la culture pour tenter d’anesthésier une excitation pressante pouvant laisser poindre des fantasmes incestueux sororaux dont l’intensité laisse planer la peur d’en devenir fou. Il maîtrise particulièrement la langue et possède un véritable talent autour de l’écriture qu’il affectionne, en témoignent ses nombreuses correspondances et écrits qui prennent leur genèse dans l’adolescence. D’ailleurs, sa quête identitaire adolescente se concrétise dans ces écrits par des réajustements autour de son nom. De Sigismund, il deviendra Sigmund entre 1872 et 1875. En se renommant, il met à distance ses origines juives et joue un fantasme d’auto-engendrement, de construction mythique du héros, tel qu’il peut également resurgir autour de la genèse de la psychanalyse.
Durant ces années, Freud engrange un flot de connaissances autour des cultures grecque et romaine dans lesquelles puiser pour construire son œuvre. Plusieurs de ses découvertes centrales prennent leur essor dans ses nombreuses lectures adolescentes, sans qu’il en ait conscience du fait d’un mouvement de répression massif qui renvoie à un fantasme parricide permettant de reléguer aux oubliettes l’apport des anciens contre lesquels la jeunesse lutte. Il en est ainsi de l’association libre puisée dans l’œuvre de Ludwig Börne, mais aussi de l’hypnose inspirée des propos de Jean-Martin Charcot, Joseph Breuer, Rudolf Chrobak ainsi qu’un spectacle. L’amitié avec les pairs comme le lien à la figure paternelle particulièrement convoquée dans cette traversée adolescente apparaissent teintés d’ambivalence, de conflits de rivalité, mais aussi en lien avec le sentiment de perte et le besoin conjoint de retrouvailles, en s’assurant que nul n’est irremplaçable ou que ce qui est perdu fait retour à travers la figure du revenant. Ainsi, ses fantasmes parricides et fratricides vifs lors de son adolescence trouvent à se jouer en empruntant la pièce de théâtre Brutus et Cassius autour de laquelle il joue avec son neveu John.
Dans le troisième chapitre, loin d’être cet adolescent aux amours platoniques et à la sexualité inexistante, Houssier met en tension les différents éléments biographico-théorico-cliniques issus de l’œuvre freudienne pour faire ressortir la dimension défensive que les désirs adolescents mobilisent chez Freud. Le plus exemplaire est l’analyse du souvenir-écran.
Se déploient ici sa phobie de la femme et les défenses qu’elle mobilise. En effet, le rapport de Freud aux femmes apparaît complexe (Houssier, 2015a). Il les craint en tant que sources de tourments affectifs, et ce faisant les met à distance, notamment par le biais d’un homo-érotisme défensif doublée d’un investissement créatif de la culture constituant un support narcissique identitaire dont va naître la psychanalyse. Ainsi leur réserve-t-il des dénominations étonnantes telles que « Icht » pour « ichtyosaure » dans un néo-langage adolescent recouvrant la dimension monstrueuse, très régressive, empreinte de toute-puissance potentiellement néfaste et évoquant des représentations de reptiles aux dents venimeuses animés de « pensées méphistophéliques ». La dimension narcissique idéalisée de son premier et unique amour adolescent, Gisela, y est également perceptible. Il use également des termes « le beau sexe », formule ironique qui condense l’ignorance des femmes en matière de sciences naturelles et leur destinée autre. Enfin, il parle de « principe » pour tout ce qui renvoie aux filles, aux flirts ou aux amours. Les « demoiselles » sont pour lui une « quintessence de poison d’ennui ». Les femmes laissent peser la menace d’une passion dévorante qui pourrait le détourner de son projet grandiose de devenir un grand homme et ainsi mettre en péril la satisfaction et la réparation parentales, ce qui apparaît notamment à travers la jalousie passionnelle ainsi que les mouvements dépressifs qu’il connut avec Martha dans les débuts de leur relation. Son amour adolescent, Gisela, se présente tel un traumatisme mêlant passion, intensité, bouleversement, et fulgurance avec rupture brutale du lien venant rappeler les ruptures antérieures ; suivis d’abattement, de chagrin, de déception et d’empêchement.
La sexualité éveille donc pour Freud angoisse et défenses. C’est ainsi qu’il recherche une amitié homo-érotique fortement investie, notamment auprès Silberstein dont il fait son confident en ce qui concerne la question des filles. De son éveil à la sexualité, au jeu de la séduction et du flirt, Freud en dresse un tableau platonique dans lequel transparaît le refoulement de ses pulsions sexuelles. Toutefois, vis-à-vis de ses camarades, il peut se montrer ironique, voire méprisant au sujet de leurs conquêtes, mais aussi triste de constater que ce que vivent ses amis lui se contente de le lire enfermé dans une intellectualisation, une sublimation et une idéalisation prégnantes. Sa forte tendance à la rêverie vise l’inhibition, voire l’évitement des fantasmes adolescents (masturbatoires, incestueux et agressifs) qui poussent. Du fait de ces fantasmes d’autant plus inquiétants que le refoulement et les limites chancellent au décours de l’adolescence, Freud a besoin de réprimer la violence de ses désirs trop brûlants en les déplaçant sur un lien d’amitié homo-érotique sublimée et en les contre-investissant par le biais d’un fort investissement de la vie intellectuelle (intellectualisation, ascétisme, banalisation, ironie, voire mépris) visant à contenir cette pulsionnalité et à mettre en forme les fantasmes pubertaires. Ce refuge qu’il cherche auprès de son ami laisse transparaître la dimension passionnelle sous-jacente, dans sa quête d’exclusivité. Leur correspondance fait la part belle à la question du désir pour les femmes, sujet qui intervient tel un tiers commun qui permet de mettre à distance le spectre homosexuel, dans un procédé circulaire puisque le recours homo-érotique vise lui-même à éloigner le désir ardent hétérosexuel et avec lui la menace de sombrer dans la folie. Il met également en œuvre un jeu de déplacements successifs en investissant un couple mère-fille plutôt qu’une femme seule, déplaçant sa passion amoureuse de Gisela sur sa mère, ce qui lui permit de dés-idéaliser l’objet d’amour et de tempérer l’investissement amoureux, tout en déplaçant les enjeux fantasmatiques (incestueux et parricides) du couple parental sur un autre couple autour duquel tisser son roman familial. La cruauté et le sadisme engagés apparaissent également dans ses traits sarcastiques flirtant avec le mépris et contrebalancés par l’inhibition, voire la timidité récurrentes de Freud.
Cet amour passionnel adolescent pour Gisela, qu’il connut vers quinze-seize ans, inspire à Freud son texte sur le souvenir-écran. Or, dans ce texte, il tend à banaliser le matériel présenté, voire à passer sous silence l’érotique adolescente au profit d’une érotique infantile mise en lumière, comme il a pu le faire de façon plus générale dans son œuvre. La première serait-elle frappée d’une censure liée à cet amour passionnel adolescent aussi fulgurant que déroutant ? En effet, si le souvenir infantile y apparaît vif, l’association du souvenir adolescent qui surgit apparaît moins déployée par Freud, ce dernier avançant l’idée selon laquelle l’adolescence, en se faisant mouvement dynamique de reprise, constitue une voie d’exploration et de compréhension des complexes infantiles dès lors revisités. L’adolescence et son éclairage pubertaire permettraient dans l’après-coup de donner sens à l’infantile qu’elle relit. Toutefois, Houssier ouvre une autre voie en soulignant qu’il ne s’agirait pas là d’un souvenir d’enfance, mais bien d’un fantasme adolescent reporté rétroactivement dans l’enfance, par le biais d’un mouvement défensif. Alors cette scène infanto-adolescente permettrait d’éteindre la charge sexuelle et la violence des fantasmes adolescents en les rabattant du côté infantile (Houssier, 2015b). Ainsi pensée, la perspective se voit inversée, ouvrant des pistes de travail et de réflexion intéressantes quant à la clinique adolescente. Il ne s’agit plus de souvenirs adolescents cachant des complexes infantiles via le déplacement et la condensation qu’il s’agirait dans le travail analytique de découvrir, mais de souvenirs d’enfance apparemment « innocents » venant dissimuler des souvenirs d’adolescence trop brûlants, intenses et violents, leur conférant une portée traumatique. Le souvenir d’enfance est alors à concevoir comme le lieu psychique d’un dépôt des conflits adolescents, permettant potentiellement d’y accéder. Le souvenir-écran, s’il permet de cacher la honte induite par les plaisirs et fantasmes infantiles, permettrait surtout dans cette perspective de se défendre de la portée traumatique des fantasmes adolescents par essence violents puisqu’ils se présentent à plein canal pour un sujet qui ne dispose plus des défenses que pouvaient jusqu’alors constituer son innocence et son immaturité. Or, repérer cette portée défensive à l’encontre des fantasmes adolescents et sa fonction constitue un prérequis indispensable pour pouvoir mettre au travail le matériel adolescent en contenant sa portée traumatique. C’est d’ailleurs sur cet apport central de Houssier, autour de l’œuvre nécessairement biographico-créée de Freud, que Gutton revient dans sa postface.
Le dernier chapitre se centre sur la relation que Freud entretint durant toute son adolescence avec Silberstein, en réalisant une lecture minutieuse de leur correspondance constituant un témoignage sur le vif de l’adolescence de Freud sur dix ans. S’y trouvent notamment la trame des problématiques qui se trouvèrent centrales au décours de son adolescence : la difficulté à se séparer des figures parentales pour ouvrir sur un travail de subjectivation, doublée d’une quête d’un double narcissique à travers lequel se (re)trouver pour progressivement s’en différencier. C’est ainsi que Freud fantasme une fugue pour échapper au monde familial et en sortir héroïquement, qui prendra forme par la suite au sein d’un désir de voyager et découvrir d’autres contrées qu’il mettra plusieurs années à réaliser. Ainsi sera-t-il tiraillé entre devenir un grand homme ou passer à côté de sa vie, ambition œdipienne de dépasser le père, renforcée par l’adolescence qui trouve ici son revers : la peur de l’échec. Cette peur recouvre celle de décevoir les figures parentales, d’échouer à les réparer, mais aussi de perdre sa place privilégiée d’enfant préféré.
Avec cet ami, un intense mouvement d’identification fait alterner une figure de double narcissique qui laisse difficilement place à la séparation et à l’altérité et une figure d’alter ego qui peu à peu émerge continuant d’assurer l’étayage narcissique tout en faisant place à une certaine altérité. Ce lien homo-érotique étayant l’aide à déployer ses idées et ses facilités associatives, dans un partage de plaisir à penser, qu’il recherchera toute sa vie durant. Avec Silberstein, c’est un lien d’amitié passionnelle qu’il crée et dans lequel se rejoue son insécurité affective héritée des pertes et ruptures précoces, induisant jalousie, doute et méfiance (Houssier, 2013). Il vit par exemple les flirts de son ami comme autant de trahisons, aspirant à un lien exclusif et indéfectible entre eux. Il lui propose même un partage de maison, telle une peau commune, dont il serait l’architecte et Eduard le propriétaire, et dans laquelle il mettrait ses contenus : au premier étage tout ce qui concerne leur lien, au deuxième les travaux et productions de Freud, et au troisième leur échange secret autour notamment des filles.
À côté de ce fantasme de peau commune apparaît un fantasme d’auto-engendrement qui trouve à prendre corps dans la création de leur « académie castillane » dans laquelle leur lien se trouve scellé autour d’une langue commune, partagée en secret, et apprise de façon autodidacte : l’espagnol parfois mêlé à l’allemand dans un langage codé, une co-création d’une novlangue visant à se construire un espace d’intimité partagé où il peut être question des filles. Il passe en effet de l’allemand à l’espagnol pour parler de sentiments, d’amour et d’attirance, langue de Cervantès ouvrant le champ de l’imaginaire et du secret. Cette « académie » cofondée semble posséder pour pilier fondateur le « colloque des chiens » de Cervantès, univers masculin dans lequel on navigue entre fantasme et réalité, avec des représentations de femmes effrayantes en lien avec la sexualité et faisant la part belle au sadisme. Après cet échange épistolaire, Freud prendra grand soin de refermer ce qui apparaît comme une « boîte de Pandore » frayée par les voies de la langue espagnole.
Ce lien est également sous-tendu par un fantasme parricide, tous deux partageant le désir de dépasser, via leur puissance intellectuelle nourrissant une certaine toute-puissance, la figure du père. Ce fantasme trop chaud se traduira par la nécessité d’en passer par un message codé pour évoquer la mort frappée d’un tabou – « il est parti de Séville »– atténuant ainsi sa portée par le biais d’un déguisement. Freud fait part à son ami de sa nostalgie d’un univers maternel dont il s’est trouvé arraché précocement, du fait d’un père défaillant pour qui il nourrit une vive ambivalence venant compliquer le nécessaire désinvestissement de la figure paternelle. La séparation apparaît à la frontière du tolérable tant elle se fait douloureuse. S’il peut se montrer tyrannique, exigeant, dépendant et avide, l’humour lui permet d’atténuer cette teinte passionnelle dans leurs échanges et de tempérer quelque peu l’agressivité engagée et son cortège de fantasmes anxieux de mort. L’ironie et la lutte maniaque dans laquelle elle s’inscrit alternent alors avec des mouvements dysphoriques qui donnent à voir dans quoi le plonge le retrait nécessaire des investissements libidinaux des premiers objets d’amour et la perte. L’homosexualité empruntée n’est pas sans rapport avec la privation que Freud s’impose face à la sexualité (abstinence, ascétisme, intellectualisation) et qui pourrait avoir affaire avec ce qu’il nomme le mythe de la horde primitive : un père qui contraint à une telle régression en s’octroyant l’avantage de l’exercice d’une sexualité avec les femelles du clan, nourrissant ce faisant des vœux parricides chez ses fils, comme a pu le théoriser Freud en 1913. C’est ainsi qu’il confie à son ami Eduard les plaisirs libidinaux liés au corps érogène, s’infligeant ascétisme et surinvestissement intellectuel, les vivant à minima par procuration avec ce double.
En ouverture, Houssier rappelle que si Freud théorise de façon infraliminaire l’adolescence, à la façon d’un objet négatif de sa pensée mobilisant son ambivalence, l’adolescence est un processus maturatif au long cours. Tout comme l’infantile, beaucoup plus traité par Freud, il laisse une trace indélébile dans l’histoire du sujet d’où l’intérêt de ne pas le négliger. Plus que son achèvement, c’est ce processus maturatif que l’adolescence engage, impulsant un rythme élaboratif en soi « laissant des traces vives de l’adolescence » (p. 184) qui importe et auquel l’analyste a à être à l’écoute.
Ainsi l’adolescence de Freud fut indéniablement tiraillée et douloureuse. Un des éléments centraux des fantasmes œdipiens pubertaires de Freud apparaît autour d’un père vécu comme étant faible et en déclin, induisant un besoin de protection accrue qu’il prend lui-même en charge, exacerbant ainsi les fantasmes incestueux et parricides. L’ascétisme se trouve dès lors au confluent d’une transmission paternelle (partage du goût pour les livres) et d’un désir de dépasser le père flirtant avec des fantasmes omnipotents. Dans son cas, ce mouvement de révolte contre le père s’avère fécond, car en surpassant les figures intellectuelles de son temps, accomplissant un meurtre par les idées, il a créé une nouvelle théorie : la psychanalyse. Freud traversa également un fort mouvement de dépressivité adolescente, oscillant entre une position dépressive et dépréciative marquée par un sentiment de solitude, voire de désespoir accompagné d’abstinence et une position maniaque teintée de mégalomanie et empreinte d’humour. À la fin de son adolescence, notons ce qui apparaît comme un acte ayant valeur de rite de passage maturatif, à savoir son autodafé alors qu’il lie une relation amoureuse avec celle qui deviendra son épouse et la mère de ses enfants après une absence de vie amoureuse pendant dix ans. Cette relation amoureuse fera d’ailleurs l’objet d’un prochain volume, poussant plus avant les explorations autour de l’adolescence de Freud et ses pépites. En effet, l’auteur propose une série de deux ouvrages autour de la jeunesse de Freud, dont cet ouvrage est le commencement. Il sera suivi d’un tome consacré à sa relation amoureuse avec Martha Bernays ainsi qu’à sa quête de figures identificatoires dans son parcours de jeune chercheur (Houssier, 2019).
En somme c’est un véritable voyage auquel l’auteur nous invite, voyage dans l’histoire commune, dans l’histoire plus resserrée de la genèse de la psychanalyse, mais aussi voyage dans l’histoire singulière de chacun pour aller au cœur de l’adolescence et de ce noyau vif qu’elle laisse derrière elle. L’auteur prend soin de confronter les nombreux biographes de Freud ainsi que les textes fondateurs de la psychanalyse redynamisant ainsi la pensée psychanalytique autour notamment de la question centrale de la filiation.
Références bibliographiques
Breuer J, Freud S. (1895), Études sur l’hystérie, Paris, Puf, 1956.
Freud S. (1871-1881), Lettres de jeunesse, Paris, Gallimard, 1990.
Freud S. (1900), L’interprétation des rêves, Paris, Puf, 1987.
Freud S. (1905), Fragments d’une analyse d’hystérie : Dora, in cinq psychanalyses,Paris, Puf, 1966, p.1-92.
Freud S. (1913), Totem et tabou, Paris, Payot, 1947.
Houssier F., Sigmund Freud /Eduard Silberstein : une amitié passionnelle et consanguine, Adolescence, t. 83, 2013, p. 31-41.
Houssier F., Freud adolescent, Les Cahiers de l’Herne, t.110, 2015a, p.31-37.
Houssier F., L’adolescence de Freud dans L’Interprétation des rêves, Les Lettres de la SPF, t. 33, 2015b, p. 123-138.
Delphine Bonnichon est psychologue clinicienne, Maître de conférences à l’Université Catholique de l’Ouest, composante UCO Angers Laboratoire RPPsy EA4050, Angers.
Véronique Saféris, Tango argentin et psychanalyse. Innovations thérapeutiques, par Michel Sanchez-Cardenas
 Véronique Saféris est psychologue et psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris. Elle a été professeure de musique en conservatoire et a pratiqué la danse, en particulier le tango. À partir de ces différentes formations et vécus personnels, elle a créé une méthode originale : la tangothérapie psychanalytique de groupe.
Véronique Saféris est psychologue et psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris. Elle a été professeure de musique en conservatoire et a pratiqué la danse, en particulier le tango. À partir de ces différentes formations et vécus personnels, elle a créé une méthode originale : la tangothérapie psychanalytique de groupe.
Son livre, dense et méthodique, est divisé en trois parties : « Psychologie du tango argentin dansé », « Les traitements psychothérapiques » et une troisième partie clôt l’ouvrage : « Autres applications de la tangothérapie psychanalytique hors cadre psychothérapique ».
La première partie constitue, pourrait-on dire, une sorte de psychopathologie de la vie quotidienne du tango. Une microsociété se constitue au bal (la milonga), faite de couples qui entreprennent une conversation sans mots, qui tourne en une ronde anti-horaire (où l’on ne double pas le couple qui précède) le temps d’une tanda (trois à quatre tangos), avant de se séparer. Le temps, le groupe, les pas spécifiques (mais enchaînés de façon improvisée), les règles du groupe constituent un cadre où se joue une micro-vie passée à deux, avant de se séparer. Un(e) autre partenaire est alors choisi(e). La rencontre est un corps à corps, portée par un instrument-poumon, le bandonéon, sans temps pour l’intellectualisation et elle induit un état de transe qui, pourtant, reste plus transitionnel, sublimatoire et sensuel que directement sexuel comme on pourrait le croire, vu de l’extérieur. La limite est aussi de la partie : danseur et danseuse se confrontent et doivent s’accorder en dansant pour soi et pour l’autre ; le désir de l’un doit respecter celui de l’autre et la mégalomanie n’est pas de mise (compter, en moyenne, trois ans de pratique assidue, pour un danseur, pour pouvoir commencer à guider suffisamment bien en bal). Les deux membres du couple se tendent un miroir qui n’est pas narcissique, car l’autre renvoie sa particularité : il n’est pas deux couples de danseurs, bien ou mal assortis, qui n’aient leur originalité, découverte au fil de la danse et après les premières harmonisations entre eux deux. Le groupe est là aussi, auquel l’on s’expose et qui se constitue en une unité harmonisée : on doit suivre le rythme et faire une belle ronde, suivre un chemin qui va de l’avant. « Ainsi, le bal de tango et ce qui s’y déroule externalisent une partie des processus psychiques, les figure, les rend plus repérables, grâce à son cadre permettant en son sein les interactions en mouvements spontanés ou intentionnels, dansés ou autres. L’essentiel de la psychologie humaine s’y retrouve d’une façon concentrée et intense, qui permet de s’y référer comme à un modèle conceptuel de la psychologie dans et de l’altérité, à la fois interne et figurée au dehors par la confrontation désirante à l’autre dans des épreuves de réalité. Cette conceptualisation du mouvement, par essence interactif, relationnel, intersubjectif, permet aussi de le penser en termes de figuration et d’expression externalisée, palpable de la pulsion, du désir, de relation d’objet, de lien, d’objectalité intrinsèque en soi, d’altérité réelle non réductible … » (p. 80). Tout ceci se conjugue pour faire que, les règles faisant tiers et le groupe faisant cadre, la pratique du tango soit névrotisante et en soi facteur de croissance psychique… Et n’entend-on pas de nombreux et de nombreuses tangueros et tangueras dire, ainsi mobilisés psychiquement par leur danse : Le tango a changé ma vie ?
Dans la deuxième partie, Saféris nous fait part de son originale invention thérapeutique. Ce dont il ne s’agit pas : d’un apprentissage du tango, d’une visée pédagogique, ni des applications déjà existantes du tango à la santé (cardiologique, celle du parkinsonien, etc.). Il ne s’agit pas non plus d’un tango dansé au sens académique traditionnel et les participants à ses séances de thérapie de groupe n’ont pas besoin de connaître les pas précis du tango. Saféris en a tiré une essence de tango. Le tango conceptuel informel, sur fond musical de tango, consiste en un suivi en mouvement et en relation des uns et des autres de la mélodie et de son rythme. Des connexions à l’autre se font aussi. On procède ainsi : pour une séance de durée fixe d’une fois à l’autre (de 40 minutes à une heure), on commence par un rituel où l’on se déchausse et où l’on met des chaussettes. Les membres du groupe (stables dans le temps) ne se voient pas en dehors. L’analyste est présente, mais reste en marge. Elle va proposer le mouvement, mais n’y participera pas. Elle n’a aucun contact touché avec les participants. On commence, après une musique d’accueil, par un temps de libre association. Puis l’analyste va proposer des mises en mouvement interactif. Son contretransfert lui fait choisir tel ou tel air du répertoire du tango et lui guide telle ou telle interaction à laquelle inviter : « Je vous propose d’imaginer avec qui vous souhaiteriez éventuellement entrer en connexion… De quelle façon pourriez-vous entrer en connexion avec cette personne ?… Comment voudriez-vous le lui faire savoir ?… Maintenant, vous pouvez entrer en connexion avec qui vous voulez… Vous gardez cette connexion et vous vous déplacez ensemble comme vous le voulez dans l’espace… Et maintenant, vous gardez toujours la même distance entre vous … vous continuez en face à face… Maintenant l’autre guide… changez les rôles… » (p. 142 sq). Se créent ainsi des formes de l’instant qui cristallisent le monde relationnel interne des participants. Des temps de parole alternent avec des temps musicaux. Les séquences dansées et associatives se suivent. Puis le temps de la fin va arriver. On quitte les chaussettes spécifiques, on se rechausse. Le groupe reprendra à la prochaine séance ses mises en mouvement et ses élaborations. Proche du psychodrame de groupe, la tangothérapie psychanalytique de groupe a cependant des indications différentes, presque à prendre au pied de la lettre : il s’agit moins d’indications pour des patients en difficulté associative que pour ceux qui, souvent même malgré une compréhension possiblement déjà avancée de leurs problématiques, piétinent et n’arrivent pas à se remettre en mouvement. Un cas, par exemple (p. 160) : Sidonie qui stagne dans sa vie et y rate tout. Elle et Zoé, une autre participante, avaient des symptômes affectant leur marche dès avant leur participation au groupe. Ceci est dépassé, mais est resté dans la mémoire de tous les participants qui à l’occasion y reviennent d’ailleurs dans leurs associations. Lors d’une séance, l’analyste propose : « Je vous propose d’observer ce que vous ressentez lorsque vous marchez vers l’avant… ressentez-vous que vous avancez ? Ou peut-être autre chose ?… Comment ressentez-vous, là, maintenant que vous marchez vers l’avant, l’expression ‟aller de l’avant ?ˮ… » (p. 163). Différentes figures vont suivre (guideur, suiveur, variation des rythmes, synchronisation ou non-synchronisation… À la reprise verbale, Sidonie éclate en pleurs et présente une crise d’angoisse massive. Le groupe est sidéré. Interrogée, elle répond que c’est quand la thérapeute a dit « aller de l’avant » qu’elle a commencé à ressentir cette vive angoisse… les associations vont reprendre… on associera sur les dyschronies associatives. L’un des participants associe : ne pas s’accorder est pour lui vital. Il a tout décidé seul depuis qu’il est petit : mieux le valait pour lui, par exemple, pour ne pas suivre sa mère qui menaçait fréquemment de se jeter par la fenêtre du douzième étage. À la séance suivante, il y aura de nombreux absents. Les associations vont alors y porter sur les deuils, les disparus, ceux qui sont absents dans le groupe, les êtres chers que l’on a perdus. Sidonie énonce les morts auxquels elle a pensé : son père, sa mère, sa grand-mère. Lorsque son père est mort, lui a dit sa mère, « elle avait pris sa démarche »… À la suite de ces séances, une fois chez elle, Sidonie peut réouvrir sa boîte de photos, close dans un placard depuis vingt ans.
De la sorte, on le voit, une corde supplémentaire est sollicitée, qui n’aurait pas vibré dans d’autres approches. Le dialogue tonico-moteur des participants la fait résonner.
Cette longueur d’onde supplémentaire peut d’ailleurs avoir un écho dans les thérapies classiques où on la repère plus facilement en filigrane des associations si l’on a pratiqué la tangothérapie. La mise en mouvement peut aussi être utilisée-élaborée dans les thérapies de couple.
La troisième partie propose des excursions en dehors des thérapies. Entre autres, Saféris, lorsqu’elle enseigne le tango à proprement parler, inclut une dimension psychotechnique où les élèves se parlent de leurs ressentis et où ils peuvent expérimenter différents éléments : danser seul un moment, changer de rôle (homme/femme ; guideur/guidé, par exemple). Dans les exemples précédents, le tango pénétrait le psychothérapique. Ici, c’est l’interaction psychologique parlée qui pénètre le cours de tango.
Michel Sanchez-Cardenas est psychiatre, psychanalyste
4 Recensions de livres parues dans la « Revue des livres » du numéro « Pulsion de vie ». Bonnes (re)lectures!
Fred Busch, The analyst’s reveries. Explorations in Bion’s enigmatic concept, par Julie Augoyard .
Évelyne Chauvet (dir.), Benno Rosenberg, une passion pour les pulsions, par Marie-Laure Léandri.
Willy Cohn, Nul droit, nulle part. Journal de Breslau, 1933-1941, par Michèle Pollak-Cornillot.
Henri Vermorel , Sigmund Freud et Romain Rolland. Un dialogue, par Nicolas Gougoulis.

Fred Busch, The analyst’s reveries. Explorations in Bion’s enigmatic concept, Londres et New York, Routledge, 2019.Fred Busch est un psychanalyste et auteur américain internationalement connu. S’il s’agissait de le situer dans un courant de pensée, on pourrait l’associer à celui de l’Ego Psychology. Les très nombreux articles et ouvrages écrits par Busch sont consacrés à des questions techniques telles que l’analyse de la résistance, la méthode de l’association libre, la question de l’acte, de « l’enactment » et des interventions de l’analyste, de la place de la conscience dans le processus analytique…
Son précédent ouvrage, Creating a Psychoanalytical Mind (2014), présenté par Marilia Aisenstein (2014), s’intéressait au processus analytique qui amène progressivement le fonctionnement mental du patient vers un mouvement spéculaire d’auto-observation favorisant la curiosité pour ses propres pensées associatives.
Avec ce dernier ouvrage, paru en 2019, Busch offre une réflexion critique sur le travail, l’état et le fonctionnement psychique de l’analyste en séance. L’idée de l’auteur est de tenter un état des lieux de l’usage du concept de rêveries de l’analyste par un certain nombre de psychanalystes qui en ont fait un pivot théorique et un instrument technique. À l’aune de sa pratique, mais aussi de ses connaissances nombreuses et diverses, Busch s’attache à suivre les développements théoriques et cliniques de quelques auteurs contemporains qui ont développé la notion de rêverie d’après le concept de Bion, la capacité de rêverie maternelle.
Le livre comporte huit chapitres que l’on peut décomposer comme suit :
– Le Commencement de l’intérêt de l’auteur pour la question de la rêverie à l’origine de l’ouvrage
– La théorie et le style clinique de Bion : Trois définitions, La définition de la rêverie chez Bion, Bion était-il un bionien ?
– Dans le chapitre 5, le plus long, les positions théoriques et cliniques sur la rêverie de l’analyste selon Trois post-bioniens font l’objet d’une enquête comparative très minutieuse
– Les trois derniers chapitres sont consacrés à des points théoriques : D’autres problèmes conceptuels dans l’usage de la rêverie, Questions sur la co-construction de la rêverie, Conceptualiser une énigme
Le commencement introductif
L’auteur livre de façon authentique et vivante la naissance de sa curiosité pour la notion de rêverie,qui devient pour lui une question insistante. Discutant le discours liminaire de Busch à l’API, le psychanalyste Claudio Eizirik apporte une illustration clinique de rêverie d’analyste partagée avec un patient. Busch voit dans cette façon de travailler, a priori très éloignée de la sienne, plusieurs similitudes : « Chacun de nous, à sa manière, tentait d’apporter des rejetons de l’inconscient vers le préconscient » (Busch, p. 2).
Le concept de rêverie, estime Busch, possède le potentiel permettant de comprendre l’ineffable dans toute cure ; mais les définitions de la rêverie et son usage dans le cadre clinique contiennent « des incohérences et de multiples voies de compréhension (par exemple, les résistances, l’élaboration, le contre-transfert, etc.) »(Busch, p. 4).Il convoque à cet égard la pensée d’un des auteurs étudiés par la suite, Antonino Ferro, qui considère la rêverie comme un concept-parapluie ayant perdu sa spécificité.
Busch s’interroge : est-il possible et constructif pour un auteur se référant à une certaine perspective théorique d’effectuer une immersion critique à l’intérieur d’un concept appartenant à une autre tradition théorique ? Si nous ne soumettons pas à comparaison nos concepts respectifs, juge l’auteur, ils risquent d’être réifiés : « Bion n’a pas écrit des textes sacrés. Ils sont ouverts à la critique et ses écrits psychanalytiques n’appartiennent à aucun de nous … » (Edna O’Shaughnessy, 2005, cité par Busch, p. 5).
Bion et la rêverie
Busch se penche dans un premier temps sur la définition de la rêverie dans l’œuvre de Bion, qu’il juge très allusive chez les post-bioniens.
Il me paraît utile de préciser ici que ce terme de rêverie, issu du corpus théorique de Bion, n’apparaît pas isolément[1] dans ses écrits. Bion a conceptualisé la capacité de rêverie maternelle, qu’il associe à la fonction-alpha, compétence (capacité) fonctionnelle de métabolisation ou de transformation psychique. Pour Bion, le travail psychique de l’analyste avec un patient constitue un analogon de la capacité de rêverie maternelle.
L’auteur reconnaît que Bion cherchait à saisir dans le processus analytique et le développement de l’enfant, quelque chose d’essentiel et qui demeure indéfini quand cela est en train de se produire. Mais, selon lui, en interrogeant ce qui se produit entre la mère et l’infans, on ne pourrait « directement corréler la façon dont une mère rêve à propos de son enfant et la façon dont elle est en relation avec lui » (Busch, p. 73).
Dans le chapitre intitulé Bion était-il un bionien ?, Busch interroge l’existence d’une identité bionienne en s’attachant au style clinique de Bion. Selon lui, les illustrations cliniques dans les écrits de Bion ne permettent pas de bien définir la nature de la rêverie de l’analyste ni le rôle qu’elle joue dans ses interprétations. L’auteur propose d’explorer les différentes idées que Bion souhaitait communiquer dans les séminaires retranscrits et publiés après sa mort ; ils auraient le mérite de faire entendre la pensée de Bion sur ce qui se passe lors d’une séance d’analyse. Il est habituel de considérer comme déconcertantes les questions et interventions de Bion lors de ses séminaires. Car il s’agit de plonger l’auditoire dans l’incertitude au sujet de ses propres outils de pensée et de ses référents catégoriels. Ainsi de cette question que pose Bion à un analyste présentant un patient : Pourquoi dit-il que ce sont des rêves ? La demande n’a pas manqué d’interroger Busch ; lequel précise le positionnement théorique de Bion : pour la partie psychotique de la personnalité (Bion 1957/1983), rêver ou être éveillé ne fait pas de différence. Selon Ogden cité par l’auteur, Bion s’attache à l’aspect émotionnel de la demande inconsciente du patient au moment de la séance : obtenir l’aide de l’analyste pour discriminer la partie psychotique prédominante de sa personnalité qui l’empêche de rêver, de différencier le rêve de la perception en état de veille. Ainsi, explique Ogden, « le patient (afin de se protéger de l’effrayante prise de conscience) prétend être une personne qui s’intéresse aux rêves » (Ogden, 2007, dans Busch, p. 17).
La rêverie selon des auteurs post-bioniens
Quelques psychanalystes post-bioniens choisis par l’auteur sont au cœur de l’ouvrage : Elias et Elizabeth da Rocha Barros, Thomas Ogden et Antonino Ferro. Busch nous avertit que ce chapitre fut un défi d’écriture et pourrait bien être un défi de lecture. Il est de fait ardu – quoiqu’intéressant – de suivre pas à pas la lecture critique détaillée d’extraits du corpus clinique et théorique de ces auteurs. Leur conception de la rêverie présente des variations, notamment des points de vue topique et formel. Ceci est déterminé par le choix de chacun de considérer que la rêverie est une structure, une fonction ou un état.
Pour les da Rocha Barros et Ferro, la rêverie provoque de la surprise et se produit sous la forme spécifique d’images-du-rêve : pictogramme (Ferro) ou pictogramme affectif (da Rocha Barros). Elias da Rocha Barros (2000) décrit ce dernier comme une forme de représentation mentale très primitive d’expérience émotionnelle conduisant à la capacité de penser une expérience au moyen de la figuration ; un premier pas vers la pensée du rêve et la forme symbolique et métaphorique du langage verbal. Selon les da Rocha Barros, la fonction de rêverie de l’analyste est particulièrement sollicitée au contact des patients qui n’assortissent leurs rêves d’aucune association : « l’analyste travaille avec les sentiments évoqués dans son esprit par la projection identificatoire[2], soit en leur fournissant une première représentation mentale dans le cas des états non mentaux, soit en modifiant la représentation d’états mentaux insupportables ; ceci afin de faciliter l’assimilation de l’expérience dans l’appareil mental, grâce à cette nouvelle représentation » (Busch, p. 34). Busch se dit plus proche de cette définition précise de la rêverie.
En revanche, Ogden y « inclut une large variété d’états psychiques qui adviennent à l’analyste dans un état spécifique proche du rêve » (Busch, p. 29).
L’attention que l’auteur de l’ouvrage porte à la théorie de Ogden est conséquente. Il s’en explique : la grande érudition de Ogden et son habilité didactique à décrire des notions de Bion, sa capacité à saisir ses propres pensées et sentiments durant une séance et à s’en ouvrir dans ses écrits sont incomparables. Cependant, si ses propos sur la rêverie ont été célébrés comme des découvertes majeures, ils n’ont pas été suffisamment examinés. Un point souligné par l’auteur concerne la confusion des registres : celui des sensations (éléments bêta) ferait partie des rêveries au même titre que celui des sentiments plus symbolisés (éléments alpha). Busch mentionne à cet égard la distinction faite par l’École Psychosomatique de Paris entre les symptômes somatiques résultant des échecs de la représentation et l’élaboration psychique dont le travail du rêve et sa mise en récit attestent. En faisant de la rêverie une fin en soi qui peut se passer de l’interprétation, Ogden négligerait le rôle de la transformation du non mentalisé (unmentalized) en symboles et en nouvelles structures.
Busch critique la généralisation conceptuelle faisant de tout éprouvé de l’analyste une rêverie quand il y voit plutôt des réactions contre-transférentielles. Penser l’analyse comme la création d’un événement inconscient intersubjectif ne permet pas de discriminer la part de contribution proprement subjective de l’analyste. Le risque est alors de privilégier le vécu de l’analyste au détriment de celui du patient. D’où la remarque de l’auteur : « Si notre objectif est d’augmenter la capacité de rêver, il convient également de respecter les défenses du patient contre le fait de rêver, et de reconnaître son droit à avoir ses propres rêves dont nous n’aurions encore aucune connaissance » (Busch, p. 45).
Pour ce qui concerne Ferro, l’auteur lui attribue une grande capacité de métaphorisation et de tissage associatif des productions du patient. Il considère sa conceptualisation des interprétations non saturées d’une grande valeur. Mais il peine à trouver dans ses écrits son « nouveau paradigme du rôle de la rêverie dans la part curative du processus analytique » (Busch, p. 49). Il lui semble que l’usage de la rêverie chez Ferro ressemble à celle qu’en font beaucoup d’analystes contemporains ; la rêverie est alors la voie d’écoute du matériel préconscient et celle empruntée pour interpréter au niveau préconscient. Il interroge l’idée que les transformations se produisent grâce au changement d’état mental de l’analyste. Ferro fait presque totalement disparaître le contre-transfert de sa conceptualisation de la rêverie bâtie sur la notion de champ analytique[3]. Ici encore, le registre formel de la rêverie repose sur un flou. Entre rêverie comme image onirique (pensée onirique de la veille, ou pictogramme) et pensées du rêve, qui seraient leur production (dérivés narratifs des pictogrammes), s’installerait une équivalence. Tantôt le récit en mots de l’analyste semble coextensif à son habilité à entrer en contact avec ses rêveries ; tantôt la transformation verbale ne semble pas nécessaire.
Les considérations théoriques de Busch
La définition du concept de rêverie souffre d’un manque de rigueur. Busch regrette qu’il ne soit pas question de mieux circonscrire les lieux de provenance et de réception dans l’inconscient de la communication inconsciente entre patient et analyste à laquelle la rêverie se réfère. Les bioniens ont ajouté au problème en parlant d’états mentaux non représentés (unrepresented)et non mentalisés (unmentalized).Or, selon l’auteur, rien ne se passe dans l’esprit qui ne soit quelque peu représenté, sans quoi la psychanalyse ne pourrait l’appréhender. Il conviendrait de catégoriser « les différents états mentaux comme rêveries potentielles [qui] peuvent se situer le long d’un continuum de degrés de représentations, de la plus primitive à la plus symbolique » (Busch, p. 92). Busch propose de considérer le langage et les pensées d’action ancrés dans des expériences primitives qui forgent un schéma sensori-moteur (Jean Piaget) : « Les souvenirs et fantasmes sont encodés dans cette forme primitive de représentation » (Busch, 1995, 2009, 2014). L’effet produit dans le psychisme de l’analyste par ce langage d’action est le même que celui décrit dans les états psychiques non représentés. Pour l’auteur, il découlerait de cette distinction une implication clinique de taille : l’analyste écouterait alors la manifestation défensive du patient, plutôt que de traiter ses productions comme résultant automatiquement d’un échec de représentation.
Busch se dit proche du modèle français de travail avec les patients dont le système préconscient n’est pas suffisamment fonctionnel. Citant Serge Lecours (2007), Pierre Marty (1976) et plus récemment Marilia Aisenstein (2017), il souscrit à l’idée d’une réponse de l’analyste interpersonnelle et soutenante (supportive), à la fois appui narcissique, voire didactique, mais aussi appel à la figurabilité ; ceci afin de soutenir l’ouverture à la mentalisation. L’écoute analytique s’inscrit dans la temporalité processuelle du transfert et doit être ouverte à la surprise que provoque la découverte des multiples significations (César et Sára Botella, 2013, cités dans Busch, 2019, p. 82). S’appuyer sur un modèle de signification moniste ferme l’accès à d’autres sens. Les conceptions post-bioniennes de la rêverie s’exposent au risque de construire ce que Busch nomme un faux positif. Si tout pictogramme affectif est une rêverie transformative, quel statut donner à l’image ? Quel modèle structural permet de travailler cette question ? Comment procède l’analyste avec des patients dont la faiblesse du moi (Otto F. Kernberg) et les formes primitives de pensée ne permettent pas de créer des représentations mentales du self et des objets (Edith Jacobson, 1954) ? se demande l’auteur.
L’image occurrente associée à un affect constitue la forme idéale pour conceptualiser la rêverie ; elle se situe, selon l’auteur, entre la représentation de chose et la représentation de mot, entre l’inconscient et le préconscient. L’analyste se doit de la mettre au travail par une investigation introspective afin d’en élaborer une représentation psychique complexe susceptible d’aider le patient. Et de faire la distinction entre ce qui peut apporter une nouvelle compréhension du patient et ce qui serait une émergence inconsciente idiosyncrasique de l’analyste. Car il y aurait dans les notions de co-construction et de champ analytique une propension à éluder la dynamique distincte à l’œuvre dans la réponse contre-transférentielle (Busch, 2006) à la défense du patient.
Quelques commentaires conclusifs
« Le destin de toute nouvelle idée sur la méthode psychanalytique semble d’être vite considérée comme un remplacement des précédentes plutôt qu’une contributionsupplémentaire … »(Busch, p. 66). On ne peut que souscrire à cette mise en garde contre tout dogmatisme théorique susceptible d’éradiquer à la fois ses propres fondations et les voies alternatives. L’ouvrage de Busch a le mérite de s’atteler à la tour de Babel psychanalytique en cherchant, à l’intérieur d’un concept qui appartient à une langue éloignée de celle de l’auteur, une voie de communication par le truchement de la clinique. L’intérêt de l’auteur américain pour la rêverie témoigne de son ouverture et de sa curiosité intellectuelles, tandis que la rigueur clinique et éthique guide sa recherche. Mais si le projet du livre est de mettre au travail et de clarifier une notion dont la définition est énigmatique, il offre à mon sens davantage une perspective sur les différentes conceptions et usages cliniques de la rêverie. L’axe comparatif de son étude me paraît sujet à ambiguïté. Busch distingue des registres d’éprouvés et d’interventions, des opérations de pensée et d’action, mais s’attache peut-être insuffisamment à leur complémentarité, à leur éventuelle articulation autour de certains invariants de la psychanalyse[4]. Il peut aussi manquer au lecteur la connaissance élargie de théories variées et non exclusives, que l’exercice comparatif impose sur le seul terrain conceptuel de la rêverie selon les auteurs étudiés – eux-mêmes s’appuyant sur le concept de Bion, la capacité de rêverie maternelle. L’exercice intertextuel que nous soumet Busch nécessiterait aussi un détour plus conséquent par la théorie de Bion pour qui voudrait pleinement saisir l’enjeu de l’enquête critique de l’auteur. Bion propose une conception originale de la genèse de l’appareil psychique et des pensées forgés par et dans la relation à l’objet au moyen de la projection identificatoire.
Dans les chapitres dédiés aux considérations métapsychologiques, Busch regrette qu’il ne soit pas question de mieux définir les lieux de provenance et de réception de la communication inconsciente entre patient et analyste à laquelle la rêverie se réfère. L’indétermination topique de la fonction alpha et de ses productions (les éléments alpha) que l’auteur critique, ne tient-elle pas précisément à la nature originaire des mécanismes que Bion tentait d’appréhender ? Ne peut-on considérer, comme le suggère la théorisation de Bion, après Freud, que ces mécanismes continuent toujours d’œuvrer sous l’égide de lois psychiques originaires et primitives qui président à leur mise en place ? Si par ailleurs l’objet attaché à la rêverie consiste dans la rencontre analytique, il est heureux qu’il demeure un tant soit peu énigmatique. La communication d’inconscient à inconscient qu’est le transfert freudien (Bollas, 2002) comporte des zones d’ombres que les théories psychanalytiques n’ont pas fini d’investiguer.
Références bibliographiques
Aguoyo J., Malint B. (2013). Wilfred Bion, Los Angeles Seminars and Supervision. London, Karnac
Aisenstein M. (2014). Creating a Psychoanalytical Mind. A Psychoanalytical Method and Theory, Rev Fr Psychanal 78(4).
Baranger M. et W. (1961). La situation analytique comme champ dynamique. Traduit par L. de Urtebey. Rev Fr Psychanal 49(6) : 1543-1572
Bion W.R. (1957/1983). Différenciation des personnalités psychotique et non psychotique. Réflexion faite. Paris, Puf.
Bion W.R. (1962/1979). Aux sources de l’expérience. Paris, Puf.
Bion W.R. (1967/1983). Réflexion faite. Paris, Puf.
Bion W.R. (1970/1990). L’attention et l’interprétation. Paris, Payot.
Bion W.R. (1990). Brazilian Lectures. London, Karnac.
Bollas C. (2006). De l’interprétation du transfert comme résistance à l’association libre. Dans A. Green, Les voies nouvelles de la thérapeutique analytique. Paris, Puf.
Busch F. (2014). Creating a Psychoanalytical Mind. London, Routledge.
Busch F. (2009), “Can you push a camel through the eye of a needle?” Reflections on how the unconscious speaks to us and its clinical implications. J Americ Psychoanal Assn 51 : 689-708.
Busch F. (1995). The ego at the center of technique. New York, Rowan and Littlefield.
Rochas Barros da E.M. (2002). An essay on dreaming, psychical working out and working through. Int J. Psycho-Anal 83(5) : 1083-109,.
Ferro A. (2012). Rêveries. Montreuil, Ithaque.
Ferro A., Basile R. (2009). le Champ analytique, un concept clinique. Montreuil, Ithaque.
Lecours S. (2007). Supportive interventions and nonsymbolic mental functionning. Int J Psychoanal 78: 855-875.
Ogden T. (1997). Reveries and interpretations, Psychoanal Q 66 : 567-595.
Sandler P.C. (2005). The Langage of Bion, a dictionary of concepts. London, Karnac.
Julie Augoyard est psychanalyste, membre de la SPP, membre de la SEPEA.
[1] De même, l’emploi du substantif au pluriel (« les rêveries ») est une autre des dérivations attestant des conceptions et usages élargis après Bion.
[2] Florence Guignard a proposé cette traduction plus fidèle du concept traduit jusqu’à présent en français par « Identification projective ».
[3] M. et W. Baranger (1961). La situation analytique comme champ dynamique. Traduit par L. de Urtubey. RfP 49(6) :1543-1572.
[4] À titre d’exemple, l’écoute des manifestations défensives reste à mon sens la pierre angulaire de toute méthode et théorie analytiques, quelles que soient les configurations psychiques.
Évelyne Chauvet (dir.), Benno Rosenberg, une passion pour les pulsions, Paris, In Press, 2019.

Excellent ouvrage que celui publié par les Éditions In Press et la Société Psychanalytique de Paris en 2019, sous le titre : Benno Rosenberg, une passion pour les pulsions.
Sous la direction d’Évelyne Chauvet, et dans la suite du colloque en hommage à Benno Rosenberg de 2017, l’ensemble des contributeurs livre un ouvrage qui est une formidable introduction, autant que le commentaire dense et riche, de son œuvre. La tentation de qualifier ce volume de commentaire quasi « exégétique » n’est sans doute pas sans rapport avec ce que nous rappelle Hélène Rosenberg, l’épouse de Benno Rosenberg : on l’appelait le talmudiste de la SPP, bien qu’il n’eût jamais lu une seule page du Talmud. Simplement sa façon de lire, en fait de prendre à bras le corps un texte, avec l’idée – comme dans le commentaire talmudique – qu’il n’y a pas un mot pour rien, le définissait très fortement comme lecteur de Freud, et les collègues qui ont travaillé pour présenter son œuvre se sont identifiés à lui, sur un mode donc quasi exégétique. Relire « Le problème économique du masochisme » avec, en arrière-fond, tous les développements proposés par nos collègues dans cet ouvrage, permet de mesurer la qualité de tous les articles ici réunis ; les questions de la liaison pulsionnelle, du « domptage de la pulsion de mort par la libido » (p. 291), de la coexcitation libidinale, jusqu’à la terrible phrase conclusive : « Mais comme il [le masochisme moral] a d’autre part la signification d’une composante érotique, même l’autodestruction de la personne ne peut se produire sans satisfaction libidinale », sont rendues plus familières, plus accessibles, éclairées par le travail de décondensation des contributeurs.
Le choix fait d’organiser le livre en quatre parties, sur lesquelles nous reviendrons, fournit en creux une représentation des lignes de force de la théorisation de Benno Rosenberg, au-delà des sujets mêmes dont cette théorisation organise l’entendement.
Dans la première partie de l’ouvrage, « Masochismes », Évelyne Chauvet, Marilia Aisenstein et Josiane Chambrier-Slama explicitent avec à chaque fois leur style et leur référentiel propres la fonction intricante du masochisme érogène primaire, tout comme l’incontournable lien du masochisme au narcissisme. Cette première partie permet au lecteur d’entrer dans la théorisation de Rosenberg et de se représenter en quoi le masochisme est gardien de la vie, formule célèbre et néanmoins énigmatique pour les non-initiés. Ainsi Chauvet décondense-t-elle le travail de Rosenberg en partant du Freud de 1924, « Le problème économique du masochisme ». Dans son texte si bien construit, et en incluant ses propres interrogations de départ, elle explicite la démarche freudienne de la sortie d’une finalité quantitative du principe de plaisir (réduction à rien ou au plus bas de la somme d’excitation) dans sa première version. C’est en passant par l’hypothèse d’un facteur cette fois qualitatif, qui prend en compte « le rythme et l’écoulement temporel des modifications », que se dessine un plaisir pris masochiquement dans le déplaisir. Le masochisme érogène devient ainsi le premier alliage des pulsions, première victoire de la pulsion de vie sur la pulsion de mort. On suit tout le développement que propose Chauvet pour présenter ce que Rosenberg nommait la « supportabilité » du déplaisir, et son cheminement à elle pour en arriver à « cette solidarité étroite entre plaisir et déplaisir [qui] lève la paradoxalité du masochisme ». Ainsi l’auteure explicite-t-elle et décondense-t-elle très précisément le travail de Rosenberg sur la vitalité fondamentale du masochisme érogène primaire, situant également, « à l’autre pôle », le masochisme mortifère ; le déplaisir cesse ici d’être un avertissement, et Chauvet cite Rosenberg : la libido, ici, n’a pas réussi à « trouver un moyen de ne pas satisfaire la pulsion de mort ». Chauvet signale son point de démarcation d’avec Rosenberg : les positions de ce dernier sont systématiquement « positivistes » écrit-elle, concernant la libido ; pour sa part, « Éros sans limites est porteur d’un potentiel de démesure tout aussi menaçant et destructeur dans son champ propre ».
Aisenstein développe quant à elle ce qu’il en est des différentes figures du masochisme, de vie, de mort, originaire ou inachevé. Elle différencie certaines des positions de Michel Fain en regard de celles de Rosenberg : si pour ce dernier la « source du masochisme érogène primaire réside dans un reste d’excitation pulsionnelle retenue à l’intérieur et non déchargée », Fain pour sa part introduit au sein du masochisme érogène primaire un impératif de constitution de l’objet sexuel qui inclut une triangulation et le surmoi dès le lien à l’objet primaire. Décryptant quelques enjeux du dialogue de Rosenberg avec les psychosomaticiens de l’IPSO, l’auteure explicite l’article de ce dernier « Masochisme et maladie » (reproduit dans le volume) et insiste sur l’intrication originelle de la pulsion de mort par le masochisme, « pour pouvoir être secondairement dérivée, projetée vers l’objet et le monde extérieur ». On retiendra par ailleurs cette formulation d’Aisenstein, qui permet de se représenter une fonction du masochisme : « Si le masochisme primaire est déficient, il remplit moins bien sa fonction de cadre [des deux pulsions] et les pulsions, comme des satellites, prennent des trajectoires différentes ».
Chambrier-Slama nous introduit quant à elle, avec précision et érudition, au travail de la mélancolie tel que théorisé par Rosenberg. Ce travail de mélancolie, cette visée de détachabilité de l’objet, auxquels concourt la distinction entre représentations d’objet et représentations du sujet, ne peut avoir lieu que par la levée du barrage inconscient/préconscient. Chambrier-Slama déploie tous les apports de Rosenberg quant au « rôle du masochisme dans la résolution de l’accès mélancolique » : la haine du mélancolique est érotisée en autosadisme mortifère, et la quatrième étape du travail de mélancolie passe par la transformation de cet autosadisme en masochisme. Après avoir exploré les dialectiques masochisme-narcissisme puis masochisme-projection (et précisant la précession du masochisme sur la projection), l’auteure explore dans la fin de son texte la dialectique mélancolie-psychose : autrement dit, l’échec de ce travail de mélancolie est-il la voie d’entrée dans la psychose ? Elle introduit ainsi la distinction faite par Rosenberg entre les psychoses délirantes, où la destructivité est liée par l’objet-délire, des psychoses non délirantes « plus proches de la mélancolie par leur problématique narcissique ».
Le second axe de travail de Rosenberg, celui qu’il avait développé dans son livre Le moi et son angoisse, fait l’objet de la deuxième partie de cet ouvrage. Dominique Bourdin met en valeur le travail de Rosenberg pour intégrer la première théorie de l’angoisse dans la seconde. Pensant que la « doxa psychanalytique » n’a peut-être pas achevé de s’approprier la pensée de Rosenberg, l’auteure reprend l’importance du masochisme dans la formation du Moi par ce qu’il permet de rétention de l’excitation et d’inhibition de la décharge, propices à cette formation. Elle nous emmène tout au long de son écriture toujours précise et ponctuée de citations très claires de Rosenberg dans l’élaboration des rapports moi-angoisse-libido. C’est, écrit-elle, le choix le plus important de Rosenberg que d’affirmer le rôle capital de la libido dans l’angoisse et elle précise : « L’angoisse ne saurait être neutre, pulsionnellement parlant. » L’auteure démontre avec un cheminement pas à pas dans l’œuvre de Rosenberg comment ce dernier a mis au jour une conception positive de l’angoisse. Dans cette même perspective des rapports du moi et de l’angoisse, Denys Ribas soutient la participation de la pulsion de mort à la vie, ce que Rosenberg démontre dans sa théorisation de la naissance du moi. Ribas, qui travaille tant dans ses écrits la désintrication pulsionnelle, prend parti pour une pulsion de mort qui ne soit pas le « mal absolu ». Ainsi écrit-il : « La pulsion de mort est souvent utilisée par le psychisme comme défense contre la pulsion de mort elle-même à un autre niveau. » On lira aussi sous sa plume l’importance dans l’œuvre de Rosenberg de la notion de préclivage du moi, défense primordiale de ce dernier. Annette Fréjaville, partant de la question de la négation, met au travail la notion d’objet primaire, matrice de l’objet interne, et souligne la défense vitale pour le sujet que constitue la projection primaire, qui succède au masochisme primaire. Le cheminement de Rosenberg entre les notions d’objet primaire, objet interne, ne le voit que peu aborder l’objet réel ; pourtant témoigne Fréjaville : « Il est clair que pour lui, la personne secourable a une importance fondamentale dans la possibilité de faire advenir chez l’enfant des expériences de satisfaction qui pourront être hallucinées et désirées. »
La question de la projection comme celle du clivage est plus profondément abordée dans la troisième partie de l’ouvrage. Reprenant la différenciation de Rosenberg entre projection dans la sphère névrotique et projection dans la sphère psychotique, Alain Gibeault explicite le lien de chacune de ces projections avec l’échec des mécanismes de défense propres à la psychose d’un côté, déni et clivage du moi, et à la névrose de l’autre : le refoulement. Il reprécise l’aspect vital pour la défense du moi qu’est la projection, et reprend une citation « névralgique » de Rosenberg : « La projection de la destruction sur l’objet est en même temps un acte de sauvegarde de l’appareil psychique et l’acte constitutif de l’objet interne. »
Annie Roux pour sa part a choisi de travailler le concept de préclivage dans sa lecture de l’œuvre de Georges Perec. Passionnant article, où l’auteure précise et explicite l’apport théorique de cette notion en la rendant vivante à travers la douleur lancinante que l’on perçoit à la lecture de Perec. « L’écriture de Perec … réalise une tentative de construction du processus de préclivage dans l’après-coup de son ratage. ».
Quant à la quatrième et dernière partie de cet ouvrage, elle est introduite par une contribution de Claude Smadja, qui définit l’approche nouvelle de la psychosomatique que propose l’œuvre de Rosenberg, en lien avec toute la prolongation qu’il aura donnée à la seconde théorie des pulsions freudiennes. Dialectisant unité somato-psychique et intrication pulsionnelle, et donc discontinuité somato-psychique et désintrication pulsionnelle, Smadja met en avant ce que Rosenberg appelait processus de dépulsionnalisation, avec un processus régressif de la pulsion à l’instinct et l’avènement d’un instinct de mort actif dans le soma. On en revient aux conséquences de la défaillance du masochisme primaire du Moi, responsable du processus de désorganisation.
Cette dernière partie se clôt sur deux articles de Rosenberg, « Masochisme et maladie » et « Relire Marty. De la dépression essentielle à la somatisation : réflexions sur le masochisme dans ce mouvement ».
Lecture d’un apport inestimable que celle de ce livre, à conserver en très bonne place dans nos bibliothèques, tant il constitue une ouverture formidable à une lecture réellement profitable de l’œuvre de Benno Rosenberg.
Marie-Laure Léandri est psychanalyste, membre de la SPP.
Willy Cohn, Nul droit, nulle part. Journal de Breslau, 1933-1941, Paris, Calmann-Lévy, Mémorial de la Shoah

Willy Cohn était une personnalité éminente de la vie intellectuelle de Breslau en Basse-Silésie, sa ville natale (aujourd’hui Wroclaw en Pologne). Historien de formation, il enseignait au Lycée de Breslau, mais depuis sa thèse n’avait cessé d’être chercheur et conférencier, spécialisé dans l’histoire de la Sicile à l’époque normande, puis celle de Breslau, et du judaïsme.
Comme il était assez fréquent à cette époque (voir Brève chronique de Freud[1]), Willy Cohn tenait depuis l’âge de 17 ans un journal. Celui-ci s’est révélé être une chronique exceptionnelle du processus de nazification de l’Allemagne, de la détermination nationale-socialiste à persécuter les Juifs, avant la mise en place de l’extermination barbare. Ce Journal de Breslau, comme le laisse pressentir la datation 1933-1941, n’est pas le témoignage d’un survivant. Si de nombreux rescapés des camps ont pu écrire, une fois passé le long temps où cela leur était impossible, ou plus exactement depuis que la Shoah a acquis la place qui lui revient dans l’histoire du xxe siècle, ils ont surtout témoigné de la barbarie des camps. Willy Cohn, lui, a écrit d’abord pour lui-même, puis dès les premières heures du régime nazi, sur ce que vivaient les Juifs de Silésie au jour le jour : son Journal permet de suivre les conséquences de la nazification dans la communauté juive de Breslau, la troisième plus grande d’Allemagne, et simultanément les privations de tout droit dans une famille juive.
S’il a eu conscience dès l’accession d’Hitler à la chancellerie, le 30 janvier 1933, d’être« pris dans une souricière » (p. 15), son attachement à l’Allemagne, mais surtout son impossible accueil en Palestine, l’obligèrent à rester à Breslau et à affronter toutes les exactions contre les Juifs, avant d’être finalement déporté en novembre 1941 au fort de Kaunas en Lituanie, avec sa femme et ses deux plus petites filles. Soucieux de la préservation de ses écrits, et du témoignage qu’ils allaient constituer, il réussit à les faire parvenir à un ami de Berlin trois semaines avant sa déportation de Breslau. L’historien allemand Norbert Conrads va en assurer la publication à partir de 1995.
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, définit dans son Article 1er le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, comme un crime du droit des gens. C’est précisément lorsque des pancartes « Juifs indésirables » sont affichées aux portes des restaurants que toute liberté d’action est interdite aux Juifs, que le 19 août 1935 Willy Cohn prend la décision de rendre compte du destin des Juifs. « On ne sera bientôt plus les bienvenus en Allemagne que dans les cimetières ! Je veux désormais insister davantage dans ces carnets sur notre sort de Juifs, peut-être cela présentera-t-il un intérêt pour les générations à venir. » Il aura désormais à cœur de transmettre non seulement des traces de cette « torture psychique », mais de relever toutes ces privations de droit avec rigueur et concision, ce qui lui donne ce caractère exceptionnel parmi les écrits sur la Shoah. Willy Cohn est souvent cité aux côtés de Viktor Klemperer (1975/1996) par les historiens tels que Saul Friedländer (2007/2008).
C’est ce contrepoint entre les notes sur la vie personnelle intime et la narration la plus objective possible des faits historiques qui fait la force de ce Journal. Le lecteur est admiratif de la ténacité et du courage avec lesquels Willy Cohn en poursuit l’écriture : « La verbalisation que permet ce journal me confère force et sérénité » (p. 145), et lorsque les conditions de vie deviennent insoutenables, il entreprend même la rédaction de ses mémoires[2] sur l’histoire des Juifs de Silésie.
Au lendemain de l’accession de Hitler à la chancellerie, le 31 janvier 1933, évoquant cette transition brutale, il prédit que « le boycott de tout ce qui est intellectuel et juif ne va cesser de s’accentuer » (p. 15). Mais « serrer les dents et attendre que cela se passe » lui semble la seule possibilité face à la terreur installée par les SA et SS qui s’installent aux postes officiels. Les juifs avaient vécu en Allemagne avant 1928 de manière plutôt paisible, et pouvaient être fondés à penser qu’il s’agirait d’une phase transitoire : « Il faut être suffisamment loyal pour se soumettre également à un gouvernement qui vient d’un tout autre camp. »
Les nazis prennent rapidement les premières mesures discriminatoires, les Juifs doivent faire tamponner leur passeport, ils sont renvoyés de l’enseignement supérieur, puis de l’enseignement secondaire, les premières pancartes Juif s’affichent sur les commerces. Willy Cohn note : « Avili en deçà de toute dignité humaine » (p. 20). On n’est qu’en mars 1933.
En historien, il souhaite se positionner avec objectivité, face à l’arrivée du nazisme. Son Journal consigne aussi bien les événements de la vie municipale, de la communauté juive. Certes la dictature s’empare de l’espace public, la rue est occupée par les défilés des Jeunesses hitlériennes. Willy Cohn en note le bruit, le tapage. Il consigne les invectives contre les Juifs du discours de Göring en février 1933 : « Appel direct au meurtre ! Les passions des masses sont excitées à l’extrême » (p. 17) et, comme Viktor Klemperer, la perversité de la propagande qui magnifie le régime : « On anticipe d’emblée sur le jugement que portera l’histoire » (p. 22).
Mais il a foi en l’Allemagne qu’il s’interdit d’identifier au régime nazi : « J’aime tellement l’Allemagne que cet amour ne peut être ébranlé par tous les désagréments que nous connaissons » (p. 34). Ayant combattu dans les rangs allemands pendant la Première Guerre, décoré de la croix de fer pour ses mérites, il ne peut encore s’imaginer une vie ailleurs qu’à Breslau où il est reconnu. La terreur se répand, la privation de tous droits pour les Juifs, les discours de haine raciale se multiplient, il va bientôt comprendre la visée destructrice du régime.
Ainsi est documentée, la mise en place de la terreur et l’évolution du régime nazi vers un régime totalitaire : « Il n’y a que dans un journal intime qu’on puisse écrire ce que l’on pense de cette société, car partout la liberté d’opinion est muselée. Il faut s’attendre encore à toute une vague de terreur. Il n’y a plus nulle part de droit en Allemagne ! Nulle part » (février 1933, p. 17). Trois semaines plus tard, tous les juges et les procureurs juifs sont suspendus de leurs fonctions (même ceux qui sont baptisés, note-t-il avec ironie).
En l’espace de quelques semaines, toutes les mesures de restriction, d’exclusion, les divers boycotts, privent les Juifs de toute possibilité de vivre, de tout droit de vivre. Ses descriptions détaillées font état des multiples vexations, offenses, humiliations, jusqu’aux menaces sur la vie de son fils aîné, qu’il fait partir à Paris dès avril 1933 une fois passé son Abitur (baccalauréat), le numerus clausus étant intervenu (deux autres de ses enfants quitteront Breslau et auront la vie sauve). Le printemps 1933 voit les perspectives des Juifs s’assombrir. Leurs passeports doivent maintenant être remis aux autorités, et les détentions préventives se font en camp de concentration : « Jamais encore on ne s’était comporté de la sorte avec nous, les Juifs. Alors certes on ne nous tue pas, mais on nous torture psychiquement, on nous enlève systématiquement toute possibilité d’existence » (p. 21).
La décadence de la morale atteint profondément Willy Cohn, il en tire très tôt la force de témoigner au quotidien des exactions subies, dans une volonté de transmettre une vérité qui devra être rétablie. « On n’arrive même pas à concevoir tout cela et on voudrait juste croire que ce n’est pas vrai ! Cela m’a quand même secoué ! » (p. 48).
Il décrit au plus près la réalité des événements et restitue ainsi l’atmosphère de la ville: « … le camion de pompiers est venu avec une voiture de la SA pour récupérer les livres qui doivent être brûlés aujourd’hui … l’autodafé de Berlin sera retransmis à la radio » (p. 24). Willy Cohn, qui avait écrit une biographie de Lassalle, de Marx, a dû donner ses livres. Les Jeunesses hitlériennes harcèlent les jeunes garçons juifs, les menacent. « Elles défilent avec leurs immenses tambours, il faut faire beaucoup de bruit, cela fait partie de l’aguerrissement » (p. 87). « Je suis convaincu que notre jeunesse doit sortir de ce pays »,confie-t-il (p. 88), formulation qui contient son sentiment d’être déjà étranger dans sa ville natale.
Avec sobriété, il note que le Congrès de la liberté qui se tient à Nuremberg « apporte bien entendu aussi son lot d’insultes habituelles » (p. 90) ; sur les colonnes de Breslau, le peuple juif était tenu pour un peuple assassin. Le 15 septembre 1935 sont promulguées les lois dites de Nuremberg. Le 16, Willy Cohn note de manière laconique les avoir lues : « Il s’agit pour l’essentiel de choses que l’on savait déjà », mais non sans humour : « Du point de vue juif, j’approuve absolument l’interdiction du mariage mixte » (p. 91).
Sur un plan plus personnel, Willy Cohn livre à son journal ses conflits intérieurs, ses inquiétudes de père de famille, les décisions pour la survie des enfants, leur éducation, il est « fier d’offrir à Erets un constructeur » (p. 60) lorsque son deuxième fils peut faire son aliyah en février 1935, et plus tard éprouvera la satisfaction « qu’ils soient dehors en liberté, là où on ne doit pas marcher dans la rue en portant une pancarte infamante ! » (p. 75).
Mais lorsque les ventes obligées de magasins juifs se poursuivent, « Tout cela rappelle de plus en plus l’expulsion des Juifs d’Espagne : nous aussi devons partir » (p. 100). Lors de la visite d’Hitler à Breslau, il se réfugie au cimetière juif de la Lohestraße, là où les Juifs sont vraiment les bienvenus, « pour un dialogue muet avec son père » et recopie les dates de naissance et de décès de tous les membres de sa famille. Plus les Juifs sont persécutés, plus Willy Cohn approfondit l’histoire du judaïsme, publie des articles, donne des conférences, par exemple sur la vie intérieure des Juifs au Moyen-Âge allemand. Il se félicite un soir de conférence de l’affluence, de la salle archicomble. « Même la Gestapo était représentée ! » (p. 105). Ce recours à l’humour, qui n’aurait pas déplu à Freud, devient plus fréquent ; les Juifs pour la première fois n’ont pas le droit de vote : « …. peut-être est-ce bon que nous soyons spectateurs extérieurs, nous n’avons plus désormais de responsabilité ; nous ne pouvons être fautifs d’aucune issue ! » (p. 105). Mais l’humour n’a d’effet que sur l’instant, la gravité des événements l’atteint en profondeur, il a du mal à être en paix, il est très abattu. « Mais comme Dieu veut. Et puis j’ai écrit pas mal de choses[3], et ce qui compte : les enfants grandissent et perpétuent mon nom » (p. 114). Sa confiance dans le judaïsme est intacte : « Notre vieux judaïsme est de toute façon immortel… le sionisme est la politique qui nous est adaptée » (p. 118).
La question de l’émigration qui s’est posée dès septembre 1933 reviendra à plusieurs reprises après l’aliyah de son deuxième fils, et lors de la visite qu’il peut lui faire en 1937 en Palestine, après une courte visite à son fils aîné à Paris : « C’est le rêve d’une vie qui se réalise » (p. 130). « J’étais au bord des larmes. Pessah en Erets Israël » sera un moment tout à fait fort de son existence. Ses descriptions détaillées traduisent l’émotion spirituelle vécue lors du séjour à Jérusalem ; sa connaissance de l’histoire du peuple juif, les lieux de prière visités, sa foi dans l’avenir du pays sur fond d’angoisse des persécutions en Allemagne ont fait de cette expérience l’une des plus intenses de sa vie. Ultérieurement, il apprendra que sa demande auprès du kibboutz où séjournait son fils a été rejetée. C’est un coup dur, un rêve disparaît.
En mars 1938, Willy Cohn pressent les grands mouvements nationaux. Il regrette l’erreur commise par les Juifs d’Autriche qui n’ont pas compris qu’ils feraient mieux de se replier sur eux-mêmes. Pour l’historien il n’y a aucun doute, « le national-socialisme va s’imposer, on ne pourra empêcher l’Autriche de se rattacher à Berlin ». Il note l’enthousiasme immense en Autriche, lors du passage de la frontière par Hitler, et se prend à rêver : « Si seulement nous Juifs étions également menés par une main aussi ferme et que nous construisions notre destin » (p. 181). La veille, il avait noté avec regret que la jeunesse juive de Vienne était peu nationaliste et que « Herzl avait déjà dû s’user » (p. 180) ; sa rêverie, outre l’ironie de sa formulation, convoque le souhait d’être sauvé de la tragédie par une figure mythique.
Les événements s’accélèrent : la chasse aux Juifs polonais s’organise dans toute l’Allemagne, une interdiction de réunion est décidée pour les Juifs à Berlin, ce qu’il craint beaucoup pour lui-même si elle s’étendait à toute l’Allemagne. Le 8 novembre 1938, il pressent que la vengeance exercée par un Juif polonais qui a abattu le secrétaire d’ambassade allemand von Rath constitue « un acte d’une grande lâcheté qui aura certainement de lourdes conséquences pour nous en Allemagne » (p. 185). Au cours de la nuit de Cristal, les SA s’en prennent aux synagogues, aux locaux des organisations juives, aux magasins et aux biens des particuliers. Les Juifs allemands sont promis à un sombre destin. Willy Cohn pourra organiser la fuite de sa fille âgée de 14 ans vers la Palestine, au moment où les détentions préventives, puis les trains de détenus vers les camps se multiplient.
Le 30 mai 1940, il lit Mein Kampf: « C’est un livre auquel il convient impérativement de s’intéresser. Sur beaucoup de points, il me semble ne pas avoir tort dans sa caractérisation du judaïsme » (p. 335). Cette formulation aussi troublante soit-elle intègre sa critique de certaines conduites, probablement des assimilationnistes.
Il est particulièrement bouleversant de saisir avec quelle acuité il a pu considérer les événements, tout en en mesurant l’impact sur sa vie psychique : « Ce journal est pour l’heure la seule forme littéraire que j’arrive à produire. Le reste est bloqué en moi » (p. 191). Il trouve du réconfort dans chaque geste de la vie quotidienne qui vient affirmer que tout le peuple allemand ne soutient pas ces persécutions : la visite fortuite d’un ancien élève, devenu pasteur, un seau de charbon offert par son employée de maison, les fruits que la femme de l’épicier accepte de lui vendre (elle sera dénoncée), les denrées alimentaires que son voisinage immédiat lui réserve. Il commente discrètement, le 23 décembre 1940 : « Retrouvé beaucoup de foi en l’homme » (p. 319). Au moment où règne l’arbitraire, où s’exerce la toute-puissance de la Gestapo, il relève chaque marque de courtoisie et de loyauté : « Une partie cherche à rejeter toute faute sur les Juifs ; mais il y a aussi des gens qui pensent autrement et qui imputent la responsabilité des blessures à la direction ». La foi en l’homme et en une autre Allemagne l’accompagne encore, au moins tant qu’il peut écrire.
Dans les années 40-41, Willy Cohn travaille dur à ses mémoires aux archives diocésaines où il est accueilli. Mais « il semblerait que l’évacuation des Juifs de Breslau soit menée à un rythme très soutenu » (p. 349) et son voisinage s’agace apparemment de ce qu’ils occupent encore leur appartement. Il sera informé que son appartement sera « attribué » à un haut fonctionnaire.
« On dirait que les Allemands se sont fixé en cette période de guerre comme objectif impératif notre extermination. On ne peut qu’espérer que leur plan échouera » (p. 366), écrit-il le 12 octobre 1941. Il sera déporté quelques semaines plus tard et assassiné avec sa femme et ses deux plus petites filles en Lituanie[4].
L’écriture n’était pas pour Willy Cohn un acte de résistance en première intention, elle l’est devenue lorsque les règles morales qui fondent l’humanité ont été bafouées par la dictature nazie, et qu’il a pris conscience qu’au-delà de sa propre mort, l’histoire aurait à rétablir la vérité des événements et condamner les auteurs de ces crimes contre le droit des gens. Son témoignage est d’une force inouïe.
Références bibliographiques
Cohn W. (1995). Verwehte Spuren, Erinnerungen an das Breslauer Judentum vor seinem Untergang. N. Conrads (dir.). Böhlau Verlag.
Cohn W. (2008). Kein Recht, nirgends, Breslauer Tagebücher, Eine Auswahl, 1933-1941. Norbert Conrads (ed.). Köln, Böhlau Verlag ; Nul droit, nulle part, Journal de Breslau, 1933-1941, Paris, Calmann-Lévy, Mémorial de la Shoah.
Freud S. ([1929-39]/1992), Chronique la plus brève : carnets intimes, 1929-1939. M. Molnar (ed.). Paris, Albin Michel.
Friedländer S. (2007/2008). Les années d’extermination. Paris, Éditions du Seuil.
Klemperer V. (1975/1996). LTI, la langue du IIIe Reich. Paris, Albin-Michel.
Michèle Pollak-Cornillot est psychologue clinicienne, membre de la SPP.
[1] S. Freud ([1929-39]/1992), Chronique la plus brève : carnets intimes, 1929-1939, éd. M. Molnar. Paris, Albin Michel.
[2] W. Cohn (1995). Verwehte Spuren, Erinnerungen an das Breslauer Judentum vor seinem Untergang. N. Conrads (dir.). Böhlau Verlag.
[3] Voir sa bibliographie sur https://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Cohn
[4] Norbert Conrads dans sa postface rend compte des informations qui ont pu être recueillies. Avec la déportation d’un millier de Juifs de Breslau à Kaunas commença non seulement en Silésie, mais partout en Allemagne le meurtre méthodique des Juifs allemands (p. 380).
Henri Vermorel, Sigmund Freud et Romain Rolland. Un dialogue, Paris, Albin Michel, 2018
In memoriam H. V.[1]
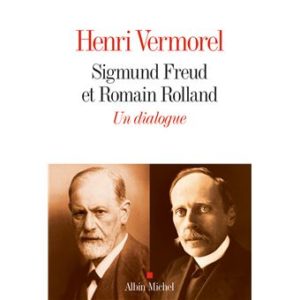
Ce remarquable livre est le remaniement d’une première édition consacrée à la relation Freud/Rolland, parue en 1993 et depuis longtemps épuisée. La nouvelle parution nous donne l’occasion d’étudier d’une part cette rencontre intellectuelle et de rendre hommage d’autre part à la recherche historique d’Henri Vermorel et de Madeleine, son épouse disparue. La première édition s’inscrivait dans le mouvement d’une étude historique de l’œuvre de Freud tel qu’initié préalablement par Alain de Mijolla. Le premier travail des Vermorel doit se lire dans l’ambiance de premières publications des correspondances de Freud. Dans cette veine, le deuxième volume de la Revue Internationale d’Histoire de la psychanalyse est consacré à la correspondance de Freud. Celle-ci est utilisée dès lors comme source historique, comme en témoigne l’irremplaçable travail de Gerhard Fichtner (1989). À cette époque, les chercheurs disposent pour la première fois de la quasi-totalité des correspondances de Freud. Aussi Vermorel dans la première édition insiste-t-il sur l’esprit du temps et le foisonnement des intellectuels du tournant du siècle.
La deuxième édition, entièrement remaniée, change de titre et, de fait, de perspective, établissant le rapport Freud/Rolland et leurs écrits respectifs comme s’il s’agissait d’un dialogue entre les deux hommes. La relecture de Vermorel nous conduit à un approfondissement de la question du processus créatif de ces personnes d’exception. L’angle de ce singulier dialogue est d’autant plus fécond, qu’il repose sur très peu de lettres et encore moins de rencontres directes.
Toutefois ce dialogue singulier, imaginé par Vermorel, reproduit en quelque sorte le procédé bien connu de Freud qui élisait souvent un interlocuteur en position de double imaginaire. Vermorel s’appuie en effet sur les écrits respectifs de Freud et de Rolland à la suite de leur entrevue en mai 1924, qui pour lui peuvent être également lus comme des lettres ouvertes qui se seraient répondu. Même si Rolland n’est pas nommé, c’est à lui que Freud s’adresse dans « Malaise dans la Culture ». Il essaie dans le texte de 1929 de répondre à la tension psychique qu’a créée la notion rollandienne de sensation océanique, pour expliquer le sentiment religieux, déjà abordé dans « l’Avenir d’une illusion » en 1927, sans pour autant faire mention de Rolland ou de ses idées. C’est seulement en 1936 que Freud fera état de l’importance de sa relation à Rolland dans une lettre ouverte intitulée « Un trouble du souvenir sur l’Acropole ». Ce petit bijou de l’œuvre freudienne marquera la fin d’une correspondance brève (à peine une vingtaine de lettres de 1923 à 1936) et un tournant de la relation qui n’aura plus la dimension intense de ses débuts.
Henri Vermorel fait figure de personne des plus qualifiées pour s’aventurer dans les méandres des origines romantiques de la psychanalyse. Fin connaisseur de l’œuvre de Freud, comme en témoignent ses nombreux articles et livres, lecteur profond de tout le mouvement littéraire européen de la fin du 19e et du début du 20e, humaniste et enfin historien rigoureux, son ouvrage donne un aperçu d’un siècle de pensée européenne (Vermorel & Vermorel, 1986). Il y examine particulièrement les œuvres des deux hommes par une lecture biographique originale, marquant les similitudes et les différences de ses deux créateurs qui se rencontrèrent tardivement. Ce faisant il nous invite à réfléchir sur leur processus de création scientifique et artistique, en nous saisissant de l’axe d’un dialogue en total contraste avec l’idée même de créateur solitaire, voire isolé, chère à Freud.
Le livre met en évidence la fécondité de la période entre 1850 et 1940, une des plus productives pour la pensée européenne. Rolland et Freud y bénéficiaient de la stimulation du changement de paradigmes scientifiques et de repères philosophiques. Ils subirent aussi la désillusion de la Première Guerre mondiale, puis l’angoisse de la montée des forces destructrices qui allaient détruire la « Mitteleuropa ».
Préambule à une rencontre
Freud et Rolland sont tous deux enfants d’une époque politiquement et socialement contrastée, où le désir de rencontre entre peuples et cultures s’oppose à la montée de nationalismes belliqueux qui conduisirent aux guerres annihilant tout un monde et une manière de vivre. L’autobiographie de Stefan Zweig, écrite peu avant son suicide en 1941, « Le monde d’hier » illustre ce monde et sa disparition.
Ces deux penseurs se connaissent intellectuellement par lecture interposée. Ils sont déjà l’un et l’autre des figures intellectuelles de premier ordre, mais restent très contestés, l’un malgré sa nobélisation pour son « Jean-Christophe » et l’autre malgré l’influence grandissante de la psychanalyse comme courant de pensée. Ils feront partie d’un mouvement d’esprits créateurs, les unissant entre autres à Thomas Mann et Albert Einstein pour combattre la montée d’une nouvelle vague de destructivité encore plus puissante que celle de la Première Guerre mondiale.
Rolland est un français tourné vers la culture allemande, un Européen avant l’heure, il rêve de rassembler les deux grandes nations. Son Jean-Christophe est un musicien allemand né sur les bords du Rhin, tout comme Beethoven à qui Rolland a consacré une biographie qui fait encore autorité. Freud quant à lui est un Viennois marqué par la culture française. Il parfait ses études de médecine à Paris auprès de Charcot. La Comédie humaine de Balzac l’accompagnera jusqu’à son dernier soupir.
Intellectuels de leur époque et écrivains tournés vers la rencontre épistolaire, les deux hommes ne pouvaient manquer de s’écrire sur un terrain d’une estime et d’une admiration réciproque. Rolland compare Freud à un Christophe Colomb, découvreur d’un nouveau continent de l’esprit. Il se vante d’avoir été un des premiers Français à le lire, ce qui, en 1908, était parfaitement exact. Freud de son côté souligne les belles illusions de fraternité entre les hommes que l’œuvre de Rolland promeut. Freud, Juif athée, et Rolland, croyant sans église, partagent cependant une sensibilité sur la mystique. Si Rolland est plus ouvertement fasciné par la pensée orientale, comme en témoigne sa sensation océanique comme source de la pensée religieuse, Freud se défend de toute fascination mystique. Mais, nous rappelle Vermorel, Freud ne laisse-t-il pas pour autant une de ses dernières notes sur la mystique, une inconnue si familière[2] ? S’ils s’estiment, les deux penseurs s’opposent quant aux idéaux. Pour Freud, Rolland est un idéaliste croyant en la fraternité des peuples. Pour Rolland, Freud est un pessimiste, un destructeur d’illusion.
Vienne 1924
C’est Freud qui est à l’origine de la rencontre. Il apprend par son ami Stefan Zweig que Rolland est en visite à Vienne pour rencontrer le musicien Schoenberg (auteur d’un Moïse, tout comme Freud). Il demande à Zweig de servir d’intermédiaire et d’interprète, car son français n’est plus celui qu’il maîtrisait jadis. Zweig adorait ce rôle de facilitateur de rencontres et ne manque pas à l’appel. Avec Anna Freud, elle aussi présente, il sera alors témoin d’un échange qui marque la relation de deux hommes. Ils évoquent le roman de Rolland, L’âme enchantée, Dostoïevski, Flaubert et la psychanalyse, qui est si près des intuitions de Rolland.La rencontre se passe donc le 14 mai 1924 et instaure d’emblée une relation forte, fondée sur l’intensité des deux interlocuteurs. Ces deux personnalités d’exception allaient par la suite devenir des partenaires intellectuels d’une aventure créative par correspondance. Rolland occupe à partir de cette rencontre une place transférentielle capitale. Freud, en l’accueillant dans son cabinet, installe Rolland dans un fauteuil rouge, comme s’il l’assignait à la position de l’analyste qu’avait occupé Fliess. Une rencontre intense qui se conclut par des échanges de cadeaux. Freud offre Les leçons d’introduction à la psychanalyse et Rolland son Gandhi.
Éclairs et ombres d’une relation
Faisant suite à la lecture biographique qui met les héros de son roman historique en perspective, Vermorel pose avec éclat sa thèse selon laquelle toute genèse d’œuvre artistique repose sur un nécessaire dialogue, fût-il imaginaire ; il bat en brèche la conviction freudienne d’un processus de création qui serait solitaire et donc héroïque. Vermorel procède à l’examen de cette conviction en proposant une nouvelle lecture de son origine même. Il s’attache à la comprendre au travers des éléments biographiques de Freud. Ainsi le décès de son puiné Julius endeuille sa mère et fait de lui un survivant. L’enfant survivant est initialement traumatisé par la position dépressive de la mère. Le petit garçon est ensuite surinvesti par une mère ayant mobilisé des mécanismes de survie et en devient son héros. Nourri par ce fantasme, l’enfant défend une vision héroïque de l’existence : la sienne propre, mais aussi celle de sa mère à laquelle il reste attaché à la vie à la mort. Aussi, l’aspect de héros solitaire comme fantasme du créateur est placé par Vermorel du côté du narcissisme originaire près du fantasme d’auto-engendrement suite à une configuration de traumatisme précoce dû à la présence d’une « mère morte » selon la notion d’André Green.
Cependant ce fantasme de la création héroïque comporte des points aveugles : la mère, le maternel demeurent pour Freud des terrains interdits et bien cachés. Vermorel souligne les surgissements de cette problématique de la mère primitive dans « Malaise dans la Culture » (sa lettre cachée à Rolland) : « À l’origine, l’écriture était le langage de l’absent, la maison d’habitation, le substitut du corps maternel, cette toute première demeure dont la nostalgie persiste toujours, où l’on était en sécurité. »
Si bien des esprits novateurs entretiennent l’illusion d’une création solitaire, la réalité est à mon sens et en accord avec Vermorel différente. Tout processus de création ne peut naître que dans une ambiance de travail souvent sous la tension d’un dialogue, fût-il invisible. Récemment une historienne a introduit l’idée de dyade de travail (Soreanu, 2019) pour étudier ce type de dialogue créatif en l’opposant à la création solitaire. Soreanu de manière juste réfute toute idée de travail créatif solitaire, montrant que toute découverte découle de la rencontre de partenaires d’une aventure. Mais cet aspect reste descriptif du travail intellectuel et ne prend pas en considération une dimension triangulaire. Car il reste à trouver à quelle interrogation interne la rencontre ou la correspondance trouvera un écho. Vermorel justement propose de lire l’aventure analytique de Freud comme un processus créateur qui est appuyé sur le transfert à un partenaire-correspondant, mais en référence à un travail intérieur qui tient lieu de tiers. Voilà l’espace tiercéisé qui définit mieux, à mon sens, la création. Celle-ci reste déterminée par des conflits psychiques bien souvent non résolus. Le partenaire devient ainsi un interlocuteur interne, parfois visible et parfois nié, jusqu’à être cannibalisé. Ainsi, par exemple, Freud écrit sa lettre ouverte à Romain Rolland, tout comme il écrivait à Fliess, là où il refoule totalement le travail d’Abraham lorsqu’il écrit son Moïse.
Parmi les correspondants successifs de Freud, nous connaissons les rôles de Fliess puis de Jung comme interlocuteurs privilégiés, mais aussi destinataires de mouvements transférentiels puissants et inanalysés allant jusqu’aux ruptures douloureuses bien connues. Les correspondances avec Abraham, Ferenczi, Jones, Rank, Bleuler, etc., témoignent de la vocation de Freud de poursuivre sa réflexion analytique dans la position de maître ou de superviseur. En revanche, la rencontre avec Rolland met tous ces échanges sous une autre lumière. On observe combien il est important pour Freud de métaboliser les éclairs de chaque rencontre dans l’ombre de son cabinet de travail solitaire. Dans cette pénombre, Freud écrit à Rolland qu’il pense à l’heure qu’ils ont passé ensemble en 1924.
Tout en pensant à lui cependant, il écrit son « Avenir d’une illusion » (sa lettre ouverte à Pfister) en omettant de faire référence à la sensation océanique de Rolland, comme base du sentiment religieux. Rolland réagit d’ailleurs, le 5 décembre 1927, en reprochant à Freud cette omission. Sa lettre travaillera Freud pendant deux ans avant que celui-ci ne lui réponde que ses propos l’ont laissé sans répit. Freud a besoin de métaboliser, de faire sien, tout ce qui vient d’une autre pensée, fût-elle celle d’un double imaginaire. Aussi répond-il d’abord indirectement avec son « Malaise dans la Culture » en 1929, comme nous l’avons déjà mentionné, puis ouvertement en 1936 avec le « Souvenir sur l’Acropole ». Ce dernier écrit possède de fait toutes les caractéristiques d’une séance d’analyse, à l’instar de l’associativité de la correspondance avec Fliess. Si le transfert n’est plus aussi passionné, Vermorel notant avec justesse le travail de maturation de Freud, l’intensité du processus créateur reste la même !
Freud décrit dans ce texte avoir éprouvé un sentiment d’étrangeté sur le rocher sacré d’Athènes. Il y reprend le fil du travail du transfert suspendu au moment de la rupture avec Fliess. Certes, la relation au père y est le point central, tout comme les relations masculines fortes qu’il a connues le long de son existence. Mais derrière ces évidences paternelles lumineuses, se cachent l’ombre du maternel et de dimensions dangereuses de transfert maternel que Freud évitait systématiquement dans ses analyses. En effet, les identifications primaires de Freud sont des processus devenus précaires par l’aspect traumatique de son complexe de mère morte à la suite du décès du petit Julius. Freud trouve un nouvel élan après cette lettre à Rolland et produit ses derniers écrits et notes qu’il a laissés.
En conclusion
Le dialogue des deux penseurs est sous-tendu par une méditation sur les origines de la création. Leurs histoires personnelles sont marquées par une présence féminine déterminante, mais qui reste dans l’ombre. Pour la découvrir, il fallait un travail d’historien et d’archéologue. Vermorel a bien fouillé les archives derrière la production épistolaire et nous a conduits dans toutes les strates enfouies des histoires, tout comme les archéologues découvraient les cités antiques qui fascinaient les deux héros. La grande valeur du travail minutieux de Vermorel est de nous donner cette richesse en faisant un dialogue en forme de roman.
Références bibliographiques
Fichtner G. (1989). Les lettres de Freud en tant que source historique. Rev Int Hist Psychanal 2 : 51-80.
Soreanu R. (2019). Michael Balint’s Wordtrail: The Ocnophil, the Philobat and Creative Dyads. Psychoanal hist 21(1) : 53-72.
Vermorel M., Vermorel H. (1986). Freud et la culture allemande. Rev Fr Psychanal 50(3) : 1035-62.
Vermorel H., Vermorel M. (1993). Sigmund Freud et Romain Rolland. Correspondance 1923-1936. Paris, Puf.
Nicolas Gougoulis
[1] Cet article a été écrit avant le décès de notre collègue Henri Vermorel au mois de Février 2020.
[2] En août 1938, Freud écrit sur le coin d’une table : « Mystique, l’obscure autoperception du royaume extérieur au moi, au ça ». OCF.P, XX : 320.
ARCHIVES
Isée Bernateau, Vue sur mer, Puf, « Petite Bibliothèque de Psychanalyse », 2018.
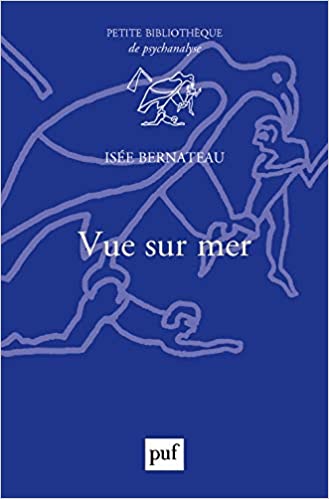
Vue sur mer est une invitation à explorer la notion de lieu pour en penser les modalités d’investissement et ce qui permet de les constituer comme lieu psychique. Qu’est-ce qui nous relie à un lieu, nous fait nous sentir appartenir à lui ? Comment s’ancre-t-on dans un lieu ? « Qu’est-ce qu’une maison natale, un pays natal, un lieu d’origine, pourquoi et comment y est-on attaché ? Pourquoi dit-on qu’on a des racines ? ». Ces questions liminaires suivent l’épigraphe perecquienne qui condense la préoccupation centrale du livre et en tracent les voies d’exploration aussi bien théoriques que cliniques : « comment arracher à l’espace le lieu qui sera vôtre » (Perec, 1974, p. 140)?
L’architecture du livre est composée de quatre parties, « La maison natale », « Lieux, non-lieux et anti-lieux de l’adolescence », « Le non-lieu de naissance » « Heimat : un lieu identitaire », chacune d’elle puisant en différents matériaux les motifs de sa construction : matériaux littéraire (ses premières amours, Isée Bernateau est agrégée de lettres modernes), anthropologique, philosophique, cinématographique… les fondations et l’armature en sont psychanalytiques.
Dans le premier chapitre, l’auteure convie le lecteur à penser ce qu’est une « maison natale » dont les deux termes sont explorés, chacun faisant l’objet d’une étude conceptuelle engagée à partir des énigmes soulevées par la clinique psychothérapique d’adolescents et de jeunes adultes faisant de leur maison le lieu de la nostalgie pour Gabriel, un lieu fortement érotisé par Lola, un lieu pour s’ancrer chez Ramesh…
La question de savoir ce qui fonde la maison comme concept a passionné les anthropologues, les sociologues, tels que Lévi-Strauss et Bourdieu, dont l’auteure rappelle les travaux, les conduisant respectivement à penser la maison comme organisation singulière de la transmission et comme « capacité à résister à la désintégration et à la dispersion » (Bourdieu, 1972, p. 45-49). Conceptions faisant peu ou prou de la maison le dépositaire de l’identité comme la marque d’une inscription dans l’espace et le temps. Architectes, historiens, géographes ont remonté le temps jusqu’à sa préhistoire, en quête d’une « maison originelle » construite ou reconstruite à partir de ses mythes fondateurs : celui d’un lien entre la création d’un espace et d’un temps maitrisables et l’acquisition du langage (thèse du préhistorien Leroi-Gourhan), celui du lieu où vivre ensemble, à l’abri (Viollet-le-Duc), celui d’une terre habitée (oikoumenê) (Berque). Les philosophes ont eux aussi dessiné les contours du concept, Bachelard logeant la maison dans ses fonctions d’enveloppes, héritées d’une protection maternelle lointaine. Un ventre défendant des attaques extérieures, un dedans contre le dehors. La réponse la plus mythique revient à Vitruve et au rôle fondateur du feu, mythe prométhéen dont Freud déploiera toute la force fantasmatique dans son texte « Sur la prise de possession du feu » liant par analogie, perception du monde et sensations corporelles. Des mythes civilisateurs à ceux de la construction psychique du petit d’homme, comment ce qu’Isée Bernateau nomme, à la suite de Freud, « le comportement de la maison », peut-il constituer un modèle fondant les liens entre les représentations du corps et celles de la maison ? La proposition de l’auteure est audacieuse : « la maison est ce qui vient inscrire dans l’espace psychique de l’enfant la délimitation dedans/dehors dont l’infans avait déjà fait l’expérience dans l’apprentissage de son corps propre » (p. 34). Elle fonde son hypothèse sur les travaux psychanalytiques relatifs à l’édification des premières différenciations. Partant des propositions freudiennes liant la différenciation entre moi et non-moi au principe de plaisir déplaisir par le truchement de l’activité sensorielle et de l’action musculaire appropriée, l’auteure emprunte à Didier Anzieu le concept de signifiants formels et de Moi-peau, à Winnicott celui d’espace transitionnel, à Piera Aulagnier celui de pictogramme pour asseoir sa proposition : « la maison n’existe qu’en tant que prolongement et dérivation analogique du rapport du sujet à son propre corps : elle est en réalité totalement dépendante de la construction de l’image du corps propre » (p. 37). Si la démarche analogique souligne ce que la représentation dans ses fondements doit à l’expérience perceptive du corps et par extension celle du monde physique – on peut rappeler ici la célèbre formule de Freud (1923) « Le moi est avant tout un moi corporel, il n’est pas seulement un être de surface, mais la projection d’une surface » – la question demeure de savoir par quelles voies de frayage pulsionnel se construit le lien entre maison et corps, in fine avec le corps érogène. Le second chapitre qui déploie les multiples formes d’investissement des espaces dans son rapport au corps et à la motricité relance la question.
Le second chapitre décline des figures de lieux composées, anti-lieux et non-lieux, en expose les formes négatives dans leur potentiel conflictuel et de destructivité. Selon la formule d’Isée Bernateau, la « position singulièrement atopique » dans laquelle se trouvent les adolescents, offre une voie d’exploration exemplaire des modalités d’investissement des lieux, entre errance et conquête. La référence aux quatre films de Gus Van Sant qui composent sa « tétralogie de la mort » – Paranoid Park, Last Days, Elephant, Gerry – accompagne l’analyse des figures de lieux tout autant qu’elle donne envie au lecteur de replonger dans les salles obscures. La proposition d’une figure d’anti-lieu engage une opposition, un contre, un tout contre la réalisation des fantasmes incestueux et de meurtre, pour penser l’investissement des espaces contre le temps, des espaces devant échapper « aux coordonnées parentales ». À l’inéluctable du temps qui passe et des changements pubertaires qu’il engage, se substitue l’investissement des espaces maitrisables à l’envi, offrant des voies de satisfaction tracées par les premiers auto-érotismes infantiles qui ont imprimé durablement dans le corps le plaisir du mouvement et du rythme. La figure des « non-lieux » engage la réflexion du côté des impasses du processus adolescent, une formule qui jouant avec les mots permet de faire entendre la violence du procès intenté à un autre, pouvant passer par l’exclusion radicale de soi dans l’errance jusqu’au meurtre, entendues comme deux formes radicales d’exil. À la lecture de ces pages, on pourrait se demander si l’enjeu de toute conquête adolescente n’est pas, pour chacun, de trouver son Acropole…
Le chapitre suivantintitulé« le non-lieu de naissance »,poursuit l’exploration des lieux placés sous le signe de la négativité. Lieux troublés qui s’enracinent dans l’impensable d’expériences qu’il ne suffit pas de qualifier de traumatiques pour faire entendre la complexité de ce que « s’enraciner » veut dire et de ce que le mot doit à l’expérience vécue, espace et temps compris. Lorsque celle-ci a été marquée par la violence, à l’échelle individuelle ou de nations entières, qu’est-ce que s’ancrer veut dire ? Ariane, soumise à l’impensable de l’inceste durant son enfance se tient en marges des lieux et ne parvient à se poser nulle part. Pérec, dans W ou le Souvenir d’enfance écrit : « je ne peux avoir de souvenir d’enfance puisque je suis orphelin ». Si les lieux ont une histoire, la question est de savoir quelles traces celle-ci laisse quand les expériences négativantes ont trop fortement marqué le fil de la vie psychique, les rendant impensables. Dans un sous-chapitre intitulé « la mémoire des lieux », Isée Bernateau formule la question ainsi, entrelaçant le mort et le vif, pour reprendre les mots de Jean-Bertrand Pontalis : « comment retrouver le temps perdu quand la violence du trauma a détruit la chair vivante du souvenir ? ». Question qui entraine dans son sillage celles des voies d’inscription des expériences psychiques, des traces mnésiques, et de leur mode de présentation, lorsque celles-ci se sont imposées sur le mode négatif de l’effacement. En infatigable arpenteur, Georges Perec a cherché dans l’exploration des espaces le moyen de s’ancrer, dans le geste de son écriture, celui d’en laisser la trace et d’y demeurer. Des mots logés dans une œuvre pour faire « œuvre de sépulture », propose l’auteure dans les suites des travaux de Pierre Fédida, « un chef-d’œuvre d’architecture littéraire » pour un « grand bâtisseur de lieux littéraires ».
Le dernier chapitre « Heimat, un lieu identitaire », offre un point de vue remarquable sur le sens des « racines », du mot et de la chose, empruntant aux constructions primitives du fonctionnement psychique et à ses formes complexuelles, les motifs inconscients de ses exaltations. Exaltation du lieu de naissance et des origines fondée en ses déterminismes inconscients sur une logique de l’exclusion et de la haine, ferments des idéologies de l’enracinement et de leurs forces destructrices. Exaltation de la terre-mère et du lien originaire dont la formule mère patrie (pater) recouvre ce que le mot doit à la chose incestueuse et à ses formes fantasmatiques. Les multiples déploiements sémantiques à partir de la racine heim lient fondamentalement l’expérience du chez-soi à celle de l’étranger. Le plus inquiétant est logé au plus profond de soi, le Un (heimlich) porte la marque du refoulement selon la proposition freudienne de l’Inquiétante étrangeté, dont la référence parcourt naturellement l’ensemble de l’ouvrage.
La question posée est de savoir, partant de ce qui fonde le rapport du sujet humain à l’autre dont l’altérité inaliénable habite la psyché en son cœur, ce qui peut alimenter l’idéologie de l’enracinement ; l’entreprise est hardie. L’aura qui entoure les temps originaires en célébrant l’union mère-enfant a nourri bien des rêveries et mythes, romantiques, philosophiques et psychanalytiques. Partant des fantasmes symbiotiques présidant aux temps mythiques de l’édification du fonctionnement psychique, l’auteure propose de penser ce qu’intimité veut dire, en écho avec le concept lacanien d’extimité. Chemin faisant, suivant les multiples voies qui impriment à la psyché ses marques de différenciations, Isée Bernateau en vient à faire l’hypothèse d’une idéologie de l’enracinement entée sur le déni de l’extimité de la Chose, moyen de faire advenir « un lien indivisible avec la terre-mère par-delà toute séparation » (p. 143). Si pour l’auteure le lieu natal tient son aura de l’amour maternel, « sa première demeure parlante » selon les mots de Edmundo Gómez Mango (1996, p.249), l’idéologie de l’enracinement fait un pas de plus en ce que la relation à l’objet œdipien n’y porte ni la marque de la perte ni de l’interdit. Dans sa sémantique même, l’idéologie porte l’empreinte de l’affirmation totalitaire, d’un individis puisant en ses racines narcissiques la force de ses investissements ; la difficulté demeure de penser ici les voies qui prolongent celles de la psychologie individuelle jusqu’à la psychologie collective, question essentielle que soulève d’une autre manière l’efflorescence des lieux de mémoires collectives dont les formes visibles témoignent de cette crainte d’effacement.
Les derniers sous-chapitres du livre sont un retour aux origines, aux sources inconscientes qui enracinent le rapport aux lieux, pour en chercher, derrière la surface, les multiples sédiments déposés dans la langue, traces mémorielles qui sont aussi celles de temps immémoriaux. La topique du lieu ne va pas sans « dynamique des innervations du mot », sans la chair des mots. J’allais écrire la chair des morts… lapsus révélateur de ce que les mots doivent à l’absence, de ce que la représentation doit à l’objet et à la haine qui l’a constitué comme tel. Le fort-da est un jeu, il n’en n’est pas moins meurtrier, c’est« une perte radicale qu’instaure le langage d’avec la chose » qui « rend impossible de considérer le lieu comme le site naturel de l’être ». En appui sur la notion platonicienne de Khôra, dans l’usage détourné que le philosophe en fait dans le Timée, l’auteure ouvre sa réflexion sur l’insaisissable du lieu, du mot tout autant que de la chose qu’il tente de circonscrire en la nommant. Freud a fondé le lieu psychique sur ses racines inconscientes, le topos figurant la spatialité de l’appareil psychique contenue en sa célèbre formule « Psyché est étendue et n’en sait rien » ; avec l’emprunt de la notion de Khôra l’auteure propose, en une formule qui lui fait écho : « khôra est là, elle est le là, mais ne peut se dire » (p. 158). Si celle-ci conserve une part d’énigme inhérente à sa condensation, elle permet de penser ce qui pourrait constituer une différence essentielle entre l’aspiration à s’ancrer dans un lieu – comme autant de déplacements du lieu de naissance, dont la maison natale est la figure paradigmatique-, et celle de s’enraciner car « nul ne peut prétendre s’enraciner, sauf à dénier tout à la fois l’interdit de l’inceste et Khôra, cette qualité énigmatique propre du lieu qui en fait au fond un insaisissable ».
Brève de vacances : sur la plage un enfant d’une huitaine d’années demande à ses frères de l’enterrer. C’est de bonne guerre qu’ils lui refusent ce plaisir. Face à sa déception, la mère se charge d’enterrer son fils, mettant du cœur à l’ouvrage. Plus tard, l’enfant se roulant dans le sable l’interpelle de nouveau, triomphant : « regarde maman, je suis pa-né ! » ?
Références bibliographiques
Bourdieu P., « La maison ou le monde renversé », Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972, p. 45-49.
Gómez-Mango E., « Fragments vers le natal », Le fait de l’analyse, 1996, 6.
Perec G. (1974). Espèces d’espaces, Paris, Galilée, p. 140.
Estelle Louët est psychanalyste, Maître de conférences à l’université Paris Descartes-Université de Paris, Laboratoire PCPP.
León Grinberg, Qui a peur du (contre)-transfert ? Transfert, contre-transfert et contre-identification projective dans la technique analytique, Ithaque, 2018.

Cet ouvrage récemment publié aux Editions Ithaque permet de découvrir ou redécouvrir la pensée de Léon Grinberg, psychanalyste argentin mort en 2007 et dont les nombreux travaux seront peu diffusés en France à défaut de traduction.
À l’intéressante construction de l’ouvrage centrée sur les questions de contre-transfert et de contre-identification projective, il convient d’adjoindre la préface de Jean-Michel Assan, à qui l’on doit la sélection et la traduction des textes de ce livre, et qui permet de replacer le travail de Grinberg dans un contexte historico-théorique international.
Médecin et psychanalyste, León Grinberg (1921-2007) a été membre de l’Association Psychanalytique Argentine (APA) et vice-président de l’International Psychoanalytical Association (IPA) entre 1965 et 1969. Il fuit l’Argentine et la dictature et se réfugie en Espagne en 1976. Issu de la très fertile école de Buenos-Aires, seuls deux ouvrages sont parus en français jusqu’ici : Culpabilité et dépression (Les Belles Lettres, 1992) et Psychanalyse du migrant et de l’exilé (Césura, Lyon, 1987).
Mais Qui a peur du contre-transfert ? Derrière ce titre un brin facétieux se profile une allusion aux controverses qui ont entouré les théories du contre-transfert, comme si celui-ci comportait intrinsèquement une menace. Les psychanalystes ont eux aussi leurs peurs à conjurer et ces mêmes théories pourraient bien être le reflet de manifestations anti-phobiques comme le souligne Paul Denis (2010).
Grinberg s’inscrit dans cette filiation où apparaissent Mélanie Klein, Winnicott ou Bion, qui a transformé une conception « classique » freudienne du contre-transfert, en une conception dite « moderne » où celui-ci est appréhendé comme un outil de compréhension du transfert du patient. Dans cette acceptation « moderne », l’analyste va se laisser envahir par les projections du patient dans le but de les comprendre et les élaborer. C’est à Bion que l’on doit l’analogie entre la situation analyste-patient et la relation mère-enfant, dans laquelle la mère (et par analogie l’analyste) grâce à sa « capacité de rêverie » accueille les identifications projectives mais aussi les transforme, avant de les restituer par l’interprétation. Approche et conceptions dont les échos se font aujourd’hui entendre avec la notion de Théorie du champ analytique dont Thomas H. Ogden et Antonino Ferro sont des représentants éminents.
Les textes rassemblés dans cet ouvrage font la part belle à la technique psychanalytique et aux leviers fournis par la dynamique transféro/contre-transférentiel. Si certains de ces aspects sont familiers aux psychanalystes contemporains, celle de contre-identification projective l’est moins. Notion repérée par Grinberg en 1956 qui après avoir été perçue comme une « défaillance du contre transfert, devient un précieux instrument du travail analytique. » Cette notion originale et centrale dans son travail vient élargir une conception théorico-clinique du contre-transfert.
Placés en début de l’ouvrage, deux textes de synthèse donnent une vue d’ensemble sur les positions de Grinberg, on y repère ses fondements et leurs articulations.
Le transfert est notre croix
Le Titre de cet article fait explicitement référence à Freud. Grinberg y reprend une formulation de Freud adressée au Pasteur Pfister où le transfert peut être entendu comme un « fardeau ». Cette phrase cristallise sans doute les divergences à naitre autour des techniques dans l’utilisation du transfert. Grinberg s’appuie sur son bagage kleinien mais aussi sur les auteurs post-freudiens pour rappeler que l’identification projective offre une représentation du mécanisme de déplacement des objets internes sur un objet externe (analyste), en insistant sur l’idée que ce sont les objets internes qui sont transférés, ce qui ouvre sur la question de la modification du surmoi.
Plus qu’une définition, il fournit une représentation du transfert, « Une approche possible du transfert est de le voir comme une relation vivante, emprunte de changements et de mouvements constants. Les patients peuvent tenter de faire agir l’analyste en l’attirant dans leurs systèmes défensifs. Il s’agit d’expérience qui vont au-delà de la parole, et ne sont souvent repérables qu’à travers le contre-transfert. »
Il défend également l’idée que, sans être une « croix », le transfert n’en est pas moins un outil technique qui comporte certains risques et une dangerosité latente. Grinberg met en garde les psychanalystes qui s’en défendraient trop, soit en le niant soit en en ayant une approche trop conceptuelle. Sa référence à Bion est explicite, l’analyste doit contenir les projections qu’il reçoit mais aussi les « désintoxiquer » avant de les restituer dans des interprétations. Pour cela, il doit être capable de se laisser envahir par les projections des patients, pour pouvoir « co-sentir » et « co-penser » les affects contenus dans ces projections d’autant qu’elles sont de nature hostile (haine, angoisse de mort, terreur catastrophique…). C’est aussi une conception où le transfert est omniprésent même si le patient évoque le passé ou l’avenir. Omniprésent ne signifie pas qu’il soit à sur-interpréter, ce qui serait le signe d’une lutte contre l’angoisse du côté de l’analyste. En revanche, Grinberg revendique une position d’écoute à l’unisson (at-one-ment) du patient pour donner lieu à du nouveau dans l’écoute et non du déjà connu, position où la référence bionienne est là encore manifeste.
La contre-identification projective
Ce texte de 1985 offre la synthèse de ses travaux initiés dès 1956 lorsqu’il repère la notion de contre-identification projective. C’est une vision originale d’un des éléments du contre-transfert, une réponse « dans l’analyste » à une identification projective du patient. Bien que cette notion ait fait l’objet de débats et d’articles en langue française, elle est restée assez confidentielle, et semble avoir fait l’objet d’interprétations un peu schématiques comme le rappelle Jean-Michel Quinodoz dans un article paru dans la Rfp en 1994.
Le détour clinique s’impose pour se représenter ce que Grinberg nomme sous ce terme de contre-identification projective. Qui n’a jamais ressenti des états de torpeur ou d’assoupissement, ou encore des moments d’angoisse surprenants dans certaines situations cliniques ? Est-ce en réaction à ses propres conflits que l’analyste réagit ou est-ce une réponse affective indépendante de ses propres émotions et réactionnelles à ce que l’analysant a projeté en lui ? Grinberg nomme cette seconde proposition sous le terme de contre-identification projective et propose que celle-ci « se produit spécifiquement comme résultat d’une identification projective excessive par l’analysant, qui n’est pas consciemment perçue par l’analyste, lequel se trouve alors passivement « conduit » à incarner le rôle que l’analysant a « forcé à l’intérieur de lui », de façon active bien qu’inconsciente. »
Et Grinberg insiste sur le fait que la réaction de l’analyste est en grande partie indépendante de ses propres conflits. Il revendique ainsi une certaine spécificité de son concept et tient à le différencier de conceptions[1] où l’analyste est le jeu d’identifications (du patient) mais qui sont acceptées par sa conscience. La différence étant que, dans la contre-identification projective, l’analyste prend en charge une réaction ou un mécanisme qui appartient au patient. L’accent est placé sur le patient et non sur l’analyste. C’est le patient qui provoque activement chez l’analyste une réponse émotionnelle déterminée, que ce dernier éprouvera de manière passive.
Le phénomène de contre-identification projective serait à entendre comme un point de départ, et non comme une défaillance de l’analyste, pour éprouver des émotions complexes qui, bien comprises et sublimées, peuvent selon Grinberg devenir de très utiles instruments techniques afin de rentrer en contact avec des niveaux les plus profonds de la psyché. Conception qui fait écho aux travaux de Joyce McDougall qu’il cite, à propos de la communication primitive du nourrisson qui, outre le fait qu’elle permet de décharger les émotions sous forme directes en affectant l’autre, est aussi un moyen de rester en contact intime avec l’autre.
Il va jusqu’à généraliser son idée autour de ces phénomènes et suppose que la transition qui mène à la compréhension et à la croissance psychique selon la formulation bionienne, doit peut-être inévitablement en passer par la contre-identification projective.
Une critique qui a été fait sur ce point théorique et technique de Grinberg concerne l’accent mis sur le rôle passif que jouerait l’analyste lorsqu’il est le réceptacle des projections du patient comme le mentionne Jean-Michel Quinodoz (1994). Grinberg propose une conception de la contre-identification projective qui se passe en deux temps. Tant qu’il n’a pas conscience d’être le réceptacle de l’identification projective du patient, il est en effet « passif ». En revanche, lorsqu’il prend conscience que ce qui a été projeté en lui ne lui appartient pas, son rôle est « actif » et le conduit à la possibilité d’interpréter le phénomène pour le restituer au patient.
À la lecture de Grinberg, on ressent sa stimulation à transmettre, il consacrera d’ailleurs un livre à la question de la supervision psychanalytique. À plusieurs reprises, il met en garde les analystes contre certaines de leurs attitudes, défauts ou défenses, notamment lorsqu’il s’agit de passer à côté des aspects transféro/contre-transférentiels. Un des textes de l’ouvrage fait explicitement référence à la supervision, dans lequel il élargit ses conceptions sur le contre-transfert à la technique de supervision. Dans cette expérience de formation et de transmission au-delà du savoir clinique, résonnent les différentes facettes des fantasmes inconscients qui surgissent dans la supervision au même titre que dans la séance entre le patient et l’analyste. Au regard du peu de travaux sur ces questions, ce chapitre intéressera à plus d’un titre les analystes en formation. De nombreuses questions y sont soulevées, et on ne s’étonnera pas que dans ce champ qui lui est familier, Grinberg préconise de différencier ce qui concerne le contre-transfert de la contre-identification projective de l’analyste en formation. Il insiste pour que ces mouvements de contre-identification projective soient à part entière au travail dans la supervision car bien que difficiles à déjouer, c’est en les mettant en lumière que l’analyste en formation pourra entrevoir ce que le patient cherche sur des modes projetés à lui montrer de ses pensées et de son fonctionnement. Il s’agit de détecter des qualités particulières des réaction émotionnelles du supervisé, la position tierceisante du superviseur offrant un regard sur ces éléments singuliers et étranges qui peuvent surgir et faire écran à l’écoute de l’analyste. Grinberg propose l’exemple de situations où l’analyste se sent manipulé ou encore excède en culpabilité de ne pas être à la hauteur.
La seconde partie de l’ouvrage rassemble trois textes qui datent de la fin des années 50 qui sont à l’origine de la notion de contre-identification projective. Ils permettent un éclairage historique et d’étayer cette conception en s’attachant à ses fondements avec un solide apport clinique. Le livre se clôt sur un chapitre où Grinberg reprend pas à pas son parcours, et il est intéressant de s’attacher aux étapes de la construction de sa pensée qui montrent bien l’évolution de ses vues et les avancées sur la théorie du contre-transfert. De l’ensemble se dégage l’influence prépondérante de la théorie de Mélanie Klein, avec au centre la question de l’identification projective qu’il déploie dans le texte « Aspects magiques du transfert et du contre-transfert ». La magie vient de la régression, au même titre que l’illusion d’omnipotence et entraine les fantasmes inconscients vers des niveaux archaïques, avec la recherche de l’expérience « magique » de ne faire qu’un avec l’objet. Il s’agit de traduire une expérience qui n’apparait pas toujours comme rationnelle. Par la suite, l’influence de Bion va s’avérer extrêmement féconde et permettre à Grinberg de déployer de nouvelles implications dans la technique psychanalytique et le maniement du contre-transfert, ou de l’interprétation, et par extension de mettre en application à l’ensemble de sa clinique ses découvertes sur l’identification projective et ses conséquences dans l’analyse.
La question du contre-transfert reste un sujet passionnel. A la fois les enjeux de la prise en compte de l’asymétrie dans la cure, ceux de l’évacuation trop rapide de la conflictualité – auxquels certains courants nord-américains de l’intersubjectivité nous invitent à tendre – et aussi les enjeux de contenance et l’accent mis sur l’aspect réparateur de la relation, autant de points de cristallisation qui viennent alimenter la crainte de perdre de vue l’inconscient et l’héritage freudien.
Si cette publication en français des travaux de Grinberg sur le contre-transfert permet d’avoir une vue d’ensemble avec un déploiement historique, théorique, technique et clinique sur l’évolution d’un concept et même bien au-delà de son auteur, il est aussi intéressant de la remettre en perspective avec les considérations actuelles sur le sujet et, de fait, elle ouvrira peut-être sur un nouvel espace de réflexion inter-analytique.
Références bibliographiques
Denis P. (2010). Rives et dérives du contre-transfert, Paris, Le fil Rouge, Puf.
Quinodoz J.M. (1994). Le psychanalyste, conteneur actif de la contre-identification projective, RFP, 5/1994 p. 1597-1600.
Lechartier-Atlan C. (2000). Intersubjectivité et contre-transfert : les enjeux d’une controverse américaine, In Marie Claire Durieux et al, Sur les controverses américaines de la psychanalyse, Paris, « Monographies de psychanalyse », Puf.
[1] Référence à Heinrich Racker avec la notion de contre-transfert complémentaire (cité p. 60).
Amélie de Cazanove est psychanalyste, membre de la SPP.
Catherine Potel (dir), J.-J. Baranes, L’adolescent, son corps, ses « en jeux » : Point de vue psychomoteur, In Press, 2018.
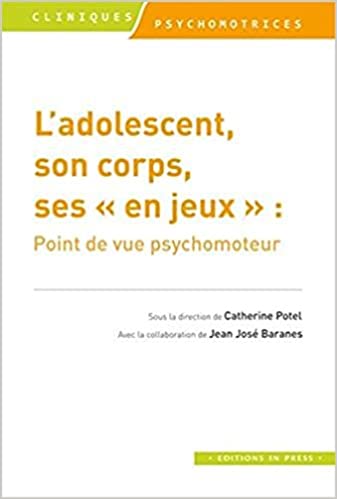
Tous les « psychistes », pour utiliser ce néologisme inventé par François Tosquelles pour désigner tous les soignants des institutions psychiatriques, savent combien l’abord corporel des traitements psychothérapiques pour des patients en grande difficulté et tout particulièrement pour les adolescents, est essentielle et centrale.
Sur le plan théorique cela paraît évident. En effet, dans le fonctionnement psychotique, les troubles de symbolisation sont tels que l’harmonie et la fluidité des échanges entre la représentation, l’affect et le corps sont rompues. L’adolescent est toujours en prise avec la violence pulsionnelle exacerbée par le bouleversement pubertaire et l’exigence développementale sur les plans psychologique, biologique et sociale de se constituer une identité sexuelle.
Le but de cet ouvrage est de faire la promotion du travail que font les psychomotriciens avec les adolescents en difficulté et il faut dire que c’est réussi.
Catherine Potel qui dirige cette somme de témoignages avec Jean-José Baranes sait de quoi elle parle. Elle a une longue expérience de son métier, dans des lieux de soins très divers, et elle a toujours su rendre compte de son travail qu’elle a mis en forme dans de nombreuses publications.
Le lien instauré avec un adolescent, quel que soit le cadre et le contexte, engage le corps de chacun des protagonistes. La tentation est toujours grande d’utiliser avec eux des circuits courts pour opposer aux attitudes de défit des contre attitudes autoritaires, aux comportements provoquants une fausse indifférence ou un geste de contention.
Les psychomotriciens sont les mieux placés pour montrer ce que Catherine Potel appelle le contre- transfert corporel. Il s’agit de ce face à face avec un adolescent qui se transforme en un corps à corps interdit. A partir de là comment se servir de ce qu’on éprouve corporellement lors de ces rencontres avec un adolescent pour l’aider à mieux se comprendre, à se saisir des conflits dont il est prisonnier, lui qui aspire tant à la liberté.
Cet ouvrage est placé sous le signe de la diversité car il ne saurait y avoir en la matière, de standardisation ou de protocole de soins pouvant répondre à telle ou telle situation. Une façon de rappeler à tous les psychistes qu’il faut toujours faire preuve de créativité et d’inventivité quand on veut rencontrer des adolescents. Et que, celui qui fait la part belle à la créativité doit témoigner de son travail dans un esprit de recherche, de recherche « scientifique » non pas ce « scientifique » actuel post-moderne qui consiste à « faire preuve », mais une recherche qui allie écoute, observation et mise en réflexion dans un après coup productif.
Que d’histoires sont racontées dans ce livre ! Chaque auteur en rapporte une ou plusieurs et toutes sont passionnantes car tout le livre est écrit avec authenticité et sincérité. Et pour cause : tous les auteurs sont des praticiens qui ont réfléchi à ce qu’ils font. Il faudrait faire référence à toutes ces rencontres, l’évocation de certaines d’entre elles illustre leur diversité.
Dans son introduction, Serge Hefez prévient le lecteur : « La clinique de l’adolescent est une clinique de l’agir, au lieu d’une parole qui fait défaut ». Ces agirs ont un effet calmant sur l’excitation propre aux transformations liées à la puberté et antalgique sur la souffrance psychique que cela entraine. On pourrait dire que le projet d’une psychomotricité bien comprise consisterait à donner la parole à ces corps pour qu’advienne leur fonction essentielle à savoir contenir et canaliser les mouvements pulsionnels. Sauf que, dans la postmodernité dans laquelle nous vivons, le corps virtuel prends trop souvent la place du corps réel et l’écart entre la masturbation devant un porno et l’acte sexuel agi avec un/une partenaire est le lieu même de la subjectivation. D’autres défis attendent les adolescents aujourd’hui : se dégager de l’emprise familiale, s’engager dans le processus de désaffiliation pour s’ouvrir à d’autres groupes avec la nécessité de croire, dans le sens le plus profond de ce terme, dans ce Monde privé de l’évidence de ses modèles de croyance. Qui croire, en quoi croire ? Pour se projeter dans quel Avenir ? C’est le rôle de tout thérapeutes de les aider sans les culpabiliser.
Orianne Legrand parle d’une clinique « brute », qui n’a pas subi d’élaboration intellectuelle, non secondarisée en quelque sorte. Il est vrai qu’elle parle de ses rencontres avec des patients dans une piscine, des adolescents hospitalisés dans un service de crise pour adolescents. Comment aider ces adolescents à s’intéresser à leurs corps autrement que comme un objet de haine ou de mépris. Il faut apaiser, observer et écouter l’adolescent parler de son corps, et enfin contenir les mouvements d’excitation chez des adolescent pour qui être en maillot, c’est d’être nus.
C’est en CMPP que Roland Obeji travaille. Il nous présente les cas de Mélissa, de Kevin, d’Edgard, des patients qui agissent, trop vite, de façon déterminée, « sans réfléchir » souvent. L’art du thérapeute c’est de se servir de ces démonstrations de force comme des instruments de bord qui renseigneraient sur la construction de l’image de leur corps afin de transformer cette force qui ne sait contre qui ou contre quoi se déployer.
Éric Rouveyrol évoque le problème de la violence sexuelle à l’adolescence. Dans un article bien documenté, il rend compte de son expérience au sein d’un CRIAVS (Centre Ressource pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles. Il conclura à l’intérêt des thérapies à médiation corporelle pour aider ces adolescents à renoncer au corps à corps imposé à la victime pour se défendre face au risque de passivité.
Avec Omar c’est d’un corps-à-corps avec le thérapeute qu’il s’agit. David Rousseau lui propose d’exprimer sa violence par le biais d’arts martiaux. Il est vrai que lui-même se sert, comme il se doit, de son propre vécu de l’adolescence que la rencontre avec ces patients d’hôpital de jour lui fait revivre. Mais dans cas-là, le cadre doit être précis. Un changement de salle et Omar se désorganise, il frappera David au front. Mais nous dit le thérapeute « Nul doute que cet événement, bien que violent, fera trace dans la construction d’Omar ». Cela n’est pas sans rappeler ce que Pierre Delion décrit comme la mise à la disposition des patients de son propre appareil psychique pour l’aider à symboliser les éléments béta qui l’envahissent. Dans quelle mesure et dans quelle condition peut-on mettre son corps à la disposition du corps de ces patient adolescent pour aider à la construction de leur corps ? C’est la question essentielle que pose l’approche corporelle de ce type de patient.
Spartacus est diagnostiqué schizophrène paranoïde. Il est incarcéré pour apologie du terrorisme, il est hospitalisé à l’UHSA (Unité Hospitalière Spécialement Aménagée) à la suite d’un épisode délirant à thématique mystique. Mélissandre Le Corre va lui proposer une série d’enveloppement sec et c’est cette histoire de soins qu’elle raconte. Assez rapidement Spartacus apprécie ces séances qu’il vit comme une « nouvelle expérience », lui qui a essayé diverses manœuvres afin de sentir son corps tant par l‘extérieur (tatouages) que par l’intérieur (absorption de psychotropes). Il éprouvera ces packings complétés par d’autres types de stimulations sensorielle et proprioceptives comme une renaissance, il se sent libre, ressent son corps, il respire, « c’est ça la magie de l’enveloppement » dira-t-il. L’auteur commence son article par une citation de A. Maurion : « Soudain arrêté dans leur course, le « silence » de la prison leur fait courir le risque d’entendre le tumulte de leur monde intérieur » qui nous rappelle que dans toutes les situations où un patient est stoppé dans son agitation psychomotrice, ne serait-ce que par le biais d’un traitement médicamenteux, est en proie à ses démons intérieurs qu’il tentait de fuir.
Pour rendre compte de sa longue pratique dans des lieux très divers (CMP, CATTP, UPA, HDJ) Charlotte Paumel propose une sorte de « grille de lecture » du corps de l’adolescent en mouvement et en relation. Cela permet de faire un bilan qui doit guider la prescription et l’organisation des soins. Mais c’est toujours la clinique qui prévaut et c’est au cours de la première rencontre que s’organise le lien. Au moment de la restitution du bilan se joue l’accord, « le deal » comme dirait les adolescents, pour s’engager dans un suivi et passer ainsi de la réticence à parler de et avec son corps, à l’alliance thérapeutique. C’est ce qui s’est passé avec Cédric l’adolescent autiste capable d’exploser jusqu’à se faire du mal.
Alice est anorexique, elle pèse 36,3 kg pour 1,70 m soit un indice masse corporel de 12,63, elle doit être hospitalisée. Odile Gaucher va la masser lentement, patiemment jusqu’à être contaminée par l’ennui que le vide psychique de Alice (a-lisse) suscite. On doit s’imaginer ce que ça fait de masser le corps d’une adolescente anorexique d’une maigreur extrême qui refuse son corps et le laisse en stand-by. Pourtant, peu à peu, Alice va réveiller son corps de femme jusqu’à le souligner par des tenues provocantes. A la dernière séance elle conclura son cheminement en psychomotricité « Au début, ça m’aidait à me découvrir, et depuis que je vais mieux ça me permet à chaque fois de me retrouver. Et c’est agréable ! » Elle aura retrouvé ce lien psychocorporel comme fondement du sentiment de sécurité interne.
Le pharmakon est à la fois remède et poison. C’est ainsi que Jacky Garrone en pratique libérale va se servir de jeux vidéo pour suivre René un adolescent d’abord suivi en CMP pour un TED (Trouble Envahissant du Développement) diagnostiqué au CRA (Centre Ressource Autisme). C’est dans ce contexte qu’il avait participé à la conception d’un jeu vidéo destiné à améliorer les compétences des enfants autistes. Il y avait pris goût au point de développer une addiction. L’utilisation abusive des jeux vidéo renvoie à une « décorporéisation » du sujet, d’un sujet privé de corps et dont la mise en relation avec son corps passe par l’intermédiaire d’une véritable sensorimotricité virtuelle. Le praticien de la psychomotricité devra travailler aussi avec les projections du corps du sujet pour pouvoir offrir au patient la contenance qui lui est nécessaire.
Sam souffre de troubles du langage oral et écrit importants. Il est assez constamment en conflit avec les autres. Alizée Lamouline va le suivre dans le cadre d’un SSESAD (Service de Soins et d’Éducation Spécialisé d’Aide à Domicile). Les séances sont difficiles car si l’agitation disparaît le temps du bilan, elle réapparait de plus belle sans que le thérapeute comprenne que par cette agitation, son comportement fuyant et son hypotonie, Sam manifeste son noyau dépressif. C’est à l’occasion d’une séance de relaxation que le travail commence conjointement avec le thérapeute. Il finira par déployer ses capacités de contenance de ses émotions, et de développer et articuler ses pensées grâce au soutien de « la tête pensante » du thérapeute pour et avec lui.
Agnès De Bernardo-Molard choisit comme médiation la thérapie avec le cheval. Elle insiste sur cette formulation car il ne s’agit pas d’équithérapie ni de thérapie par le cheval mais bien de thérapie avec le cheval car c’est un médiateur vivant qui entre en communication par ses propres codes avec l’être humain. Être en contact avec un cheval c’est être dans un bain sensoriel permanent, ce bel animal stimule la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et surtout la proprioception lorsqu’on est dessus pour tenir en équilibre. Toutes les conditions sont réunies pour que les fonctions de Holding et de Handling soient réactualisées chez ces adolescents en hôpital de jour. C’est le cas d’Arnaud qui a pu trouver dans la figure tranquille de la jument un apaisement qui lui a permis de modifier l’image de son corps.
Avec Bernard Meurin on a affaire avec des adolescents autistes. Ça se passe à Lille dans le service de pédopsychiatrie dirigé par le Pr P. Delion et l’on sait combien son école est attachée aux fondements psychomoteurs du développement psychologique chez l’enfant. Bernard Meurin postule que chez ces adolescents la tâche est la même que chez le bébé à savoir « Habiter son organisme pour en faire un corps ». L’assise théorique est solide, s’appuyant sur les travaux de A. Bullinger et même d’un des fondateurs de la discipline J. de Ajuriaguerra, l’auteur rend compte de son travail avec ces personnes avec autisme qui consiste à les aider à maintenir un équilibre sensori- tonique et la stabilité de leurs représentations corporelles malgré la pression des modifications liées à la poussée pubertaire.
Avec Joëlle Villain il ne s’agit plus à proprement parler de psychomotricité mais de jeu dramatique et, somme toute, toujours de thérapie corporelle. D’ailleurs le premier temps du groupe est un temps d’échauffement corporel et psychique belle façon de faire le lien entre le corps et la parole. Puis on jouera une histoire élaborée en groupe et on la commentera. Victor présente une hyperkinésie envahissante et il suscite chez l’interlocuteur une inquiétante étrangeté. L’histoire de son évolution tout au long de sa cure dans ce groupe est passionnante pour finalement contribuer à recréer cette expérience de rassemblement interne (Esther Bick) qui lui faisait défaut. Victor commencera à la suite de sa participation dans ce groupe un psychodrame individuel, preuve qu’il avait pu avoir accès à un travail de symbolisation.
Claude Broclain connaît bien ses classiques. Il commence par Abraham et Sarah, deux vieillards à qui Dieu fait une drôlerie (its haq), ainsi sera nommé Isaac. Cette scène de l’ancien testament peut être lu comme une scène de psychodrame : l’amour, la sexualité, éros est présent à tout âge de la vie même (et surtout) aux âges où on est sensé ne pas pouvoir enfanter : la vieillesse et l’enfance. Au fond voilà le message qu’un Dieu psychomotricien veut nous faire passer, et ya pas d’quoi rire ! Élisabeth, préadolescente, propose une scène au psychodrame : elle va chez son voisin : « Bonjour Monsieur, y a mon robinet qui fuit » et elle éclate de rire. Voilà qui est dit : un robinet qui fuit au psychodrame = ça mouille dans la culotte. C’est tout à fait insupportable de penser ça pour un vieillard comme pour un adolescent, alors ils rient pour soulager leur angoisse. Rire, accepter son angoisse sans la fuir, utiliser un langage cru comme le font les adolescents pour être au plus près de l’objet fantasmé, c’est déjà être dans le système préconscient/conscient. Après Jérusalem, Claude Broclain connaît aussi Athènes : Déméter est profondément triste à la suite de la perte de sa fille. Baubô soulève sa robe et lui montre son sexe de femme, Déméter éclate de rire. C’est sans mot dire que cette scène de psychodrame figure que Éros est toujours là pour faire face à Thanatos, le système préconscient/conscient est ranimé et la vie psychique reprend.
Parler de psychodrame dans un ouvrage qui se veut être un point de vue psychomoteur sur l’adolescence est a priori un pas de côté. Mais il est essentiel car c’est une façon de rappeler que le corps, l’affect et la représentation sont intimement intriqués et que tous les « psychistes » in fine parlent de la même chose.
Jean-José Baranes dans sa postface rappelle que le travail de symbolisation, porte d’entrée de tout travail de subjectivation, est d’abord affaire d’enveloppe psychique et corporelle individuelle ou groupale. Il témoigne de la pusillanimité de l’approche corporelle pour les adolescents dans les années quatre-vingt comme s’il avait fallu transgresser un tabou.
Pourtant, tout au long de son œuvre Freud n’a cessé de dire et d’insister sur le fait que le moi est corporel et s’il invente le dispositif divan/fauteuil en isolant le corps de tout contact sensoriel, c’est bien qu’il savait que le corps « parle » ! Et que dans sa vocation civilisatrice qui consistait, pour lui, à donner le primat à la pensée plutôt qu’à l’action, il fallait faire « parler » la psyché plutôt que le corps. Quant au renoncement du face à face, peut-être avait-il l’intuition de l’existence des neurones miroirs avec ce que cela induit comme phénomène d’empathie au détriment des mouvements de transfert.
Mais à force d’éloigner le corps du champ d’une psychanalyse mal comprise le risque est qu’il devienne la proie des neurosciences qui veulent « faire preuve ».
Battons-nous pour donner au corps sa vraie place, sa place subjective.
Merci aux auteurs de ce livre d’en faire la preuve et de nous rappeler nos obligations.
Marc Hayat est psychiatre, psychanalyste. Membre de la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe. Membre Associé Temporaire du Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse de l’Université Paris V Descartes.
Nathalie Zilkha, L’altérité révélatrice. Transfert et désidentification, Puf, « Le fil rouge », 2019.

Nathalie Zilkha est psychiatre et psychanalyste, membre formateur de la Société suisse de psychanalyse. Elle a publié de nombreux articles dans la Revue française de psychanalyse, mais aussi dans les « Monographies et débats de la Revue française de psychanalyse », ainsi que dans les Libres Cahiers pour la psychanalyse. Elle a été co-lauréate du prix Pierre Mâle en 2008 et a reçu le prix Maurice Bouvet en 2013.
Le présent ouvrage propose un ensemble de textes sur différents thèmes cliniques et métapsychologiques. Mais son grand intérêt provient précisément de leur articulation particulièrement soignée par l’auteure, qui divise ainsi le livre en trois parties : « Sur le fil de la subjectivation », « De l’autre en soi. L’énigme de l’ombre portée de l’objet », « En séance », dont chacune fait l’objet d’une brève présentation à la fois de son thème général et de chacun des chapitres qui la constituent. Le titre lui-même condense en quatre mots l’essentiel de son propos, dont il souligne l’unité, et qui se centre sur la place de l’objet dans la vie psychique, son rôle dans la subjectivation, et les implications que l’on peut en tirer pour le processus de la cure. C’est en effet le passage par l’autre, dans la vie comme dans la cure, qui permet au sujet de conquérir son identité, à l’issue d’un parcours toujours ouvert fait d’investissements et d’émancipations (ou désidentifications).
Sa réflexion est marquée par la référence constante au texte freudien, mais aussi à Raymond Cahn, René Roussillon, Claude Janin et Jean-Luc Donnet, et à travers eux à Donald Winnicott et André Green, et à la clinique de l’adolescence. Mais elle en tire une pensée très personnelle, fine et rigoureuse, qui s’appuie également sur des illustrations littéraires ou cinématographiques, témoignant ce faisant pour elle-même de la thématique de l’ouvrage. Elle parvient ainsi à conjoindre une grande richesse et variété dans les différents aspects qu’elle présente, et une réelle unité dans sa démarche, fidèle à son titre. Il me semble que de surcroît elle aborde ainsi des questions cruciales de la psychanalyse contemporaine, sur lesquelles elle apporte une lumière originale et très stimulante.
Je souhaiterais donc dans cette recension donner un aperçu, nécessairement limité, des grandes qualités de ce livre.
Quatre chapitres constituent la première Partie (« Sur le fil de la subjectivation ») :
« Le petit bassin ». Réflexions sur le face-à-face psychanalytique.
L’auteure y aborde l’ambivalence des psychanalystes envers le cadre du face-à-face. Au-delà des préférences personnelles, cette ambivalence touche à l’interrogation légitime sur l’effet de celui-ci sur la résistance : risque-t-il de la servir, ou peut-il au contraire aider à la surmonter ? Cela dépend sans doute des conjonctures cliniques, et plus précisément de la manière dont l’analysant supporte la passivité. Si celle-ci représente pour lui une menace de passivation, alors « le dispositif du face-à-face psychanalytique offre ainsi des conditions de déprise là où le sujet recourt à l’emprise. … À travers ce choix, nous reconnaissons les modalités défensives du patient, et nous les confions au cadre… » (p. 11). Celles-ci sont abordées de biais, plutôt que frontalement. C’est ainsi qu’il faut entendre la métaphore du « petit bassin » : « Avoir pied peut permettre à l’analysant de jouer à le perdre » (p. 6).
L’auteure souligne dans ce dispositif la part projetée et la part réelle dans la perception de l’analyste par le patient (dont le contre-transfert de l’analyste manifesté dans son attitude corporelle, son expression faciale), et le risque de clivage entre les deux. L’enjeu de la cure sera au contraire de promouvoir une forme de transitionnalisation. Pour cela, l’analyste peut faire « le choix de la résonance et de l’utilisation de la fonction messagère du corps ». Mais parfois « le patient rencontre l’altérité de l’analyste … Cela en constitue l’une des difficultés, mais aussi l’une des richesses potentielles » (p. 17), dans la mesure où, avec le temps, l’analysant sera en mesure de « se laisser interroger, et faire vivre, associativement », les expressions perçues chez son analyste.
Ainsi, le face-à-face permet-il que l’analyste joue un rôle plus actif dans la cure, avec ses avantages, mais aussi ses risques. Les chapitres suivants vont nous permettre d’approfondir cette question.
L’inquiétante étrangeté dans la rencontre avec soi et avec l’autre.
Ce thème rejoint le chapitre précédent dans la mesure où l’inquiétante étrangeté peut être suscitée par l’expérience de l’altérité interne réfléchie par l’altérité de l’analyste, plus volontiers dans le face-à-face, témoignant de la porosité entre le monde interne et le monde extérieur. L’auteure développe alors les possibilités, dans la cure, de transformer cette expérience en vue de sa subjectivation. Elle évoque à ce propos la façon dont, plus généralement, un sujet soumis à celle-ci va tenter de la surmonter, éventuellement en la « retournant » vers autrui (et elle se réfère ici à Marie Shelley, et à son écriture de Frankenstein, mais aussi au « jeu du double » chez l’enfant) : il s’agirait de « civiliser l’inquiétante étrangeté », selon l’expression de Laurent Danon-Boileau. L’enjeu dans la cure réside dans son lien avec le travail de désidentification : « Rémy Puyuelo considère l’inquiétante étrangeté comme un mouvement psychique qui signe l’ouverture du moi à un remaniement identificatoire devenu tolérable » (p. 32).
Qui échappe à l’exception ?
Se référant au texte de Freud (« Quelques types de caractère dégagés par le travail psychanalytique ») au sujet de Richard III, l’auteure propose de voir le « caractère d’exception » comme résultant d’« une difficulté d’accueillir l’inquiétante étrangeté dans la rencontre avec soi-même et avec l’autre », en lien avec une défaillance de l’entourage à « refléter au sujet sa singularité, son caractère unique, sur un fond implicite suffisant de ressemblance » (p. 44) (ce qui aurait dû lui permettre de se voir au contraire « soi-même comme un autre », selon l’expression de Paul Ricoeur). Le travail de transitionnalisation qu’appelait le vécu d’inquiétante étrangeté n’ayant pu se produire, il ne reste au sujet qu’à revendiquer sa position d’exception, au risque de n’en devenir que plus désespérément ordinaire. On pourrait rapprocher cela des revendications actuelles toujours plus poussées, et vaines, de certains adolescents d’être reconnus comme « différents » dans leur identité sexuelle.
Finir l’adolescence, sans en finir,
clôt cette première Partie. L’auteure y propose une réflexion à partir du film La Chatte sur un toit brûlant, de Richard Brooks, tiré de la pièce éponyme de Tennessee Williams. Le héros, un jeune homme bloqué dans une adolescence interminable, parvient enfin à s’en dégager à l’issue d’une confrontation dramatique avec son père, auquel il ne pouvait jusque-là que s’opposer. À l’issue de celle-ci, le père lui apparaît dans sa vulnérabilité, ce qui lui permet de se saisir « d’une identification à un objet paternel autrement plus complexe et plus humain que le père secrètement idéalisé qui lui barrait le chemin » (p. 50). Je le rapprocherai d’une œuvre récente magnifique de Daniel Mendelsohn (que l’auteure cite abondamment à propos d’un autre livre, Les disparus) : Une Odyssée : Un père, un fils, une épopée.
La deuxième Partie, « De l’autre en soi. L’énigme de l’ombre portée de l’objet », s’ouvre par un chapitre intitulé
« Les objets les plus grandioses »
expression freudienne dans Le Moi et le Ça, à propos de la constitution du surmoi. On peut comprendre ce texte comme une suite du premier chapitre concernant le face-à-face, dans la mesure où il traite, là où celui-ci concernait l’importance de l’analyste « en personne » dans la cure, de la place de l’objet idéalisé, et de son rôle dans le devenir du surmoi. De même que l’analyste peut se sentir requis « en personne » dans la cure, à la mesure d’une certaine précarité narcissique du sujet, mais au risque d’une possible aliénation, de même on peut penser que le surmoi reste d’autant plus personnalisé que le sujet se trouve en attente d’un appui « extérieur », plus libidinalisé. En témoigne la difficulté du sujet, dans ces conjonctures, à s’émanciper de cette figure, ce qu’illustre ici la Lettre au père de Kafka. Le sujet se trouve alors dans un cercle vicieux, s’accrochant à un objet idéalisé par sentiment d’insuffisance, pérennisant une dépendance qui le dévalorise. Ces sujets pourront parfois réagir à cette défaillance par une identification à l’agresseur, mais aussi par une certaine prématurité (Ferenczi, Green). L’auteure conclut : « Nous pourrions opposer ces formations psychiques prématurées et désubjectivantes à l’introjection progressive et subjectivante qui caractérise l’identification au fonctionnement psychique de l’analyste en séance » (p. 76).
Le rapport moi-surmoi et la subjectivation.
prolonge ces analyses. Il reprend en particulier la difficulté du sujet à se dégager de l’imago surmoïque en raison du soutien qu’il pense y trouver. L’auteur va l’illustrer ici de deux manières :
– d’une part à propos du film La fureur de vivre, de Nicholas Ray, dans lequel l’héroïne, Judy, reste empêtrée dans une relation trop sexualisée à son père et « peu encline à renoncer à ses objets œdipiens et à l’équivalence de réalisation incestueuse que constitue la soumission à son surmoi » (p. 82).
– d’autre part la manière d’intervenir de l’analyste dans ses interprétations, pour « contribuer à modifier le rapport de force moi-surmoi et soutenir une désexualisation du surmoi » (p. 84). L’auteure mentionne à ce sujet l’intérêt des interventions en « côte à côte » (Roussillon), l’utilisation de l’humour (toujours avec précaution toutefois).
Un héritage, et une conquête, au féminin. Réflexions sur le rapport moi-surmoi de la femme.
Dans ce texte, l’auteure propose de distinguer « d’une part une loi du jour, corrélative de la persistance du lien préœdipien duel et emprunte de narcissisme et associée à la répression, et une loi de la nuit, organisée par l’Œdipe, c’est-à-dire davantage portée par le refoulement, la désexualisation et le travail de renoncement » (p. 92). La première est liée à la mère, et peut provoquer une perte d’élan vital ; la seconde est liée au père, et concerne le renoncement à la satisfaction sexuelle. Les deux marquent leur empreinte chez la femme, mais l’auteure précise qu’elle a accordé « une place particulière à l’impact des vicissitudes du renoncement à l’objet préœdipien sur le processus de surmoïsation » (p. 104). Il y a ainsi une relativisation de l’enjeu de « l’envie du pénis » freudienne, derrière laquelle l’auteure pense qu’il faut surtout voir, comme Maria Torok, « une invention ad hoc pour camoufler un désir, comme un obstacle artificiellement dressé sur le chemin de se rejoindre soi-même dans la libération des actes inhibés » (p. 100). Ces considérations me semblent dessiner une sorte de dépendance mutuelle indépassable entre mère et fille, déniée par la mère, mais en tout état de cause excluant le père : « La relation à l’objet maternel préœdipien doit périr, mais elle est impérissable » (p. 97).
Force identificatoire, travail de désidentification
porte sur la dimension transgénérationnelle des identifications, à propos du très beau livre de Daniel Mendelsohn, Les disparus. L’auteure y aborde à la fois le poids des secrets familiaux sur le destin des identifications, par la précarité qu’ils y introduisent, et les aliénations que cela provoque, et l’ambivalence qui en résulte chez le sujet, entre recherche de racines, et besoin de se différencier des ascendants. Le travail de désidentification est ici particulièrement marqué.
La troisième Partie, « En séance », s’intéresse encore plus précisément aux enjeux de la cure.
Au fil du transfert, jouer.
La puissance du phénomène transférentiel ravive l’ambivalence de la psychanalyse, des psychanalystes, envers la « réalité » dans la cure. Réalité non pas là objective de l’analyste, mais réalité des affects, de l’investissement de l’analysant, sans laquelle il ne peut y avoir de processus. D’où découle la nécessité du transfert, « moteur » de la cure, mais nécessité aussi du renoncement de l’analysant aux désirs suscités par celui-ci, puisque le but du traitement est l’émancipation du sujet. Pour dépasser cet antagonisme prend place le recours au jeu, dans un but de transitionnalisation. L’auteure propose en particulier de passer « de l’illusion freudienne à l’aire de l’illusion et l’espace transitionnel winnicottien » (p. 132). Elle en précise les conséquences pour la « technique », privilégiant « certaines formes d’interprétation qui impliquent de quitter, en partie, la position de surplomb pour accompagner le mouvement inconscient et préconscient de l’analysant et permettre à ce dernier de mieux entendre son improvisation en cours. [… mais néanmoins savoir] travailler au corps-à-corps avec le transfert reste évidemment nécessaire par moments » (p. 142), ce qui ne peut se faire sans risque ni incertitude.
Agieren comme après-coup, agieren pour l’après-coup.
De manière très intéressante, l’auteure introduit ce chapitre sur la répétition agie de transfert, ou agieren, comme « un autre cas de figure » (que l’interprétation) de ce qui peut favoriser l’advenue d’un après-coup dans la cure. Ce serait ainsi le pendant, du côté de l’analysant, de ce qui vient par ailleurs de l’analyste, les deux permettant de rouvrir un espace de remémoration, de favoriser une associativité. Il s’agirait pour le sujet de reprendre activement, pour la subjectivation, ce qu’il a d’abord subi passivement.
De l’hétérogénéité de la parole en séance
prolonge la réflexion précédente, à propos des agirs de parole cette fois, sur le potentiel remobilisateur de ceux-ci sur les identifications, de la part du patient, en regard des interprétations de l’analyste.
Parcours dans l’interprétation de l’agir
propose précisément, dans la suite des deux derniers chapitres, de relier dynamiquement agir et interprétation : « L’agir dans la cure porte un potentiel de transformation qu’il s’agira de pouvoir faire – ou laisser – advenir. Dans cette évolution, l’interprétation occupe une place centrale, mais ses enjeux sont complexes et son maniement délicat, d’autant que le contre-transfert y est souvent bien engagé » (p. 165). L’auteure illustre cette complexité en présentant la conception de différents auteurs : Jean-Luc Donnet, en tout premier lieu, mais aussi R. Horacio Etchegoyen, André Green, René Roussillon, Emmanuelle Chervet, Sandor Férenczi, Jacqueline Godfrind-Haber et Maurice Haber, Thomas Ogden, Donald Winnicott, Margaret Little, en une très complète et passionnante revue de la littérature, sur laquelle elle conclut : « Lorsqu’il interprète l’agir, l’analyste joue, au contact des manifestations de son contre-transfert, une partition qui n’est pas encore écrite, une partition ‟improviséeˮ, dans laquelle il y a la place et la liberté pour l’improvisation de son analysant ; celle-ci pourra se poursuivre bien au-delà de l’espace-temps de la cure » (p. 180). Conclusion exemplaire de la pensée de Nathalie Zilkha.
Consolation, inconsolé et inconsolable.
L’auteure pose d’emblée la question essentielle sur ce thème : « Qu’est-ce qui fonde la valeur de l’expérience consolatrice dans l’analyse ? Qu’est-ce qui la protège d’une destinée éphémère ? Qu’est-ce qui soutient son passage dans l’investissement d’une vie créative, c’est-à-dire une ouverture aux consolations souvent inattendues que la vie peut offrir ? (p. 183). Et elle conclut de manière très subtile sur le rôle possible de la cure : « Si l’inconsolable n’a pas fait fuir l’analysant ou l’analyste, hors de la cure ou dans la quête d’une consolation intempestive, la capacité de pleurer ses peines, associée à la reconnaissance et à l’accueil de l’inconsolable soutiennent une analyse avec fin » (p. 196).
Limites mouvantes de l’analysabilité
Ce dernier chapitre peut s’entendre en écho au précédent : accepter ces limites. Mais il est surtout une belle reprise conclusive de l’ensemble du livre : celui-ci a en effet tout particulièrement mis en exergue les enjeux de la place de l’objet analyste, soutien au processus, mais possible aliénation, qu’il s’agit de dépasser. Ce qui fait écrire à Nathalie Zilkha : « L’apport narcissique de la présence et de l’estime tempérée de l’analyste pourra également se prolonger dans la poursuite d’un travail d’historicisation, sans l’analyste » (p. 206).
Proposition que nous pourrions appliquer à notre situation de lecteurs, invités à poursuivre, au-delà de ce beau livre, la réflexion si personnelle qu’il nous a généreusement fait partager, et soulignant encore l’importance du passage par l’autre annoncée par son titre.
Benoît Servant est psychanalyste, membre de la SPP.
Jean-Louis Baldacci, Dépasser les bornes. Le paradoxe du sexuel, Paris, Puf, « Le fil rouge ».

Dans L’analyse avec fin (2016), Jean-Louis Baldacci partait du paradoxe transfert, qui est à la fois la plus grande des résistances et la meilleure arme pour les réduire. Car le transfert, dans sa dimension d’investissement, fixe à l’objet et aliène ; mais dans sa dimension de déplacement, il éloigne de l’objet, transforme les traces mnésiques en souvenirs, ouvre sur l’autre et libère la pensée. L’étude de la dynamique processuelle de ce paradoxe a conduit l’auteur à un autre paradoxe : celui de l’interprétation dont certaines formes renforcent le transfert investissement, tandis que d’autres le réduisent au profit de l’ouverture et d’une fin possible de l’analyse.
La coexistence dynamique de la sexualisation et de la désexualisation, expression du jeu analytique pris entre la séduction et l’interdit, manifeste un troisième paradoxe. Ce jeu donne à la parole sa fonction symbolisante, permet l’investissement d’un nouvel objet ainsi que le partage d’un idéal. AvecDépasser les bornes, le paradoxe du sexuel, ces trois paradoxes sont ramenés à un seul, celui du sexuel comme concept limite qui permet la coexistence paradoxale de forces opposées, celles de la vie et de la mort, dont l’union et la désunion sont susceptibles d’ouvrir sur le nouveau grâce à l’instauration de transformations dynamiques fécondes. J.-L. Baldacci reprend donc « la grande énigme de la sexualité » (Freud, 1937) pour en manifester le paradoxe intrinsèque. La pensée freudienne souligne que le sexuel est un principe évolutif qui s’oppose aussi bien à la reproduction à l’identique qu’à la mort. Ce ne sont pas les sexes qui le définissent, mais leur différence, l’écart qui unit et sépare, signe de son essence paradoxale. Le sexuel permet l’articulation dynamique des couples d’opposés. Le sexuel pousse ainsi au dépassement des limites, au franchissement des bornes imposées. « À quelles conditions et avec quels risques le sexuel permet-il de dépasser et d’utiliser le jeu des forces opposées qui le constituent ? C’est le thème du livre » (Entretien avec J.-L. Baldacci, Revue française de psychanalyse, en ligne sur le site de la SPP).
La première partie du livre analyse le paradoxe du sexuel montre en quel sens la sexualité infantile « dépasse les bornes » et caractérise la pulsion. Pour rendre compte à la fois du besoin éprouvé et de la satisfaction ressentie, Freud recourt à deux termes : la pulsion sexuelle qui part du corps pour caractériser le mouvement vers l’objet du besoin sexuel, et la libido, qui traduit la manifestation dynamique de ce trajet dans la vie psychique. Ces deux termes esquissent dès les Trois essais (1905d) la distinction dedans/dehors et annoncent la problématique ultérieure du renversement, sans pour autant résoudre la question inaugurale du rapport entre excitation et satisfaction. L’introduction du narcissisme déplace le conflit entre autoconservation et sexualité à l’intérieur même du sexuel : le conflit oppose désormais les investissements objectaux et les identifications nourries par les motions pulsionnelles, ce qui oblige Freud à reconnaître des mouvements de désexualisation et de resexualisation. En deuxième théorie des pulsions, désexualisation et satisfaction feraient le jeu de la pulsion de mort, tandis que la sexualisation et l’excitation sous-tendent Éros.
« Le sexuel, ni excitation, ni satisfaction, ni union, ni désunion, ni liaison, ni déliaison, ni conjonction, ni disjonction, ni sexualisation ni désexualisation, maintiendrait l’articulation de ces termes en préservant ce qui les sépare sans les disjoindre » (p. 9) ; ainsi devient possible la coexistence de forces opposées, dont l’union et la désunion, rythmées par l’effet des contraintes, permettent l’émergence du nouveau et son champ de transformations dynamiques. Le sexuel est ainsi un concept de la limite, frontière entre deux territoires. Fermé, le paradoxe révèle l’impossibilité d’organiser une ambivalence permettant le décollement par rapport à l’objet (H. Searles, D. Anzieu, J.-P. Racamier) ; mais Winnicott montre que le paradoxe et sa tolérance – condition d’ouverture de la dynamique du paradoxe – sont au cœur du fonctionnement psychique. Le texte de 1925 sur « La négation »pose la possibilité, grâce à la parole, d’un paradoxe qui ouvre l’espace associatif de l’idée incidente, du rêve et du souvenir. Avec la traduction de Hyppolite et de Lacan, l’Aufhebung devient l’ouverture à la sublimation. La voie sublimatoire ne vise pas la résolution désexualisante du paradoxe, mais sa tolérance, maintenant un équilibre dynamique de la sexualisation et de la désexualisation. Dans la situation analytique coexistent séduction et interdit, suscitant l’expression de fantasmes originaires ouvrant sur celui de scène primitive, grâce à la neutralité suffisante d’un psychanalyste qui respecte le paradoxe du sexuel, sait osciller entre orthodoxie et transgression pour préserver la coexistence paradoxale des mouvements antagonistes et transmettre à son patient la possibilité d’une ouverture sublimatoire.
Les théories sexuelles infantiles, découverte du pouvoir du langage, qui se déploient grâce aux autoérotismes, sont une première manière de dépasser les bornes, celles des limites imposées par la nature comme celles des interdits de la culture. Confrontées à une inhibition nécessaire, elles font découvrir la toute-puissance des pensées, sa sexualisation et une première activité théorisante. La créativité théorique de la sexualité infantile est manifestée par la reprise du cas du petit Hans que Baldacci rapproche d’éléments biographiques de la sexualité infantile de Freud lui-même, ce qui l’amène à évoquer la sexualité infantile de la psychanalyse. La sexualité infantile passe d’un temps de décharge (actif) à un temps réflexif de retournement sur soi autoérotique puis à un troisième temps introjectif caractérisé par l’accès au fantasme. Quelque chose venant de l’objet est nécessaire au renoncement permettant le passage d’un temps à l’autre, suscitant les opérateurs psychiques de la menace de castration et de la culpabilité – ce qui éclaire le travail de contre-transfert pour élaborer la haine – notamment lorsque la parole du patient approche des traces mnésiques traumatiques.
Le troisième chapitre se confronte à la pulsion avec des commentaires de « Pulsions et destins des pulsions » (Freud, 1915c) et d’« Un enfant est battu » (Freud, 1919e). Les destins pulsionnels sont pluriels et appellent grâce à la parole au retournement – qui implique le corps et les autoérotismes, et met en place la passivité et les fantasmes. Le renversement sur la personne propre permet de sortir d’une logique binaire et ouvre la voie sublimatoire. Le travail analytique, rendu possible par l’élaboration du contre-transfert devient ainsi un « triomphe par la bouche », l’expérience de la puissance de la parole. Mais la question du devenir des pulsions qui échappent à cette transformation demeure : inhibition, culpabilité partagée, ou menace de déferlement ?
Vient ensuite l’étude de la « transition sublimatoire » qui dégage la voie ouverte par le sexuel vers des transformations dynamiques. Du refoulement à l’identification, quel est le rôle dynamique de la sublimation dans cet équilibre ? Est-elle le moyen de corriger les excès pulsionnels ou la force du refoulement qui leur est opposé ? Dans les névroses classiques, après le traitement des excès du refoulement, la sublimation survient d’elle-même. Dans les organisations non névrotiques où le refoulement se trouve débordé, il s’agit de rétablir une coexistence et une coopération entre refoulement et sublimation, limitant les défenses contre-pulsionnelles telles que le clivage. En tout cas, la sublimation est « dès le début » (Baldacci, 2005) au cœur du rapport à l’objet dans la genèse du moi. Cette première étape est essentielle pour la transformation de la libido d’objet en libido narcissique, moment de la genèse du moi qui permet le renversement de la pulsion. Ensuite, la sublimation proprement dite repose sur un moi constitué et se déploie en renforçant les processus complexes de la recherche et de la créativité. La sublimation est essentielle dans les processus de désidéalisation, d’identification et de subjectivation. Dans la cure, le jeu partagé de la parole est brillamment illustré par un bel exemple clinique de desserrement de la censure : on y passe de Droopy, le personnage de Tex Avery, au souvenir culpabilisé de la mort de l’analyste précédent ; honte et fierté, tristesse et joie coexistent dans le sentiment d’être soi-même, dans une unité retrouvée en assumant d’être double parce que l’on a senti que l’analyste lui aussi assume sa duplicité. Pris entre déduction et interdit, le jeu de la parole sexualise la pensée avant de la désexualiser par l’interprétation du transfert – qui désidéalise l’objet, permet de retrouver le souvenir et ouvre sur la recherche de l’idéal. Sublimation et transitionnalité sont rapprochées par la notion de « transition sublimatoire », en appui sur la clinique de Winnicott qui développe la tolérance au paradoxe. Mais selon Winnicott, la mise en place des paradoxes fondateurs du fonctionnement psychique est violente, car elle repose sur la coexistence du couple destruction/survie. La clinique de Baldacci et celle de Winnicott se répondent pour justifier que transitionnalité et sublimation peuvent être considérées comme des notions complémentaires, à condition que le sexuel infantile ne soit pas oublié. À condition aussi de ne pas séparer la sublimation du début, d’essence maternelle, transgressive et centrée sur le corps, de la sublimation post-œdipienne centrée sur le culturel et l’introjection de l’idéal. L’alliage de ces deux temps est une transition sublimatoire qui articule, grâce au jeu, le sexuel infantile et le culturel, le corps et le langage.
C’est donc l’ouverture par la parole (troisième partie) qui s’avère l’agent décisif de cette processualité. Nous ne détaillerons pas ce chapitre ; il interroge le transfert sur la parole, en appui sur la Règle fondamentale qui rend la cure analytique possible. Paradoxe du sexuel, écart entre transparence et secret, silence et parole, patience et impatience y sont intimement liés à la problématique de la castration.
Une quatrième partie est consacrée aux détournements narcissiques du sexuel : l’idéalisation de l’objet avec une sexualisation de la pensée, la pensée magique et « l’intraitable » où l’objet se rend maître de la pulsion. Dans ces occurrences, évoquées avec acuité, le narcissisme devient une forme binaire de la fermeture, qui pose des alternatives clivantes : l’excitation ou la satisfaction, la pulsion ou l’objet, la vie ou la mort, fermant tout questionnement.
La cinquième partie interroge les conditions de sortie des clivages grâce aux aménagements du cadre : le face-à-face, le psychodrame, la consultation psychanalytique.
L’ouvrage s’achève par une interrogation sur un meurtre de la mère et son absence de trace psychique : si le sexuel est un processus paradoxal qui réunit et qui sépare, si l’écart et le renversement sont nécessaires à l’évitement de la fermeture clivante du paradoxe et à la possibilité de son ouverture sublimatoire, si l’analyste est condition d’un transfert sur la parole, à quoi correspond le premier effacement qui initie les étapes de la psychisation du sexuel ? Correspond-il à un meurtre de la mère qui serait, grâce au langage, l’agent de la séparation des corps, permettant dans l’après-coup la reprise symbolisante du meurtre du père ? Ces questions amènent l’auteur à des questionnements novateurs, qui pourraient faire penser à l’hallucination négative de la mère (condition de l’émergence d’une structure encadrante) chez André Green. Mais pensée en termes d’hypothèse d’un meurtre de la mère, l’élaboration débouche sur d’intéressantes considérations sur la façon dont pourrait s’effectuer l’élaboration de la haine.
Parsemé de vignettes et de notations cliniques suggestives, cet ouvrage très dense stimule la réflexion. Il témoigne d’une grande force de synthèse en même temps que d’une finesse clinique et d’une rigueur théorique remarquables. Penser le sexuel en termes de paradoxe s’avère d’une puissante fécondité. Y voir une capacité transgressive – et créatrice – à « dépasser les bornes » renouvelle notre compréhension de la grande intuition freudienne du caractère central de la sexualité et des destins des pulsions sexuelles.
Références bibliographiques
Anzieu D. (1975/2012). Le transfert paradoxal. Nouv Rev Psychan. Repris dans Créer, Détruire. Paris, Dunod.
Anzieu D. (1993/2009). Transfert paradoxal, contre-transfert paradoxal : 342-355. Le travail de l’inconscient. Paris, Dunod.
Baldacci J.-L. (2005). « Dès le début », la sublimation ? Rev Fr Psychan 69 (5) : 1405 à 1474.
Baldacci J.-L. (2016). L’analyse avec fin.Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse ».
Baldacci J.-L. (2018). Dépasser les bornes. Le paradoxe du sexuel. Paris, Puf, « Le fil rouge ».
Entretien avec J.-L. Baldacci. (2019). Rev Fr Psychan. En ligne sur le site de la SPP.
Freud S. (1905d/2006). Trois essais sur la théorie sexuelle. OCF.P, VI. Paris, Puf.
Freud S. (1909b/2007). Analyse d’une phobie chez un petit garçon de cinq ans (le petit Hans). OCF.P, IX. Paris, Puf.
Freud S. (1915c/2005). Pulsion et destin des pulsions, OCF.P, XIII. Paris, Puf.
Freud S. (1919e/1996). « Un enfant est battu » : contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. OCF.P, XV. Paris, Puf.
Freud S. (1937c/2010). L’analyse avec fin et l’analyse sans fin. OCF.P, XX. Paris, Puf.
Green A. (1966/1982). Narcissisme de vie, narcissisme de mort. Paris, Minuit.
Green A. (1973). Le Discours vivant, Paris, Puf.
Racamier J.-P. (1978). Les paradoxes des schizophrènes. Paris, Puf.
Roussillon (1991). Paradoxe et situations limites de la psychanalyse. Paris, Puf.
Searles H (1975/1977). L’effort pour rendre l’autre fou. Nouv Rev Psychan. Repris dans L’effort pour rendre l’autre fou. Paris, Gallimard.
Winnicott D.W. (1975). Jeu et réalité. L’espace potentiel. Paris, Gallimard.
Dominique Bourdin est psychanalyste SPP, agrégée de philosophie, docteur en psychopathologie fondamentale.
Christopher Bollas, Sens et mélancolie : vivre au temps du désarroi, Paris, Ithaque.

Le paradoxe du dernier ouvrage de Christopher Bollas, déjà présent dans son titre, tient dans sa double dimension, tout à la fois crépusculaire et résolument optimiste. Il s’appuie sur un diagnostic du monde contemporain, à la fois constat de son désarroi et réquisitoire engagé contre les dérives qui se présenteraient comme autant de symptômes : Trump, le Brexit, l’essor des mouvements populistes un peu partout dans le monde, ainsi que l’avènement de nouvelles formes de pensée.
C’est au travers d’une analyse de l’histoire de l’Occident des deux siècles derniers que Bollas tente de comprendre cet état de fait. Les références à des disciplines très diverses – sociologie, histoire, philosophie, littérature, psychanalyse – s’entrecroisent pour alimenter cet essai.
Mais ce qui donne à son analyse sa dimension particulièrement humaine réside peut-être dans la manière dont Bollas traite la folie des hommes et leurs actes. On reconnaît dans sa mise en perspective d’une situation politique donnée, son souci de sortir des abstractions, de replacer ce qui arrive dans l’espace et le temps, et dans la concrétude d’une réalité historique. Au travers de cette réflexion, il nous exhorte implacablement à sortir du désarroi sans direction, de la sidération, et de la stupeur stérile. Il nous amène à prendre les grands maux de notre temps par la main, pas à pas, et à y réfléchir en psychanalyste, avec la responsabilité de retour à une vérité psychique que cela implique. Il redonne du même coup à la pensée psychanalytique ses lettres de noblesse comme détour réflexif indispensable à toute situation sociale qui nous dépasse.
Dans la lignée amorcée par Freud à la suite de Gustave Le Bon, dans « Psychologie des masses et analyse du Moi » (1921c), Bollas s’exerce à une analogie entre psychologie individuelle, dite du Self, et psychologie collective pour en arriver à ce qu’il appelle une « Psychologie politique ».
Bollas s’efforce ici de dégager des éléments significatifs, des traits saillants d’une « mentalité culturelle » qui s’inscriraient de manière transgénérationnelle, « survivant de beaucoup à ceux qui vivaient lorsqu’elle a adopté sa forme originelle » (p. 12).
Ainsi, des états psychiques comme la dépression deviendraient structurels, pour se muer en mélancolie, transmise d’une génération à l’autre, dont le sens se perd s’il n’est pas relié à son origine.
L’ouvrage retrace donc sur deux siècles les évènements et processus qui auraient façonné les cadres de pensée actuels du monde occidental : de la crise maniaque de la fin du xixe siècle en Europe liée à l’optimisme engendré par les révolutions sociales et industrielles, à la Grande Guerre, comme point de bascule, et à ses conséquences psychologiques en termes de deuil et de bouleversement des valeurs. « Crise morale », « perte de foi », Bollas fait une description alarmiste du virage aride et de la désillusion mortifère d’après-guerre, et du sentiment d’absurdité qui en a découlé. Le mouvement existentialiste et le personnage de Meursault dans l’Étranger de Camus en sont un miroir : « Meursault représente le Self tué par les guerres » (p. 67). La Seconde Guerre mondiale, avec l’extermination des Juifs d’Europe et l’usage de la bombe atomique, vint se surajouter à cette perte non élaborée.
Cet effondrement des valeurs va être également au cœur de son analyse de l’histoire de l’Amérique comme puissance mondiale : de la croissance et de la prospérité sans précédent des années d’après-guerre à la désillusion. La perte de confiance en des principes respectés et des repères comme le progrès, la démocratie, entraînée par le déclin de l’essor des années 1970 et les séquelles psychologiques des grandes catastrophes du xxe siècle, a créé un équivalent sociétal de la dépression clinique. Les opinions radicales actuelles et la colère d’une part importante de la population se seraient constituées comme un rempart contre cette détresse foncière, parallèlement à une anesthésie matérialiste. L’élection de Trump en 2016 et ses conséquences dans le paysage politique actuel en seraient le symptôme.
En réaction à cette perte de sens radicale, source de confusion et de perplexité, Bollas met en évidence différentes solutions défensives, apparentées à des catégories psychopathologiques, parmi lesquelles la paranoïa occupe une place de choix. La projection des difficultés à l’extérieur permet de purifier le Self des éléments indésirables et de lutter efficacement contre les angoisses de persécution, la culpabilité et la dépression. Cette tendance à la paranoïa se serait généralisée au sein de la nation américaine qui projetterait sa destructivité sur des nations utilisées comme bouc émissaire. Ce mécanisme présente l’avantage de maintenir pour la nation une « auto-béatification » permanente et un sentiment de puissance, et de réduire les nations mises au banc à un trait unitaire au détriment de toute complexité. Le clivage ainsi mis en place permet de laisser libre cours et de faire coexister une réalité maniaque et l’acte d’annihilation de l’autre. Bollas analyse le succès de Trump, lorsqu’il retournait le message du christianisme en « sanctification de nos pires défauts » (p. 111), par l’exploitation d’une veine sentimentale, plongeant ainsi ses partisans dans un enthousiasme irréfléchi qui les sortait de leur torpeur et de leur désenchantement.
Il complète cette analyse psychopathologique sociétale en proposant l’idée d’un clivage de « Selfs dissociés », qu’il différenciera de celui des états limites, décrit plus spécifiquement dans le chapitre « Des Selfs en morceaux » (p. 65), où les parties qui s’opposent ne communiquent pas entre elles. Dans ce chapitre, il explique comment la dérégulation capitaliste et les crises financières qui lui sont associées depuis 2008, peuvent s’apparenter à la théorie freudienne du moi et du ça, dans l’échec du moi à contrôler les motions pulsionnelles du ça. Il en va de même pour la question écologique.
Dans cette époque qui fit naître différents profils en relation avec une perte interne radicale, Bollas poursuit son inventaire. Il définit le Self « normopathe » (p. 77) du milieu du xxe siècle, reprenant le terme de Joyce McDougall (1978), pour décrire une variante de l’état limite. Le normopathe, pour se protéger de sa vie psychique, se réfugie dans les faits, le confort matériel d’une vie de loisirs et la consommation de technologies qui annihilent progressivement l’individu en tant que sujet.
De la même façon, Bollas décrit le « syndrome du quartier sécurisé »au sein duquel « les Selfs sécurisés évoluent dans la gélatine de leur environnement protecteur » (p. 82), coupés de tout apport sensoriel, intellectuel, et de toute excitation. Cela génère une détérioration du fonctionnement psychique et des aptitudes à l’empathie. Il épingle ainsi les classes du pouvoir politique et cette dynamique qui conduit à la pure culture de l’instinct de mort.
Dans le chapitre suivant, « Des Selfs transmissifs », Bollas se penche sur les nouveaux moyens de communication et ce qu’ils induisent de transformation dans la présentation et l’intégration de nous-mêmes. La présentation de soi simpliste devenue permanente via les réseaux sociaux et les nouvelles techniques de communication et de transmission des informations, héritiers à cet égard de la tradition orale, deviendrait « le véhicule de notre dissémination » (p. 87).
En effet, l’information se transmet sans analyse ni réflexion préalable et sans que le Self, rappelle Bollas, y trouve un intérêt bien clair. Il complète cette notion dans « Nouvelles formes de pensée » par celle d’horizontalisme. Propre au début du xxie siècle, elle « consiste à éradiquer les priorités, au profit d’une mise en équivalence qui rend toutes les idées également valides » (p. 96). Une autre notion, celle « d’homogénéisation », désigne le besoin d’annuler la différence. Ainsi il n’y a plus d’opposition ni de débat. Sous couvert d’efficacité, les points de vue contraires sont éliminés, et toute capacité introspective mise de côté.
La « pensée réfractive », associée elle aussi aux nouveaux moyens de communication, sélectionne un trait souvent secondairedu message pour le projeter instantanément vers l’extérieur, en évacuant ainsi sa substance et son épaisseur. Il y ajoute la notion d’« opérationalisme », qui convertit sans délai la réflexivité en plan d’action. Enfin, le concept de « visiophilie » traduit l’idée que les expériences visuelles sont prises pour des vérités en soi, dans un monde qui remplacerait le langage par l’image, et où la pollution visuelle dominerait.
Tous ces mécanismes et modes de pensée dégradés, « subjecticides », ennemis de la réflexivité, se présentent comme des formes de pensées adaptatives promues par l’exigence d’efficacité du Self et dans l’espoir de maîtriser son désarroi.
Une fois ces constats et ces notions posés, comment réanimer une pensée réduite à sa plus simple expression et fossilisée ? Comment sortir du clivage, réintégrer les parties projetées à l’extérieur de soi ? La réponse en passe pour Bollas par le modèle de l’association libre.
Celle-ci serait la seule issue pour sortir du « brouillard défensif des abstractions », redonner l’aptitude au Self d’« appréhender le monde inconsciemment », et lui permettre d’utiliser la pensée inconsciente ainsi retrouvée pour remobiliser sa créativité. Ce que Bollas finit par ériger en philosophie dans sa définition du sujet : « vivre en qualité d’entité consciente sans cesse mue par des intérêts inconscients singuliers ».
Car, au-delà de cette liste de notions, de cette analyse historique et sociétale sévère et sans complaisance, Bollas nous offre un ouvrage tourné vers l’avenir. Il cherche des solutions pour soigner cet homme malade que représente l’homme d’aujourd’hui dans la société dans laquelle il évolue. Ce programme en passe par la tentative pour ces personnes dont les Selfs seraient fragmentaires de se réapproprier leur conscience sociale, et de lutter activement, individuellement et collectivement, contre la « psychophobie » et les courts-circuits de la pensée.
Il s’agit de renouer avec une conflictualité psychique à la place d’un consensus mortifère, de permettre une reconnexion avec le monde dans sa diversité, et de réintégrer cette partie souffrante non reconnue qui se doit d’être identifiée, sans dénier les blessures narcissiques qui lui sont associées, au prix d’une intégration dépressive maturative.
Prendre la mesure de la souffrance et de la pathologie sociétale qui lui est associée, l’accueillir pour ce qu’elle est, afin de chercher des solutions novatrices et créatrices comme Bollas a l’habitude de le faire dans son travail de psychanalyste.
S’opposer à la culture de l’oral – archaïque, avec ses messages simplistes, compréhensibles immédiatement – qui recouvre les aspects de la communication horizontale telle que décrite précédemment pour en revenir à une conception plus verticale qui laisse la place à la réflexion, au temps, au détour d’une analyse plus approfondie, où la pensée politique ne s’arrête pas à l’adhésion au premier mouvement affectif et identificatoire.
Brandir l’instinct de vie face à l’instinct de mort, en permettant au Self d’investir des objets très divers et d’élargir ses centres d’intérêt et son potentiel créatif.
En s’appuyant également sur les travaux sur les groupes de Bion, Bollas présente la relation analytique comme un modèle de démocratie psychologique, en tant que la mise en présence et la voix redonnée à différents points de vue constituent en soi une entreprise thérapeutique. Il s’agit d’intégrer l’idée que chacun des membres du groupe porte en lui un aspect du monde de l’esprit. C’est peut-être là que Bollas se place le plus dans le courant intersubjectiviste : « Une psychologie politique aiderait nos leaders et tous ceux qui prennent part aux processus politiques à redécouvrir la liberté offerte par le cadre de pensée démocratique. » Engagé lui-même politiquement, Bollas prône le recours à « l’introspection psychologique à l’intérieur même de l’expérience démocratique » (p. 162), donc utilisée collectivement.
Pour endiguer les décharges effrénées de la vie pulsionnelle, le retour aux principes fondateurs de la démocratie qui s’opposent au court-circuit de la pensée, serait non seulement nécessaire, mais vital. Car ils proposent dans l’intégration de l’expression de toutes les voix, même les plus extrémistes qui ne représentent que des aspects méconnus de nous-mêmes, des solutions de compromis régulatrices. « Sauf à trouver une manière d’attirer les Selfs hors de leurs retraites – fondamentalisme religieux ou matérialisme normopathe – la trame de nos sociétés continuera de se détériorer et le processus politique sera vidé de sa vitalité intellectuelle et de l’effort collectif indispensable à la survie de l’homo sapiens. » (p. 159)
L’ouvrage de Bollas, qui nous a fait voyager du « moment freudien » – où la découverte de l’inconscient était préparée naturellement par un contexte historique, pour permettre de penser une forme de destructivité – à sa déconfiture, présente l’immense avantage de considérer cette évolution comme moins extérieure, moins insaisissable et donc avec moins de fatalité. Il redonne l’espoir qu’une prise de conscience des facteurs intrinsèques de cette évolution nous permette d’en dévier le cours. Il nous fait prendre conscience de la responsabilité pour le psychanalyste, à partir de la compréhension des mécanismes en jeu, de prendre en charge la pathologie collective au même titre que la pathologie individuelle.
Il insiste sur la nécessité d’un retour sur soi, d’une reconnaissance des dimensions perverses de la mondialisation et de son aspect déshumanisant, insensé pour lui trouver une autre issue que le virage cynique ou le populisme.
Et, au-delà de cela, Bollas suggère d’utiliser la psychanalyse et l’accès à l’inconscient et aux rêves comme des indicateurs, non seulement de notre histoire antérieure, mais aussi et surtout de ce que la vie peut nous offrir pour l’avenir. « Comme si nos songes allaient prêter au monde d’objets où nous vivons, la vitalité et le sens dont ils manquent. Le rêve se présente au Self comme une inspiration, un acte de créativité vitale qui nourrit l’imagination humaine » (p. 106). À cet égard, l’ouvrage de Bollas s’offre aussi à nous comme une source d’inspiration.
Références bibliographiques
Bollas C. (2011). Le moment freudien. Paris, Ithaque.
http://christopherbollas.com/videopodcast/, Prairie Public Video, July 24, 2018.
Freud S. (1921c/1972). Psychanalyse des foules et analyse du moi : 117-217. Essais de psychanalyse.Paris, Payot.
Alexia Blime-Cousi est psychanalyste, membre de la SPP. Cofondatrice et codirectrice de la Revue en ligne « Les Enfants de la Psychanalyse ».
Marion Oliner, Psychoanalytic studies on dysphoria – the false accord in the divine symphony, Londres, Routledge.
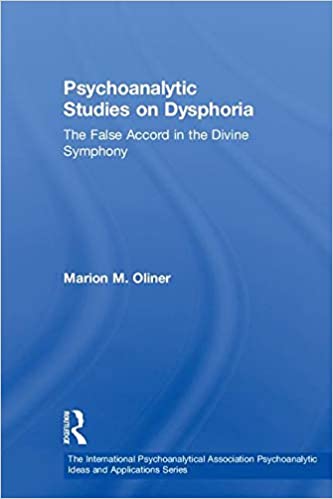
Études psychanalytiques sur la dysphorie. Le faux accord dans la divine symphonie : le titre du dernier ouvrage de Marion Oliner intrigue. De par son étymologie, la dysphorie renvoie à une humeur difficile à supporter. La notion est vaste, mais le sous-titre, tiré d’un poème de Baudelaire (1857/1975, p. 78-79) intitulé l’Héautontimorouménos (« bourreau de soi-même », en grec), donne plus précisément à penser que le plus dur à supporter, c’est peut-être d’abord soi-même.
Ne suis-je pas un faux accord
Dans la divine symphonie,
Grâce à la vorace Ironie
Qui me secoue et qui me mord ?
(…)
Je suis la plaie et le couteau !
Je suis le soufflet et la joue !
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau !
Le fait qu’Oliner ait choisi de mettre en exergue ce poème de Baudelaire pour un ouvrage qui traite des effets psychiques du trauma et de sa transmission donne à penser qu’elle ne se limitera pas à la sidération et la position de victime. Le livre part en effet des conséquences psychiques de la Shoah pour dégager des thèmes essentiels à tout processus psychique, au-delà des cas extrêmes de survie au trauma. Elle interroge ainsi l’origine et le sens de la répétition, la conflictualité intrapsychique toujours présente, la fonction subjectivante de la confrontation entre réalité extérieure et intérieure, ainsi que de la destructivité, pour se dégager de l’illusion d’omnipotence. Marion Oliner parvient également à mettre en perspective des sources nombreuses et variées, témoignant de sa culture internationale et de son ouverture d’esprit.
Marion Oliner est d’origine allemande et vit depuis longtemps à New York. Elle avait 9 ans quand elle a dû fuir l’Allemagne nazie avec sa mère vers la Belgique. Elle a souffert comme les autres enfants juifs de la peur et de l’humiliation, laissant l’empreinte indélébile d’un sentiment d’infériorité. Elle raconte aussi l’ambivalence à l’égard de son pays d’origine. « En Belgique, j’ai été Allemande jusqu’à ce que les Allemands arrivent. À partir de là, j’ai été juive » (p. 62). L’auteur ne revient pas en détail sur les traumatismes qu’elle a subis pendant la guerre, évoqués plus précisément dans son ouvrage précédent (Oliner, 2012). Mais dans le chapitre « The root of war is fear ; the rest is history[1] », elle analyse l’écho de 1940 en 2001, à New York, alors qu’elle assiste à l’effondrement des tours et au sursaut patriotique américain. Certes, elle n’a pas vécu ce drame comme un traumatisme similaire, elle se sentait protégée, en sécurité aux États-Unis. Mais la vue des drapeaux américains jusque sur les tables d’un restaurant a fait ré-émerger l’effroi, face à un pays prêt à entrer en guerre pour effacer la peur et la faiblesse. Ce fut le déclencheur d’une guerre inutile et désastreuse en Irak. Comme le dit Bill Clinton (2002) : « Quand les gens sont dans le doute, ils préfèrent quelqu’un de fort et qui se trompe plutôt que quelqu’un de faible et qui a raison. » Marion Oliner se souvient des chants lors des défilés nazis de son enfance avant la guerre, de la fascination exercée par l’énergie, la puissance, l’ordre qui se dégageaient de ces parades. L’impression trompeuse d’un idéal moral. Elle se réfère à Slavoj Zizek qui considère l’idéologie comme une construction symbolique qui comble une impossibilité structurelle et qui en même temps nie cette impossibilité.
La peur peut donc engendrer la guerre, mais la violence est plus fondamentale, ainsi que l’a montré Jean Bergeret (1994) : elle peut être une violence sans objet constitué, car l’autoconservation implique dès le début que le nouveau-né se dégage du corps de la mère. La violence n’est pas instinct de mort, elle est au service de la vie, voire de la survie. Pour Oliner, une organisation psychique orientée vers la réalité extérieure, sans objet, n’est pas narcissique (p. 5). L’autoconservation n’est pas forcément amour de soi, elle suppose une attention aigüe à l’égard de l’environnement et des menaces extérieures. Le narcissisme exacerbé au contraire conduit à la défaite, les chefs nazis se sont tous suicidés.
Marion Oliner s’interroge alors sur la difficulté de haïr son ennemi[2]. Elle prend appui sur une phrase de Winnicott (1969, p. 358) qui constitue le fil rouge de tout l’ouvrage : « Il n’existe pas de traumatisme qui soit extérieur à la zone de toute-puissance de l’individu. » Inévitablement, les souffrances endurées sont reprises dans l’ère d’omnipotence pour ne pas s’effondrer sous le poids de la détresse, de la honte et de l’impuissance. La réalité traumatique n’existe pas hors de la psyché. Celle-ci tente désespérément de la maîtriser, au prix d’une culpabilité inconsciente aux effets délétères. En effet, même si elle est projetée sur les auteurs des persécutions, la culpabilité demeure, clivée, en chaque victime. Oliner se réfère aussi à la psychologie expérimentale qui a montré que l’on tend souvent à oublier les causalités extérieures d’un événement pour s’attribuer plutôt la responsabilité de son occurrence.
Lors d’un traumatisme, la haine ne peut se développer, car le sujet n’a pu se représenter l’objet. Au lieu de cela règne un malaise fondamental, la culpabilité primaire décrite par René Roussillon. « À la place de la forme matricielle de l’illusion “je suis le sein” (Freud, [1938, 1941f]/2010, p. 319) s’instaure une illusion négative à l’origine du noyau de la culpabilité primaire : “Je suis le mal.” Ce noyau de culpabilité primaire est non ambivalent. Il précède l’organisation et la différenciation sujet/objet et repose sur une confusion primaire moi-non-moi » (Roussillon, 1999, p. 83). « Je suis le mal », on retrouve là le bourreau de soi-même qui a inspiré le titre de l’ouvrage, la source de la dysphorie, qui, à la différence des événements eux-mêmes, peut se reprendre au travers de l’analyse, dans un travail de réintégration et de construction d’une histoire personnelle.
Une partie du livre d’Oliner interroge la manière dont se transmet ce malaise aux générations suivantes, comment le mal devient malédiction. Un chapitre, reprenant un écrit plus ancien, explore la problématique hystérique présente chez les enfants des survivants. Le trauma des parents agit sur les enfants comme une séduction incestueuse : ce qui est transmis est aussi mystérieux que la sexualité adulte. La tendance des mères survivantes des camps de concentration à utiliser leur enfant comme moyen de réconfort, comme substitut de parents décédés, a souvent conduit à minimiser les peurs et les souffrances de leurs enfants. Ces mères, débordantes d’angoisse à l’égard de leurs enfants, ont ainsi pu être amenées à favoriser un déni de leur réalité psychique. Tout en faisant preuve d’une indulgence excessive à l’égard de leurs besoins physiques. Ceci n’est pas sans rappeler la description des mères hystérogéniques de Masud Khan (1974)[3] associant une méconnaissance des besoins du moi de leur enfant et une surstimulation excitante. L’enfant de survivants s’identifie aux objets perdus de ses parents, tente de pallier la perte et d’éviter la compétitivité œdipienne, et souvent se produit un brouillage des générations comme chez Dora par exemple, confidente de son père.
Oliner expose ainsi le cas d’une jeune femme qu’elle a nommée « la chasseuse de nazis » qui d’une certaine manière endosse la persécution vécue par ses parents, déniant par là même la souffrance liée à ses propres vécus traumatiques. Elle fait alors le triste constat que la vie de ses parents lui paraît plus réelle que la sienne. Longtemps, elle ne peut imaginer son analyste autrement que comme une nazie et ne peut que se positionner comme une victime en colère au nom de ses parents. Oliner analyse combien cette colère permet de mieux refouler les mouvements agressifs à l’égard de parents inattaquables et montre ainsi que le travail analytique avec les victimes de traumas comme avec leurs descendants permet de ne pas perdre de vue les défenses liées aux conflits internes. « Au lieu d’être une expérience du passé … , le trauma devient un écran ou un mythe dont la fonction est d’externaliser la culpabilité » (Oliner, p. 37).
Un des thèmes principaux de l’ouvrage est en même temps celui de la prise en compte de la réalité (the importance of being real[4]). Il ne s’agit pas là du Réel de Lacan – ce qui échappe absolument à la réalité psychique, ce qui est irreprésentable – mais plutôt de l’importance de la réalité perceptible dans la construction de la psyché et dans le processus psychanalytique. Les psychanalystes traitent souvent la réalité extérieure avec méfiance, estimant que celle-ci peut être une défense contre la réalité psychique, comme un échec de la mentalisation. Pourtant, la perception aiguë de l’environnement est nécessaire à la survie, surtout en temps de guerre. Mais plus encore, Oliner, à partir de La recherche du temps perdu, montre combien seules des sensations liées à des objets réels peuvent permettre de se dégager d’un temps qui ne passe pas, pour reprendre l’heureuse formule de J.-B. Pontalis. Dans La recherche (1913-1927), Proust fait une distinction subtile entre la mémoire vivante du passé retrouvé grâce à la dégustation de la madeleine et le souvenir figé, obsédant et pénible du moment du coucher où il devait se séparer de sa mère (Oliner, p. 81).
Comment la retrouvaille à l’identique d’une sensation du passé peut-elle faire percevoir l’écart du temps, alors qu’une scène chargée d’émotions peut être stérile, figée, hors temps ? Ces sensations qui rendent les souvenirs réels, tout en faisant prendre conscience du temps qui a passé, n’est-ce pas ce que l’analyse recherche ? La qualité sensible est un élément essentiel au travail psychique, on la retrouve dans l’impression de réalité du rêve. Oliner souligne que le mot utilisé par Freud au sujet de cette fonction du rêve – Darstellbarkeit – a été traduit à tort par representativity dans la Standard Edition. Darstellbarkeit est la figurabilité alors que la représentativité renvoie plutôt au terme Vorstellbarkeit. Le rêve est réalité pour le rêveur, il figure, voire incarne des impressions sensibles, plus qu’il ne les représente.
Le besoin de répéter une réalité sensible ne relève pas forcément de la pulsion de mort avance Oliner, il peut se produire là un acte créatif, comme pour le rêve, ou comme dans le besoin d’enactment dans la cure (p. 84). Les individus ayant souffert de traumatismes ont besoin d’actualiser leur vécu dans la réalité. Le besoin de répétition n’a pas à être attribué à un instinct spécifique, mais plutôt au besoin d’intégrer une vie pulsionnelle au sein de la réalité sensible. Le besoin de réel est plus important encore chez les victimes de trauma. Oliner donne l’exemple d’une patiente qui fut saisie de désespoir en voyant un jour son analyste porter une robe noire. Elle avait besoin, semble-t-il, d’imaginer que son analyste était en deuil et qu’elle la dérangeait, qu’elle devait la laisser tranquille. Fut ainsi ravivé pour la première fois le souvenir d’avoir vu sa mère en deuil et de n’avoir pas eu de place à ce moment-là. Oliner se démarque alors de Bion qui interprète souvent l’accent sur la réalité externe comme un procédé d’évacuation de la réalité psychique. Elle se rapproche plutôt de Cesar et Sara Botella, qui insistent sur la nécessité de renoncer à la confusion entre le sein halluciné et le sein réel. Là est le premier traumatisme, la première perte. Les deux aspects du sein sont réels, mais non identiques. Le besoin de répéter une réalité est la recherche de l’identité perceptuelle qu’évoque Freud dès L’esquisse (1895), une identité qui paradoxalement introduit la notion du temps qui passe et de sa propre histoire.
La position analytique de Marion Oliner avec les patients adultes qui n’ont pu s’appuyer sur des parents suffisamment solides est clairement inspirée de Winnicott et de son concept d’utilisation de l’objet. Ces personnes n’ont pu se détacher psychiquement de leurs parents de peur de les détruire et se vivent comme le faux accord dans la divine symphonie. Malgré tout, Oliner se réfère à Jacques André pour réfuter toute conception trop littéralement développementale de l’usage de l’objet selon Winnicott. L’analyse avec des adultes fragiles n’est pas une reconstitution du passé. Il n’en reste pas moins que le processus dépend beaucoup de la capacité de l’analyste à maintenir un statut ni subjectif ni objectif (« neither subject nor object », p. 109) ou peut-être plutôt les deux à la fois.
L’attention à la réalité psychique est la caractéristique et l’atout de la psychanalyse. Pour autant, Oliner à la suite de Winnicott souligne que se centrer exclusivement sur la réalité psychique peut être une défense chez le patient comme chez l’analyste contre une réalité environnementale incontrôlable. Elle-même, dont les parents ont péri pendant la guerre, n’a pu utiliser ceux-ci pour se reconstruire. Un objet utilisable est un objet qui favorise l’indépendance de l’enfant, par exemple ce serait une mère qui ne fond pas en larmes et ne se sent pas réprimandée quand on punit son enfant qui s’est mal comporté. C’est également un objet qui survit à la destruction. Il faut bien abolir le sein halluciné pour pouvoir s’adapter au sein réel, nous rappelle Winnicott. Oliner donne ainsi l’exemple d’un patient qui ne supportait pas d’avoir confronté ses fantasmes concernant sa bibliothèque aux questions de son analyste. Ses représentations, non dénuées de culpabilité, devaient rester internes sous peine de destruction (p. 103).
Une qualité essentielle de l’objet est de pouvoir être « externe » pour limiter l’omnipotence du sujet. Oliner constate que souvent les victimes de traumatismes utilisent l’omnipotence inconsciente comme défense, notamment contre le sentiment de leur destructivité. Une trop grande adaptation de l’analyste, par exemple changer les horaires des séances à la demande du patient, peut ainsi générer un sentiment de dette, de culpabilité et une impression de faiblesse insupportable de l’analyste. Pour certains patients, tout changement peut être preuve de leur destructivité et leur préférence ira vers un analyste rigide, voire cruel, pour mieux se sentir impuissants et innocents. La plus grande attention est ainsi à prêter au cadre, qui incarne ce qui est le plus primitif et indifférencié. Et surtout, tout au long du livre, Oliner nous aide à penser l’importance et la subtilité du jeu entre subjectivité et objectivité, par exemple entre le développement du transfert, par essence subjectif, et l’interprétation, qui donne à l’analyste le statut d’un objet externe. Et aussi entre représentations et sensations bien réelles. C’est une condition pour redonner toute sa liberté et son indépendance au sujet.
Références bibliographiques
Bergeret J. (1994). La violence et la vie. Paris, Payot & Rivages.
Baudelaire C. (1857/1975). Les Fleurs du mal. Œuvres complètes,t. I. Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléïade ».
Clinton B. (2002). Discours au Democratic Leadership Council, prononcé à l’université de New York le 3 décembre 2002
Freud S. (1938 (1941f)/2010). Résultats, idées, problèmes, OCF.P, XX. Paris, Puf.
Khan M. (1974). La rancune de l’hystérique. Nouv Rev Psychan, 10 : 151-158.
Oliner M. (2012). Psychic reality in context, perspectives on psychoanalysis, personal history and trauma. Karnac Books.
Oliner M. (2016). À l’origine de la guerre: la peur. Rev Fr Psychanal 80(1) : 107-122.
Oliner M. (2016). De la difficulté de haïr son ennemi. Rev Fr Psychanal 80(2) : 408-420.
Roussillon R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, Puf.
Winnicott D.W. (1969). La théorie de la relation parent-nourrisson. De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris, Payot.
Catherine Ducarre est psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de la SPP.
[1] À l’origine de la guerre : la peur ». Version en français parue dans la Revue française de Psychanalyse 80 (1), 2016.
[2] « De la difficulté de haïr son ennemi ». Version en français dans la Revue française de Psychanalyse 80 (2), 2016.
[4] Voir aussi, dans ce numéro de la Revue française de psychanalyse, la traduction de l’article de Ilse Grubrich Simitis : « Épreuve de réalité au lieu d’interprétation. Une phase du travail psychanalytique avec des descendants de survivants de la Shoah ».
Rachel Rosenblum, Mourir d’écrire ?, Paris, Puf, « Le fil rouge ».

Ce livre de Rachel Rosenblum nous invite à partager des années de réflexions, de questions, de doutes, et de recherches approfondies sur la clinique des traumatismes extrêmes. Il porte sur le traitement par le dispositif et la méthode psychanalytiques des effets destructeurs de ces traumatismes sur la vie psychique des victimes, de leurs descendants ou de leur entourage. Le sous-titre du livre : « Shoah, traumas extrêmes et psychanalyse des survivants » en indique les contenus. Rachel Rosenblum a consacré à ce thème beaucoup d’articles et d’essais qui lui ont valu deux prix, le prix Hayman pour ses études sur l’Holocauste et le génocide en 2013, décerné par l’API, et le prix Maurice Bouvet en 2016 pour l’ensemble de ses écrits et pour deux articles publiés dans la Revue française de psychanalyse en 2000 et en 2016.
La lecture de ce livre ne se fait pas sans une vive émotion. Celle-ci traverse autant les récits de cure de patients venus chercher de l’aide auprès de psychanalystes pour une souffrance innommable, que ceux d’écrivains célèbres ayant vécu la Shoah ou ses conséquences, et que l’écriture ne put sauver d’un destin dramatique. Il y a tout au long du livre un entrelacement subtil entre ces deux espaces « thérapeutiques », celui de la cure et celui de l’écriture. Cette navigation constante suscite et nourrit une profonde réflexion.
C’est un très beau livre, sensible, sobre, cultivé, profond. Un livre qui condense à la fois une expérience humaine et de longues années de travaux cliniques sur la psychanalyse des survivants de la Shoah et leur devenir psychique.
C’est aussi le livre d’une psychanalyste « engagée » au sens où l’entendait André Green auquel Rachel Rosenblum se réfère souvent et dont la pensée est fortement présente tout au long du livre, en particulier autour du concept de « position phobique centrale », qui souligne bien le risque d’une « potentialisation » des traumas, et de leur amplification dès lors que, nombreux, cumulatifs, ils sont mis en relation les uns avec les autres. « Engagée », car elle a une conscience aiguë de la « responsabilité nouvelle » qui a frappé les psychanalystes depuis qu’ils ont commencé dans les années 70/80 à recevoir des patients victimes du nazisme et à écouter leur souffrance, inédite, inconnue du champ psychanalytique « classique ». Celle-ci dépassait parfois les limites de « l’analysable ». Rachel Rosenblum revient en effet sur les risques de l’après-coup de tels traumas mettant fortement en question d’une part, la fonction cathartique de la parole et d’autre part, parfois, celle d’un travail élaboratif d’après-coup. Elle montre toutefois l’importance d’un tel travail analytique pour les générations suivantes.
À la lecture de ce livre, on ne peut plus concevoir tout à fait de la même façon les traumas extrêmes de l’expérience d’horreur des camps. Mais il faut ajouter que ce livre ne s’adresse pas seulement aux psychanalystes, il parlera aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont interrogés sur les destins des victimes et sur les traces laissées par ces vécus effroyables.
Parmi les questions posées tout au long du livre, voici celles qui en constituent les axes principaux :
– Est-ce qu’on peut s’en sortir et comment, quand on a survécu aux camps de la mort, qu’on est enfant de survivant, ou membre d’une famille anéantie par la Shoah, « orphelin de la Shoah » ou enfant caché et qu’on porte cet « héritage » ?
– Un travail analytique est-il possible après une telle expérience ? Est-il souhaitable pour tous, et de la même manière pour tous ? Et quel travail peut permettre de vivre avec les souvenirs de ces souffrances « intolérables » ?
– Quel travail de pensée, de créativité ou de création, sublimatoire ou de contrainte, peut-il constituer une voie de survie et potentiellement de retour dans la vie ? Et à contrario quels dangers menacent la vie de ceux qui s’y risquent ?
R. Rosenblum fut alertée très tôt par ce qu’elle découvrait chez ses patients, dans les témoignages de survivants, et chez certains écrivains dont le destin a montré que l’écriture, la mise en mots, n’était pas nécessairement la garantie d’une libération ou d’une issue salvatrice. Elle faisait le constat du contraire : pour certains d’entre eux, l’écriture pouvait parfois aboutir à un vécu si « intolérable » qu’il conduisait à la mort. Peut-on mourir d’écrire ? se demanda-t-elle après le suicide de Sarah Kofman qui aura été un déclencheur de ses réflexions sur cette terrible question. Elle écrivit un article qui fit date dans la Revue française de psychanalyse en 2000, « Peut-on mourir de dire ? »,à propos de Sarah Kofman et de Primo Levi qui, comme d’autres, ont mis fin à leurs jours, peu de temps après avoir écrit des livres racontant leur histoire de manière plus intime, en explicitant directement leurs affects liés au trauma. Trop directement ? Cette question pourrait être un fil rouge du livre.
Cet article interroge « le rapport entre la mort et le dire ».
Je la cite : « croyant régler son sort à l’horreur certains textes ne font qu’y précipiter leurs auteurs … » (p. 26). Ceci ne signifie nullement qu’elle établisse un lien direct ou univoque. R. Rosenblum s’en garde bien. Mais elle n’évite pas non plus d’interroger cette « indécidable » causalité… Heureusement, la mort n’est pas toujours la voie de sortie du trauma, tous les écrivains n’ont pas eu ce destin funeste, on pense à Kertesz entre autres, et l’on se souvient de la vitalité de Marceline Loridan qui disait haut et fort qu’il fallait « tenir et s’appuyer sur sa force de vie jusqu’au bout ». La survivance reste une énigme.
Il y a dire et il y a « se dire »… Et il y a le rapport du sujet à son dire, son rapport au récit, distancié et masqué ou au contraire frontal, à nu, qui interroge le seuil de « tolérance » de chacun aux affects qui surgissent avec le récit. Semprun pose directement le problème dans le titre de son livre L’écriture ou la vie ? Le tout dire de la cure peut parfois déclencher des épisodes psychotiques, des atteintes somatiques graves, parfois le suicide, nous rappelle R. Rosenblum.
Le dire de la cure ou l’écriture biographique se rejoignent chez un auteur qui a une place particulière dans ce livre, Georges Perec, dont R. Rosenblum a beaucoup travaillé l’œuvre, un écrivain talentueux en analyse avec un analyste et écrivain également talentueux, J.-B. Pontalis.Perec écrivait à propos de son analyse : « Ma voix ne rencontrait ni mon émotion, ni ma peur, ni mon désir, ni mon corps … il importait que s’effrite cette écriture-carapace, que s’érode la muraille des souvenirs tout faits. » (cité, p. 12).
Alors, y a-t-il un risque d’épuisement d’une « écriture-carapace » ou d’une « écriture-écran » (l’expression est de Sarah Kofman), dont les ressources ne suffiraient plus un jour à surmonter la désolation profonde, et à contre-investir la violence des affects qui prennent corps : la détresse, l’effroi, mais aussi la haine et la honte ? Peut-on négocier la honte, demande R. Rosenblum ?
Si le poids de ces traumas extrêmes est parfois élaborable par l’analyse, cette élaboration peut aussi conduire à des échecs thérapeutiques dramatiques pour certains patients. Nous pouvons suivre à travers des exemples pris dans la clinique de différents auteurs, notamment ceux proposés par Sydney Stewart, les développements de questions qui intéressent au premier chef les psychanalystes : jusqu’où peut-on pousser l’analyse ? Comment savoir s’il convient de s’en tenir à un certain équilibre économique acquis, « suffisamment » satisfaisant pour la vie du patient, ou si l’on peut sans risque continuer à favoriser un processus qui mène vers la rencontre du trauma ? Comment savoir si l’analyse ne mettra pas en péril des défenses chèrement acquises en laissant un moi défait et incapable de réorganisation ? Sur quels critères, quels indices pouvons-nous nous appuyer pour nous aventurer (ou pas) à démasquer les affects sous-jacents inconscients ?
Ce livre propose un ensemble d’interrogations qui entrelacent, au fil de chacun des chapitres, les effets positifs et négatifs de la cure, du témoignage et de l’écriture pour les survivants et descendants de la Shoah, avec ce souci constant : que devrait être le récit pour que l’investissement de la charge affective soit tolérable ?
R. Rosenblum met l’accent sur les traces laissées par ces traumas extrêmes qui ont mis les psychanalystes face à une forme de retournement de la position winnicottienne par rapport au concept bien connu de crainte d’un effondrement déjà vécu, mais non inscrit psychiquement du fait d’un moi trop immature pour en assumer la charge traumatique. Là, nous ne sommes plus dans un espace primaire de traumas précoces qui n’auraient pu trouver de lieu psychique en leur temps ni de moyens d’inscription dans la psyché. La remémoration de l’horreur du trauma peut entraîner, nous dit-elle, un dégel brutal des affects et provoquer un effondrement par la prise de conscience de l’intensité effroyable du vécu, amorti ou dénié jusqu’alors. Ce sont les moyens psychiques d’inscription qui sont atteints et sidérés par la violence du trauma. Le risque est alors celui d’une « re-traumatisation » dans la situation de cure par le retour de la catastrophe dont il sera impossible parfois d’enrayer la force destructrice, nous dit R. Rosenblum. Elle met ainsi en évidence l’économie des défenses, pas seulement par rapport à un quantitatif pulsionnel, mais par rapport à un quantitatif intolérable de la réalité traumatique.
Est interrogée l’idée de Ferenczi qui préconisait dans un texte de 1932 la reviviscence du trauma dans la cure, dans des conditions « moins défavorables ». R. Rosenblum montre que la clinique de tels traumas ne permet pas de s’engager dans cette voie. Ferenczi était du reste lui-même revenu sur cette approche. En même temps, elle rend hommage à cet auteur qui a su critiquer en avant-gardiste les enjeux spécifiques inconscients des traumatismes, et la place parfois trop exclusive donnée aux fantasmes qui allait de pair avec une sous-estimation d’une réalité traumatique mal reconnue. Elle reprend certaines de ses avancées dont la fécondité se confirme dans l’approche clinique des traumas extrêmes, en soulignant les modifications techniques auxquelles parfois il est nécessaire d’avoir recours pour ne pas entraîner les patients dans une « déréalisation » dommageable. Elle nous fait connaître les travaux de Dori Laub et de Ilse Grubrich Simitis qui vont dans le même sens et mettent en garde contre cette « déréalisation ».
R. Rosenblum nous invite alors à reconsidérer le paradoxe d’un après-coup qui, au lieu d’être un deuxième temps élaboratif du trauma, pourrait être fatal (une référence est faite ici à l’article de Laurent Danon-Boileau : « L’après-coup fatal » paru dans la Revue française de psychanalyse, en 2009). Y a-t-il une possibilité d’élaborer ce type de traumatisme non intégré, clivé, aux affects gelés parfois depuis de longues années, si l’après-coup devient une véritable épée de Damoclès ? Ou, dit autrement, sur quelles modalités un travail d’après-coup pourrait-il mettre en mouvement une processualité qui ouvre sur une réorganisation pulsionnalisée pour que la vie psychique soit mise à nouveau sur le chemin du principe de plaisir ? L’histoire de la psychanalyse fut marquée dans les années 1975 par toutes ces interrogations, les psychanalystes s’étant alors trouvés face à cette question d’ordre vital : y avait-il un danger spécifique à favoriser un processus de subjectivation pour les patients ayant survécu aux camps de la mort ? Question qui ne concerne pas les générations suivantes qui ont pu bénéficier de traitements analytiques classiques.
Toutefois, qu’on ne se méprenne pas, la prudence de R. Rosenblum ne vise pas à démontrer les limites de la psychanalyse dans ces cas, ce qui conduirait à une fermeture et à un pessimisme stérile en contradiction avec son expérience comme avec celle de nombreux analystes. Elle est plutôt une invitation à ne pas sous-estimer, pour ces sujets engagés dans un processus analytique, l’importance de leur « construction psychique de survie », pour qu’une certaine vie pulsionnelle puisse se vivre.
Si R. Rosenblum s’appuie sur une longue expérience pour nous faire partager ses réflexions sur les dangers à faire renaître trop directement ou trop frontalement les vécus de l’expérience traumatique de la Shoah, elle ne méconnaît pas pour autant la destructivité ni les sentiments de haine dans le transfert et le contre-transfert, elle ne tombe pas non plus dans le piège de la compassion empathique ni dans celui du déni du transfert négatif à l’œuvre. Il n’y a pas pour elle de renoncement à opérer à l’analyse de l’agressivité, ni à celle des conflits, ni à celle des liens primaires et des traumas survenus dans la préhistoire du sujet. Mais sa pensée est infiltrée par une prudence vitale pour ces êtres brisés par l’histoire, une pensée sous-tendue par un refus de réduire l’interprétation des conflits et des affects à une problématique de névrose infantile si l’analyste en venait à superposer celle-ci au trauma sans prendre en compte la profondeur des effets délétères de cette expérience. Très ferenczienne, elle souligne combien une écoute réductrice apparaîtrait au sujet comme « dérisoire » au regard de son vécu des camps de la mort. L’analyste fournirait alors, non plus des « circonstances moins défavorables » pour raconter et ab-réagir le trauma, mais une situation de violence ajoutée. La cure risquerait de devenir le lieu d’un redoublement du trauma par un autre, actuel, celui de l’incompréhension et de l’absurdité qui iraient heurter de plein fouet un narcissisme déjà violenté qui ne s’en remettrait pas.
Quelques mots encore sur les prolongements donnés par R. Rosenblum à cette problématique. Elle consacre en effet un chapitre au terrorisme et à l’effroi, écrit à la suite d’un colloque de la SPP qui avait pour thème « La vie psychique à tout prix », après les attentats de 2015 en France, chapitre auquel elle a donné pour titre : « Si la mort vous effleure ». Il y est question des effets de « l’avant-coup » (l’expression est de Christian David), des moments où la mort est vécue par anticipation par quelqu’un qui sait qu’il va mourir ou qu’il risque de mourir. Un avant-coup qui provoque une angoisse d’annihilation qui, disait C. David, dépasse largement l’angoisse de castration.
Un autre chapitre explore ce que R. Rosenblum appelle « la stratégie du détour » lorsque celle-ci en vient à dériver vers une « stratégie de l’imposture » par l’emprunt de l’expérience même de la Shoah comme si, paradoxalement, elle seule pouvait représenter un moins insupportable que l’insupportable de l’histoire réelle. C’est l’histoire de Binjamin Wilkomirski : le trauma d’une enfance « irracontable » masqué par un destin usurpé.
Son dernier chapitre est particulièrement émouvant : « Voyages de mémoire, le retour sur les lieux du trauma ». « Le voyage mnésique », une métaphore du retour comme elle l’appelle, désigne le voyage sur les lieux géographiques du retour qui va, pour certains, s’associer au voyage psychanalytique. Celui-ci sera parfois libérateur (Emmanuel Carrère, Un roman russe, portant sur la transmission intergénérationnelle), parfois terriblement violent (Romain Gary, La danse de Gengis Cohn), ou parfois inutile et totalement vain, « un voyage pour rien », écrit-elle à propos de Georges Perec (W ou le souvenir d’enfance).
Je terminerai sur une question à méditer à propos de la survivance à la Shoah, question centrale du livre : Peut-on vivre avec Auschwitz après Auschwitz ?
J’ai retenu un passage qui illustre bien cette problématique lorsque R. Rosenblum évoque Charlotte Delbo : celle-ci racontait qu’elle avait réussi à vivre quasi normalement à sa sortie des camps, et il lui est demandé si elle vivait « avec Auschwitz » ? Elle répondit : « Non, je vis à côté… » Sa réponse pourrait être un condensé du livre : avec ou à côté ?
Ce livre est une profonde méditation, faite de questions multiples, ouvertes, de points d’interrogation et de points de suspension… Et en réponse à toutes ces questions, pas de généralisation. R. Rosenblum privilégie toujours un trajet singulier et subjectif, qui ne donne pas de conclusion générale. Sa pensée est ponctuée de « parfois, peut-être, souvent, pas toujours… », d’adverbes qui montrent son refus d’unifier dans une théorie globalisante les souffrances de ces sujets auxquels on a retiré le statut de sujet, et dont la parole pour tenter de récupérer cette subjectivité, peut elle-même déboucher sur sa destruction.
Évelyne Chauvet est psychanalyste, membre la SPP.
ARCHIVES
Lawrence J. Brown, Transformational processes in clinical psychoanalysis, dreaming, emotions and the present moment, Londres, Routledge

Dans cet ouvrage remarquable de 250 pages, publié chez Routledge fin 2018 par l’International Psychoanalytic Association, le psychanalyste américain Lawrence J. Brown propose une synthèse des processus de transformation émergeant au sein du dispositif analytique. Il appartient à cette génération d’analystes (Grotstein, Ogden, Ferro, etc.) qui ont fait évoluer les outils conceptuels et la pratique analytique à partir des travaux de Bion. Comme le souligne en préface Civitarese, cette approche s’émancipe d’une recherche concernant l’histoire du sujet pour favoriser les capacités de rêverie et les liens de signification. Brown décrit ainsi, durant les douze chapitres qui composent l’ouvrage, les transformations psychiques du traitement analytique ainsi défini : « […] un processus actif, dans l’ici et maintenant, de transformations continues des affects émergeant dans le champ intersubjectif. De nouvelles significations sont ainsi créées par un processus inconscient et commun de rêve et d’après-coup (nachträglichkeit). Celui-ci est rendu possible par la liaison des fonctions alpha du patient et de l’analyste au sein du cadre analytique[1] » (p. 9).
Brown reprend au premier chapitre les écrits de Bion sur la notion de transformation en soulignant que « la libre association est un processus transformatif par lequel la signification est créée » (p. 2). Le processus transformationnel permet ainsi l’avènement d’éléments non représentés. En ce sens, les travaux sur la transformation psychique portent sur les origines de l’appareil à penser les pensées. L’ouvrage s’appuie également sur cinq présupposés de base : (1) la psyché transforme les expériences émotionnelles en des représentations signifiantes (2) le travail inconscient de l’analyste nécessite son propre contre-transfert et des effets de surprise (3) le travail de l’inconscient implique le champ intersubjectif et la création d’un tiers analytique (4) l’accent sera mis en séance sur l’émergence des émotions (5) le rêve est essentiel au processus de transformation. Dans le deuxième chapitre, Brown décrit l’évolution de la notion de contre-transfert vers celle de transformation à partir des travaux de Freud, Klein, Heimann, Lewin, Racker, Grinberg, Reik et Kernberg. L’inconscient de l’analyste apparaît ainsi comme un « instrument de l’analyse » (Freud) qui implique le contre-transfert, s’agissant de se laisser traverser par le vécu du patient et de tolérer les résistances ainsi induites. Heimann précise que l’analyste doit être « affecté par ce qui est projeté » (p. 25) tandis que Bion montre, à partir de son travail avec des patients psychotiques, comment ceux-ci « placent de mauvais sentiments en moi et les laissent là aussi longtemps que nécessaire pour qu’ils soient modifiés par leur séjour dans ma psyché » (p. 27). Kernberg propose pour sa part de distinguer « contre-transfert classique » et « contre-transfert total » qui fait de ce dernier le moteur du processus de transformation. Le patient produit alors une pression sur l’analyste qui se traduit par une implication émotionnelle dans le moment présent de la séance, les scènes du passé étant rejouées au présent de la thérapie. Il en découle un processus analytique qui dépend du « niveau émotionnel profond du couple sur lequel les identifications projectives sont utilisées pour établir une fondation émotionnelle » (p. 25).
Le troisième chapitre porte sur la fonction alpha décrite comme le « moteur du processus de transformation ». Brown fait l’hypothèse que cette notion fut une tentative pour Bion d’autothéoriser la sidération induite par les traumas venus enrayer sa capacité à rêver son expérience durant la Première Guerre mondiale (« je suis mort le 8 août 1918 à Amiens »). Ainsi, si Freud a pensé le rêve à partir du principe de plaisir, Bion le conçoit dans son rapport au principe de réalité : « Freud dit qu’Aristote établit qu’un rêve est la manière dont un esprit travail quand il est endormi : je dis que c’est la manière dont il travaille éveillé » (p. 44). La réalité sera donc rêvée pour être intégrée, le rêve opérant aussi bien de jour que de nuit. Quand ce travail est mis en échec, le sujet est confronté à une perte de signification menant à un vécu de mort psychique. Les capacités d’intégration sont effractées et les expériences sensorielles sont évacuées dans l’environnement comme le fait l’estomac lors d’une indigestion. Le sujet ne peut alors croître au contact de l’expérience. La fonction essentielle de l’analyse sera de favoriser une relance du « travail de rêve alpha » (dream-work-alpha) dont la qualité dépend de la fonction contenante. Dès lors, l’interprétation n’est plus suffisante et la tolérance au séjour des pensées du patient dans la psyché de l’analyste est essentielle pour développer cette contenance. Celle-ci implique une capacité à rêver qui apparaît comme facteur essentiel de la fonction alpha de même que la relation contenu-contenant et les processus de diffraction-synthèse. Un appareil à penser les pensées se développe ainsi menant à une constellation for thinking. Brown relève enfin deux caractéristiques essentielles de la fonction alpha : sa transmission de génération en génération comme procréation psychique (Bion utilise les symboles mâle-femelle pour décrire les relations contenu-contenant) ; son équivalent dans le groupe nommé « fonction gamma » (Carrao).
Brown précise au chapitre suivant l’influence de la notion de transformation sur la pratique clinique dont l’usage conduit à porter l’accent sur le processus de représentation lui-même plutôt qu’aux conflits entre représentations. Un positionnement fondé sur une attente désaturée et la capacité négative favorisent ainsi l’avènement d’une vérité intersubjective dont Bion n’a cessé de souligner l’importance : « l’apport constant de vérité est aussi inévitable que la survie physique demande de la nourriture » (p. 67). Brown reprend également les différentes transformations (projective, à mouvement rigide, en hallucinose) dégagées par Bion. Il décrit ensuite le point d’origine du processus de transformation – O pour origine – qui prolonge et étend l’ombilic du rêve évoqué par Freud comme contact à l’inconnu.Brown rappelle également la distinction entre transformation en O et transformation en K. La première est une compréhension intellectuelle tandis que la seconde est la voie vers une transformation profonde qui nécessite que l’analyste accepte de partager émotionnellement le vécu de son patient lors de moments d’unisson (at-one-ment). Une vérité intersubjective, relationnelle et émotionnelle émerge alors par une spirale intersubjective qui étend les capacités d’élaboration de la dyade analytique. Bion a tenté avec sa grille de produire un modèle de ces transformations, ce qu’il abandonnera à la faveur de son tournant mystique et son intérêt pour le O, l’intuition et l’inconnu. L’intuition devient alors la sonde par laquelle l’espace mental de l’analyste est confronté à une réalité ultime infinie et sans forme (formless infinite).
Dans le cinquième chapitre, Brown se centre sur la réceptivité de l’analyste. Il décrit une situation clinique pour laquelle il imagine être supervisé par Freud, Reik et Bion. Freud l’invite à se placer dans un état d’attention flottante favorisant la communication d’inconscient à inconscient. Il lui rappelle qu’« aucun psychanalyste ne peut aller plus loin que ses propres complexes et résistances internes ne lui permettent » (p. 92). C’est ensuite Reik qui invite Brown à se laisser surprendre, empruntant à Nietzche la métaphore de la « troisième oreille ». Quant à Bion, il insiste sur le fait que « chaque séance du psychanalyste ne doit avoir ni histoire ni futur » et considère la supervision comme une « deuxième opinion ». Il souligne l’importance de l’intuition et de l’imagination spéculative dans le processus analytique. Celles-ci permettent l’émergence de significations nouvelles grâce à la rêverie. Brown étudie ensuite au sixième chapitre les perturbations du champ analytique associées à des ruptures du cadre analytique. Il reprend les travaux de Bleger et Searls sur le lien fusionnel entretenu avec les parts non humaines de l’environnement. Le cadre représente ainsi un fond indifférencié sur lequel les parts les plus archaïques de la personnalité – le « noyau agglutiné » (Bleger) – se transfèrent de manière symbiotique. Pour Green, le cadre est comme le corps en bonne santé qui devient signifiant lorsqu’il est souffrant, menant alors à des ruptures du tiers analytique. L’internalisation du cadre (rythme, contenance, etc.) et sa réparation auront en revanche des vertus thérapeutiques relevant du maternel primaire.
Le septième chapitre propose une analyse des peintures de William Turner qui « semble focaliser ses impressionnantes capacités artistiques comme s’il avait pour mission de découvrir l’essence de la lumière » (p. 124). Ses derniers mots sur son lit de mort seront d’ailleurs « le soleil est Dieu ». Brown s’appuie sur la notion de sublime – mélange de terreur et de beauté hors-norme – pour décrire la rencontre avec O qui caractérise l’œuvre de Turner. Pour Kant, le sublime transcende les sens et conduit à l’expérience d’un monde infini émergeant du néant. Cette rencontre avec O est marquée d’un paradoxe : « Nous pouvons connaître l’océan à travers nos sens en plongeant nos pieds dans l’eau salée, mais l’étendue de l’océan est une idée qui ne peut être l’objet de l’expérience sensorielle, car elle n’a ni contour ni limites » (p. 127). Bion distingue ainsi les expériences liées à une connaissance délimitée (transformation en K) des expériences intuitives relatives à l’infini (transformations en O). Brown rappelle enfin que Turner fut élevé par une mère mélancolique et qu’il vécut des expériences de perte sa vie durant. Cette recherche de lumière était-elle un moyen d’éclairer et de sublimer ces douloureuses expériences ?
Brown décrit au chapitre suivant trois voies privilégiées de représentation inconsciente chez l’analyste : la rêverie, les rêves de contre-transfert et le travail de l’humour. Ces constructions sont des faits-choisis qui rassemblent des éléments épars à partir du fantasme bi-personnel (Baranger) qui sous-tend la relation analytique. Des expériences non symbolisées seront rêvées émotionnellement – un « rêve de couple » (Grotstein) – à travers un point de contact avec l’infini qui implique une présence interne que Grotstein résume ainsi : « qui est le rêveur qui rêve le rêve ? » (p. 143). Les rêves de transfert seront également un outil essentiel du travail de représentation qui révèle « la façon inconsciente profonde dont le patient est rêvé à l’existence dans l’esprit de l’analyste » (p. 149). Brown montre avec plusieurs vignettes cliniques comment un trait d’humour représente également une construction qui participe du processus de transformation.
Les deux chapitres suivants portent sur les transformations autistiques et décrivent l’univers psychique des patients souffrants de troubles ou d’enclaves autistiques marquées par le vide, des vécus de chute, la non-existence et un caractère « aplati » ou dé-dimensionnalisé. Les processus d’identification adhésive (Meltzer) ne se sont pas déroulés dans de bonnes conditions et mènent à un moi-peau troué (Anzieu) qui utilise des défenses primitives. Ces patients ont donc besoin de développer une seconde peau (Bick) afin de se protéger des excitations sensorielles. Il en découle une carapace et le recours à des objets autistiques. Brown explique ainsi que « l’enfant autiste est face à un dilemme impossible : vivre sans une peau psychique protectrice, ce qui le laisse vulnérable au déferlement d’une insurmontable implosion sensorielle, ou être protégé par une carapace inviolable » (p. 160). Cette dernière entrave les transformations psychiques et le passage des sensations aux émotions. Il rappelle que les agonies primitives (Winnicott) n’ont pu être éprouvées subjectivement et laissent chez le sujet un manque à être faisant retour sous forme de craintes de l’effondrement. Brown rapporte une situation clinique qui témoigne de ce processus, le menant à éprouver des angoisses intenses de non-existence lors d’un rêve de transfert. Le travail du contre-transfert permet ainsi d’accompagner le patient vers des vécus de mort non subjectivés. Dans un deuxième cas clinique, Brown décrit le processus de transformation chez un patient autiste à partir de l’humour et du joke-work. Si Freud avait souligné la place de l’humour dans la vie psychique, il n’a pas théorisé son utilisation dans le dispositif psychanalytique. Brown rappelle à ce propos que la mère est le premier clown, l’humour étant un outil essentiel du travail de transformation.
Le douzième chapitre porte sur le positionnement psychanalytique et le fait d’être « sans mémoire, sans désir » (Bion). Pour Freud, les conflits psychiques resurgissent par l’action et la répétition au sein du cadre analytique dont l’élaboration suppose des capacités symboliques suffisantes tandis que Bion insiste sur la dimension anhistorique du dispositif afin de catalyser les fonctions symbolisantes de la psyché. Brown montre à partir d’une situation clinique comment chaque séance est alors considérée comme une « vérité émotionnelle » (Bion), un « contact réel » (Joseph) et une « expérience vécue » (Ogden). Sur la scène onirique des séances émergent des « hologrammes affectifs » (Ferro) qui donnent forme à l’informe par une personnification des processus. Il s’agit donc davantage de rendre accessible des pensées non pensées que de se souvenir par l’agieren freudien. Brown reprend à ce propos les travaux du groupe de Boston sur le changement en psychothérapie et la notion de « moment présent » à laquelle il reproche de se centrer sur les processus conscients tandis que le modèle de la rêverie porte sur ses soubassements oniriques.
Brown conclut l’ouvrage en montrant comment la notion de transformation conduit à une nouvelle Weltanschauung pour laquelle la capacité à rêver implique une « subjectivité disciplinée » (Erikson). Brown souligne l’importance de l’expérience et cite Ferro concernant les risques d’une cristallisation théorique des langages psychanalytiques : « Nous sommes comme une famille qui n’aurait pas vidé ses placards depuis deux siècles comme le font certains patients psychotiques : des accumulations d’accumulations de concepts que nous conservons alors qu’ils font partie de l’histoire de la psychanalyse et ne sont plus utiles » (p. 213). Le modèle des transformations psychiques aide à voyager léger et conduit à se centrer sur l’intuition clinique et l’imagination. Cette évolution se traduit par une transformation du modèle psychanalytique comme processus de « décryptage » en une pratique dans laquelle l’analyste est partie prenante et dont la vision binoculaire, ainsi que la capacité négative aident à faire l’expérience de la nature kaléidoscopique du réel. Cet ouvrage représente ainsi une excellente synthèse concernant le développement de la notion de transformation dans la psychanalyse contemporaine, ce qui aidera le lecteur à saisir aussi bien ses ramifications théoriques que ses riches implications cliniques.
Thomas Rabeyron est professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université de Lorraine ; Psychologue clinicien.
Gilberte Gensel, Neuf lettres sur la dissonance sexuelle, Paris, Gallimard, 2017.
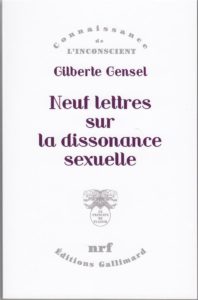
Le propos de Gilberte Gensel sur ce qu’elle propose de penser comme « dissonance sexuelle » m’a d’emblée intéressé, alors que je travaillais sur la bisexualité psychique. En effet, là où Platon envisage Éros comme une tendance à la « consonance […] sorte de conciliation » (1960, p. 713) des parties masculine et féminine de l’être humain, elle entend « une fêlure dans l’accord parfait » (Gensel, 2017, p. 138) qui maintient le désir en éveil et rend possible le rapport sexuel. Cette métaphore musicale suggère que l’interprétation gagne à être énoncée depuis un lieu autre que celui que le transfert lui attribue, par exemple, la voix d’une mère ou d’un père. La dissonance de la parole de l’analyste introduit à du nouveau par-delà l’inquiétant. Gilberte Gensel amène son lecteur à envisager le travail de la bisexualité psychique en séance et son devenir multiple dans les associativités – dissociativités réciproques du patient et de l’analyste sur le modèle du travail du rêve. En effet, la notion de dissonance fait écho à la découverte freudienne de représentations « inconnues » au-delà des « représentations buts » (Freud, 1900a, p. 449) plus clairement établies. La polyphonie des voix – le livre est composé de neuf lettres, chaque fois la narratrice est singulière – met en scène un déplacement permanent du sujet de l’énonciation. La construction de l’ouvrage correspond de la sorte à une théorie implicite de la pratique : il semble possible de faire du terme « dissonance » plus qu’une métaphore, un véritable concept limitrophe du multiple du sexuel infantile et du féminin même si dans sa conclusion l’auteure préfère y voir un mot parmi d’autres de la langue – mais les mots de la métapsychologie n’émergent-ils pas d’un travail de la langue ?
Arrêtons-nous un instant sur l’analogie musicale avant d’entrer dans chacune des lettres et leurs styles d’adresse spécifique. C’est par habitude que l’on dit chez Beethoven ou Bach la tonalité comme le naturel par excellence – l’atonal de la musique contemporaine, les anti-rythmies du jazz, les césures chez Schönberg et Debussy, par leur dissonance même, ont fini par créer pour nos oreilles une nouvelle tonalité, harmonique à sa façon. Alors que dans l’interprétation psychanalytique la dissonance est toujours en rupture avec la répétitivité infinie (fausse harmonie) du discours qui se cite lui-même et en reprend d’autres (Compagnon, 1979). Pour l’ouverture à un sens autre, et l’advenue d’un contact plus sensible, plus juste, avec le monde et les affects : « Ce n’est pas non plus un désaccord : la dissonance ne sonne pas faux. Ce pourrait même être l’absence de dissonance qui dénote une ‟faussetéˮ ».
La présentation qu’a trouvée l’auteure fonctionne comme la situation analysante : c’est certes toujours elle qui parle, mais dans chaque lettre s’exprime une personne différente, par exemple cette femme qui apostrophe un mari homosexuel pourrait avoir vécu à une autre époque, tandis que les interlocutrices de Lou Andréas Salomé, Freud ou Lacan représentent plus directement Gilberte Gensel elle-même. Dans ses interpellations des grand(e)s auteur(e)s, elle s’adresse aussi au lecteur, l’embarque avec elle dans un reproche, un questionnement. On imagine à partir de là une qualité d’écoute et une attention particulière à ce que la voix porte, dans tous les sens du mot. La parole de l’analyste fait entendre au patient les dissonances qui habitent les vibrations sonores de sa voix, échos de ses objets intimes œdipiens, réduits au silence, qui lui reviennent par la voix de l’analyste au-dehors tout en semblant provenir de son intériorité. D’où de possibles scandales, par exemple quand Gilberte Gensel rétorque à Christine Angot que le père incestueux c’est vraiment le père, là où en première approximation on donne raison à Angot de le dénoncer comme disqualifié, pas du tout un père.
La première lettre destinée à Lou Andréas Salomé, commence par un commentaire « agacé » du propos de Lou : « chez la femme l’appareil génital n’est guère qu’une partie du cloaque prise en location » : préjugé misogyne que cette condensation vagin/anus, mais c’est surtout la « métaphore immobilière » qui éveille sa réflexion. La femme ne serait pas propriétaire, mais seulement « locataire » de sa sexualité toujours menacée d’on ne sait quelle régression ? Ce que les mots disent exactement introduit ici à l’idée que le « plaisir mauvais » de l’ « exonération » anale avec son « autodiscipline » (p. 4) oublieux, comme il est écrit dans un article antérieur (Gensel, 2014, p. 263), qu’il constitue d’abord la « scène intestine où s’élabore ce qui est voué à se mélanger intimement à la substance corporelle, la nourrir ou l’accroître », serait à l’origine de toutes les haines de soi. Dès le début, la psychisation irait de pair avec une disqualification anale, dit Gensel, en particulier chez la femme. Pensons au petit garçon effrayé par la menace de castration qui oublie le « temps où pour lui la femme avait encore sa pleine valeur » (Freud, 1910a, p. 121). Cette valeur renvoie à la spécificité de « l’organe génital féminin », ajoute Freud, le primat du phallus est ici analysé comme un symptôme. Pensons à Schreber : c’est comme s’il fanfaronnait : je ne suis pas un homme, pas une femme non plus, mais une merde. N’existe-t-il pas chez l’homme un cloaque imaginaire où se mélangent analité et génitalité ?
La seconde lettre, à Christine Angot, poursuit cette pensée en renversant si ce n’est le politiquement correct, du moins nos conceptions civilisatrices. Elle lui reproche de dire que lorsqu’un père agit un désir incestueux sur son enfant, par définition, il se discrédite dans sa fonction et n’est plus un père, propos de bon sens, dans la ligne de notre lecture courante du mythe du meurtre du père (incestueux) de la horde par ses fils associés dans un projet d’institution des interdits nécessaires à la vie collective. Cette lecture pourrait recouvrir un déni de la situation vécue, Christine Angot écrit en effet « comme s’il n’était pas mon père, et que je n’étais pas son enfant ». Gensel commente : « Regretter infiniment l’absence d’un père, c’est aussi en avoir un » (p. 32) – ce propos éclaire le contexte actuel de dénonciation de l’homme qui abuse de son pouvoir sur la femme, qui est peut-être une façon d’en attendre encore, au fond, de l’amour.
La lettre à Alexis Gera réalise le vœu inaccompli de Marguerite Yourcenar (cf. sa préface à Alexis ou le traité du vain combat) d’écrire une réponse de la femme d’Alexis à la confession de celui-ci. Le dialogue, ou l’impossibilité du dialogue, entre la femme et l’homme, le féminin et le masculin, sont ici approchés d’un point de vue peu souvent utilisé. À un mari qui découvre son homosexualité, elle dit qu’elle l’aime, mais qu’il est de mauvaise foi lorsqu’il argue de ses désirs, car ce qu’elle lui reproche est autre chose, son « égoïsme » qui fait passer le principe de plaisir avant la parole donnée et l’engagement dans le lien, et sa difficulté à avoir admis plus tôt cette homosexualité, ce qui lui aurait permis d’éviter un faux-semblant. Ce ton est-il anachronique ? Il montre que la plainte féminine face à l’homme qui se dérobe est de tout temps. Cette colère traditionnelle est aussi féministe : « Car c’est bien sûr sur ma force que vous avez compté pour oser vous éclipser ainsi […] vous ne m’avez jamais aimée […] Mais notre enfant ? » Ce mari devenu homosexuel se moque « comme d’une guigne » des ravages qu’il cause chez les autres. La lettre à Angot parle de l’homme violeur, celle-ci de l’homme qui fuit, chacun blesse à sa façon.
À qui donc faire appel, recourir ? C’est l’heure de la « Lettre en haut lieu », pièce centrale de l’ouvrage, où l’auteure convoque Freud, que l’on suppose vivant et recevant cette missive – que dirait Freud s’il était parmi nous ? Fantasme enfantin, celui-là même que Sigmund voyait à l’origine de la culture et des religions, forme naïve et native du surmoi, un « haut lieu » salvateur. « Je suis mal à l’aise dans ma civilisation qui n’est plus celle de votre Malaise » (p. 47). De la légalisation du mariage entre personnes du même sexe et de la reconnaissance de leur droit à l’adoption « qu’en auriez-vous pensé ? ». Gensel, contre ceux qui sont pour ou contre, suggère que suspendre son jugement et penser serait l’attitude freudienne. « Parfois, je suis tentée de considérer tout cela comme des puérilités – de grands enfants jouant à papa et maman – et de me dire que la vie suit son cours et qu’arrivera ce qui doit arriver » (p. 53). Puis se fait jour une inquiétude de femme : et si l’humanité en venait à oublier que « nous sommes tous nés du ventre d’une mère et que l’on ne peut se passer de la matrice féminine pour enfanter » dès lors que la technique le permettrait un jour et que déjà la GPA néglige l’importance du lien prénatal entre l’enfant en gestation et la femme qui le porte ? Ce qui ne désavoue pas forcément la parentalité homosexuelle : « Ne serait-il pas plus raisonnable de reconnaître que nous ne savons pas exactement ce qui détermine qu’un enfant parvienne à se procurer ce dont il a besoin pour son développement […] ni dans quelle mesure la situation œdipienne des parents a une influence » (p. 67). Ce propos contredit à certains égards le précédent sur la plainte concernant l’absence du père qui serait une façon de le faire exister : je pense que l’Œdipe reste présent jusque dans son effacement apparent, les parents homosexuels ayant une histoire œdipienne et l’environnement sociétal continuant à signifier cette thématique. Gilberte Gensel estime qu’il s’agit sans doute d’un « malentendu de plus », qui génèrera lui aussi des déceptions, après la prétendue libération de la vie sexuelle qui a achoppé sur une conflictualité intrinsèque aux pulsions elles-mêmes.
La lettre à Winnicott poursuit la réflexion sur le malaise. N’encourage-t-il pas les économistes à tenir compte de l’avidité, alors que justement les sciences économiques et sociales sont fondées sur un refus d’envisager les facteurs pulsionnels inconscients, incommensurables, pour reprendre le terme qu’utilise Freud à propos de l’écart entre l’amour infantile primaire pour la mère et les amours ultérieurs (1931b) ? En effet, comment le socius pourrait-il admettre l’incommensurable, incompatible avec la mesure ? Début de réponse analytique : faire attention aux mots que l’on emploie, par exemple l’« envie » serait plus celle du patient en analyse que de l’enfant qui ne se console jamais de la perte du sein maternel. S’appuyant sur le texte de Winnicott « Usage du mot Usage » elle écrit que le psychanalyste « se laisse guider par le patient dans l’usage que celui-ci fait de certains mots : ses mots à lui, son lexique » (p. 75) au plus près de sa langue infantile, formulant les interprétations dans un mixte des mots du patient et des siens, qui apportent du nouveau. Le mot avidité doit-il être remplacé par le mot amour ? Oui, si on précise que l’attachement primaire, son emprise impitoyable, vite tournée en agressivité régressive destructrice du lien, avec sa crudité sadique originelle et son caractère passionnel indubitablement sexuel, c’est cela, l’« amour ». Winnicott était lui-même porté par « une attente de quelque chose de plus que ce qu’il est possible d’avoir » (p. 81) lorsqu’il supposait que si le patient est mû par l’envie c’est à cause des défaillances de l’analyste – l’incommensurable habite désormais l’idéal analytique.
Ce qui mène directement à l’Hiflosigkeit qu’Adam Phillips, destinataire de la sixième lettre, suggère d’exprimer en anglais par « helplessness », après le désaide, la détresse, le désarroi – helplessness étant traduit dans l’édition française du livre d’A. Phillips comme l’impuissance de l’enfant, et, je crois, au-delà du besoin d’une aide extérieure, le drame de l’amour sexuel œdipien primitif incapable de parvenir à ses fins, ce qui est susceptible de précipiter dans des désorganisations régressives mortifères. Mais reconnaître l’impuissance pourrait produire, par l’introjection d’une expérience passive intense, une puissance autre, présument Phillips et Gensel.
Freud n’a-t-il pas écrit que « la névrose est le négatif de la perversion » ? Jacques Lacan traduit : « la perversion est le négatif de la névrose ». Ce n’est pas une simple bourde, ou une lecture cavalière de Freud, Gensel le cerne bien dans sa septième lettre : Lacan, pour fonder le triptyque névrose/psychose/perversion, autour de l’idée de la « solution perverse » (au conflit névrotique selon lui, mais, en fait, surtout à la psychose), a besoin de hausser le déni au même niveau d’importance clinique et théorique que le refoulement. La formule freudienne serait-elle réversible ? demande avec pertinence Gilberte Gensel. C’est en effet là la vraie question. Et la dissonance sexuelle par excellence. Car la phrase de Freud – qui date de 1905 avant le beau texte sur la nervosité dans les temps modernes qui réclame moins de névrose et plus de liberté – contient logiquement son possible renversement dialectique. Les choses ne sont pas si simples, car, comme le rappelle Gilberte Gensel, l’hystérie refuse non pas la sexualité, mais la perversion. C’est une notation qui éclaire nombre de phénomènes contemporains : les symptômes névrotiques « constituent l’expression convertie » de pulsions « que l’on qualifierait de perverses » si elles étaient agies, écrit Freud. Aujourd’hui, dans les discours sur le sexuel libéré, on revendique la transgression comme légitime : la perversion à force d’être partout n’est nulle part, mais resurgit dans la hantise et la crainte d’une perversité possible des hommes avec les femmes ou des adultes avec les enfants. « Il n’est donc pas indifférent de savoir, de la névrose ou de la perversion, laquelle est le négatif de l’autre » (p. 110). Question complémentaire : qu’entend-on exactement par « perversion » ? La conjoncture où une personne semble obligée d’en passer par un rituel non génital pauvre et répétitif pour accéder au plaisir, ou une perversité psychique manipulatrice et destructrice d’autrui, possiblement indépendante de telle ou telle sexualité ? Le mot évoque spontanément pour les locuteurs de la langue une destructivité intentionnelle indissociable d’un certain usage du sexuel : consonance et dissonance, du concept, mais aussi de la chose même.
La huitième lettre interroge Michel Gribinski sur son livre Les scènes indésirables, qui traite de l’entreprise nazie d’éducation d’enfants « germanisables », puis sur l’indésirable en analyse où « la mémoire est actuelle » (p. 126) loin de la conception linéaire où « chaque fraction de temps est constamment perdue » – mais les deux assertions sont vraies en même temps, par exemple en marchant dans les rues, je perds en permanence tel ou tel angle de perception de la ville, et je trouve alors le fond atemporel de la mémoire. Hypothèse moins optimiste, l’accentuation du malaise dans la culture « fait penser à la surface qui nous est offerte par les écrans de toute sorte où nous nous regardons, scrutant ces images convenues, nous cherchant nous-mêmes en vain, chaque jour plus passifs, dans cet état particulier de conscience que Bion avait caractérisé comme “ni endormi ni éveilléˮ, insomniaque. Dans ces conditions, le chemin de la régression, donc du rêve, est barré. Peut-être dans tel état de la culture, la phase de latence perd-elle toute signification, tend-elle à disparaître » (p. 135).
La neuvième lettre, intitulée Après-coup, théorise la dissonance comme quasi-concept : « ce qui dissone inquiète […] le sexuel dissone », dans la voix, la culture, la cure analytique, l’écriture sans doute aussi faut-il ici ajouter, ce dont ce beau livre cherche à rendre compte.
François Richard est psychanalyste, membre formateur de la Société Psychanalytique de Paris, Professeur émérite à l’Université Paris Cité Sorbonne.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Andreas Salome L. (1980). Anal et sexuel. L’amour du narcissisme. Paris, Gallimard.
Angot C. (2015). Un amour impossible. Paris, Flammarion.
Compagnon A. (1979). La seconde main ou le travail de la citation. Paris, Seuil.
Gensel G. (2014). Secrets de Polichinelle. Penser/rêver 25.
Gensel G. (2017). Neuf lettres sur la dissonance sexuelle. Paris, Gallimard.
Gribinski M. (2009). Les scènes indésirables. Paris, L’Olivier.
Freud S. (1900a/1967). L’interprétation des rêves, Paris, Puf.
Freud S. (1905d/1987). Trois essais sur la théorie sexuelle. Paris, Gallimard.
Freud S. (1910c/1993). Un souvenir de Léonard de Vinci. OCF.P, X : 83-164. Paris, Puf.
Freud S. (1931b/1995), De la sexualité féminine. OCF.P, XX. Paris, Puf.
Phillips A. (2009). Trois capacités négatives. Paris, L’Olivier.
Platon (1960). Le Banquet. Œuvres complètes 1. Paris, Gallimard, « La Pléiade ».
Winnicott D.W. (2000). L’Usage du mot usage. La crainte de l’effondrement et autres situations cliniques. Paris, Gallimard.
Yourcenar M. (1971). Alexis ou le traité du vain combat. Paris, Gallimard.
[1] Les citations ont été traduites pour cette note de lecture. Étant donné que l’auteur cite de nombreux travaux et afin de simplifier la lecture, nous proposons la page correspondante dans l’ouvrage et non la pagination initiale de chaque ouvrage cité.
Michel Granek, Le complexe de Josiane, Nouvelles psychanalytiques. Paris, Penta, « Psychanalyse, art et civilisation ».

Avec la publication du Complexe de Josiane, Nouvelles psychanalytiques, Michel Granek s’inscrit dans le sillon des psychanalystes écrivains que sont Didier Anzieu avec Contes à rebours, Michel de M’Uzan et ses Short stories. Je pense aussi à Jean-Bertrand Pontalis, auteur de Loin, de l’Amour des commencements et d’autresécrits que j’ai lus avec délice. C’est surtout Fenêtres que j’ai en tête, car il y a dans la série des petits récits de cet ouvrage un subtil mélange entre une quotidienneté racontée à la Georges Perec, une grande sensibilité et une réflexion sur le travail du psychanalyste teintée souvent d’humour, d’une certaine mélancolie, mélange que je retrouve dans les trois nouvelles que publie M. Granek. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas pour rien que M. Granek a été responsable de la traduction et de l’édition en hébreu de Fenêtres ! L’amitié entretenue par les deux hommes a aussi conduit à la traduction et l’édition du Vocabulaire de psychanalyse (J. Laplanche et J.-B. Pontalis).
Michel Granek est psychiatre, psychanalyste en Israël. Il est auteur de nombreux articles. Je pense en particulier à : « Passeurs du passé, relève de l’impassé » (Granek, 2014) et « Histoire de faussaire » (Granek, 2015) où, aussi bien dans l’un comme dans l’autre, il montre, entre autres, une fine analyse de son contre-transfert.
Mais revenons à Le complexe de Josiane qui est le premier livre de M. Granek, recueil donc de trois nouvelles analytiques dans lesquelles nous sommes invités à partager les affres de Josiane Laon une psychologue psychanalyste très renommée de la SPP, celles du Docteur Bourru, médecin généraliste de quartier qui a de bonnes connaissances de la psychiatrie et qui est sensible aux phénomènes inconscients, ainsi que les tourments de Jean-Paul Girard, jeune psychiatre qui débarque dans un hôpital de province et qui reconnaît, lui aussi, les phénomènes inconscients.
Récits imaginaires certes, mais dans lesquels nous sommes plongés avant tout dans le sel de l’épaisseur de la réalité des sensations, des affects tels qu’ils sont éprouvés dans la relation analytique. L’auteur décrit comment ses trois cliniciens consentent à s’exposer aux démesures du transfert de leur patient et comment en retour ils s’exposent à leur propre complexité, douleurs, se laissent atteindre contre-transférentiellement. Profondeur qui nous secoue d’autant plus que s’ajoutent l’incertitude, les errances d’une compréhension du patient qui ne se veut pas forcément agile, voire qui accepte l’échec. Ce que J.-B. Pontalis appellerait peut-être « l’humilité face à l’inconscient ».
Mais ce n’est pas tout ! M. Granek nous capture littéralement dans le dévoilement lent et minutieux d’une énigme à partir d’une série de remarques cliniques qui la constituent. Il polarise ses récits vers le dénouement de cette énigme les construisant comme de véritables histoires policières. Il utilise le modèle méthodologique de Sherlock Holmes, en fait celui de la clinique, qui a inspiré l’écrivain-médecin qu’était Conan Doyle. Le psychanalyste n’a-t-il pas quelque chose du détective ? « Nous avançons, tel le légendaire Sherlock Holmes, une loupe à la main, pour tenter de recueillir d’autres traces, d’autres indices grâce à la procédure d’investigation que Freud a inventée », écrit Serge Leclaire (1976, p. 208-209).
Aussi, ne s’agit-il surtout pas pour moi de révéler en les résumant les récits de M. Granek, mais de juste donner quelques indices à mon tour, à la fois sur ces petits polars et sur quelques trames métapsychologiques qui me semblent les traverser.
« Le complexe de Josiane », le premier récit, nous introduit dans le lieu où travaille Josiane avec le point de vue d’un patient. C’est un vieil immeuble de la rue de la Contrescarpe à Paris, la salle d’attente est petite, mais agréable, lithographies sur les murs, petite bibliothèque avec des BD. Une porte ouvre sur le bureau qui est de forme trapézoïdale. Trois murs sont recouverts par des rayons remplis de livre tandis que le quatrième est entièrement occupé par une grande baie vitrée donnant sur une cours calme où sont plantés des platanes…un bureau Louis XV placé en biais à une extrémité de la baie, des fauteuils, « l’inévitable » divan avec à sa tête un confortable fauteuil dans lequel « Josiane s’abandonnait à son attention flottante »… L’entrée en scène de la psychanalyste se fait véritablement là dans son fauteuil situé dans ce décor à la Perec. Mais nous voici maintenant en présence du patient : Olivier Leroi en analyse depuis six mois, dont les parents sont aussi analystes, et qui depuis toujours souhaite être analyste. Olivier est brillant, très intuitif, il a une vie fantasmatique très riche, et il a toutes les qualités pour faire une analyse et pourtant Josiane a hésité à le prendre en analyse. « Son instinct lui disait de s’en écarter, sa curiosité de s’en approcher. » En vain, Josiane essaye de préciser son hésitation, l’inquiétante étrangeté est présente d’emblée et va durer, perdurer… Elle prend finalement Olivier en analyse subissant une sorte de contrainte intérieure. Celui-ci la fait voyager, naviguer, son analyse serait comme une nef, pourquoi pas celle des fous ? Josiane se laisse entraîner, prenant du plaisir, trop de plaisir à le suivre dans les méandres de ses associations, sidérée et embarquée dans le tourbillonnement provoqué par Olivier. Plus l’analyse avance et plus Josiane se demande si cette dérive flottante ne masque pas une crypte voilée/dévoilée par son patient. Au trouble très présent que provoque Olivier pour son analyste s’associe alors la fascination d’Olivier pour l’un de ses patients à lui : celui-ci a été adopté par un couple de parents juifs rescapés d’Auschwitz, la mère ayant été stérilisée par Mengele et le père ayant attrapé la poliomyélite pendant la guerre. Séance après séance, Olivier cherche à revivre l’enfance de son patient, avant et après l’adoption et bute, achoppe. Aussi bien alors : « Séance après séance, Josiane souffrait. Elle vivait le discours d’Olivier, ses questions répétées sur le comment et le pourquoi d’une adoption, comme une attaque vicieuse, un acharnement diabolique contre elle. » Son contre-transfert devient insupportable, « ce n’était plus un contre-transfert, c’était son vécu, c’était elle ». Dans les éprouvés liés au contre-transfert s’infiltre une réalité, il y aurait un « vécu ». Que peut cacher/révéler cette histoire d’adoption ?
Voici les premiers indices et la première question qui nous ficellent ! Je laisse le lecteur aller à la découverte de la suite du récit pour noter quelques fils métapsychologiques que ce récit a évoqués chez moi.
L’auteur psychanalyste raconte une cure conduite par une femme, il s’amuse sans doute à s’identifier à une femme. Josiane relit l’Odyssée, Olivier serait-il Ulysse ? (Quant à M. Granek, il vient d’écrire un article intitulé « Œdipe et Ulysse, Freud et Kohut » !) En même temps nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que M. Granek est aussi le patient lui-même. Nous sommes pris dans les tourments de l’un et de l’autre, dans une sorte de flottement identitaire et d’inquiétante étrangeté. Me sont alors venues ces questions : qu’est-ce qui peut rendre ce patient aussi proche et étrange chez cette analyste ? Qu’est-ce qui plonge la lectrice que je suis dans cet état ?
La question d’une adoption qui ébranle Josiane et fascine son patient constitue aussi la trame d’une réflexion latente sur le contre-transfert maternel du psychanalyste et ce qu’il implique de réactualisation d’un passé qui peut être « impassé » (Granek, 2014), de traces transgénérationnelles qui peuvent se mettre à suinter des restes d’expériences traumatiques.
De son côté, Olivier rêve… un rêve qui le conduit dans le bureau de sa mère ! Ses associations nous orientent vers un livre donné par son père Le cheval sans tête qui est l’histoire d’une bande de gosses qui joue avec un cheval à roulettes sans tête. Les gosses se trouvent aux prises avec une bande de malfaiteurs qui cachent leur magot dans le ventre du cheval… ce qui conduit Olivier au Cheval de Troie et le ramène à Ulysse dissimulé dans le cheval… et dans le bureau du rêve qui devient alors celui de son père… ses souvenirs à ce sujet… pour conclure : « Bon, alors ma mère, évidemment, c’est vous… » Dans le bureau du père où se trouve sa mère, Olivier rentre, caché dans le Cheval de Troie, et tente de s’approprier « sa mère qui est son analyste »…
Dans le second récit, nous retrouvons le Docteur Bourru rencontré précédemment, car il est le médecin généraliste de Josiane. Celui-ci n’a rien de bourru, brave homme 65 ans, il est installé depuis un bon bout de temps dans le quartier dont il a vu la population changer. Il apparaît très à l’écoute de ses patients qui peuvent lui raconter leurs petits secrets. Le voilà en train de monter péniblement les escaliers pour aller revoir Annie Olson et pensant qu’il va buter sur un problème aussi tordu que la cage de cet escalier ! En effet, il y a trois mois, se trouvant dans l’immeuble où il venait de voir un patient du 6e étage, il a été interpellé par une voisine d’Annie Olson, car, pendant qu’elles discutaient ensemble, Annie Olson est « tombée dans un sommeil bizarre ». Après examen minutieux de l’état de la patiente qui est une belle jeune femme blonde de type nordique, à contrecœur il décide de l’envoyer à l’hôpital, mais voici qu’elle se réveille « fraîche comme un gardon ». Le bilan, aussi bien que l’examen neurologique, le scanner et l’électro-encéphalogramme n’apporteront rien. Annie revient à la consultation du docteur Bourru, car elle a rencontré un nouveau problème. Nous voici alors pris avec Bourru dans le travail fin, lent et minutieux de la recherche clinique, de la recherche anamnestique pour tenter de comprendre ce que sont les symptômes, leurs sens. M. Granek rapproche « Bourru » de « Bourrel » le fameux inspecteur de la série télévisée Les cinq dernières minutes, qui, lorsqu’il a résolu l’énigme, s’écrie : « Bon Dieu, mais c’est bien sûr ! » Ce qui n’est pas tout à fait le cas de Bourru qui se montre plus modeste lors de la résolution de l’intrigue. Bourru est de plus quelque peu embarrassé par l’attirance sexuelle qu’il éprouve pour Annie Olson ce qui rend plus difficiles les prescriptions thérapeutiques qu’il propose. Va-t-il arriver à envoyer sa patiente chez Charron, psychologue clinicien, hypnotiseur ? Le sentiment de jalousie qui s’associe et qu’il repère lui rappelle un souvenir d’enfance lorsqu’il avait 12 ans. Il était tombé amoureux d’une grande de 16 ans qui l’avait séduit et fait découvrir les premiers plaisirs de la vie sexuelle. Mais le surlendemain, la cherchant, il l’avait trouvée au lit avec un grand de 16 ans. Impossibles amours comme ceux d’Annie Hall et d’Alvy Singer dans le film de Woody Allen… Le docteur Bourru n’est pas un psychanalyste, mais comme un psychanalyste il écoute son contre-transfert, associe, se souvient.
À nouveau, M. Granek nous fait partager la finesse de travail de recherche d’un clinicien, nous prend dans les mailles de son désir de savoir, désir pris lui-même dans ses désirs sexuels à sublimer.
« L’immortel », la troisième nouvelle, met en scène un jeune et brillant psychiatre lassé de la vie parisienne qui, grâce à son excellent CV et du piston, peut aller travailler dans un service de province. Le premier dossier que Jean-Paul Girard lit le rend extrêmement curieux d’un patient nommé Blaise Beaugendre. Il va à sa rencontre (le contre-transfert précède le transfert ?) et le trouve comme indiqué par la surveillante du service en train de faire son jogging. « C’était l’hiver, les platanes étaient dénudés, mais ils reprenaient vie sous les rayons du soleil étonnant pour la saison. Au loin, sur une allée, un peu à contre-jour, Jean-Paul vit un petit vieux qui trottinait dans sa direction, une crinière blanche de prophète de film américain tressautant doucement à chaque petite foulée. Jean-Paul s’assit sur un banc sur le trajet de son patient et attendit qu’il arrivât à sa hauteur. » Jean-Paul va être décontenancé par ce patient, ne sachant pas toujours qui examine qui ? Va durer ainsi chez lui une impression de joute silencieuse. Nous apprenons que Blaise Beaugendre a organisé un délire et son existence à partir du syllogisme bien connu : « Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme. » Si les deux prémisses ne posent pas de problème, la conclusion par contre en pose un, car elle est la suivante : « donc Socrate est immortel. » Quel diagnostic porter ? En dehors de la question du diagnostic et des difficultés à comprendre cet homme qui fait tout « pour baisser la probabilité de sa mort », ce récit prend une allure plus philosophique que les autres. Il traite de l’intimité complexe entre la vie et la mort. Si Blaise Beaugendre accepte la mort qui nous tombe dessus avec la guerre, la maladie, l’accident, il refuse (voire dénie) celle de l’usure, de l’entropie, ce qui le conduit à une forme de vie bien particulière : la vie asilaire. Progressivement Jean-Paul abandonne ses visées thérapeutiques pour se « promener intellectuellement » avec Blaise à travers la Psychiatrie, l’Histoire, la Philosophie, la Vie et la Mort. Il n’essaye plus de convaincre son patient qui dépense une énergie folle à ne pas mourir… Mais voilà qu’un accident de voiture bouleverse leurs promenades. Comme Josiane et Olivier, Blaise va se questionner sur le devenir d’un enfant…
Pour conclure, il faut absolument lire cet ouvrage parce qu’il passionne comme trois romans policiers aux allures à la fois romantiques et modernes, mais aussi parce qu’il est une véritable leçon de psychanalyse. Il montre avec simplicité comment un clinicien recherche pas à pas des indices et les découvre, comment en effeuillant chacun d’eux avec minutie et délicatesse il fait advenir avec la complicité du patient quelques-uns des mystères qu’ils contiennent, comment le sens émerge alors dans les lenteurs du cheminement transféro-contre-transférentiel. Ces petits récits racontent aussi comment un psychanalyste peut travailler sur son contre-transfert et s’en trouver désemparé sans pourtant lâcher la recherche d’une vérité toujours à advenir.
Dominique Cupa est membre de la SPP et de l’Institut de Psychosomatique de Paris, Professeure émérite de psychopathologie psychanalytique de l’Université de Nanterre, chef de service honoraire de l’Unité de psychosomatique, AURA, Hôpital St Joseph, Paris.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Granek M. (2014). Passeurs du passé, relève de l’impassé. Rev fr Psychanal 78(5) : 1703-1709.
Granek. (2015). Histoire de faussaire. Rev fr Psychanal 79(1) : 132-143.
Leclaire S. (1976). Fragments d’une langue d’avant Babel. Nouv Rev psychanal 14.
Roger Perron, En scène au psychodrame, Toulouse, Éres, 2018
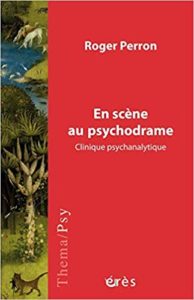
Dans un style très clair vivant et pédagogique, l’auteur nous donne les principes fondamentaux du psychodrame psychanalytique et nous livre une théorie originale. Le livre est construit comme une pièce de théâtre. Il est divisé en quatre grands chapitres : demander le programme, en scène, drame, les coulisses et la troupe.
De nombreux exemples cliniques montrent l’intérêt du psychodrame pour des patients atteints de fonctionnement limite, psychotiques ou névrotiques. Ceux-ci sont très souvent dans l’agir ou dans une difficulté importante à associer librement et à penser. Ces patients ont pour la plupart un clivage du moi, une forte destructivité, des failles de symbolisation et un transfert de type narcissique. Tout le long de ce livre, la position de l’auteur est avant tout celle d’un psychanalyste et la méthode utilisée au psychodrame est psychanalytique. Roger Perron témoigne du plaisir à jouer ainsi que celui des co-thérapeutes. Ce plaisir finit par contaminer les patients et les amène ainsi à sortir d’une répétition mortifère. À travers de nombreux exemples cliniques, l’auteur nous montre comment le psychodrame arrive à sortir les patients des impasses dans lesquelles ceux-ci se sont enfermés.
Il arrive, parfois, que des patients sortent du jeu en disant « ma mère n’est pas comme ça ». Ils sont, en effet, totalement collés au réel qui ne comporte qu’une seule version. L’assouplissement du mode d’accrochage au réel permet d’admettre qu’il est possible d’avoir plusieurs images de son histoire. « C’est un des bénéfices majeurs du psychodrame », écrit l’auteur, « voir autrement c’est voir plus et mieux ».
Certains patients confondent la personne et le personnage joué par le thérapeute. Ainsi, dans un psychodrame, une patiente qui choisissait toujours la même thérapeute pour jouer sa mère rétorque, en l’absence de celle-ci « je ne peux pas jouer avec ma mère puisqu’elle n’est pas là ».
Quand un patient accepte de jouer un autre rôle que le sien, c’est un tournant dans la cure. L’auteur écrit : « Jouer un autre rôle que le sien permet aux patients une possibilité de distanciation par rapport aux imagos ouvrant la voie à une certaine forme de deuil et de séparation consécutive à l’organisation des imagos en leur altérité et donc à une mobilisation des identifications. »
Le psychodrame et la fonction symbolique
On peut considérer que les patients qui relèvent du psychodrame n’ont pas suffisamment accès à la dimension symbolique. Leur monde est plat, en quelque sorte. Une chose est une chose et rien de plus. Mais en accédant à un espace de jeu, ils commencent à rencontrer le registre symbolique. Quand ils jouent leur père, ils se rendent compte que, dans le jeu, ils sont et ne sont pas leur père.
Ainsi, on peut changer le passé, celui qu’on s’est construit dans la tête. La plupart des patients finissent par se construire plusieurs versions de leur passé. Joyce McDougall aimait à dire : « Il n’est jamais trop tard pour avoir une belle enfance. »
Le langage devient progressivement polysémique. Lorsqu’on parle, on dit toujours plus et autre chose que ce qu’on voudrait dire. « La psychanalyse entend d’autres sens possibles et propose aux patients d’y réfléchir. Ils y gagneront en liberté » (Perron, p. 8).
Le temps du jeu est toujours celui du présent, comme dans les rêves. Il s’agit d’actualiser le passé et de le revivre au présent. Le mode utilisé dans le jeu, lui, est le conditionnel : « On dirait que je suis le marchand. » C’est tout le monde du jeu infantile qui réapparaît ainsi.
Le psychodrame et le transfert
L’auteur insiste sur le processus du transfert qui est le moteur de la cure dans le psychodrame. En effet, c’est un transfert singulier puisque celui-ci est éclaté sur autant de thérapeutes acteurs. Ce n’est que dans un deuxième temps que ce transfert dispersé se rassemble sur la personne du meneur de jeu.
Le psychodrame et le transfert
La question de l’interprétation est aussi posée.
« L’interprétation au psychodrame, part de ce qui est donné à voir pour déboucher sur ce qui est donné à comprendre » (p. 131). Il y a deux temps distincts dans l’interprétation. Dans un premier temps, c’est le jeu des thérapeutes-acteurs qui a valeur interprétative et, dans un second temps, c’est le meneur de jeu qui propose une interprétation après le jeu.
Il est inévitable que le thérapeute-acteur fonctionne de façon projective. D’où la nécessité d’avoir fait une psychanalyse personnelle pour être au clair avec ses conflits inconscients.
Le patient, lui, opère des identifications projectives que le thérapeute se doit d’accueillir et de transformer avant de les lui restituer.
Le psychodrame et le traumatisme
Le psychodrame crée toujours, plus ou moins, une situation traumatique pour le patient en le confrontant à ses conflits et à ses fantasmes. Il y a une reviviscence des traumatismes anciens, avec un effet cathartique et un effet élaboratif. La catharsis est un procédé qui interviendrait le plus souvent chez des patients psychotiques ou états-limites, alors que l’élaboration se verrait davantage chez les névrosés.
Le psychodrame et le fantasme
La question du fantasme est centrale chez l’auteur : « Tout fantasme est centré sur une représentation d’action. » C’est la thèse que Michèle et Roger Perron avaient présentée, en 1986, lors du Congrès de Psychanalyse de Langue Française. Celle-ci soutient encore aujourd’hui les propos de l’auteur.
En effet, Roger Perron reprend, dans son livre, que la structure fondamentale du fantasme est ternaire :
1. – un sujet agent de l’action
2. – une représentation d’action qui en constitue le cœur et le pivot
3. – un objet de l’action
« Il s’agit d’une structure de transformation caractérisée par la vicariance des agents, la vicariance des objets et les retournements de la représentation d’action » (p. 85).
Ainsi lorsque nous suggérons aux patients de reprendre une scène en inversant les rôles, lorsque nous introduisons une variante quant aux personnages, lorsque, au cours de la scène, un acteur-thérapeute se mue de professeur en père ou d’adulte en enfant, lorsqu’il inverse l’affect joué d’amour en haine, nous invitons le patient au jeu des transformations.
Ce que nous donnons à voir, au patient et à nous-mêmes, ce sont des « figurations d’actions ». Elles procèdent des représentations au sens de processus psychique interne. Tout le travail de transformations que le jeu psychodramatique sollicite du patient vise ainsi à animer en lui le « métabolisme des représentations ».
Travaillant à partir de ces représentations particulières, que sont les représentations d’actions, le psychodrame est donc bien en prise directe sur le fantasme.
Le progrès de la cure se marque à la souplesse croissante des transformations possibles, à une meilleure mobilité des représentations, des affects et du plaisir à jouer que prennent le patient et les thérapeutes avec lui. « Il s’agit alors d’un travail de subjectivation au cours de la reprise évolutive à laquelle nous convions le patient. À partir d’une image de soi et d’images d’autrui rigidement figées, le psychodrame est un exercice d’assouplissement des représentations de soi et d’autrui » (p. 86). Ce qui est remanié, du personnage à l’objet, via la personne, c’est donc toute la dimension des relations du sujet et de ses objets, internes et externes.
L’auteur pointe toute l’importance des figurations d’actions.
Le psychodrame travaille à partir de figurations d’actions qui procèdent de représentations. « Tout le travail de transformation au psychodrame vise à animer chez le patient le jeu des représentations. »
Le psychodrame et le préconscient
L’auteur insiste, à juste titre, sur l’importance du préconscient.
Au psychodrame, nous assistons à un dialogue des préconscients. Le jeu se développe par interaction des processus identificatoires des protagonistes. Le préconscient a une place essentielle dans le psychodrame. Souvent le préconscient, chez nos patients, n’est pas fonctionnel. Les représentations n’arrivent pas à franchir la censure entre le préconscient et le conscient et ainsi les représentations restent inaccessibles. Parfois même la représentation de mot n’existe pas. C’est l’investissement des figurations d’action via le transfert sur le meneur de jeu qui va créer de nouvelles représentations. Puis les mots stabilisent les représentations. Le jeu permet une plus grande mobilité et un plus grand assouplissement des représentations.
Condensation et déplacement
En effet cette mobilité survient quand on arrive à réduire le processus de la condensation au profit du déplacement des représentations, car trop de condensation aboutit à figer les représentations. Cela amène à un niveau élevé de libido qui empêche de penser. C’est la qualité de la libido qui est souvent particulière. Elle est caractérisée par Freud comme visqueuse (Freud, 1905d/2006, p. 180) et empêche la mobilité des représentations.
On peut considérer le préconscient comme un réservoir de représentations de différentes époques plus ou moins liées entre elles et plus ou moins prêtes à effleurer le conscient. Ces représentations consistent en une évocation de perceptions. Ces perceptions et leur évocation sous forme de représentation sont toujours accompagnées d’affects plus ou moins précis plus ou moins agréables.
Dans les cas pathologiques que nous rencontrons au psychodrame, des représentations de mots peuvent perdre leurs composantes affectives et symboliques et ne gardent que la valeur de représentation de choses. Les représentations se montrent limitées et superficielles, elles reproduisent directement des perceptions vécues de la réalité. Ces représentations sont peu sujettes à des associations d’idées. Elles fonctionnent comme de simples témoins d’événements enregistrés. La vie mentale de ces patients apparaît peu complexe. « Ces représentations de mots, limitées et superficielles, régressent à des représentations de choses et limitent l’accès à la fonction symbolique. À l’extrême, elles produisent des névroses mal mentalisées ou des névroses de comportement », écrit Pierre Marty (1990, p. 41). La fluidité de la circulation préconsciente permet de créer des associations entre les liaisons transversales et les liaisons longitudinales des représentations. Les insuffisances de connotations affectives, les insuffisances quantitatives et qualitatives des représentations aboutissent à créer des lacunes dans l’organisation préconsciente. « Ces insuffisances sont le plus souvent dues aux excès ou aux carences affectives de la mère. Ces lacunes provoquent une impossibilité de se remémorer toute une période de sa vie » (ibid., p. 45).
Dans son livre, Roger Perron nous communique son plaisir de jouer et de faire du psychodrame. Ainsi, le pari du livre est gagné. L’auteur se montre particulièrement optimiste dans l’aboutissement du changement pour ces patients : « La cure progresse dans la mesure où les représentations se modifient, concurremment au jeu des affects qui leur sont liés. La visée est d’instituer, de réinstituer de la polysémie là où il n’y avait que la pseudo-évidence du sens unique. »
Isaac Salem est psychanalyste (SPP), membre titulaire formateur, fondateur du Centre de Traitement par le Psychodrame (ETAP).
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Freud S. (1905d/2006). Trois essais sur la théorie sexuelle. OCF.P, VI. Paris, Puf.
Marty P. (1990). La psychosomatique de l’adulte. Paris, Puf.
Perron R. (2018). En scène au psychodrame. Toulouse, Érès.
[1] Perron Roger (2018). En scène dans le psychodrame. Toulouse, Éres, 2018.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Laurence Kahn, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, Paris, Puf, « Petite Bibliothèque de psychanalyse », 2018 .
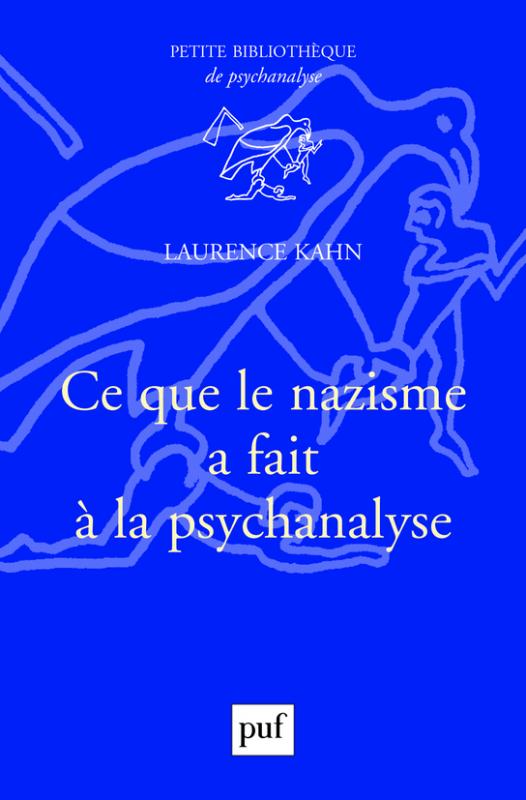
En m’attelant à l’écriture de cette note de lecture, je me suis senti comme le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges:pour rendre justice à l’ouvrage de Laurence Kahn, dans lequel chaque mot, chaque phrase semble indispensable, j’aurais voulu le citer… in extenso ! C’est que Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse est un livre passionnant, mais ardu, doublement ardu. Ardu tout d’abord parce que Laurence Kahn, citant souvent des témoins et des théoriciens de la Shoah nous plonge dans l’univers nazi, dans l’univers d’Auschwitz. Et si l’on désirait s’accrocher à la conception illusoire selon laquelle Auschwitz est un événement certes monstrueux, mais un accident, un déraillement dans l’histoire de l’humanité, elle nous montre, avec Imre Kertész, que si événement il y a eu, c’est un événement qui a mis un terme à la culture d’avant la Shoah, un événement inexorablement fondateur d’une nouvelle culture, ce qui concerne également la culture psychanalytique. Ardu également par la masse de documents que l’auteure apporte dans son impitoyable et rigoureuse argumentation. En effet, elle ne se contente pas de nombreuses citations, de phrases percutantes qui prennent parfois valeur de quasi-aphorismes, mais surtout, elle apporte une étude à la fois étendue et en profondeur d’ouvrages concernant d’un côté l’instauration de la culture nazie – de la contre-culture nazie – en Allemagne hitlérienne, les répercussions de cette culture sur la psychanalyse dans le Troisième Reich et en Europe, et concernant de l’autre les avatars de la psychanalyse transplantée, essentiellement aux États-Unis ; en particulier, elle analyse le développement outre-Atlantique de toute une littérature sur la Shoah et de son engagement vers des conceptions particulières sur le trauma de la Shoah en rupture avec le modèle freudien du trauma… j’y reviendrai.
Dans un entretien à Libération (mai 2018), Laurence Kahn explique pourquoi elle a choisi le titre Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse : « Parce que Nazisme et psychanalyse aurait débouché sur une histoire des instituts psychanalytiques et des psychanalystes durant la période nazie. » Et de fait on a beaucoup écrit sur les conséquences de la politique d’aryanisation sur la psychanalyse austro-allemande, la création de l’institut Göring, l’épuration des instituts de psychanalyse de leurs membres juifs et leur émigration massive vers la Grande-Bretagne et l’Amérique, surtout les États-Unis, ce qui a entraîné un bouleversement des forces psychanalytiques en présence, et un remaniement de la politique de la psychanalyse. Mais bien qu’elle rappelle nécessairement ces mouvements géopsychanalytiques, le propos de Laurence Kahn est bien différent, et bien plus troublant : elle démontre comment la rhétorique nazie, La langue du IIIe Reich (Klemperer), s’appuyant sur des théories pseudo-scientifiques biologisantes, a eu comme conséquence surprenante de modifier l’esprit même de la psychanalyse et sa théorisation : en effet, les psychanalystes expatriés, en cherchant à sauver la psychanalyse de la pervertisation nazie, ont paradoxalement contribué à cette véritable métamorphose de la psychanalyse, en arrivant même à sacrifier la métapsychologie.
Dans ses premiers chapitres, ce livre semble être la suite de son précédent, à tel point qu’on aurait pu proposer de l’intituler Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, tome 2, sous peine, en éliminant le triste vocable « nazi », de se faire taxer de négationniste. En effet, comme Laurence Kahn le précise également dans l’entretien à Libération, quand on demande ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, c’est sur l’usage des mots qu’il faut premièrement se pencher. Dans leur délire mégalomane de créer un nouveau mythe, les nazis emploient des termes du vocabulaire psychanalytique, pulsion, pulsion d’auto-conservation, inconscient etc., mais leur donnent une acception toute différente. Quand des analystes de langue allemande transplantés aux États-Unis, à l’instar de Hartmann, essaient de lutter contre la pervertisation de la langue, d’affermir une éthique contre la création autocratique de la néoréalité nazie, ils élaborent de fait « […] une théorie de la vie psychique où la préséance du moi, ses facultés de juger le réel et sa relative autonomie libidinale permettraient à la conscience de se dégager de la psychose de masse » (p. 17), et du coup se démarquent considérablement de la théorie freudienne : c’est l’avènement de l’Ego-psychologie, de la psychologie du moi que sans la défendre, Laurence Kahn semble non pas condamner, mais excuser en fonction des circonstances ; elle admet que « la difficulté d’envisager l’Extermination », la difficulté du « report au passé du réel actuel s’incarnant dans le transfert » (p. 27) aient pu favoriser la tendance aux histoires de vie et à leur narration. Mais poursuivant son argumentation elle avance que « Référer les subjectivités à l’objectivité des faits ou restaurer le vécu grâce au récit apparaissent plutôt comme des résurgences de ce qui a fracturé l’univers des analystes » (ibid.), fracture qui amènera l’avènement de l’Ego-Psychology et la promotion de l’empathie comme outil thérapeutique majeur.
Le chapitre La loi hors la loi, qui, bien que se rapportant exclusivement à la politique nazie et à ses exactions, à leur justification par les théoriciens du nazisme, m’a particulièrement troublé, car ses assertions semblent vraies, trop vraies, aujourd’hui, un peu partout dans le monde ; en effet, quand Laurence Kahn rappelle, en citant le juriste Hans Kelsen, que l’ordre juridique est censé s’appuyer sur la rigoureuse neutralité du rapport de la loi à son objet, et comment les autorités nazies, élues démocratiquement, ont démocratiquement mis la loi hors la loi en l’asservissant à leur idéologie[1], elle décrit des procédés qui sont malheureusement d’actualité dans des pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie. Et quand affirmant avec Kertész, qu’« il s’est avéré que le meurtre constitue un mode de vie vivable et possible, donc institutionnalisable[2] » (Kertész, 2009, p. 127, in Kahn, p. 29), il semble que, bien que ce dernier ait parlé spécifiquement de l’après-Auschwitz, il s’agisse en fait d’une phrase toujours et tristement d’actualité en 2018 : le lecteur pourra faire son choix, tout à sa guise, et se tourner vers telle région du monde, tel gouvernement, telle idéologie militante, pour y trouver une indéniable application.
Freud a écrit le Moïse avec en toile de fond « la retombée [du peuple allemand] dans une barbarie quasi préhistorique » (Freud, 1939a, p. 132) ; Freud, l’auteure le rappelle, désigne Moïse par le terme Führer, vocable banal en allemand pour qualifier un chef, un guide, un meneur. Toutefois, le terme, pour un non germanophone, a de lugubres résonances, surtout et a posteriori, quand on connaît les actions prônées par ce chef, l’extermination de masse, programmée, revendiquée, industrialisée, allant bien au-delà d’une « barbarie préhistorique ». Le halo sémantique que le terme a pu prendre dans la rhétorique nazie est, lui aussi, porteur de connotations sinistres : les théoriciens de l’ordre nouveau ont en effet revendiqué l’anéantissement des obligations éthiques, amenant à l’effondrement des figures de la culpabilité ; « […] le chef n’est plus un représentant institutionnel. Sa volonté politique est réalisation du ‟droit immanent, propre aux ordres vitaux et communautaires qui soutiennent l’Etatˮ » (Schmitt, 1934, in Kahn, ibid.,p. 44-45), et finalement quand le führer affirme « [l]’état total ne tolérera aucune différence entre droit et morale » (ibid., p. 50), il proclame la destruction en acte de l’autonomie du droit.
On sait que Freud, dans la 35e des Nouvelles Leçons,posa la question de savoir si la psychanalyse est une Weltanschauung[3], une vision du monde, ce qu’il récuse formellement : « [la psychanalyse] est absolument impropre à former une vision du monde qui lui soit propre, il lui faut admettre celle de la science » (Freud, 1933a, p. 242). Avec des accents prophétiques, il affirme même qu’introduire des illusions, des motions de souhait, dans une vision du monde conduirait à la psychose, individuelle ou de masse. Et à la fin de la leçon, il revient sur son affirmation : « La psychanalyse, selon moi, est incapable de créer une vision du monde qui lui soit particulière » (ibid., p. 267). Dans les chapitres 5, 6, et 7, Laurence Kahn montre comment « sous le masque convenable de son nom officiel, ‟psychanalyse et Weltanschauungˮ, on assiste sans doute à l’un des épisodes les plus redoutables de ce que le nazisme a réussi à faire à la psychanalyse » (p. 91). Elle nous fait revivre un débat d’une importance cruciale, débat dont les arguments sont souvent contradictoires, en fonction de ce qu’ils cherchent à affirmer, ou à prouver, et qui ne manquent pas, là aussi, de pervertir la pensée ou les écrits freudiens ; elle nous montre bien comment les textes étant produits ad hoc pour servir un but précis à un moment donné, il en résulte un enchevêtrement assez inextricable. Parfois, il s’agit d’affirmer l’indépendance de la psychanalyse par rapport à toute idéologie, parfois au contraire de montrer que si la psychanalyse a des valeurs, ou même des normes implicites, celles-ci ne vont pas nécessairement à l’encontre de l’idéologie nazie ; voire même, la psychanalyse peut contribuer « au renforcement de la tâche de la communauté du peuple unie par le sol et par le sacrifice, si son énergie naturelle est organiquement canalisée grâce à la nouvelle Weltanschauung » (p. 117). Il est remarquable qu’entre 1930 et 1933, quatre textes paraissent sous le titre de « Psychanalyse et Weltanschauung », y compris celui de Freud. Mais à ceux-là, on peut ajouter un texte de Bernfeld publié en 1927-1928, « La psychanalyse est-elle une vision du monde », et un chapitre de Mathias Göring en 1939, Weltanschauung et psychothérapie. Ainsi quand il s’agit, avec le soutien de Freud, de démarquer clairement la psychanalyse de conceptions matérialistes (sous-entendu marxistes), et de contrer les psychanalystes de gauche (Bernfeld, Fenichel, Reich…), la psychanalyse n’est pas une vision du monde. Elle ne l’est pas non plus quand il s’agit de décider que les psychanalystes aryens n’ont pas à démissionner de leurs sociétés. La position est plus nuancée quand les nazis souhaitent obtenir une reconnaissance internationale, même d’une « cochonnerie juive marxiste ». Alors, épurée toutefois de ses membres juifs, proposant à ses étudiants un cursus concocté par Carl Müller-Braunschweig, qui comprend « l’étude de l’unité ‟âme-corpsˮ, la théorie de l’hérédité et de la race, […] et quelques conférences sur l’‟entretien du patrimoine héréditaireˮ et la ‟psychologie des racesˮ » (p. 113), la psychanalyse peut procéder d’une vision du monde favorable à l’idéologie nazie.
Le rôle de ce même Müller-Braunschweig, auteur de deux de ces textes sur Psychanalyse et Weltanschauung que l’auteure détaille remarquablement, ne peut que laisser perplexe ; membre de l’institut psychanalytique de Berlin, semblant au départ un freudien classique, il devient avec Felix Boehm un artisan du prétendu « sauvetage de la psychanalyse » auquel Jones donnera son aval : afin de ne pas donner aux nazis un prétexte pour interdire la psychanalyse, les juifs sont exclus de Société psychanalytique allemande – DPG –, en les contraignant à démissionner « volontairement ». Il sera un éminent collaborateur nazi de l’institut Göring, mais au lendemain de la guerre, alors que la DPG était exclue de l’API à la suite de sa position dans le IIIe Reich, lui-même fondera l’Association Psychanalytique allemande – DPV – et réussira le tour de force incompréhensible d’obtenir son intégration au sein de l’API en 1951.
C’est contre cette dénaturation, cette pervertisation de la psychanalyse que va s’élever Heinz Hartmann. Lui-même auteur du quatrième texte « Psychanalyse et Weltanschauung » paru en 1933, il réitère le refus de Freud d’inscrire l’analyse dans une conception du monde, et plus précisément une orientation politique quelconque ; préoccupé de contrer la pensée biologisante des Nazis, il cherche à libérer le moi de ses bases pulsionnelles, à affirmer une zone affranchie de l’asservissement au ça, il provoque, en pratique – de fait en théorie et c’est que là réside le problème – la bascule de la psychanalyse vers ce qui caractérisera la psychanalyse américaine dans son ensemble, dans ses divers courants, psychologie du moi, psychologie du soi etc. : minimisation du pulsionnel, maximation du moi ou du soi, rôle thérapeutique prépondérant à l’empathie. L’analyse de Laurence Kahn est tout à fait pénétrante : « La question qui hante alors Hartmann est que la différenciation ça/moi-surmoi, du fait même de l’enracinement infantile du surmoi – et la référence à Freud est, là, solide – peut à tout moment déboucher sur des phénomènes de ‟dédifférenciation‟. On assiste alors à des formes d’adaptation à la réalité parfaitement régressives, conduites par des affects et des jugements de la réalité qui se placent au service de la destruction – Hartmann renvoyant à ‟l’agression libreˮ reliée à la pulsion de mort par Freud. Le statut de la conscience et la stabilité du moi, conditions de la pensée, doivent donc être reconsidérés à l’aune de la relation entre pulsion de mort et libido désexualisée dont on découvre que, d’adversaire du ça, elle peut devenir son alliée » (p. 129). Je trouve piquant que, Hartmann, niant avec force que la psychanalyse procède d’une vision du monde, propose en fait une théorie de la psychanalyse qui y réponde, même si par la négative. L’aveu de Laurence Kahn le souligne : « Au moment où la ‟dictature de la raisonˮ pousse à l’infléchissement théorique vers le renforcement du moi et son autonomie pulsionnelle, le désastre politique d’un nazisme triomphant pèse d’un poids que je n’avais pas auparavant soupçonné » (p. 130).
Ironie du sort ou sardonique satisfaction posthume du nazisme, la théorisation du trauma perpétré par le nazisme, le trauma de la Shoah, continue à diviser le monde psychanalytique. Dans le chapitre capital, « Trauma extrême : quel inconscient » ?, suivi de « La mère, l’enfant et l’empathie »,l’auteure critique les théoriciens reconnus de la Shoah outre-Atlantique (N. Auerhahn, D. Laub, W. Niederland, etc.) qui récusent le modèle freudien du trauma en deux temps, fondé sur le refoulement et l’après-coup. Pour eux en effet un tel trauma, massif à la fois car il touche une masse de sujets et massif par son intensité, ne peut se comprendre comme la réactivation d’un premier temps refoulé ; le refoulement lui-même est mis hors circuit ; la massivité du trauma résulte en une attaque contre les liens, une fragmentation psychique ; la psyché est « trouée » ; le sujet recourt à des souvenirs écrans, à des récits écrans, voire à un transfert écran, qui ont pour but et pour effet de masquer le trou noir. « De tels écrans ne seraient pas le produit déformé de souhaits impulsés par le désir ou le sexuel infantile [mais des] créations ultérieures, mythiques, dont la valeur de peau narcissique est essentiellement défensive » (p. 143). De plus, pour certains de ces théoriciens (Y. Danieli), le contre-transfert n’est pas conséquence de ce qui se passe en séance, réaction du thérapeute au patient, mais contre-transfert à l’Holocauste, pouvant induire une tendance à une aide spécifique qui tienne compte de l’expérience réelle des victimes. Toujours est-il que grâce à son « narratif » rencontrant l’écoute empathique du thérapeute, le sujet parviendra à des screen reenactments, ouvrant la voie, dans le dialogue, à la restauration des processus symboliques détruits. En fait Laurence Kahn montre bien comment l’avènement de l’empathie comme outil thérapeutique majeur provient pour beaucoup d’une attitude réparatrice issue de l’écoute des patients revenus des camps, ce qui ne saurait pour autant abolir la métapsychologie. Or… Et l’auteure de poser une question terrible : « Faut-il entendre que la haine vouée par la barbarie nazie à la psychanalyse aurait trouvé ici la méthode de sa réussite, ne serait-ce que sous la forme de la révocation ultérieure de la complexité pulsionnelle ? » (p. 171).
Dans Faire parler le destin Laurence Kahn se demandait si la notion de faute tragique telle que Freud l’avait héritée des Grecs, permettait encore d’appréhender le désir meurtrier inconscient, son refoulement et la culpabilité civilisatrice, et elle parlait déjà de l’effondrement de la scène tragique (Kahn, 2005, 4e de couverture). Dans l’ouvrage actuel le chapitre 10, « Liquidation de la tragédie »,reprend ce thème dans le contexte spécifique de l’impact du nazisme sur la pensée. En lisant Faire parler le destin lors de sa parution, je n’avais pas eu à l’esprit l’éventualité que ce livre dialoguait peut-être avec Être sans destin,de Kertész, mais tous deux remettent en question la notion de culpabilité telle que Freud l’avait empruntée à la tragédie grecque. De plus, si Laurence Kahn guide le lecteur à travers les méandres de l’univers psychanalytique après le nazisme, en la lisant, et en lisant les auteurs qu’elle cite – surtout Kertész –, on plonge souvent avec elle comme avec lui dans l’univers nazi, et parfois d’une manière brute, sans le filtre de la réflexion psychanalytique. L’impact peut en être terrible.
Dans une lettre à Frederick Hacker, Adorno a pu écrire : « Nous avons enfin réussi à briser le mécanisme de refoulement qui, en Allemagne et en Autriche, a continué de fonctionner à l’égard de Freud, même après la chute de Hitler » (in Le Rider, 2007, p. 103-104). Malheureusement, il semblerait que l’avenir ne lui ait pas donné raison ; à mon sens ce que le livre de Laurence Kahn démontre d’une manière terrifiante – et en cela les écrits de Kertész lui servent d’argument-massue –, c’est que si la culture d’avant Auschwitz était fondée sur le meurtre du père, celle d’après Auschwitz est fondée sur le meurtre tout court,le meurtre « non en tant que mauvaise habitude, ‟casˮ, mais en tant que mode de vie, attitude ‟naturelleˮ adoptée face à la vie et à l’autre – le meurtre comme philosophie de l’existence » (Kertész, 2009, p. 126). Mais là aussi, l’érudition de Laurence Kahn lui permet de montrer que Freud avait déjà insinué quelque chose d’approchant en affirmant « ce qui fut commencé avec le père s’achève avec la masse » (Freud, 1930a, p. 320) et elle souligne que l’oubli de cette petite phrase est « peut-être très exactement le stigmate de ce que le nazisme a fait à la psychanalyse » (p. 259).
Ce livre est de toute évidence un ouvrage incontournable en ce qui concerne les rapports du nazisme et de la psychanalyse, mais pour moi son impact va bien au-delà car les processus que Laurence Kahn met en évidence, ne sont malheureusement pas spécifiques – devrais-je dire pathognomoniques ? – du nazisme ; et il laisse le lecteur avec un profond malaise concernant la culture d’après Auschwitz, la civilisation du xxie siècle.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Freud S., (1930 a), Le malaise dans la culture, OCF-P, XVIII, 1994.
Freud S., (1933 a), Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, OCF-P, XIX, 1995.
Freud S., (1939 a), L’homme Moïse et la religion monothéiste, OCF-P, XX, 2010.
Kahn L., Faire parler le destin, Paris, Klincksieck, 2005.
Kertész I., Être sans destin, Arles, Actes Sud, 1997.
Kertész I., L’Holocauste comme culture, Arles, Actes Sud, 2009.
Le Rider J., L’Allié incommode, Paris, L’Olivier, 2007.
Kahn L., Entretien avec Virginie Bloch-Lainé, Libération, 11 mai 2018, http://www.liberation.fr/auteur/12793-virginiebloch-laine).
[1] Selon Kertész, « L’instrument de la destruction a pour nom idéologie » (2009, p. 232).
[2] Italiques dans le texte de Kertész.
[3] Selon Laurence Kahn, la traduction exacte de Weltanschauung est conception du monde, les OCF-P ont opté pour vision du monde, terme que j’emploierai dans ce qui suit.
Michel Granek est Psychiatre, psychanalyste, membre formateur de la Société Israélienne de Psychanalyse. Ancien directeur du programme de psychothérapie psychanalytique de l’Université de Tel Aviv.
François Pommier (dir.), La folie ordinaire, Paris, Éditions Campagne Première, 2018.
Introduction

« Folie ordinaire », ce titre antinomique dans ce qu’il induit d’extraordinairement normé, ou de normalement extraordinaire, engage des représentations subjectives multiples qui convoquent de près ou de loin notre rapport à la folie du quotidien, ou à la psychopathologie de la vie quotidienne pour reprendre les termes de Freud. La folie ordinaire s’inscrit dans les rapports parfois ténus entre ce qui fait norme et ce qui fait marge, dans une interdépendance subjective entre ces deux pôles : entre marge ordinaire et folie normée. Les auteurs questionnent alors ce qui fait « disruption », dans ce que nous pourrions nommer ces « moments de folie ordinaire » comme rupture de la pensée, de la temporalité, ou au contraire dans la continuité d’une pensée folle qui s’emballe avec ou contre le principe de réalité. En effet, cet ouvrage propose d’envisager la Folie ordinaire, entre culture, clinique, corps et traumatisme. En ce sens, au fil des chapitres, la folie ordinaire se décline pour envisager l’extrême jusqu’aux derniers remparts de l’activité de pensée, tant au niveau anthropologique que dans l’intime des processus psychiques. L’ouvrage se compose d’une préface écrite par Patrick Guyomard, à laquelle succèdent trois grandes parties distinctes « Anthropologie, culture et psychanalyse », « Cortèges tragiques de l’imprévu » et « Corps halluciné, corps hallucinant », chacune divisée en plusieurs chapitres.
À propos de la première partie : « Anthropologie, culture, et psychanalyse »
La première grande partie de ce livre propose plusieurs réflexions argumentées autour de la manière dont la culture, l’anthropologie et la psychanalyse permettent de penser le paradoxe qui guide cet ouvrage, entre ordinaire de la folie et folie de l’ordinaire, entre individu et société. Dans un premier temps, Roberto Aceituno nous propose une réflexion sur les subjectivités contemporaines. Ce propos s’inscrit dans la tentative freudienne d’élargir la recherche en psychopathologie vers le champ de la culture : à travers la vie collective, les dynamiques sociales et la transmission de la culture. L’auteur propose de penser la « folie ordinaire » en perspective des travaux de Freud et des enjeux de la subjectivité : entre singularité irréductible du sujet, société, institutions et cultures. La subjectivité contemporaine érigerait le savoir à la place de la vérité, économisant le travail de pensée : qu’il s’agisse de la relation du sujet à la langue, de la « non-relation » des sujets et des communautés à l’histoire ou encore de la subjectivité contemporaine en politique. La folie ordinaire dans la culture marque également les propos de M. David-Ménard qui s’intéresse à l’affaire Kant-Swedenborg. L’auteur reprend l’histoire et le parcours de vie de Swedenborg et s’intéresse à la passion de Kant pour ce savant et philosophe investi comme « un prophète de l’autre monde », questionnant de près les rapports entre folie et philosophie. Fasciné par les miracles du savant, Kant en vient alors à délaisser l’exigence de cohérence propre à la pensée philosophique pour s’engager dans les investigations des hallucinations de Swedenborg. Cette lutte entre raison et croyance pour se déprendre de l’aspiration par la folie de l’autre sera – nous dit l’auteur – au cœur même de la naissance de la philosophie critique. Ainsi, au détour de cette histoire, David-Ménard nous propose de lire la folie ordinaire à triple titre : tant au niveau de l’ordinaire de la folie de Swedenborg, qu’au niveau de la pensée de Kant lui-même entre passion et raison faisant alors de la folie, le risque ordinaire de la pensée, ou bien encore au niveau de la folie ordinaire des lecteurs de Kant. Dans un troisième chapitre, en marge de la névrose ordinaire précédemment décrite, Marion Feldman propose une lecture des effets du vécu de la folie ordinaire chez des enfants juifs cachés entre 1940-1945, et pose alors l’hypothèse d’un traumatisme blanc. Selon l’auteur, la folie ordinaire se situerait alors dans l’instauration officielle de l’exclusion d’un groupe humain en dehors de toute forme d’humanité. L’auteur aborde la question de la folie ordinaire collective au regard du bain intersubjectif entre adulte et enfant, de l’objet primaire jusqu’à la matrice de l’état elle-même sujet d’injonctions paradoxales. C’est ainsi sur ce brouillage des points de repères autour de ce qui fait autorité : du bourreau à la figure protectrice républicaine que s’inscriraient les ingrédients de la folie ordinaire et collectivement partagée.
La question du partage collectif de la folie est également à mettre en perspective des apports de Sara Skandrani, dans un contexte transculturel. L’auteur revient sur les correspondances entre les symptômes psychopathologiques tels qu’ils apparaissent dans les discours des patients et la formation culturelle à travers les mythes, contes, rites et coutumes. Ainsi l’altérité culturelle risque de conduire le clinicien à la tentation de ramener de manière défensive le « non connu » au connu, attribuant un sens culturel et subjectif au symptôme des patients. Désordre et folie exigeraient alors toujours une interprétation collective partageable qui parle de notre propre rapport au social, voire de notre rapport à l’extraordinaire folie de l’autre, finalement très proche de notre folie ordinaire. Cet abord culturel résonne alors avec le chapitre de Sylvain Tousseul qui dans une toute autre perspective décrit la « folie » à travers les époques. L’auteur explique que la folie serait en fait le produit de la société. Il revient sur les rapports entre folie et mœurs du Moyen-Age, jusqu’à l’époque contemporaine. La folie serait donc le terme sous lequel seraient désignées les pathologies mentales les plus péjoratives comme la psychose, certaines formes de névroses graves, mais aussi des comportements plus variés, telles que les sexualités plaçant l’intime de tout un chacun comme potentielle folie, et donc comme une folie ordinaire. Enfin, cette partie se clôt sur les apports de François Pommier qui, revenant directement au transfert dans la cure, décrit ce qu’il appelle « les folies ordinaires du psychanalyste ». L’auteur se propose d’aborder à travers plusieurs vignettes cliniques les moments de folie ordinaire traversés par le psychanalyste. Selon F. Pommier, le cadre comme la neutralité serviraient de remparts et préserveraient le travail analytique de la folie, tout en la démarquant de la norme au sens social du terme. La psychanalyse en elle-même peut être considérée comme une folie qui se déploierait dans un cadre normé, la folie de la norme pouvant alors se résumer au transfert. F. Pommier émet l’hypothèse que la capacité de l’analyste à traverser l’espace de la séance en équilibre instable, ou celle de s’inscrire dans un autre temps circulaire cette-fois ci, relèverait d’une forme de folie ordinaire dans l’engagement et la naissance du transfert.
Au sujet de la deuxième partie : « Cortèges tragiques de l’imprévu »
De la passion amoureuse, à la folie de l’artiste, à celle du travailleur, jusqu’au tragique de l’imprévu aux extrêmes frontières entre vie et mort, par le geste suicidaire ou la clinique de la réanimation néonatale, les auteurs de cette seconde partie traitent tous du retentissement de cette folie de l’instant. Il est alors question de l’impensé qui traverse le sujet et son objet, voire même cette injonction à penser qui par définition nous interroge sur notre propre rapport à la norme, voire à la folie ordinaire de la norme. Jacqueline Schaeffer évoque la folie ordinaire/ extraordinaire de l’expérience passionnelle amoureuse. L’auteur tisse des liens entre coup de foudre, lien infantile archaïque, dépendance, idéalisation narcissique, impossible séparation, attente, passion sexuelle, jouissance, violence, haine, destructivité, pulsion de mort, pour ouvrir un autre regard sur la passion définie dans le registre de l’emprise, en défense contre le risque permanent de la perte. Elle y questionne la passion entre haine et amour, dans une fonction à la fois destructrice et séparatrice qui tracerait les contours du moi : « D’où ce paradoxe de la passion qui est de s’aliéner dans le lien pour mieux se retrouver. Pourrait-elle alors devenir une expérience initiatique ? » (ibid., p. 103).
Dans ce registre passionnel, mais artistique cette fois, Gisele de Araujo Abrantes et Marta Rezende-Cardoso reviennent sur la conception de l’art comme expérience à la fois subjective et tout à fait ordinaire. Selon les auteurs – en appui sur les travaux de Laplanche – les passions dans leurs expressions les plus extrêmes se retrouveraient dans l’opéra. Le spectateur n’aurait aucun moyen de traduction, tel le nouveau-né face aux messages intromis de l’inconscient infantile de l’objet primaire. Analogie de la première relation de séduction dans la situation anthropologique fondamentale, l’expérience offerte par la scène d’opéra se situerait au carrefour d’un vécu subjectif infantile des plus ordinaires, passivité extraordinaire chez le sujet devenu adulte. Dans une perspective toute autre, la psychodynamique du travail, Christophe Dejours questionne les rapports entre folie et normalité pour décrire ce qu’il appelle la normalité souffrante, aux marges de la folie certes, mais qui n’est pas sans travers. Il évoque alors les stratégies collectives contre la souffrance au travail et l’impact des nouvelles formes d’organisation du travail. L’auteur revient sur les réactions aux effets nocifs de la normalisation au xixe siècle, plaidant le respect de la folie comme intrinsèquement extraordinaire, comprenant en son sein la créativité. Selon Dejours, la « normopathie » en perspective d’une passion de la norme, vecteur d’un clivage entre promoteurs et victimes, serait alors peut-être la forme derrière laquelle se cacherait aujourd’hui cette « folie ordinaire » que La Boétie avait désignée sous le nom de « servitude volontaire ». Enfin, c’est par la question directe du traumatisme, et de ses après-coups que se termine cette seconde partie. Tout d’abord, Elisabeth Chaillou revient sur une clinique particulièrement extrême – au sens courant du terme – à savoir sur la limite plus que ténue entre la naissance et la mort néonatale. S’appuyant sur plusieurs vignettes cliniques, l’auteur revient sur la traversée de ces parents au risque de la mort réelle de leur enfant : de l’urgence de la réanimation au drame possible du handicap d’un enfant, qu’il faudrait « fantasmatiquement » ne pas avoir réanimé, agitant évidemment les fantasmes infanticides. Nathalie De Kernier revient quant à elle sur les sens de l’acte suicidaire à l’adolescence à partir du cas de Susane baignée d’une folie ordinaire familiale dont elle cherche à éprouver le point de rupture. Elle y décrit la manière dont l’espace psychothérapeutique offert à l’adolescente a pu servir de contournement d’un mensonge ordinaire familial par l’espace extraordinaire analytique. Extraordinaire car il l’amène à associer autour d’un inconscient qui n’a de cesse de la surprendre par ses manifestations au-delà de tout ordinaire.
Au sujet de la troisième partie, corps halluciné, corps hallucinant…
Dans cette troisième et dernière partie, les différents auteurs questionnent la place du corps, du fantasme, dans la rencontre avec des patients convoquant l’analyste jusqu’à l’extrême intime de sa propre folie ordinaire. Tout d’abord, Derek Humphreys revient sur la notion de limite à l’épreuve du transfert à l’aune du cas d’une patiente consultant pour des douleurs insupportables durant les rapports sexuels. L’auteur dit se situer dans une approche situationniste, en concentrant son attention sur un moment, une séance, en lien avec la déstabilisation d’une organisation bancale à la reprise de nouveaux mouvements entre affect et représentation. Il décrit la manière dont le thérapeute est engagé dans le transfert, jusqu’au point de crise et aux conditions de son dépassement.
Car c’est bien de la mise à l’épreuve de la neutralité par la folie ordinaire du transfert dont il est question dans cette troisième partie, au détour des rencontres cliniques de l’analyste. Jean-François Solal revient ainsi sur la temporalité fantaisiste de l’adolescence, entre dyschronisme et anachronisme, au travers de deux vignettes cliniques, entre corps halluciné barré de toute élaboration symbolique et corps hallucinant échappant aux épreuves de castration. À travers l’analyse des mouvements transférentiels à l’œuvre, l’auteur pointe l’inquiétude de l’analyste d’adolescents quand ces derniers s’enferment dans des espaces normés, confondant alors ordre et immobilité.
À l’issue d’une réflexion sur les liens entre folie ordinaire, clinique et sémiologie Jean-Malo Dupuy décrit la folie ordinaire comme une juxtaposition des mondes délirant et réel. Ainsi, l’extrême des tableaux sémiologiques historiques aurait pour fonction d’éclairer des situations moins bruyantes, moins extraordinaires ou socialement plus convenues qui ne pourraient être que l’écume de processus morbides déjà à l’œuvre. Et c’est à travers l’abord direct, en psychiatrie adulte, des processus morbides alors clairement à l’œuvre que Bruno Secchi questionne dans un nouveau chapitre la fonction de l’hallucination comme prothèse transitoire chez des sujets en état de psychose. Pris dans la circularité des symptômes psychotiques, le clinicien s’intéresse à la fonction de levier de ces différents symptômes et mécanismes de défense, et notamment à leur potentiel évolutif. Guillemine Chaudoye et Hélène Riazuelo s’interrogent quant à elles sur la manière dont les corps fantasmés et réels peuvent investir le travail transférentiel. Le corps parfois mutilé s’inscrirait comme un accident dans le travail de mise en sens, servant alors des mouvements de cruauté proche d’une folie ordinaire du thérapeute au carrefour de fonctions organisatrices et désorganisatrices, et dessinerait les contours d’une folie ordinaire à deux. Enfin, au plus près du corps sexué, Jean-Baptiste Marchand se questionne sur la manière dont la différence des sexes pourrait constituer une folie ordinaire dans une dialectisation du genre, du sexué et du sexuel. L’auteur propose une définition de l’ordinaire comme le maintien des capacités de négociation et de résistance, concevant la folie ordinaire comme « le résidu de folie latente dans le pseudo maintien de l’ordinaire, en écho de la poussée constante de la pulsion ». Il questionne la folie ordinaire du trouble dans le genre chez le clinicien, à la manière dont l’analyste supporte le traumatisme précoce de la folie ordinaire de la différence des sexes. Pour finir, Laurie Laufer nous propose par l’héritage des travaux de Foucault une conception de la folie ordinaire entre subjectivation et désubjectivation. Elle aborde les fonctions de l’expérience analytique prise dans la modernité intrinsèquement entreprise de désubjectivation. Questionnant les liens complexes et non systématiques qui relient/délient sujet et subjectivité en appui sur les travaux de l’écrivaine Chloé Delaume, l’auteur s’interroge sur l’essence et le pouvoir du regard parlé, du sujet qui regarde et/ou de l’objet regardé, plaçant la performance de l’écrivaine comme celle de la mise en condition de la désubjectivation.
Ainsi, avec finesse, les auteurs de cet ouvrage invitent le lecteur au plus près de l’intime folie de la scène sociale et analytique, pour décrire, mais aussi analyser, l’essence même de ce qui fonde le caractère dit « ordinaire » de cette folie, souvent non loin des seuils du « subjectivement insolite ». Ne serait-ce pas la possibilité de « partager » cette folie qui la rendrait ordinaire ? Et n’est-ce pas là toute l’entreprise de cet ouvrage ?
Elise Pelladeau est Maître de conférence des universités en psychologie clinique.
Jean-Claude Stoloff, Psychanalyse et Civilisation contemporaine, Quel avenir pour la psychanalyse ?, Paris, Puf, « Souffrance et théorie », 2018.

En publiant ce dernier ouvrage, Jean-Claude Stoloff nous dit renouer avec ses intérêts de jeunesse concernant le caractère déterminant pour la psyché humaine du champ économique et sociopolitique. Il n’est pas possible de dissocier la naissance, le développement et l’avenir de la psychanalyse de l’environnement économique et social dans lequel elle a émergé et dans lequel elle se déploie. Mais si la psychanalyse paraît intrinsèquement liée à la démocratie, on peut s’interroger sur ce que cette discipline peut apporter de nouveau et de spécifique aujourd’hui à la compréhension du lien social et du champ politique.
Un premier questionnement surgit alors : en quoi la psychanalyse est-elle fondamentalement dépendante, tant pour ses outils de réflexion théorique que pour sa pratique clinique, de la démocratie ? Bien sûr, la société du xxie siècle est profondément différente de celle qui a vu le développement des théorisations freudiennes et il faut donc chercher à cerner les conséquences de ces changements sur l’avenir de la théorie et de la pratique de la psychanalyse. La psychanalyse survivra-t-elle à la révolution numérique et à « l’homme augmenté » ? A-t-elle toujours quelque chose de radicalement original à proposer à l’homme d’aujourd’hui ? Reste-t-elle un traitement singulier au sein de la diversité des propositions de psychothérapies ?
En intégrant dans la connaissance de l’homme les déterminations venues de l’inconscient, la psychanalyse a débouché sur une anthropologie spécifique, originale et inédite dans l’histoire des sciences. Partant de la cure psychanalytique individuelle conduite selon une méthode très précise, Freud a abouti à des hypothèses concernant la psychologie collective et le processus culturel universel par lequel le petit humain se transforme de « petit primitif » en homme civilisé, porteur mais aussi victime d’une culture péniblement conquise – quelle que soit la culture envisagée. Ce long travail d’acculturation, nommé par Freud le « Kulturarbeit », processus civilisateur à la fois individuel et collectif, est un travail dont l’étendue apparaît si gigantesque et interminable qu’il l’a comparé à l’asséchement du Zuyderzee ! Mais si ce travail d’acculturation paraît universel, il est cependant bien différent selon la culture précise que l’on examine. Cette universalité ne peut empêcher de prendre en compte les diversités sociales, géographiques et historiques déterminantes à la fois pour le contexte précis qui a permis l’émergence des théories de Freud dans la société de son époque mais aussi en ne sous-estimant pas les changements fondamentaux dans la société d’aujourd’hui. Bien que l’on ne puisse linéairement faire des analogies entre processus individuels et processus collectifs, ces constatations nous confrontent aujourd’hui à un débat fondamental pour l’avenir de la psychanalyse dont Jean-Claude Stoloff pose les termes et les enjeux dans cet ouvrage.
Un nouveau « malaise dans la civilisation » ?
L’apparition de « l’Homo numericus » est-elle sans conséquence sur le psychisme humain et sa compréhension ? Si nous sommes en train de vivre non seulement un processus d’évolution mais – peut-être beaucoup plus – une mutation vers une ère nouvelle, celle de « l’homme augmenté » ou du transhumanisme, nous ne pouvons pas en négliger les conséquences sur le cadre et la méthode analytique tels qu’ils ont été conçus dans leur contexte initial. Avons-nous besoin de nouveaux éléments de compréhension pour envisager l’émergence de la violence et de la cruauté humaine apportés par les totalitarismes, les conflits mondiaux du xxe siècle, les fondamentalismes religieux actuels et les nouvelles formes des guerres modernes ?
Jean-Claude Stoloff rejoint les analyses de Marcel Gauchet et d’Hannah Arendt et s’attache à décrire ce « nouveau malaise dans la civilisation » qui accompagne depuis quelques décennies la sortie des croyances religieuses qui dominaient nos sociétés traditionnelles. Cette disparition des croyances sur lesquelles étaient fondées la culture, couplée aux nouvelles conditions de production, impose à l’homme de pénibles conditions d’isolement et d’esseulement. On peut constater, alors, que se forme le terreau d’où émergera la quête compensatrice et désespérée pour trouver des raisons de continuer à investir dans un monde sans sens et sans certitude, ce qui engendrera à son tour la plus folle violence. Toutes les conditions sont alors réunies pour que les forces pulsionnelles, sans objet culturel stable et signifiant auquel se lier, se libèrent avec leurs forces anarchiques et déqualifiées. On assiste alors à une expansion du narcissisme, mais dans son versant négatif et destructeur qui est au cœur de ce nouveau malaise sociétal. Il est frappant de constater que même si ces pages ont été écrites avant la crise des « Gilets jaunes », elles annoncent, de façon presque prophétique, les troubles de l’hiver 2018-2019…
Jean-Claude Stoloff remarque alors que la psychanalyse comporte une grande analogie avec ce qui constitue la démocratie et qu’elle ne peut se développer que dans une société assurant au sujet un espace préservé, intime et singulier. Ceci est le propre d’un régime démocratique qui laisse l’individu libre et qui protège cette liberté. Mais cette nécessité intrinsèque va plus loin car, comme dans la démocratie, les sujets sont appelés à une réflexion individuelle plutôt qu’à une adhésion hypnotique à une figure d’autorité. La personne vivant en démocratie peut à la fois s’identifier à des éléments de son environnement et, à la fois, en rejeter d’autres dans un processus de changement continu qui rappelle le processus de changement indéfini en psychanalyse.
Cependant, il existe en permanence un conflit entre les exigences de la civilisation et la constitution pulsionnelle humaine. La psychanalyse a montré que le sujet humain se développe à partir de ses pulsions qui lui sont pour la plus grande part inconscientes et qui nourrissent son imaginaire dans le lien à l’autre. La recherche de la jouissance – ce toujours plus de la satisfaction pulsionnelle – qui va « au-delà du principe de plaisir » s’oppose à ce qui fonde la culture : le maintien de liens libidinaux suffisamment solides entre les hommes. Aussi l’avenir de ce combat entre Éros et Thanatos – et donc l’avenir de notre civilisation – est-il toujours incertain et cette incertitude, sans les espérances apportées par les religions ou les idéologies totalitaires, constitue ce qui est le plus difficile à admettre et à supporter pour nos contemporains. Le destin incertain de notre civilisation rejoint le destin incertain de l’individu autonome dans la société démocratique qui paye cette incertitude par son angoisse et sa solitude.
La psychanalyse, une théorie dépassée ?
Comme nous venons de le voir, les fondements de la théorie psychanalytique reposent sur tout le corpus de la métapsychologie qui s’est développé dans un contexte social bien différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Mais bien que ce contexte social soit très différent selon les époques et les cultures, y compris géographiquement dans une même époque, il reste un invariant universel : la prématurité du petit humain qui lui impose de poursuivre son développement durant de nombreuses années avant de parvenir à l’âge adulte et à sa maturité sexuelle. C’est pourquoi, même si la « maladie des temps modernes » n’est plus la même que celle que pouvait observer Freud dans la société viennoise du xixe siècle, ses fondements constitués par le soubassement pulsionnel de la sexualité en interaction avec l’environnement culturel et social reste identique dans les deux cas.
Ainsi la décomposition actuelle de la cellule familiale et la libération sexuelle qui se sont développés au xxe siècle ont déplacé les problématiques névrotiques habituelles du temps de Freud. Kohut a pu dire que nous sommes passés de « l’homme coupable », notamment de ses désirs sexuels, à « l’homme tragique » recherchant désespérément un sens à son existence. De fait, les problématiques narcissiques ont remplacé, sur le divan et dans nos cabinets de consultation, les problématiques œdipiennes. L’homme contemporain est avant tout confronté à une nouvelle injonction : réussir sa vie et développer toutes ses potentialités, ce qui peut devenir largement aussi contraignant que les injonctions répressives sur sa sexualité qui primaient au début du siècle. Mais si la focale s’est déplacée des troubles sexuels aux troubles narcissiques et identitaires, le soubassement reste bien identique puisqu’il s’agit tout aussi bien du développement de la sexualité et de ses avatars, le narcissisme étant une étape et une position incontournable dans le développement psychosexuel de l’individu.
De même, les mouvements qui ont pu attaquer l’universalité du complexe d’Œdipe ont négligé le fait que partout et en tout temps, le développement de l’enfant humain s’inscrit dans une structure ternaire et symbolisante qui lui permet de se détacher de la dyade originelle pour aller vers « l’autre », en l’occurrence « l’autre de la mère », quelle que soit la forme précise que cette structure triangulaire prend dans une configuration familiale donnée, à une époque donnée (thèse que l’auteur a déjà développée dans son précèdent ouvrage « La fonction paternelle »). Ainsi la métapsychologie freudienne, née de la réflexion et de la pratique de Freud avec ses patients, reste un socle incontournable aujourd’hui, même si elle s’est considérablement enrichie et doit continuer de s’enrichir pour constituer un corpus vivant et actuel.
La psychanalyse, un traitement dépassé ?
La civilisation contemporaine a accentué plutôt qu’elle n’a dépassé les résistances à la psychanalyse et au traitement psychanalytique. Les traitements longs avec de multiples séances, donc forcément coûteux en termes de temps et d’argent, l’incertitude des résultats et la déviation majeure constituée parfois par une véritable addiction à la psychanalyse conduisent nos contemporains à rechercher une correction plus rapide aux maux qui les affligent. La progression des neurosciences et la découverte importante des psychotropes ont transformé aussi la prise en charge des maladies mentales et certains troubles névrotiques. À côté de l’émergence d’innombrables nouvelles thérapies, certains courants psychanalytiques eux-mêmes – en particulier outre-Atlantique – mettent l’accent sur la mise en sens et la narrativité dans un climat d’empathie réciproque entre le psychanalyste et son patient. Ils vident ainsi le socle qui constitue l’originalité et l’efficacité du traitement analytique qui vise non seulement à la remémoration et à la construction, et à parvenir ainsi à une conviction partagée entre le patient et son analyste concernant ce qui se serait passé autrefois pour le patient, mais surtout à modifier les traces mnésiques inconscientes, y compris dans leur substrat biologique. Cette modification supposée qui s’attaquerait à la racine corporelle et biologique des troubles psychiques était déjà supposée par Freud quand il postulait « une modification du refoulement originaire mettant fin à l’excès quantitatif » dans son article : « Analyse avec fin et analyse sans fin ».
Nous touchons là la pierre angulaire qui distingue le travail psychothérapeutique de l’analyse « qui permet implicitement de tabler sur des acquis définitifs rendant impossible, contrairement à l’hypnose, le retour aux causalités ayant entraîné l’entrée dans la névrose » nous dit Jean-Claude Stoloff. C’est sur ce point précis que l’on trouve le principal défi que se donne la psychanalyse : parviendra-t-elle, en dépit de conditions sociétales hostiles (mais elles l’ont toujours été !), à préserver ce qui fait que la psychanalyse n’agirait pas comme tous les autres traitements psychothérapiques ? Au prix de ce cadre particulier, qui met en jeu des moyens longs et coûteux, la psychanalyse vise un changement radical et irréversible de la vie psychique d’un sujet. Elle est en cela une discipline singulière, qui entraîne une « praxis » singulière qui ne peut rester que marginale et subversive.
Mais on peut espérer, et c’est la conviction de l’auteur, que se rejoignent un jour une approche neuro-bio-cognitive et une approche psychanalytique, même si notre discipline ne peut entrer dans l’expérimentation scientifique au sens des sciences dures. Des travaux existent déjà dans ce sens qui ont ouvert la voie, comme ceux portant sur l’angoisse[1], et il faut espérer que cette voie féconde s’étoffera dans l’avenir et sera soutenue par les psychanalystes eux-mêmes.
Si la psychanalyse peut s’enrichir d’un dialogue fécond avec les neurosciences, elle a elle-même beaucoup à apporter à d’autres domaines scientifiques en articulant ses connaissances spécifiques à celles des autres sciences, comme l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie et l’histoire à condition de ne pas évacuer son paradigme central : l’inconscient représenté par le couplage « sexuel infantile-narcissisme ». C’est à cette condition qu’elle peut garder son regard original et aider à la compréhension de la culture et de la civilisation de notre temps.
Jean-claude Stoloff traite dans cet ouvrage de ces nombreuses interrogations actuelles qui traversent la psychanalyse de nos jours. Il conclut son livre par des questionnements et des incertitudes. Ni optimiste, ni pessimiste, il lui semble que l’avenir de la psychanalyse appartient aux psychanalystes eux-mêmes. Entre diffusion excessive et dilution, c’est en se recentrant sur ses fondements spécifiques et subversifs – même s’ils ne touchent qu’un public plus restreint – que la psychanalyse aura des chances de s’assurer un avenir.
Christine Voyenne est psychanalyste, membre formateur de la SPRF.
[1] Voir D. Wildocher, Anxiety and program of action, Psychiatrie et Psycho-Biologie, 3, 1988.

