
Critiques de livres
Le site de la Rfp propose des critiques de livres en lien avec sa rubrique papier « Revue des livres ». Dans cette livraison, nous vous proposons la lecture de :
Conviction, Suggestion, Séduction,par Adela Abella et Geneviève Déjussel (dir.).
Adela Abella et Geneviève Déjussel (dir.), Conviction, Suggestion, Séduction, Puf, « Monographies de la psychiatrie de l’enfant », 2017.

Cet ouvrage, publié par les PUF dans la collection « Monographies de la Psychiatrie de l’enfant », présente un ensemble de contributions de psychanalystes d’origines diverses, certaines issues d’un cycle de conférences données au Centre de psychanalyse Raymond-de-Saussure à Genève en 2011-13, les autres reprenant des textes parfois publiés précédemment.
Les directrices de l’ouvrage, Adela Abella et Geneviève Déjussel, toutes deux membres de la Société Suisse de Psychanalyse, présentent fort clairement dans leur introduction les enjeux de ce thème : « La conviction, la suggestion et la séduction apparaissent comme des phénomènes universels et inévitables dans toute relation humaine et, a fortiori, dans tout traitement par la parole. […] doit-on leur attribuer des effets positifs, stimulants et enrichissants ou, au contraire, faudrait-il leur imputer d’abord des risques d’influencer, et d’empiéter sur la liberté d’autrui ? ».
Leur « conviction » est que ces deux points de vue se retrouvent au sein de la communauté analytique, en lien avec la question des buts de la cure : strictement thérapeutique ou de meilleure connaissance de soi-même, le premier acceptant plus facilement l’influence du thérapeute.
Adela Abella en déroule dans son texte, « Conviction, suggestion, séduction : des points de vue divergents », une présentation claire et complète. Elle propose de rattacher ces deux grandes orientations à deux conceptions métapsychologiques différenciées, plutôt francophone pour l’une, anglophone pour l’autre, à propos en particulier de quatre notions : le narcissisme primaire, l’« Hiflosigkeit », l’intérêt pour le préverbal, l’espace analytique. La tradition française a toujours privilégié la dimension du narcissisme primaire (fidèle en cela à l’orientation solipsiste de Freud), associée pour l’auteure à l’Hiflosigkeit d’un bébé sans recours, quand l’anglophone a toujours mis l’accent sur le rôle de la relation d’objet dès la naissance. Il en résulterait dans la première une place positive donnée à l’influence nécessaire de l’objet pour sortir de son autarcie, qui peut prendre la forme d’une séduction mobilisatrice (mais aussi induire des risques d’excès), qui n’est pas nécessaire aux yeux de l’autre tradition. Cette opposition va se retrouver pour la prise en compte du préverbal et la notion de champ analytique, très développés dans la psychanalyse contemporaine, et qui reconnaissent l’un et l’autre la part active jouée par l’analyste dans le processus. Dans cette perspective, la place de l’influence, voire de la séduction, est reconnue comme inévitable, voire nécessaire ; il ne reste qu’à en éviter les dérives.
L’auteure mentionne à ce sujet les travaux de César et Sara Botella, qui contribuent par ailleurs à ce volume avec « Conviction et remémoration », dans lequel ils présentent leur théorisation sur la régrédience en séance, à laquelle ils attribuent un potentiel non de suggestion mais de transformation.
Cette évolution affecte l’ensemble des courants, sans distinction de traditions. La différence ne se déterminerait-elle pas alors, au sein de chaque courant, voire de chaque analyste, en fonction de la nature de la pathologie, les pathologies les plus sévères étant celles qui requièrent les interventions les plus actives, mais du même mouvement l’attention la plus soutenue aux risques d’empiètement ?
C’est ce à quoi nous invite le texte de René Roussillon, « Séduction, suggestion, influence en psychanalyse : à la découverte de la fonction de l’objet ». L’intérêt de celui-ci est de nous permettre de dépasser la seule opposition séduction nécessaire/ séduction dangereuse, pour reconnaître que la séduction est inévitable, et que la question est non de son existence, mais de sa qualité. Inévitable, car « le rapport de soi à soi est nécessairement médiatisé par la réponse de l’objet en tant qu’il est aussi un autre sujet ». Tout dépendra de l’adéquation de cette réponse, et donc de l’accordage de l’objet : « Si le travail d’accordage et d’ajustement imposé au sujet par l’objet excède les capacités du sujet, celui-ci se trouve placé devant une alternative : soit il s’identifie à la réponse de l’objet et alors « l’ombre de l’objet tombe sur le moi » et le sujet se tord pour assimiler celle-ci, ou, si l’écart est trop important, il se clive lui-même ; soit il refuse cette réponse, se révolte contre elle, [et] il ne peut alors que mobiliser des mécanismes de rejet contre une part de lui-même et son expérience subjective ». « Une autre conjoncture qui produit des effets de « séduction aliénante » [est celle] du silence de l’objet et des techniques fondées sur le silence de l’analyste ». Le sujet fait alors l’expérience d’une absence de retour, de réponse, et d’une annulation de son « message ».
Tout l’enjeu de la cure est donc précisément de ne pas rester silencieux, sans être empiétant. Ceci parce que « le trouvé et le créé ont été suffisamment rapprochés par le travail en commun pour qu’ils rentrent en coïncidence, [et] à ce moment-là les inévitables effets de séduction, de suggestion ou d’influence […] sont dépassés par le processus appropriatif du sujet ».
Je ne cacherai pas que cette réflexion entraîne… ma conviction, car il me semble qu’elle permet de rendre compte de cette ambiguïté de la séduction, et qu’elle peut éclairer en retour l’ensemble des contributions : le danger de la séduction, de la suggestion, de la conviction, serait directement proportionnel à la défaillance de la fonction symbolisante de l’objet premier, par l’insécurité sur son jugement propre qu’il entraîne chez le sujet, et donc sa vulnérabilité à l’influence de l’objet.
C’est en effet ainsi que l’on peut comprendre le texte de Paul Denis, « Croyance, conviction et vérité ». L’auteur rattache en particulier la croyance au lien d’amour : « La réalité extérieure se découvre avec quelqu’un d’autre, dans la relation à un Nebenmensch, à un autre secourable. » Réciproquement, le doute s’instaure quand le lien n’est pas suffisamment assuré. C’est alors que vient la tentation de la croyance, comme un fétiche aux vertus antitraumatiques. Croyance qui est le propre de la psychologie des foules : « Dans la séduction par le leader d’une foule, cette instance [le Nebenmensch] s’éclipse, ouvrant à la croyance que celui-ci détient la vérité. » L’auteur tente alors de cerner la différence entre croyance et conviction scientifique, et rappelle à ce sujet la mise en garde de Pasteur : « Le plus grand dérèglement de l’esprit est de croire les choses parce qu’on veut qu’elles soient. » Et il conclut : « Comment, en tant que psychanalystes, ne pas souscrire à la mise en garde de Pasteur ? »
Cette importante interrogation est abordée à propos de Freud lui-même dans le texte de Rachel B. Blass, « Du fantasme de séduction à la Foi ». Elle y oppose les doutes qui ont longuement assailli Freud à propos de sa théorie de la séduction, avant qu’il ne finisse par y renoncer (convaincu d’avoir cédé à son désir de séduire ses patientes en leur suggérant cette étiologie de leurs troubles) au début de sa vie intellectuelle donc, à sa conviction réaffirmée, contre les arguments hostiles, à la fin de sa vie, au sujet de ses hypothèses sur la naissance du peuple juif dans le « Moïse ». L’intérêt de cette réflexion est bien entendu de faire vaciller nos convictions rationalistes les mieux établies, pour donner sa valeur, non au détachement scientifique, mais au désir passionné de connaître : « Je pense que progressivement, [Freud] en est venu à considérer que c’est grâce à une relation investie et personnelle avec le monde que nous sommes amenés à mieux le découvrir. » C’est une position qui résonne tout particulièrement pour nous si nous l’appliquons à notre situation envers nos patients.
Pourtant, c’est une telle certitude que met en cause le texte de Ronald Britton et John Steiner, « L’interprétation : fait choisi ou idée surestimée » (en référence à Bion), en s’appuyant d’ailleurs sur un Freud plus prudent, quand il « note la difficulté à évaluer et valider une construction en soulignant que nos formulations ne sont que des hypothèses qui doivent être testées par le matériel qui suit », citant à l’appui de ce point Nestroy, « Au cours des événements, tout deviendra clair ». Les auteurs s’intéressent au moteur de l’idée surestimée, qu’ils situent dans l’intolérance à l’incertitude, reprenant la compréhension proposée par Paul Denis.
Dans la même veine, Michael Feldman, dans son texte, « Le problème de la conviction en séance », invite à trouver le juste équilibre entre la confiance en sa capacité de compréhension, et doute « raisonnable » permettant de garder fluidité et ouverture.
De même, Silvia Haellmigk, avec « La suggestion dans la cure et deux de ses avatars, la suggestion et la conviction », invite à doser judicieusement la séduction « utile » pour redynamiser la cure (en distinguant trois formes : sexuelle, narcissique et surmoïque) en se gardant de tout excès.
Stefano Bolognini propose, dans « Conviction, persuasion, suggestion » de commencer par une réflexion étymologique, qui met en évidence la connotation agressive possible (dans convaincre, il y a vaincre), ou le degré de manipulation en cause. Il en tire une distinction intéressante entre le « transpsychique », où il y a une colonisation violente et occulte de l’autre avec pour conséquence une atteinte de l’intégrité psychique, et « l’inter-psychique », décrit en termes d’échanges intimes, sains et créatifs entre deux mondes internes.
Il partage ainsi les points cruciaux retrouvés dans nombre de contributions : reconnaissance d’une distinction justifiée entre « bonne » et « mauvaise » séduction ; problématique identitaire et de limites dans la seconde.
Nous avons présenté ici l’ensemble des chapitres de la première partie, intitulée « Quelques points de vue théoriques ». Dans la seconde partie, « Quelques situations cliniques spécifiques », le thème est abordé successivement chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, et dans le cadre de la supervision.
« À propos du travail avec les bébés et les enfants autistes », de Bernard Golse, va mettre en évidence l’exacerbation, en raison de la spécificité du travail avec ces patients, des interrogations mises en évidence dans l’ouvrage. On imagine en effet sans mal la nécessité pour les thérapeutes de se montrer particulièrement actifs, ce qui peut avoir une valeur structurante, mais le risque proportionnel d’« abus » et d’effets aliénants. Cette problématique est sans nul doute au cœur des débats actuels particulièrement violents autour de la place de la psychanalyse dans le traitement de l’autisme.
Gérard Szwec, dans « Conviction, suggestion, séduction dans la construction dans l’analyse avec des enfants », met de même en exergue un risque inhérent à l’asymétrie du cadre à cet âge, plus particulièrement à propos de la construction biographique et de la place excessive qui peut lui être donnée, alors même qu’un certain nombre d’éléments auront été fournis par les parents.
Catalina Bronstein, dans « La place de la séduction dans le traitement psychanalytique des enfants », a un point de vue plus nuancé, en accord avec le point de vue majoritaire de l’ouvrage, reconnaissant la valeur mobilisatrice (et sans doute incontournable) de la séduction, tout en mettant en garde sur son rôle défensif, et les problèmes qu’elle pose à l’analyste.
Enfin Thomas H. Ogden, avec « À propos de la supervision psychanalytique », rappelle opportunément, en se référant à la pensée de Bion, combien cette pratique devrait permettre au supervisé de se sentir libre dans sa pensée. On sait en effet que cette situation réunit beaucoup de facteurs pour que cette liberté, pourtant impérative par principe, soit dans la réalité souvent entravée, tant en raison du superviseur que du supervisé, et probablement aussi du tiers institutionnel.
J’espère avoir pu rendre compte de la grande richesse de ce livre, permise par la diversité des auteurs, qui reste au fond le plus sûr de moyen de se prémunir des dangers de la séduction, comme en témoigne a contrario l’isolement de toutes les dérives sectaires.
Benoît Servant, Psychanalyste, membre de la SPP.
AUTRES LECTURES
Sigmund Freud, Eugen Bleuler, Lettres, 1904-1937, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 2016.
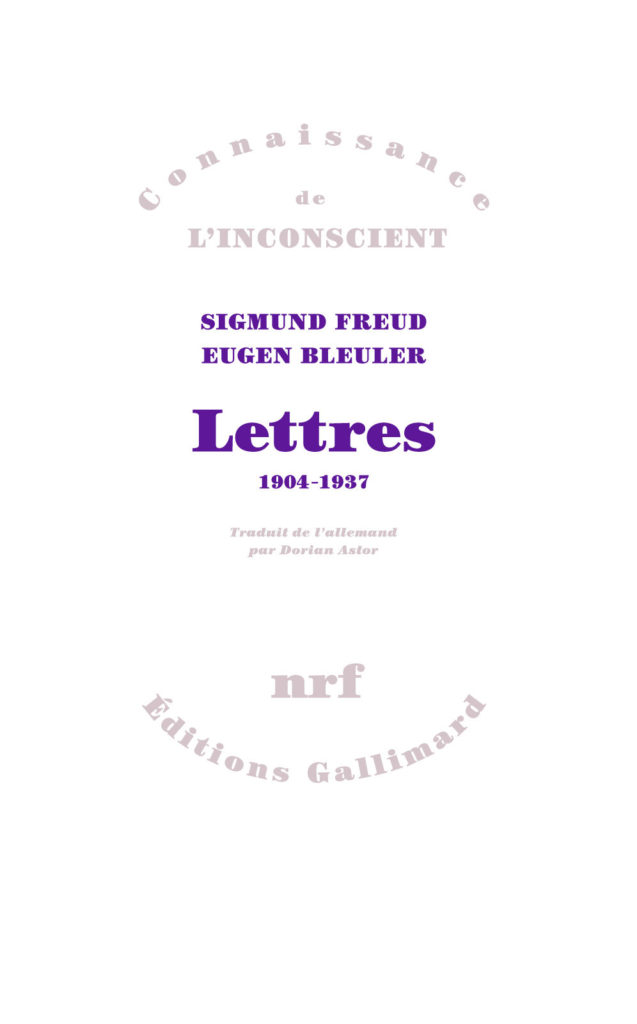
Gallimard publie en français la correspondance entre Sigmund Freud et Eugen Bleuler, le psychiatre zurichois et « père » de la schizophrénie, dans une claire et élégante traduction de Dorian Astor. Cet échange épistolaire, qui s’étend de 1904 à 1937, comprend 53 lettres de Bleuler et 26 de Freud. L’existence de cette correspondance était connue depuis 1965, certaines lettres étaient consultables à la Library of Congress de Washington, mais des « obstacles familiaux » chez les descendants de Bleuler avaient jusqu’ici empêché l’établissement d’une édition complète (parue en 2012 en langue allemande, chez l’éditeur suisse Schwabe). Certaines lettres ont été détruites ou perdues ; il manque environ la moitié des lettres de Freud, ainsi que des récits de rêves de Bleuler, mais cela demeure un document largement inédit, qui se révèle, à la lecture, bien plus qu’une simple pièce supplémentaire au puzzle de l’Archive freudienne.
L’édition offre par ailleurs un important et précieux appareil critique, que l’on doit à Michael Schröter, ainsi qu’un avant-propos de Tina Joos-Bleuler, la petite fille de Bleuler. Une mise en perspective historique et épistémologique est proposée dans la grande introduction par François Villa et Thomas Lepoutre, auteur d’une thèse récemment soutenue sur Freud, les psychiatres et la psychiatrie. Une contribution de Bernhard Küchenhoff, spécialiste de Bleuler, referme le volume, et vient équilibrer l’analyse en apportant un éclairage sur la pensée nosologique de ce dernier.
Cette correspondance a une couleur particulière, celle que lui donne un transfert unique entre Freud et Bleuler. Entre les deux hommes, une relation d’estime mutuelle, mais aussi une certaine distance toujours maintenue, un constant souci de clarifier les termes des désaccords, et des malentendus persistants. Bleuler se pose en « élève qui du reste n’est pas tout à fait sans rien comprendre » et nomme Freud son « Maître ». Freud voit en lui un homme toujours « un peu impressionnant », et il est sensible à la reconnaissance universitaire que lui accorde très tôt « un psychiatre officiel, Bleuler de Zurich ». En effet, Bleuler, qui s’est notamment formé auprès de Charcot, est le premier à introduire la psychanalyse et les aspects psychodynamiques en psychiatrie. Directeur de la clinique du Burghölzli, titulaire de la chaire de psychiatrie à Zurich, il prend position pour Freud dès 1896 dans l’une des critiques les plus positives des Études sur l’hystérie. Il fallait du courage pour prendre le parti de Freud face à la communauté universitaire et médicale, très rétive, dominée par la psychiatrie kraepelinienne.
Bleuler encourage la méthode associative au Burghölzli. On lit de passionnants témoignages sur l’état d’esprit, les débats, l’infatigable activité d’interprétation, et l’atmosphère de psychanalyse sauvage qui règnent dans la clinique. Bleuler, en bon élève, explique à Freud comment les médecins de sa clinique, « admirateurs zélés des théories freudiennes en psychologie et pathologie », ont pris l’habitude d’analyser mutuellement, entre collègues, leurs formations de l’inconscient : lapsus, oublis, actes symboliques, mélodies fredonnées inconsciemment… Les médecins du Burghölzli sont très appliqués dans leur mise en pratique, parfois dogmatique ou un peu mécanique, de ce que Bleuler nomme la « psychologie des profondeurs » ; encore l’un de ces termes bleulériens qui passera à la postérité, avec ceux de schizophrénie, d’ambivalence, ou d’autisme. À la publication du cas de Dora, il écrit à Freud : « Nous tous ici l’avons avidement dévorée, c’est un travail tout à fait génial. Mais les difficultés ne manqueront pas pour convaincre les autres de la justesse de vos idées. » (28 novembre 1905)
La discussion d’un cas de paranoïa chronique, en 1906, est aussi significative. Bleuler réinterprète le cas de paranoïa relaté par Freud comme une « forme paranoïde de démence précoce au sens de Kraepelin » (28 janvier 1906). Il crédite Freud de la compréhension de l’influence de l’affectivité (grande catégorie bleulérienne) sur la pensée saine ou morbide, et dans ses travaux, et il soutient qu’il est impossible de comprendre la symptomatologie du groupe des psychoses schizophréniques sans les mécanismes freudiens, certaines régularités dans la formation des rêves se retrouvant dans la formation des symptômes psychotiques.
Freud se prend à penser que le moment est venu de « conquérir la psychiatrie » ; mais entre le psychanalyste et le psychiatre, les choses ne sont pas simples : la correspondance révèle des désaccords stratégiques. Le soutien de la théorie analytique dans la psychiatrie ne peut être que conditionnel, compliqué. « Je suis certain que vous m’accordez trop de crédit alors que vous avancez à mes côtés », écrit-il à Bleuler, le 30 décembre 1906.
La position personnelle de Bleuler reste d’ailleurs profondément marquée d’ambivalence. En effet, « Bleuler se sert du transfert comme résistance », écrivent Lepoutre et Villa, dans leur introduction. Le meilleur exemple de cela est l’impossibilité de parvenir à une interprétation concluante de ses rêves : « … J’ai soumis mon rêve aux médecins assistants et à ma femme. On ne peut avancer en ma présence. Je dus quitter la pièce un long moment et lorsque je revins, on avait interprété mon rêve, mais dans un sens qui ne pouvait correspondre à la pensée : on y avait très clairement intégré les complexes de ma femme, qui avait pris la conduite de l’analyse en mon absence » (Lettre du 14 octobre 1905). Dans la même lettre : « Je n’ai encore jamais réussi à analyser en laissant aller simplement mes pensées. Soit je reste coincé, soit je me perds entièrement, de sorte qu’à la fin il ne me reste rien d’autre à faire que revenir à mon thème par une secousse consciente ». A peine plus tard (les lettres sont rapprochées) : « Si seulement je savais comment écrire plus inconsciemment » (5 novembre 1905).
Lorsqu’il s’essaye à l’auto-analyse, en effet, c’est l’impasse : « Bien que j’aie reconnu dès la première lecture la justesse de votre Interprétation du rêve, je ne réussis que très exceptionnellement à interpréter mes propres rêves. […] Si je rêve quelque chose de cohérent, je n’en trouve que rarement la clé, et mes collègues, qui s’exercent à la chose, de même que ma femme, qui a une compréhension innée pour la psychologie, s’y cassent les dents » (Lettre du 9 octobre 1905). Aussi met-il Freud au défi de le mettre « sur la voie d’une solution » et d’analyser les récits de rêves qu’il lui envoie par la poste. « Je comprendrais que vous trouviez mon exigence trop grande », ajoute-t-il, mais son adhésion est à ce prix.
Souvent les résistances à la psychanalyse se mêlent aux résistances individuelles. Par exemple, juste après la parution des Trois Essais, Bleuler écrit : « Grâce à un rhumatisme, j’en suis venu ces jours-ci à lire votre Théorie sexuelle et votre Mot d’esprit. J’aurais vu volontiers la première plus développée. Je crois sinon pouvoir rendre hommage à tous vos écrits. Mais là, je ne puis tout à fait vous suivre. Il me manque ces preuves qui, dans les autres publications, sont si convaincantes » (Lettre du 9 juin 1905). La « brochure sexuelle », comme il l’appelle, laisse Bleuler dubitatif. A Freud qui suggère une « résistance affective », il proteste avec énergie. Non, ce qui manque, ce sont les preuves ! « Il me manque aussi le lien de cette nouvelle découverte avec la téléologie phylogénétique » (Lettre du 9 juin 1905). Ou encore : « La déduction à partir du matériau m’a chaque fois bloqué » (Lettre du 14 octobre 1905).
L’objection principale de Bleuler est que la théorie freudienne reste inapplicable à son propre cas. « La relation à vos théories n’a pas encore fonctionné ; soit la chose est pour l’essentiel encore incomplète, soit elle est fausse… » (Lettre du 14 octobre 1905) Il accorde à Freud le « lien indéniable entre l’angoisse et la sexualité » (14 octobre 1905), mais il ajoute, avec cette manière un peu brutale de s’exprimer : « Pour moi, la question sexuelle que j’ai posée n’est pas résolue, même si j’accepte votre explication. (…) Moi-même je n’ai pas été séduit pendant l’enfance ; mais ma pulsion sexuelle m’a été claire très tôt… » (14 octobre 1905) Trois jours plus tard, il y revient : « Je crois toujours que ma résistance à certaines analyses n’est pas une résistance affective. » Et encore : « Je connais ma propre sexualité depuis l’époque où je jouais encore sous la chaise de ma nourrice. Il n’y a pas eu chez moi de refoulement… » (Lettre du 17 octobre 1905) Trois semaines plus tard : « Je suis aussi hétérosexuel que possible. (…) Où la résistance peut-elle résider chez moi, si c’est une résistance ? Depuis ma jeunesse, je m’analyse sans gêne. » (Lettre du 5 novembre 1905)
Freud voit bien que là est le nerf de la guerre, et il s’en ouvre à Jung dans une lettre datée du 19 avril 1908 : « Il [Bleuler] veut accepter la psychologie sans la sexualité, par quoi tout reste alors suspendu en l’air. »
Ainsi que le montrent Lepoutre et Villa, Bleuler soulève des questions fondamentales sur le rapport de la psychanalyse à la science, sur la différence de ce rapport d’avec celui de la médecine. Bleuler écrit : « La psychanalyse n’est ni une science ni un artisanat ; on ne peut pas l’enseigner, au sens habituel du terme. C’est un art qui ne peut être qu’inné et ensuite seulement développé. C’est pourquoi, à court terme, vous subirez le destin de devoir en découdre avec les artisans de la psychologie et de la médecine » (Lettre à Freud, le 28 novembre 1905).
La publication de cette correspondance réactive et même réactualise les enjeux politiques et les enjeux de pensée liés à la naissance du mouvement analytique et à son développement organisationnel. Bleuler, depuis sa position de psychiatre, joue dans ce moment fondateur un rôle singulier, du fait même de sa position d’autorité. En 1907-1908 est créé le Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. On connaît l’importance de l’activité éditoriale pour Freud : ce n’est donc pas rien, que Bleuler ait accepté d’être co-éditeur du Jahrbuch. Il y publie souvent, jusqu’à sa démission du comité éditorial à la fin de 1913.
La correspondance nous plonge au cœur du mouvement analytique et des difficultés rencontrées au tournant des années 1910. La présence de Jung se lit constamment entre les lignes, enjeu entre les deux hommes. Bleuler avait vigoureusement encouragé les travaux de Jung, mais les relations entre eux se dégradent au fil des années, et on en trouve de nombreux témoignages originaux dans la correspondance. Parfois Freud essaye de réconforter Bleuler : Jung est quelqu’un de difficile. Ce sont aussi les années d’un débat très âpre, jusqu’à la rupture, entre Freud et Bleuler, autour de la création et de l’organisation de l’IPA. Dans la correspondance, la discussion sur les statuts de l’organisation et sur l’adhésion de Bleuler à celle-ci constitue les plus vifs motifs de désaccord. Pour Bleuler, le problème majeur est celui de l’exclusivité de l’IPA : si les freudiens siègent seuls, entre eux, dans les congrès, c’en sera fini de toute possibilité d’échanger avec ceux qui pensent différemment. Lettre après lettre, les deux hommes essayent de démêler leurs divergences, pour exposer chacun ses arguments. Les petites retouches des statuts proposées par Freud ne suffisent pourtant pas à convaincre Bleuler de prendre la présidence de la section zurichoise de l’IPA, qui finit par démissionner fin novembre 1911.
Plus rien n’est pareil après cela. Mais malgré tout, Bleuler continue, en bon « ministre de la défense », de « préserver les ponts qui conduisent de la psychanalyse à la psychiatrie universitaire et doivent permettre une circulation dans les deux sens », selon les mots de Freud, et il contribue de loin en loin au Zentralblatt für Psychoanalyse. Il ne cesse pas d’engager l’autorité de sa position et de sa personnalité en faveur de Freud, et il écrit encore pendant quelques années de nombreux comptes rendus des publications freudiennes, quoique devenant de plus en plus critique. A partir de 1913, les deux hommes s’éloignent donc, et souvent, dans leurs courriers, ils le déplorent vivement, sans pouvoir rien y faire. Leurs lettres finissent par s’espacer et devenir plus brèves. Les choses sont déjà bien altérées, en 1920, lorsque Ludwig Binswanger veut dédier son Introduction aux problèmes de la psychologie générale à ses deux maîtres, Bleuler et Freud ; l’un et l’autre y objectent – chacun avait chuté dans l’estime de l’autre.
En 1925 : « Nos différences de conceptions s’expliquent sans doute par le fait que vous pratiquez la psychiatrie et essentiellement la psychiatrie, tandis que moi, depuis bientôt trente ans, je ne fais rien d’autre que de l’analyse, encore et toujours de l’analyse » (Lettre du 22 février 1925). Les lettres de la fin maintiennent pourtant un contact, tantôt sur des questions théoriques (l’occultisme et la transmission de pensée), tantôt au prétexte d’une énigme ou d’un problème que Bleuler soumet à Freud. Ils demeurent compagnons de route ; après tout, écrit Freud, ils furent « frères d’armes ». Bleuler lui souhaite son quatre-vingtième anniversaire avec ces mots : « Pour son quatre-vingtième anniversaire, je rends un hommage admiratif au grand scientifique qui a ouvert au monde la voie obscure qui mène aux profondeurs de l’âme » (1er mai 1936). Il y a de belles lettres de vieillesse. En 1932, Freud écrit : « Lors de la dernière visite que vous m’avez rendue, j’ai dû à nouveau constater combien je vous suis resté attaché depuis que nous avons fait ce bout de chemin ensemble ». Le ton se fait parfois personnel, et dans la dernière lettre du volume, le lecteur peut lire ces mots de Freud : « Ravi d’avoir de vos nouvelles, peu importe l’occasion (…). Oui, je vois, enfin je traite des patients quotidiennement, mais vraiment très peu. On ne se presse plus autant qu’avant auprès d’un vieil homme » (Lettre du 28 janvier 1937).
Claire Nioche-Sibony, psychanalyste SPF.
Paulette Letarte, Entendre la folie, Paris, Puf, « Le fil rouge », 2018.
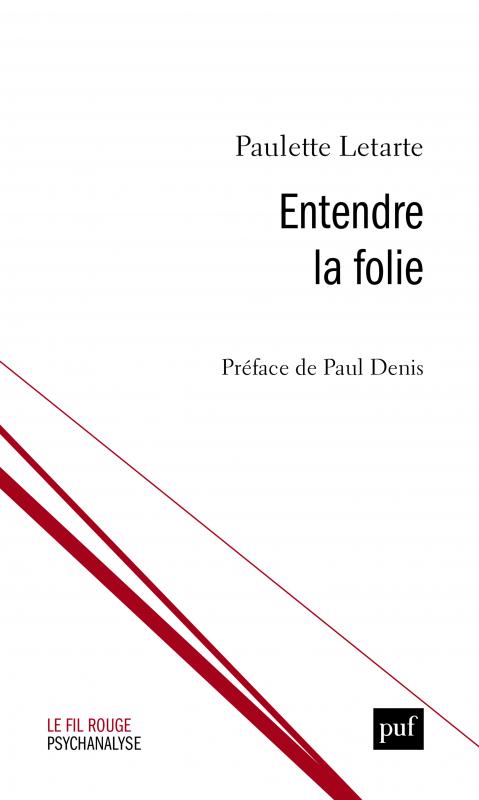
Paulette Letarte, biologiste, médecin, psychiatre, psychanalyste membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, décédée en 2009, était tout particulièrement reconnue dans la communauté psychanalytique, mais aussi psychiatrique, en raison de sa pratique de la psychothérapie psychanalytique auprès de patients difficiles, psychotiques ou border line, et de ses qualités pédagogiques en ce domaine tant auprès des jeunes psychanalystes que des jeunes psychiatres.
Le présent volume, qui rassemble un certain nombre de textes passionnants réunis et présentés par Paul Denis, permet de retrouver la valeur irremplaçable de sa pratique et de son enseignement.
Chacun des chapitres, issus d’articles publiés séparément à l’origine, présente de façon éclairante une question clinique, sur le plan psychothérapique, illustrée par une ou plusieurs vignettes, le plus souvent rapportées de façon très approfondie, qui permettent de voir l’analyste au travail, y compris dans la réflexion qui accompagne en permanence sa pratique, dans l’instant ou en après-coup. En soi-même, ce parti pris donne à ces textes une valeur exceptionnelle, peu fréquente dans la littérature psychanalytique actuelle.
Ainsi se dégagent un certain nombre de thèmes privilégiés que le lecteur va retrouver au fil des différents textes.
En tout premier lieu, Paulette Letarte souligne que la psychothérapie des patients psychotiques et border line travaille en sens inverse de la cure analytique classique : là où cette dernière vise, par une démarche régrédiente, à lever les défenses pour mettre au jour le processus primaire recouvert par le processus secondaire, la première cherche tout au contraire à permettre au patient de disposer de mécanismes de défense. Mais elle se distingue aussi de l’abord psychiatrique, car elle n’a pas pour objectif premier la suppression des symptômes, mais l’acquisition d’une certaine souplesse psychique.
En fait le souci prioritaire de l’analyste dans de telles conjonctures cliniques est d’établir un équilibre narcissique, qui garantisse la survie des deux. En effet, la relation à l’analyste peut représenter une menace pour le patient, si le premier ne respecte pas suffisamment son espace propre. Ceci va avoir des conséquences importantes sur le maniement des interprétations : « Le thérapeute doit inventer les moyens d’interpréter tout en respectant la différence entre sa pensée et celle du patient : l’interprétation doit donc être proposée ouvertement comme fruit de la pensée du thérapeute, en langage ordinaire. » (p. 139, dans le chapitre « Les pièges de la surinterprétation dans le traitement des schizophrènes »). A l’inverse en effet, du fait que pour ces patients, le mot est volontiers la chose, l’interprétation peut créer une excitation, et favoriser un passage à l’acte.
« Il faut pouvoir renoncer à interpréter : le fait pour le malade de ne pas comprendre peut permettre le maintien de la relation, même pathologique. » (p. 146). De même, l’auteure conseille d’utiliser la forme interrogative pour les interprétations, qui laisse la liberté au patient ; la forme affirmative représente à l’inverse un double bind, puisqu’en lui proposant de devenir autonome, elle lui signifie dans le même temps que l’analyste sait mieux que lui ce qu’il pense. Elle souligne le rôle structurant du « peut-être » qui respecte les limites du patient et qui prend en compte les limites de compréhension de l’analyste. Il faut à la fois rapprocher et éloigner. Il est nécessaire de ne pas savoir avant le patient, mais de découvrir avec lui.
Toute cette dimension peut apparaître contradictoire avec une autre exigence de ce type de traitement, qui est d’assumer ou de renforcer « activement certaines fonctions psychiques qui ne sont pas assumées par le patient, du surmoi, du moi, du ça intégré par le moi » (p. 108). Ce qui peut passer en effet par des interventions auprès du patient. Ainsi, dans une vignette (dans le chapitre « Les interventions du psychanalyste »), interdire à une mère de frapper sa fille : « A la suite d’un récit particulièrement révoltant j’interromps Mme X en lui disant : « Maintenant, c’est moi qui parle ! Vous allez me faire le plaisir de ne plus frapper cette enfant ! Votre fille n’est pas votre frère, et elle n’est pas votre analyste ! Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le donc ! ». J’ai utilisé mon indignation comme tremplin hostile pour assumer le rôle d’un surmoi tempéré, qui impose de conserver l’objet plutôt que de le détruire : que la haine soit harnachée par l’amour, dirait Freud. D’aucuns parleraient ici de la fonction contenante de la mère […] Interdire est alors favoriser l’instauration d’un surmoi plus évolué, qui ne participe pas seulement de la pulsion agressive, mais aussi du rapport à un objet aimé intériorisé » (p. 104). Une telle intervention pourrait surprendre si on s’en tenait à la conception habituelle de la neutralité requise dans la cure type.
C’est sans doute cette notion de fonction contenante qui permet de dépasser l’aporie entre nécessité d’intervenir (pour contrer la destructivité), et nécessité de respecter l’espace propre du patient (sauf à représenter une menace pour lui).
L’analyste est utilisé comme double narcissique rassurant, comme témoin-déversoir d’un trop plein non assimilable, comme recours qui contient, qui comprend, comme garantie de survie. L’analyste est celui qui n’interprète pas, qui tente d’assimiler pour lui-même le non assimilable et qui se souvient.
Ainsi, le passage à l’acte doit-il être contenu, calmé plutôt qu’interprété. En effet, interdire le passage à l’acte ne sert souvent à rien, et peut même le favoriser. Par contre, on peut tenter de l’anticiper, en essayant de ramener les choses au sens. En cas d’acting, il est important d’empêcher que tout soit détruit, de restaurer le cadre éclaté, de permettre de penser rapidement ce qui vient de se passer ; de construire un espace intermédiaire (ce que l’auteure illustre par une vignette dans laquelle, n’ayant pu empêcher qu’une de ses jeunes patientes ne casse un objet chez elle, elle lui propose un nouveau rendez-vous le jour-même pour en reparler, ayant par ailleurs faire réparer l’objet cassé, dont elle lui communiquera toutefois la facture…)
Paulette Letarte consacre un chapitre aux passages à l’acte qui constituent des mises en danger : « « On » joue avec la mort ». Elle y voit la mise en jeu, souvent répétitive, d’un fantasme d’immortalité, de toute-puissance, qui lui-même tente sans doute de contrer un fantasme inverse de nullité. Le psychothérapeute n’a d’autre choix ici que d’être réducteur de toute-puissance, d’immortalité, tout en sachant que ces fantasmes soutiennent les patients. Malheureusement, ces histoires finissent souvent mal (échapper à la mort ayant renforcé le fantasme, et donc poussé le patient à recommencer), et confrontent l’analyste à ses limites, et c’est aussi sa fonction que de les accepter.
Accepter ses limites, c’est également toujours laisser la place au tiers dans ces prises en charge, et l’auteure y insiste tout au long de l’ouvrage.
Elle le mentionne dès les premiers textes quand elle présente son cadre de travail, qu’il soit libéral ou hospitalier (elle a longtemps suivi des patients à la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale à Sainte-Anne, ayant pris la suite de Francis Pasche à la direction de la consultation de psychothérapie de ce service), qui comporte toujours un double suivi, psychothérapique et psychiatrique.
Mais elle y insiste aussi sur le plan strictement psychothérapique, dans l’appui sur le groupe de psychothérapeutes avec lesquels elle travaillait à Sainte-Anne (et du groupe de psychothérapeutes auquel elle a longtemps appartenu également à la Clinique Georges Heuyer, établissement soins-études dans lequel j’ai eu la chance de collaborer avec elle).
Elle précise les fonctions irremplaçables de ce travail de supervision (ou d’intervision) :
« – favoriser la difficile mise en mots des affects archaïques
– respecter la liberté de penser de l’autre, et oser poser les questions
– partager des éléments de son expérience personnelle pour diminuer la tension et enrichir les échanges
– dépister les indices de contre-transfert projectif et les désirs cachés de mort
– ne pas réagir sur un mode dénonciateur triomphaliste aux erreurs ni sur un mode infantilisant aux angoisses
-savoir mettre un obstacle aux mouvements régressifs du thérapeute
– ré-inclure au besoin la profondeur de la pensée symbolique.
– se poser en témoin de l’extra-psychique, de la réalité extérieure et lui donner sens. (p. 22) »
Toutes ces fonctions témoignent a contrario de la grande difficulté de ces cures, liée en particulier aux mécanismes de paradoxalité en jeu : « Se soustraire à la vie pour échapper à la mort : c’est l’un des paradoxes fondamentaux à l’intérieur duquel le thérapeute de schizophrène doit lui-même survivre […] Le schizophrène voudrait à la fois nous déborder et être retenu, avoir raison de nous et retrouver sa raison, maintenir ou restaurer un équilibre, fut-il pathologique, nous faire servir sa schizophrénie (p.142) » De ce fait, le sujet observé se trouve tout autant dans le thérapeute que dans le malade. Le thérapeute ressent souvent à la place du patient. Le patient induit chez lui « la perpléxité, les paradoxes, les régressions prégénitales, les clivages du moi et de l’objet (p.144) ». C’est lui qui doit assumer l’ambivalence que le patient rejette.
Or s’il est si important que l’analyste « survive » à tous ces mécanismes archaïques et pathologiques, c’est afin de pouvoir maintenir avec le patient une relation suffisamment empathique et humaine. Je souhaite souligner cette dimension, si décriée aujourd’hui, au nom d’une certaine orthodoxie analytique, et qui est revendiquée par Paulette Letarte. « Nous devons être d’obédience clinique et humaine » nous dit-elle, et nous garder de l’idéalisation (du malade, de notre fonction d’analyste, et de nos références théoriques).
Ainsi dans son récit bouleversant d’une cure auprès d’un patient atteint du sida et qui se trouve en fin de vie (« Une psychothérapie de dernière heure… ») : « J’ai voulu vous faire part d’un vécu de souffrance, d’une expérience qui n’a pas été désespérante dans la mesure où elle a été partagée. Jusqu’à ses derniers moments, il donne sens à sa vie (p. 251). » Mais, dans des circonstances moins dramatiques, cette dimension est présente tout au long de l’ouvrage.
Dès le deuxième chapitre par exemple (« Les nouveaux psychotiques »), à propos d’un patient dont la cure lui a permis de se dégager d’un fonctionnement paranoïaque en retrouvant ses émotions liées à la disparition précoce et brutale de son père dans un contexte particulièrement traumatique. Il a pu adresser à l’analyste toute sa crainte d’être abandonné ; il a trouvé en elle l’objet narcissique et fiable qui lui manquait, et a désinvesti progressivement son délire.
Mais aussi de façon particulièrement illustrative dans le chapitre intitulé « La peau d’Anna. Traitement au long cours d’une adulte psychotique ». Paulette Letarte rapporte ici de façon savoureuse comment elle aide sa patiente à prendre conscience d’elle-même (de sa sensation de froid, et de mal voir), en lui transmettant ces mêmes sensations éprouvées par elle, la thérapeute, par identification à la patiente (n’hésitant pas à mettre ses lunettes de travers comme la patiente pour comprendre comment celle-ci voit le monde). Or cette expérience d’identification lui permet précisément de se sentir différenciée de l’analyste ; elle acquiert la possibilité d’être à l’intérieur de soi, et de regarder à l’extérieur de soi.
C’est aussi le cas dans le chapitre « A partir d’un roc : de la quantité à la qualité » : « L’action de l’analyste ressemble à celle de la mère d’un très jeune enfant : [elle] cherche à transmettre la saveur d’un mets nouveau, [tente] de circonscrire le lieu d’une sensation, de le reconnaître et le faire reconnaître, celle qui apprend à retenir ! On observe alors une diminution de la quantité d’excitation au profit d’une qualité de plaisir. La vie acquiert une saveur ! Par l’intégration de la composante anale, on assiste à une ouverture en direction d’une éventuelle symbolisation, vers la sublimation (p. 209). »
« L’action de l’analyste consiste à enrichir imperceptiblement ce langage qui montre sans trop dire, à l’infléchir vers un langage qui signifie sans faire […] :
– les mots du corps sont représentés, les sensations sont nommées, les sentiments sont exprimés […]
– la mise en mots, la référence à un personnage tiers, l’évocation d’un autre temps de la thérapie, l’allusion à un autre lieu viennent mettre obstacle au rapprochement et compléter l’ouverture en direction du symbolisme (p. 211). »
Il faut à la fois rapprocher et éloigner, et ainsi maintenir un équilibre entre regard intérieur et extérieur.
C’est en effet tout l’enjeu d’un traitement psychanalytique avec ces patients que de leur permettre de constituer un espace psychique plus sûr, mieux délimité, mais précisément parce qu’il est plus ouvert à l’échange avec l’autre.
Et c’est une extraordinaire leçon que nous offre ce recueil des écrits de Paulette Letarte en exposant de façon si intime son expérience éclairée par sa réflexion, ce qui nous permet, en comprenant mieux nos patients, de mieux nous comprendre nous-mêmes.
Benoît Servant, Psychanalyste, membre de la SPP.
Claire Squires et Sarah Bydlowski (Dir.), Un bébé pour soi, Assistances à la procréation et mutations familiales, Paris, Editions Campagne première, 2019.
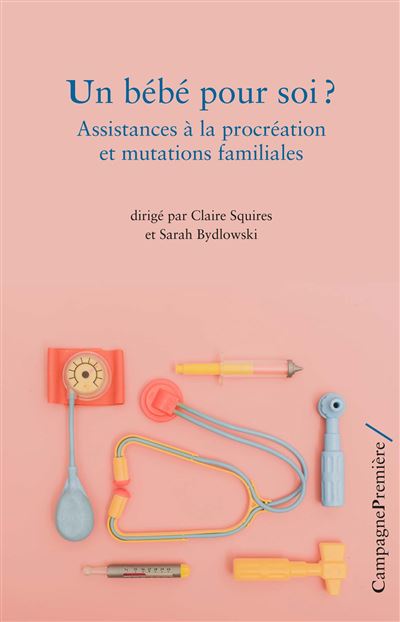
Un bébé pour Soi, aborde l’immense champ bio-psycho-socio-culturel de la procréation médicalement assistée et de ses conséquences psychiques, tant pour les enfants que pour leurs parents tout aussi bien au sein des familles dites traditionnelles que « des nouvelles familles ».
À la transmission intergénérationnelle du mariage traditionnel et à la procréation qui lui était intimement associée se substitue un bouleversement où fécondations in vitro, dons de gamètes, gestation pour autrui résonnent avec transgression, dettes, doutes identitaires, modifications des liens de filiation.
Les contributeurs de cet ouvrage, biologistes, gynécologues, psychiatres, psychanalystes, sous la direction de Claire Squires et de Sarah Bydlowski, interrogent l’engagement narcissique : « un bébé pour soi » de ces parents (couples hétérosexuels ou homosexuels) et de ces mères qui ont recours à une assistance médicale pour procréer.
Le risque pour cet enfant virtuel serait-il d’être chargé « de présider à la naissance de ses parents », comme le suggère Sarah Bydlowski ?
L’enfant du XXIe siècle deviendrait il plus que jamais un enjeu narcissique ?
La question de la fertilité et de l’in-fertilité tient également une place importante dans l’ouvrage. L’in – fertilité comme défense psychique active à respecter est questionnée par plusieurs auteurs à la suite de Monique Bydlowski[1].
L’expérience pour les auteurs, dont plusieurs sont psychanalystes, d’un suivi psychothérapique de femmes en postpartum et de traitements mère-bébé et père-mère-bébé, permet d’observer en diptyque, d’un côté, les effets sur le couple parental et, de l’autre, les effets sur le développement psychique de ces enfants conçus avec l’intervention d’un tiers médical et d’un tiers donneur dans un grand nombre de cas.
Infertiles : devenir parent avec la PMA, constitue le premier chapitre.
Christine Anzieu-Premmereur, dans un souci de prévention, met l’accent sur la spécificité propre à chacun de ces couples et sur l’écoute nécessaire des sentiments ambivalents qui les habitent.
Sarah Bydlowski illustre par un cas clinique très approfondi la discontinuité d’investissement d’un bébé fille par sa mère, bébé né par don d’ovocytes. Difficile de démêler, dans la pathologie narcissique très sévère de la mère, ce qui serait inéluctable et propre à une naissance naturelle de ce qui a particulièrement flambé ici, introduisant par les ovocytes et le don, une autre femme. L’association faite par la patiente au bout d’un temps de suivi avec sa propre mère accouchant d’elle : « accouchement traumatique et leur séparation à la suite d’un grave accident obstétrical » apparaît comme l’axe central de la difficulté à investir.
L’émouvant récit clinique, relaté par Sylvain Missonnier, nous confirme l’intérêt de cette clinique de la prévention et de ses aléas. Autour d’un récit d’infertilité, Missonnier traite « des obstacles générationnels traumatiques ». Dans un style profondément humain, il nous entraîne dans une sorte de roman policier où s’entremêlent conflit œdipien et grande Histoire au profit d’un heureux happy end. En conclusion, fort de son expérience et de ce beau récit, qui pourrait sembler prôner une réalité psychique toute-puissante, il rappelle l’unité psyché-soma et plaide pour sa conviction d’un dialogue interdisciplinaire, dialogue nécessaire au dépassement de « l’infertilité inexpliquée ».
Ce qu’illustre l’article suivant avec le travail transdisciplinaire entre la psychologue Ophélie Ségade, la pédopsychiatre Bérangère Beauquier-Maccota (Necker Enfants Malades) et Véronique Drouineaud, médecin biologiste de la reproduction (CECOS de Cochin).
Recherche en cours sur un suivi des familles « issues d’un don de gamètes ». Cette étude, qui en est à son tout début, s’intéresse tant aux parents qu’à l’enfant dans un travail longitudinal : ses premiers résultats sont rassurants.
À noter l’arborescence d’un nouveau vocabulaire co-parentalité, paternalité etc.
Malgré un certain nombre d’études qui vont dans ce sens les auteures de l’article suivant, Claire Squires et Hélène Ferrary, montrent que l’on peut franchir l’obstacle de l’infertilité par la naissance d’un enfant, mais paradoxalement continuer à souffrir au long cours de sa stérilité, que celle-ci soit masculine ou féminine.
– Parents Gays, Lesbiens, Transgenres.
« Pères gays entre coparentalité et gestation pour autrui » nous livre deux approches cliniques de pères gays. L’auteur, Alain Ducousso-Lacaze, reste prudent et nuancé quant aux réaménagements propres au devenir parent et au lien au tiers de procréation, tiers investi et présent – présence féminine– dans les deux cas étudiés.
– La société en mutation.
Dans « Actualités et perspectives », René Frydman rappelle les textes de loi puis soulignent leurs incohérences. Pas assez de donneuses en France pour le don d’ovocytes, analyse génétique de l’embryon non autorisée avant transfert dans l’utérus, dans les situations à risque, contrairement à ce qui se passe dans les grossesses naturelles. Il soutient avec force l’autoconservation ovocytaire préventive sans pathologie particulière et l’autorisation du don de sperme aux femmes célibataires.
Jean Philippe Wolf, médecin directeur du CECOS, met à la fois en garde contre un certain leurre de la conservation d’ovocytes et nous ouvre aux techniques d’avenir pour combattre l’infertilité.
Monique Bydlowski se demande « pourquoi tant de bruit » autour de la GPA (gestation pour autrui), si ce n’est la fascination pour la transgression que suscite ce prêt ou cet achat du corps d’une autre femme et « soumis au seul principe de plaisir du narcissisme sans limite ».
Luc Roegiers, pédopsychiatre, plaide pour des études empiriques responsables, ni idéologiques ni démobilisatrices, et sur l’attention à apporter à ces situations. Ces études peuvent être, de plus, comme il le soutient et, comme on le constate dans cet ouvrage, des outils pour un travail transdisciplinaire.
En 2019,
année d’adoption d’une nouvelle loi de bioéthique, les auteures, en conclusion,
espèrent que les idéologies diverses n’étoufferont pas les besoins ni la diffusion du nécessaire travail de
collaboration dans toutes ces situations ainsi que la nécessité ’une écoute psychanalytique.
[1] Monique Bydlowski, Les Enfants du désir, Odile Jacob, 2008 ; Sylvie Faure-Pragier, Les bébés de l’inconscient : le psychanalyste face aux stérilités féminines aujourd’hui, Puf, 2004.
Joyceline Siksou, psychanalyste, membre de la SPP.

