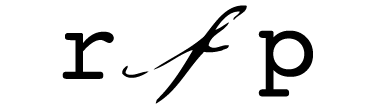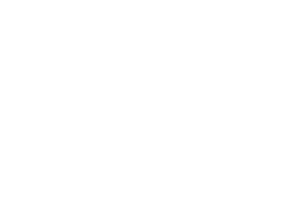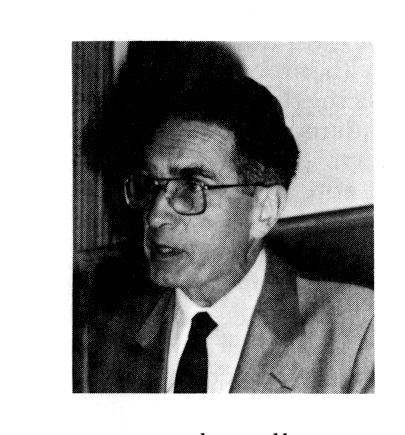
Maurice Bouvet Les résistances
La cure psychanalytique classique : 121-217. Paris, Puf, « Le fil rouge », 2007 […]
Je vais donc successivement vous présenter :
1.– les résistances du « trop éprouver » : résistance du transfert (Freud) ;
2.– les résistances du « trop comprendre » : résistance au transfert ;
3.– et j’ajouterai quelques mots des résistances de caractère, indépendantes de la situation de transfert et d’exercice permanent.
Pour chacun de ces groupes cliniques, je suivrai dans mon exposé le même plan ; je consacrerai d’abord quelques lignes à des notions générales sur ce type de résistances en faisant état éventuellement des descriptions de Federn, pour bien montrer que le comportement analytique de ces sujets découle des caractères généraux de la structure de leur Moi, et illustrer ainsi cette notion que la résistance n’est qu’une connotation par rapport au travail analytique de la notion de défense, ce qui deviendra évident à la confrontation des modalités réactionnelles générales de ce type de personnalité et de leur comportement en analyse. Après quoi je décrirai quelques modalités cliniques de ce type de résistances pour dire enfin quelques mots sur sa réduction (analyse).
Résistances du « trop sentir » (ou Résistances du transfert)
[…]
Ce sont des sujets dont le Moi est passif. Incapables d’une maîtrise active de la réalité, ils s’en remettent à d’autres du soin de régler leurs difficultés ; pour reprendre une expression de l’auteur, ils sont comme des enfants qui ont sans cesse recours à leur mère. Leur « Moi psychologique » est incapable de faire face à un conflit, il ne se défend d’une situation angoissante qu’en se détournant d’elle par l’évitement, l’exclusion. De tels sujets, n’ayant pas les moyens de dominer les situations conflictuelles, se laissent facilement emporter par des orages affectifs qui donnent lieu à des crises violentes, excessives, qui ne représentent pas une modification substantielle de leur position en face du monde, mais un effondrement brusque de leur système d’adaptation à la réalité, effondrement sans lendemain d’ailleurs, puisque l’activité défensive reprend bientôt ses droits (évitement), ce qui fait qu’aux orages succèdent des phases de calme et ce qui explique leur apparente labilité. Tout paraît s’être évanoui, tout paraît être oublié, il n’y a plus rien, il semble que rien n’ait jamais existé.
[…]
Avant d’en terminer avec ces quelques notes, sur la défense du Moi hystérique et par conséquent sur sa manière de résoudre un conflit, je voudrais dire quelques mots d’une notion qui me paraît importante et que je compte développer ailleurs. Il s’agit de celle de la différence foncière entre la phobie prégénitale et la phobie œdipienne banale. J’ai pu constater en effet qu’il y avait là deux aspects du syndrome phobique qui s’opposaient tant sur le plan sémiologique que sur le plan psychopathologique et pronostique. Ce que j’appelle phobie prégénitale et qui correspond sensiblement à la phobie paranoïde de Glover, est un syndrome phobique en soi analogue au suivant, mais plus complexe, plus diffus, ayant une tendance plus marquée à l’extension, à la multiplicité des manifestations, mais surtout il se développe chez un sujet qui présente plus ou moins manifestement, mais toujours de façon indiscutable, à condition que l’on sache les chercher, des troubles marqués de la structure du Moi. Les phénomènes de dépersonnalisation aigus ou chroniques ne manquent jamais. Ils peuvent n’être sensibles que dans des situations particulièrement traumatiques, quand le niveau des activités défensives est assez abaissé. Les manifestations psychosomatiques se développent fréquemment au cours de l’analyse, les phénomènes de conversion hystérique, tout à fait typiques, ne sont pas rares ; ce tableau si complexe d’un pronostic tout à fait réservé, car ses états sont voisins de la psychose, s’oppose, sans qu’il soit utile d’y insister davantage, au tableau simple de la phobie œdipienne, phobie souvent unique, sans tendance excessive à l’extension et au polymorphisme, se développant sur un Moi relativement fort, sans phénomène de dépersonnalisation, de pronostic relativement sûr.
[…]
Réduction
La réduction de ce type de résistances doit présenter une physionomie assez spécifique pour que son isolement soit justifié. Résumons les données du problème.
1.– Le sujet vit dans le présent et ne s’observe pas. Il faut rétablir sa faculté d’observation. Il n’établit aucune connexion avec le passé et risque de s’engager dans une névrose de transfert grave, même s’il nie son transfert d’affects ou d’émois, ou le masque derrière un transfert de défense maximum – tout est dans le présent.
2.– Le sujet vit sa vie analytique avec le minimum d’angoisse puisque la situation ne serait vraiment traumatique que s’il lui donnait tout son relief en rétablissant des connexions avec le passé. C’est là l’aspect défensif et par conséquent de résistances de cette situation auquel j’ai dit plus haut que je ferai allusion, un autre consistant (Freud) en l’épuisement de toute l’énergie instinctuelle dans les satisfactions substitutives du dialogue analytique, ce qui rend le sujet inapte mais lui évite de chercher des sources normales de satisfaction.
[…]
Les conséquences thérapeutiques d’une telle assimilation peuvent se normaliser ainsi : en sus de l’analyse du transfert de défense, ou mieux du comportement défensif fait de mécanismes de défense et de satisfactions instinctuelles, facilitant l’émergence du transfert d’affects et d’émois accompagnant les poussées instinctuelles, qui doit là comme ailleurs être pratiqué, l’attention du sujet doit sans cesse être ramenée sur l’avantage défensif qu’il trouve à ne pas saisir que dans son attitude générale actuelle il ne fait que reproduire ce qu’il faisait dans le passé – « il se contente de vivre » –, et dans le détail à lier autant que possible, en de très nombreux rapprochements, le présent et le passé.
[…]
La résistance au transfert
Généralités
Ici la situation est exactement inversée. Le sujet est trop poussé à observer et à comprendre, ce qui implique automatiquement une évocation prédominante du matériel du passé ou du présent mais surtout du passé, ce qui ne serait guère préjudiciable si le sujet ne se mouvait à l’aise dans son passé, et d’ailleurs dans son présent, que grâce à une désaffectivation générale de celui-ci. […] Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la partie la plus traumatique du passé est refoulée ici comme ailleurs et que ce n’est qu’aux progrès du transfert, c’est-à-dire au jaillissement des affects dans le présent, que correspondra un véritable défoulement.
[…]
Modalités générales réactionnelles du Moi obsessionnel de Federn
[…] il oppose trait pour trait le Moi obsessionnel au Moi hystérique. Le Moi obsessionnel est un Moi fort, durci, précocement rompu au travail psychique (un Moi précocement intelligent, à tel point que Freud s’est demandé si ce n’était pas à un développement prématuré du Moi qu’était due la névrose obsessionnelle), un Moi actif, Moi ne confiant pas à l’Ego-physique le soin de résoudre le conflit.
La défense est ici une lutte active. […]
La structure du Moi est contemporaine de l’âge sadique anal du développement, mais des traits normalement dissimulés derrière cet énorme effort de maîtrise traduisent la fragilité fondamentale du Moi et c’est à ce niveau qu’il faudra redescendre […]
Réduction
Ici la situation est tout à fait différente de celle qu’instauraient les résistances du groupe précédent. Dans les deux cas, le sujet évite d’établir des connexions étroites entre le présent et le passé qui leur donneraient à tous deux leur plein sens, mais alors que dans le premier cas les mesures défensives, et par conséquent les résistances, se bornaient en fin de compte à l’emploi de techniques d’évitement directes et simples, impuissantes à prévenir des « éruptions affectives » (Fenichel) dont elles triomphaient en fin de compte (refoulement), seule possibilité d’un Moi impuissant devant des orages qui le submergeaient par instant, le Moi étant trop accaparé par le souci de se maintenir dans la situation actuelle pour pouvoir suivre un quelconque dessein à longue portée et renoncer à l’oubli bienfaisant d’un passé douloureux, ici tout au contraire un Moi actif, depuis longtemps rompu à faire front à l’angoisse et à la juguler par un aménagement continuel, arbitraire mais efficace d’une réalité dont il orchestre minutieusement la représentation qu’il en tolère, habitué à gouverner, c’est-à-dire à prévoir, use de toutes ses possibilités pour maintenir sous son étroite tutelle une situation présente, où il craint plus que tout d’être débordé par des orages affectifs analogues à ceux dont il n’a qu’apparemment perdu le souvenir, et s’applique à nier toute participation affective à une situation dont précisément il ne veut connaître que l’aspect cognitif et qu’il entend bien utiliser au mieux de ses habituels moyens de gouvernement ; or, comme ses techniques se situent dans le jeu même de la pensée, il en montre plus aisément tous les ressorts, si habile qu’il soit à les tenir secrets, et c’est ainsi qu’alors que le premier ne pouvait que vivre et n’était pas en mesure de se pencher délibérément sur le vécu antérieur, le second s’accrochera à la connaissance, s’efforcera d’y puiser de nouveaux éléments de maîtrise et se détournera automatiquement d’un présent, j’entends dans le cœur même de l’analyse, où il pourrait perdre pied, si seulement il consentait à le percevoir entièrement. Pour éviter tout anthropomorphisme abusif, disons que l’un et l’autre agissent ainsi en fonction de leur état présent et non parce qu’ils le veulent, et que rien n’est plus éloigné d’une attitude « arrêtée » que l’usage de ce genre de garantie que le sujet prend contre l’imminence d’une situation traumatique.
Ainsi, alors que pour le premier, vivre était inévitable, pour le second, connaître s’impose, et de toute manière la restitution intégrale au Moi du passé vécu manque dans le premier cas parce qu’il serait trop vivant à la lumière des explosions actuelles auxquelles il donnerait tout leur sens, dans le second parce qu’il perdrait ses caractères de neutralité si, présentement, un certain laisser-aller émotionnel s’installait.
De toute manière le résultat final est le même, mais certaines qualités spécifiques imposent des conduites différentes à l’analysé, et partant à l’analyste. Ici le transfert de défense est en fin de compte plus saisissable et s’il est difficile d’en faire admettre l’existence au sujet, il est plus à portée de l’analyste du fait même qu’il nourrit le discours et ses intentions, alors que dans le premier cas il revêtait un caractère d’automatisme, de fatalité même qui était d’autant plus difficile à défaire que favoriser les libérations affectives ne servait qu’à déclencher des abréactions insupportables et inutiles, épuisant d’un coup tout le potentiel instinctuel du sujet et qu’il fallait sans cesse prendre bien soin de lier au continuum du sujet et avec tant de prudence et de patience, le peu qui était tolérable, en lui montrant qu’il est plus facile de subir sans se rendre compte, et en lui mettant sans cesse sous les yeux ce que signifiait autrefois, ce par quoi l’on est possédé maintenant. Ici l’analyse de la défense fait lentement émerger les affects et les émois, et le présent restitué dans toute sa plénitude donne toute sa valeur au passé ; et de la démonstration de toute la signification défensive de la connaissance pure, par l’expérience de l’illusion que l’on a de connaître la situation présente en la croyant limitée à un rapport rationnel, alors qu’elle est pleine d’une tout autre chose que l’on évite par l’usage de techniques en réalité préventives, résulte la destruction du mythe de la vérité de l’intellectualisation qui n’apparaît plus alors que comme une appréhension aussi fallacieuse que l’était celle de la situation analytique. Si le but final reste le même, la démarche est de sens inverse. Réduire la résistance du Moi hystérique consistait à donner un sens à ses affects actuels par référence au passé ; réduire celle du Moi obsessionnel consiste à donner un sens à son passé en lui rattachant des affects actuellement découverts. Ainsi faudra-t-il sans cesse attirer l’attention du sujet sur les défenses qu’il utilise, pour éviter que ses affects violents, sans nuance, disproportionnés, ne vivifient la situation analytique (j’y ai insisté plus haut en parlant des résistances des obsédés), et lui montrer que si son passé lui est si accessible, c’est grâce à une méconnaissance analogue de sa réalité affective.
[…]
Les effets de l’interprétation des résistances
Il est classique de dire que l’interprétation des résistances favorise l’émergence du transfert d’affects et d’émois liés aux pulsions instinctuelles, pour s’exprimer dans les termes de la classification d’Anna Freud, et au contraire que la démonstration du caractère répétitif de ces derniers, grâce à la référence historique, diminue les tensions de transfert. Cela reste vrai dans les grandes lignes, mais outre que le transfert est en soi, surtout quand il est toute l’analyse, une résistance d’une part, et que d’autre part, et particulièrement dans le cas de la résistance du transfert, la référence historique n’est allégeante que dans la mesure où elle est administrée au bon moment, je préférerais définir l’analyse de la résistance comme l’ensemble des procédés techniques aboutissant à la résurgence dans la situation expérimentale de l’analyse de la situation traumatique ou des situations micro- traumatiques, d’une façon atténuée certes mais tout de même réelle. Je crois avoir suffisamment démontré qu’une telle résurgence exige l’établissement de connexions aussi étroites que possible entre le présent et le passé et dans les deux sens, mais j’ajouterai, pour compléter ma précédente définition, et qu’en face de cette situation les voies normales de décharge soient rétablies. À quoi servirait en effet qu’une situation traumatique soit restituée si le sujet encore sidéré par l’angoisse ne pouvait y exprimer pleinement ses exigences instinctuelles, les verbaliser sous leur forme première avec tous les émois et les affects qui les accompagnent. Il y aurait encore là exercice d’une résistance, très légère, peut-être moins évidente, mais marquant une difficulté de réintégration qui pourrait éventuellement être le point de départ d’une relation d’objet à nouveau régressive et d’une reconstruction de l’édifice névrotique. Si l’analyse de la résistance facilite l’apparition de la situation traumatique, il est à préjuger que sa mise en lumière, son analyse ne puissent guère être du goût du sujet, et je ne crois pas que l’on puisse ici parler à coup sûr d’une réaction de soulagement. À vrai dire l’interprétation valable de celle-ci pourra être accueillie de façon fort diverse suivant qu’elle est très peu consistante ou qu’au contraire elle est très forte, ou encore que le gain libidinal obtenu par la satisfaction de compréhension prime toute autre considération. Aussi je ne crois guère avec Fenichel que l’on puisse déduire quelque chose de la réaction du sujet, et c’est la perception intuitive d’une certaine concordance dans le présent, le mouvement évolutif dans l’avenir qui décideront de la réussite d’une interprétation. Encore la preuve indubitable fournie par la reprise de l’analyse ne sera-t-elle dans l’immense majorité des cas obtenue qu’après que la réitération de l’interprétation aura creusé l’obstacle de telle manière qu’il ne pourra plus tenir debout. Faut-il renouveler l’interprétation sous une forme immuable ou en varier l’expression ? Je ne pense pas qu’ici l’on puisse recommander une conduite rigide ; rien ne doit être plus exaspérant pour un malade qui ne peut voir une vérité que de se l’entendre proclamer d’une voix neutre et sous une forme strictement identique. Je pense que beaucoup plus convaincante est une intervention simple, vivante, qui sans s’écarter d’une ligne de conduite inflexible dans son tracé, est capable d’un certain éclectisme dans le choix des termes comme de la manière et du moment. L’essentiel à mon sens est de ne changer ni de point de vue ni de niveau avant que l’effet désiré ne soit obtenu. L’on serait tenté d’essayer d’analyser rapidement les principales surdéterminations d’un comportement défensif avec l’espoir de lever plus rapidement l’obstacle. Ces coups de sonde peuvent réussir ou paraître réussir, mais est-on sûr que l’on n’ait pas ici favorisé l’apparition d’un nouveau comportement défensif. Jacques reste figé dans sa passivité malgré l’interprétation réitérée de son rôle défensif contre son agressivité œdipienne ; il est évidemment tentant de l’interpréter comme une protection cette fois contre son agressivité prégénitale envers moi. Mais si l’ensemble de l’analyse n’est pas tel qu’il puisse éprouver le changement d’atmosphère qu’une telle régression implique, je lui fournirai un refuge facile. Il pourra manier, sans y participer, des formes d’agressivité qui n’auront pour lui qu’un quantum de réalité insignifiant ; non, la souplesse de la formulation réside dans le ton, la fréquence, le point d’impact ; sa forme peut être variée, l’essentiel est que l’analyste ait le sentiment qu’il suffise d’une variation insensible de l’état intérieur pour qu’elle paraisse évidente.
L’on m’objectera peut-être que si la source profonde de la résistance appartient à une forme très archaïque de l’état du Moi et des pulsions, les choses risquent de stagner définitivement et la résistance toujours maintenue, l’interprétation n’atteignant jamais son but. C’est une objection valable mais à bien voir, quoiqu’elle soit refusée, les effets dynamiques d’une telle interprétation sont équivalents à ceux d’une interprétation acceptée. Le matériel, que ce soit du fait de la simple continuation de l’analyse, et je ne le crois pas, ou de celui de l’interprétation, qui possède plus de sens que n’en contient strictement sa formulation, se montre de plus en plus régressif et la forme générale du transfert change tant et si bien que le sujet nous autorise à aborder la motivation la plus profonde de son comportement défensif.
[…]
Ainsi, si la souplesse que je recommande dans l’interprétation de la résistance au même niveau et sans changement de point de vue, correspond sensiblement à l’élaboration interprétative de Fenichel, je pense que la redécouverte spontanée par le sujet, la notation par lui de toutes les manifestations instinctuelles qu’il se cachait n’est qu’assez tardive et ne se produit que quand tous les filins qui retenaient « le navire au port » ont été tranchés. Cela peut arriver rapidement quand le conflit le plus important qui nourrit la résistance est superficiel, beaucoup plus tardivement quand il est plus profond sans que pour autant le travail analytique soit arrêté.
Quand cette attitude du sujet est acquise, alors le matériel se simplifie et s’éclaire, mais je le répète : il me semble que sa collaboration totale n’est obtenue qu’en fin de course ; auparavant il y a bien des périodes où il semble avoir renoncé à se cacher la vérité, et il est classique de dire que les résistances réapparaissent, alors qu’elles avaient préalablement disparu, quand l’on aborde un nouvel aspect du conflit ou un conflit nouveau. Cela est certainement exact, mais encore ne s’agit-il ici que d’une disparition assez superficielle, transitoire et relative. En fait, la résistance subsiste en puissance, l’acquiescement est partiel, la normalisation et l’interprétation spontanée du matériel limitées. Quand la résistance s’accuse à nouveau, il se peut, lorsque l’on amorce un conflit plus ancien ou plus exactement le conflit fondamental, que la forme de la résistance change sans que pour autant les éléments essentiels qui la charpentent soient différents. C’est ainsi par exemple que les attitudes impuissantes de Jacques étaient, mais à un étage génital, l’équivalent de son sommeil à un « âge » prégénital. Sa passivité prenait un masque différent suivant le niveau d’organisation de la personnalité où elle se manifestait. Ce polymorphisme n’empêche nullement que les ressorts restent les mêmes, les bénéfices secondaires identiques et l’analyse identique.
Les résistances doivent être traitées de façon un peu particulière à l’orée et au déclin du colloque analytique, ce sont là des aspects bien connus de leur analyse et je n’y insisterai pas.
Au début de l’analyse, il est souvent impossible de fournir d’une résistance une interprétation complète, elle n’est d’ailleurs pas toujours recevable par le sujet sous sa forme la plus élaborée sur laquelle je reviendrai plus loin. L’on ne sait le plus souvent ni son motif ni son histoire, et pourtant il est judicieux de ne pas la laisser s’éterniser, le sujet tendant à se durcir dans un comportement dont on ne lui signale pas la signification. Par ailleurs, il est préférable de ne pas lancer au hasard une explication en l’air ou trop générale. Si l’interprétation est fausse, le sujet peut utiliser la voie qu’on lui indique aux seules fins de résistance. Il vaut donc mieux suivre le conseil de Fenichel et lui faire remarquer qu’il est en état de résistance, si l’on n’a rien de plus valable à lui dire. Le sujet peut se découvrir alors et montrer plus directement ce qu’il tenait à se cacher. Au surplus, cette forme d’interprétation est en accord avec le principe général de la superficialité.
À la fin du traitement il n’est pas rare, après qu’une date ait été arrêtée qui marquera la fin de l’analyse, que des manifestations morbides analogues à celles qui ont commandé le traitement ou légèrement différentes réapparaissent ou apparaissent, elles doivent alors être interprétées comme autant de manifestations de résistance à la prise de conscience, et du besoin satisfait dans l’analyse, et du désir actif de la poursuivre. Elles se présentent en effet de façon évidente comme autant de raisons qui obligent le sujet qui les subit à prolonger sa thérapeutique. Sans doute beaucoup de ces symptômes apparaissent clairement comme des relations d’objet régressives dont la nécessité se fait transitoirement sentir au moment où va se rompre la relation d’objet transférentielle même suffisamment normalisée, mais il n’en reste pas moins qu’elles ont une fonction de résistance.
Avant d’en terminer avec cette partie de mon exposé, il me paraît nécessaire pour concrétiser les enseignements qui se dégagent de ce que je viens d’écrire dans cette quatrième partie, de donner un exemple d’interprétation complète de résistance.
Interpréter complètement une résistance, ce n’est pas d’emblée, sauf un cas extrêmement simple, mettre en évidence un mécanisme défensif dont on ferait purement et simplement état ; il arrive que les choses se présentent ainsi pour l’annulation rétroactive, certaines formes d’isolation évidente ; le plus souvent l’on a affaire à un comportement défensif plus complexe dans la psychogenèse duquel interviennent simultanément divers mécanismes élémentaires dont les motivations sont nombreuses, et qui permet certaines satisfactions substitutives de pulsions instinctuelles dont la forme et partant la formulation varient selon le moment de l’analyse. Ajoutons à cela que ledit comportement a une histoire, qu’il eut des ancêtres qui servirent dans des circonstances analogues à celles actuellement revécues et pour les mêmes fins en assurant, là encore, l’exutoire minimum aux instincts et aux affects qui les accompagnaient. La réduction complète du comportement défensif devra rendre conscients ces divers éléments pour que sa réintégration au Moi en soit complète et qu’il perde son caractère d’automatisme, autrement dit qu’il cesse dans la vie analytique où il n’a aucune raison logique d’être utilisé. Cela ne veut pas dire pour autant que, sauf dans une interprétation synthétique de rappel, la révélation de tous ces constituants doive être faite en une fois, car alors l’interprétation trop longue perdrait de ses effets dynamiques au profit d’un apport presque exclusivement intellectuel, ainsi que l’un de nous (Nacht) l’a noté. C’est au hasard des moments favorables que l’interprétation est complétée à seule charge que les appoints successifs qui lui donneront toute sa complétude soient façonnés selon un certain ordre logique, quoique dépourvu de rigidité dans ses exigences.
Il faut d’abord faire prendre conscience au sujet qu’il se défend – c’est là évidemment le premier pas, et nous le savons, c’est loin d’être toujours commode – qu’il se défend en utilisant tels ou tels « petits moyens » qui répondent à la façon dont s’exercent concrètement quelques grandes techniques générales de défense (mécanisme élémentaire, Anna Freud). Ces « petits moyens » varient selon chacun, ils donnent son cachet individuel à la technique de défense, ils sont en général bien reconnus du sujet, il en voit facilement l’usage dans une multitude de circonstances. Ils constituent les instruments de la défense qui peut en fin de compte être ramenée à un ou des mécanismes élémentaires. De telles interprétations comportent déjà souvent une allusion à ce que le sujet ne veut pas percevoir de ses exigences pulsionnelles, mais il arrive aussi qu’il ne les aperçoive pas quoique l’analyse du processus défensif soit au fond déjà fort poussée et admise.
[…]
Je crois que la détection et la mise en lumière de la nature des satisfactions substitutives, filtrant malgré et à travers la défense, est un des temps essentiels de l’analyse de la résistance, comportement défensif qui est un compromis entre l’interdiction et l’instinct comme le symptôme ou le trait de caractère, temps important, car il ruine la défense en lui enlevant tout sens et favorise, en partant de l’actuel, du plus proche du Moi, l’émergence de ce contre quoi le sujet se défend. Quant à la référence historique, elle peut intervenir à un quelconque moment de la réduction d’une résistance, au cours de l’examen des « petits moyens » des mécanismes généraux élémentaires plus ou moins nombreux structurant le comportement défensif.
[…]
Conclusions
Arrivé au terme de cette étude où j’ai successivement envisagé la définition de la résistance, les travaux essentiels qui lui furent consacrés, eu égard à cette même définition, ce qui m’amène à considérer ce phénomène dans la très grande majorité des cas comme une conséquence de l’activité du Moi (notion d’autant plus importante qu’elle conditionne la réductibilité de la résistance et partant l’accessibilité à la thérapeutique analytique), et où je me suis essayé à un essai clinique de classification et de description avant de terminer sur une rapide revue des règles qui inspirent sa réduction, je voudrais m’efforcer de préciser en quelques phrases les avantages de la technique dont l’exposé a motivé ce travail.
En procédant à l’analyse des résistances comme je l’ai indiqué, c’est-à-dire en respectant le principe de la superficialité, du plus proche du Moi sous tous ses aspects, l’on obtient en effet une intégration au Moi aussi profonde que les choses le permettent, et ce, dans les conditions optima de sécurité et de naturel, je dis bien de naturel, car il me semble très important que dans une analyse, les évolutions, les intégrations se déroulent dans la forme que l’organisation névrotique d’une part, et les circonstances actuelles de l’autre, ont tendance à imposer spontanément l’analyste.
Il peut peut-être sembler à première vue que l’énoncé de règles » soit le reflet d’attitudes tout à l’opposé d’un accueil sans parti pris et d’une spontanéité sans faux-semblant, mais si l’on veut bien ne pas oublier que toutes ces règles se ramènent à l’observance d’un principe unique (superficialité), découlent très simplement du style de la résistance (du transfert ou au transfert), l’on pourra fort aisément se convaincre qu’elles ne peuvent ni constituer pour le thérapeute une préoccupation assez absorbante pour le gêner dans son attention flottante, ni nuire à la spontanéité et à la brièveté de son intervention, en la transformant en une démonstration compliquée, puisqu’aussi bien l’interprétation d’une résistance se complète progressivement dans une série d’interventions aussi nombreuses qu’il est nécessaire.
Cela dit, voyons ce qui se passe et ce que j’ai avancé plus haut se vérifiera aisément.
Le transfert de défense tendra à être réduit au fur et à mesure qu’il sera décelé, et déjà une partie du matériel extra-transférentiel sera incluse dans la réduction historique de ce même transfert de défense.
Quant au transfert d’affects et d’émois, que l’analyse de la défense tendait à faire émerger, il subira à son tour la réduction historique par référence spontanée (du fait du sujet) ou provoquée (par le médecin) à des situations traumatiques anciennes, à des modèles déjà vécus.
J’ai assez insisté sur cet entrelacement du présent et du passé pour n’avoir pas à y revenir.
Ainsi des intégrations progressives au Moi de plus en plus vastes, de plus en plus nombreuses se produiront dans l’ordre que les circonstances imposeront, qu’elles relèvent du cas ou de la vie actuelle, réactivation accidentelle de par les situations présentes, de position conflictuelle.
La névrose de transfert, complication majeure de l’analyse quand elle s’éternise, sera évitée, puisque aussi bien transfert de défense et transfert d’émois et d’affects seront progressivement dissous, et nous avons vu quelle orientation particulière imprime à la direction générale de l’action thérapeutique l’existence d’une des deux modalités de résistance : la résistance du transfert et la résistance au transfert.
Comme on me l’a fait remarquer au cours d’un colloque sur la fin de l’analyse, la persistance et l’aggravation de la névrose de transfert exigent une réponse contre- transférentielle inadéquate. Soit ; mais il n’empêche que l’absence de progrès de l’analyse, absence en rapport avec une analyse mal adaptée, de ces deux grands types de résistance, favorise ou même provoque inévitablement au bout d’un temps, l’apparition d’un contre-transfert vicieux, en réponse à la répétition indéfinie des comportements de résistance, et alors le cercle est fermé.
Mais surtout cette avance progressive permet d’utiliser toutes les ressources de l’analyse. C’est ce à quoi je faisais allusion plus haut en écrivant en substance que l’on pouvait pousser l’analyse aussi loin que les choses le permettent en toute sécurité.
L’analyse au plus près du Moi en effet, outre qu’elle évite les impasses d’une situation chaotique thérapeutique (situation où du fait d’interprétations trop profondes, des complexes, normalement étagés dans le temps, se trouvent artificiellement et anachroniquement réactivés, et où de ce fait, le matériel se présente en un imbroglio qui ne permet que difficilement l’appréciation, nécessaire pourtant, des corrélations entre ses éléments), l’analyse au plus près du Moi, dis-je, permet d’aller aussi loin que la structure du cas le permet sans risquer les drames d’un effondrement de la structure de la personnalité. J’ai déjà insisté sur ce danger majeur, le seul à vrai dire que puisse courir un sujet en analyse : que du fait d’une action traumatisante, ébranlant l’économie entière, le sujet soit automatiquement amené à utiliser les défenses plus régressives de la psychose, autrement dit, à franchir le seuil de la folie. En même temps, une crainte excessive devant un cas limite qui pourrait entraîner une abstention thérapeutique regrettable se trouve écartée. En se tenant au plus près du Moi, en effet, l’on évite « au mieux » à la fois les dangers d’une thérapeutique à l’estime et ceux d’une exigence trop rigoureuse dans la détermination des indications ; les choses tendent à se passer selon le « génie » de chaque cas ; le Moi n’abandonne ses activités défensives que dans la mesure où il peut assumer l’émergence de dérivés instinctuels moins aménagés par ladite défense, et cette liberté laissée au sujet d’abandonner ses défenses s’il le peut et quand il le peut, lui donne la possibilité de « se défendre », si son équilibre ne peut être maintenu, si mauvais soit-il, que dans la forme présente, en même temps qu’elle permet au thérapeute d’aller au plus profond qu’il puisse atteindre, et même dans des cas d’indication discutable en réduisant au maximum la crainte d’une brusque rupture de la personnalité.
Je ne prétends pas pour autant que cette technique de l’analyse des résistances ne suppose pas de variantes, ni qu’elle mette à l’abri de toutes les difficultés ; il serait absurde de l’imaginer.
J’ai assez montré qu’elle n’affirmait que la nécessité de se guider sur un principe unique et très général : celui de la superficialité, qu’il n’en découlait qu’une certaine manière de voir, qu’une orientation assez souple de la technique, pour qu’on ne puisse s’y méprendre ; et je n’ignore pas que, quelles que soient les précautions prises, des évolutions imprévues peuvent se produire, soit brutalement, soit à bas bruit, que tel comportement sensiblement adapté puisse se briser, par exemple, dès la mise en train d’une analyse, ou qu’une évolution psychotique puisse se préciser plus lentement. Mais je crois, tel est du moins ce que j’ai pu constater personnellement, qu’une telle technique est de celles qui donnent les meilleurs résultats, permettent la plus grande liberté de manœuvre et sauvegardent au maximum et dans tous les sens les intérêts primordiaux du malade. L’analyse va jusqu’où elle peut tout autant qu’elle ne s’arrête pas en deçà ! C’est l’état du patient qui en module l’avance et en marque le terme. Il n’y a là, à mon sens, rien qui soit factice ou inspiré par une théorisation abusive ; le sujet abandonne l’analyse après en avoir profité « au mieux », compte tenu de son état certes, mais aussi, soyons réalistes, des possibilités de l’analyste, quel qu’il soit d’ailleurs. Les résistances dites du « Ça » ont été réduites dans la mesure où elles n’étaient que fonctionnelles et conditionnées par des activités du Moi ; le Surmoi s’est assoupli et le Moi, de ce fait, a accédé à de nouvelles relations d’objet ; mais une telle manière de définir le progrès de l’analyse est évidemment tout empreinte de relativité ; elle exprime avant tout le mouvement évolutif résultant d’une analyse chez un sujet donné : il tend à un assouplissement du Surmoi par exemple, ou si l’on veut encore être plus exact, des activités de Surmoi de son esprit, qui ne se trouvent pas remplacées par un Surmoi analytique.