
Critiques de livres
Le site de la Rfp propose des critiques de livres en lien avec sa rubrique papier « Revue des livres ». Dans cette livraison, nous vous proposons 3 lectures:
James S. Grostein, Un rayon d’intense obscurité. Ce que Bion a légué à la psychanalyse par Béatrice Ithier.
Cosimo Schinaia, Figures de la pédophilie. La psychanalyse et le monde du pédophile, par Denis Bouchet-Kervella.
Michel Godefroy, Esthétique et psychiatrie par Laurent Danon-Boileau.
James S. Grostein, Un rayon d’intense obscurité. Ce que Bion a légué à la psychanalyse, Paris, Les Éditions d’Ithaque, 2016.

« Ce livre, écrit Antonino Ferro (2009), constitue une sorte de rêve sur l’ensemble de l’œuvre de Bion qui permet de frayer la voie à un nombre infini d’associations. Un rêve qui n’est pas à décoder, mais qui perpétuellement ouvre la voie à de nouvelles pensées et développe l’aptitude même à penser. » C’est si vrai et en cela si proche de Bion, lui que Grotstein n’a pas manqué de considérer toujours en train de rêver.
Pourquoi ce titre ? Bion communiqua à son analysant Grotstein cette indication de Freud : « Quand on conduit une analyse, il faut projeter un rayon d’obscurité intense afin de mieux faire luire dans les ténèbres ce qui jusque-là avait été obscurci par l’éclat de l’illumination. » Tout le livre se propose à la fois comme un magnifique hommage à son analyste, de même que comme une vaste réflexion sur l’œuvre de Bion dans une mise en perspective des différents liens et articulations qui la composent et l’animent, car cette œuvre est en constant mouvement, elle vit. De même que s’y trouvent aussi entretissées des pensées issues de leur vécu partagé. Toutefois, ce qui contribue à la qualité de ce livre exceptionnel est la manière dont Grotstein, non seulement met en valeur les idées de Bion, dans un mode d’exposition les approfondissant, mais propose aussi son propre développement à partir de ces idées.
Si nous revenons à Bion, nous pouvons ainsi appréhender, à travers Grotstein, une œuvre qui est une formidable théorie de la connaissance commencée par l’identification projective des émotions et des pensées sans penseur, dans la mère, dont la capacité de rêverie et la fonction Alpha vont permettre leur transformation en pensées pensables, en sentiments, en pensées oniriques et en souvenirs. Que propose alors Bion en penseur de la clinique et particulièrement de la séance ? De se défaire de la mémoire et du désir pour faire place à la foi dans la réponse créative de l’inconscient, en supposant une orientation sur l’être et les « transformations » dans, depuis et vers O, la vérité absolue quant à la réalité ultime, ineffable. Ce qui nous conduit d’emblée au Bion « mystique », le plus souvent mal compris, et taxé de religiosité.
L’introduction du livre commence par « Le langage des grands accomplissements » que Grotstein explicite à partir de la communication entre l’enfant et sa mère, le patient et l’analyste, avec cette idée que les émotions charrient la vérité personnelle du sujet. Grotstein met alors l’accent sur la manière dont Bion rêvait en acte ses sentiments et ses écrits. De l’émotionnel, il met en valeur celui partagé, en définissant la réponse émotionnelle entre les deux protagonistes en lien avec une conception de l’inconscient caractérisée précisément par les émotions et l’imagination infinie. De la conception du besoin de l’autre pour devenir soi-même découle la pensée d’une théorie et d’une pratique clinique accordant au couple et à sa rencontre en devenir, le moteur des « transformations ». Les post-bioniens, comme Ferro et Civitarese, les situeront dans « le champ, ou le post-champ ». Il est intéressant de noter que Grotstein a le souci, pas si fréquent, de situer Bion dans le solide ancrage Kleinien, mais avec l’indication d’une assomption de la position dépressive associée à la capacité négative qui permet de ne faire qu’un avec les émotions, permettant ainsi la rencontre avec le Soi créatif infini. Bion, selon Grotstein, visait l’atteinte de la foi et de la capacité négative afin de pouvoir devenir O.
Il nous montre clairement comment Bion a déplacé l’attention exclusive sur les pulsions vers les émotions et restructuré l’idée de pulsions en A, H, C, amour, haine et connaissance, en catégories émotionnelles pour ces liens. Bion, note-t-il, reconsidère la manière dont Freud appréhendait l’onirique en permettant à l’expérience inconsciente du rêve d’être pensée consciemment, alors qu’il entend l’étendre et le soumettre aux pensées du rêve, afin de les rêver. L’analyste, dira Grotstein, devra rêver la séance comme la mère rêve le vécu du nourrisson. C’est ainsi aussi qu’il sera possible de passer de la mentalisation à la pensée, à partir de la transformation des éléments Bêta en éléments Alpha, grâce à la fonction Alpha qui met en place et en ordre la vie émotionnelle. Grotstein ne manque pas de saisir le protocole transformationnel de Bion correspondant à un cycle mental et émotionnel.
Il pose alors avec la dimension du trauma et de la terreur sans nom les divergences d’avec Klein, plus à l’aise dans la psychose infantile souligne Grotstein. Il propose que la divergence provienne, sans doute, du fait que Bion ait ajouté l’infini à la pensée de Klein, ainsi que sa transformation du concept d’identification projective, alors que lui, Grotstein, va définir la transidentification projective comme une activité émotionnelle plus intense. Avec l’introduction du concept contenant-contenu, dont il analysera précisément la fonction qu’il donne à la mère et à l’analyste dans la relation en leur attribuant un état de rêverie qui manifeste la résonance avec l’état du patient, Grotstein insiste sur la nécessité, pour Bion, de s’immerger dans un état réceptif de rêverie, alors que, souligne-t-il, la théorie de l’esprit repose en partie chez lui, précisément, sur le concept de transformation et de rêverie.
Discutant du transcendantalisme de Bion, Grotstein explique que Bion retient les formes idéales qu’il rattache à Platon, alors que l’appareil sensoriel conçoit ces éléments comme « sens commun ». Dénommées « Mémoires du futur », précise-t-il, elles constituent ces instruments de la réalité psychanalytique qui servent à résonner avec O, vérité absolue ou vérité ultime.
Il faut rendre grâce à Grotstein de définir très clairement la métathéorie de Bion, conjuguant à la fois une théorie de la connaissance, une ontologie et une métapsychologie. À nouveau, Grotstein va se référer à Klein, dont la pensée, dit-il, est prolongée « avec élégance ». Cette référence est suffisamment rare pour être à nouveau soulignée. Mais il est vrai que Bion, analysé par Klein, était Kleinien et très proche de Rosenfeld, particulièrement du dernier Rosenfeld qui selon les dires de ce dernier, joua un rôle dans son installation à Los Angeles. Bion décédé, Grotstein reprit son analyse interrompue avec un Kleinien. Mais revenons à cette métathéorie et comment la définit-il ? Il y place la vérité des expériences émotionnelles comme élément central avec, je le cite « la foi comme son gardien et comme présence qui plane au-dessus d’elle, et avec O comme à la fois ce qui initie ces expériences et ce qui les réal-ise. » Ce qui signifie, déclare-t-il, une sorte de transcendance qu’il entend démontrer. Et de se référer à O, le sujet des sujets qui ne peut être ni sujet des sens ni de contemplation. Or, comme il le dit, l’expérience de O est le privilège du sujet ineffable de la psychanalyse. Cet abandon du moi par l’analyste, qui pourrait nous faire penser asymptotiquement à la « dépersonnalisation » chez de M’Uzan, nous fait devenir O, ce que Grotstein propose de conceptualiser sous la terminologie de « position transcendante », qui se développe depuis l’enfance, y compris fœtale, à tolérer, et dit-il, à souffrir, et donc à être en résonance avec O, dénomination de l’être ou de l’existence en soi. On ne peut que penser à ce que Grotstein élabore en termes de « présence ». D’où cette définition afférente du mystique qu’il nous donne selon Bion, à savoir celui qui voit les choses comme elles sont vraiment.
Comme précédemment, Grotstein interroge à nouveau l’édifice kleinien, cette fois au niveau des positions dont on devrait dire, selon lui, qu’elles sont psychotiques tant elles sont omnipotentes. Elles doivent être pensées en termes de défenses maniaques, paranoïdes ou dépressives contre l’émergence de O. Ce qui le conduit à une véritable ontologie de la vérité qu’il oppose à l’objet obstruant qui s’attaque aux pensées et aux liens avec les autres objets, dégagé chez Bion avec ce qu’il décrit de façon saisissante, par exemple, de la projection à l’envers. Dans son analyse du contenant/contenu, qui lui fait suite, Grotstein rappelle les 5 étapes par lesquelles s’est effectué le développement des théories bioniennes :
- Le contenant/contenu et sa formalisation (62),
- La fonction Alpha, comme propriété requise du contenant maternel,
- Les transformations par les fonctions alpha, transformations des contenus d’éléments Bêta correspondant à des impressions sensorielles non mentalisées d’expériences émotionnelles, en éléments Alpha, mentalisés et aptes à la réflexion, à la mémoire, au rêve, etc.
- L’attention conçue comme version spécialisée de la conscience, en tant qu’organe sensoriel réagissant aux qualités psychiques : conscience inconsciente, intuition, etc.
- O, le concept « définitoire » dit Grotstein, eu égard aux conceptualisations antérieures. N’oublions pas ici les transformations en O dont Grotstein va évoquer le refus par ceux qu’il appelle les « kleiniens de Londres ».
- La vérité émotionnelle qui se transforme en O – la Vérité Absolue (indifférente, impersonnelle) quant à la Réalité ultime – en vérité personnelle tolérable (acceptable).
Grotstein semble ajouter ici un septième point, l’unisson, présent chez Bion, puisque la mère, non seulement autorise les communications émotionnelles projetées en elle à « incuber », mais elle leur permet aussi de résonner avec ses propres émotions originaires, issues de sa mémoire d’expériences conscientes et inconscientes. C’est ce qui va permettre le passage, comme Grotstein le souligne, à un sens personnel malgré l’impersonnalité initiale de O. Ne pas penser ce concept contenant/contenu sans référence à l’identification projective constituerait une erreur, car c’est lui qui trame les échanges dans le rapport intersubjectif mère/enfant, comme patient/analyste. Il concevra un seuil minimal de bonté dans ce contenant maternel, mais surtout il nous livre une analyse croisée du contenant/contenu et du holding Winnicottien, extrêmement fine et utile, en grande partie traitée par Ogden dans : « Tenir, contenir, être et rêver » (2005/2012).
Le concept Winnicottien d’environnement contenant : « holding environnement » est utilisé comme synonyme de contenant/contenu chez Bion, déclare Grotstein. Pour Winnicott, explique-t-il, l’enfant kleinien dont cette dernière parle très précisément dans Le Sevrage (1937), est cet enfant actif, et selon lequel le sein est le fondement d’existence. Le second enfant, celui de Winnicott, c’est l’enfant en tant qu’il est. La mère du holding fonctionne en objet d’arrière-plan, se préoccupant de favoriser le développement autonome de son enfant. Ceci m’apparaît être une certaine interprétation du holding de Winnicott dont ce dernier n’a pas son pareil pour expliquer la faillite en termes de holding mécanique, facteur de grave dissociation notamment dans la névrose obsessionnelle. Peut-être que Grotstein, en la caractérisant de « coach existentiel », une présence en arrière-plan de l’identification primaire a-t-il tendance à en diminuer l’importance ? Les soins assurés de manière mécanique, sans ressources émotionnelles et affectives, ont un impact pathologique important chez l’enfant. D’une certaine manière, l’on retrouve cette idée dans la conception de Green de « la mère morte ».
La mère contenante de Bion soutient et absorbe les états émotionnels de l’enfant, en les transformant et en les lui « interprétant ». Or, remarque Grotstein, toutes les conceptions du contenant n’ont pas envisagé la fonction « transcendante » du contenant, par lequel le bébé acquiert la capacité de converser par le biais de la mère/analyste avec son autre Soi, son Soi inconscient infini. Grotstein nous invite, en référence aux ultimes implications de la théorie de Bion, à considérer santé et maladie mentales comme concernant l’activité du contenant, d’abord externe puis internalisé. O et non plus les pulsions, sauf la pulsion de vérité affirme–t-il, devient « cause première ». Tout va se trouver déterminé par les interactions entre O et le contenant.
Grotstein nous introduit alors avec subtilité à la transidentification projective qu’il définit en lien avec l’identification de l’objet avec la projection qui a lieu en lui. Pour Grotstein, elle désigne la forme intersubjective de l’identification projective. Toutefois, selon lui, l’identification projective ne s’exerce pas entre le sujet et l’objet externe mais entre le sujet et sa représentation de lui-même. Ici Grotstein cite le Bion de Cogitations qui affirme qu’il s’agit de la limitation imposée par nos sens qui ne nous permet pas de connaître véritablement la réalité, nous n’avons alors de l’objet qu’une image d’un objet internalisé. Grotstein propose à ce propos la conception d’un « co-sujet » qui forme aussi sa propre image du sujet qui se projette en lui. « Ultimement, une résonance mutuelle induite se produit entre ces deux images. » Nous pouvons donc considérer, et ceci a une incidence clinique considérable, que dans le modèle bionien à deux personnes, (et non freudien ou kleinien à une seule), se produisent de multiples changements dynamiques dans la relation à l’objet dans son rôle de contenant. À nouveau, une comparaison avec la pratique clinique avancée par le dernier Rosenfeld s’impose au niveau de l’exigence de O qui domine sa clinique, en assurant au patient une renaissance authentique, sans apparaître bien sûr sous ce vocable tant la formulation conceptuelle de Bion lui est est spécifique. O, objet de la transformation, devient « le coup de cœur » de la psychanalyse, déclare Grotstein pour affirmer plus avant que O est indifférent et impersonnel. « A, H. C lui donnent la personnalité », à savoir un sens personnel.
L’espace me manque pour déplier ici les différents liens que Grotstein relie dans le système transformationnel Bionien. Le chapitre consacré aux « Transformations » en témoigne particulièrement. Ainsi, nous donne-t-il en exemple la recension de l’outillage théorique absolument nécessaire de l’analyste selon Bion. À propos des Transformation de O et en direction de O, Grotstein souligne que Bion n’a pas discuté ces transformations, or selon lui le sujet « devient » ce qu’il a expérimenté. C’est ainsi que le O impersonnel (ou destin), peut devenir la propriété personnelle du sujet.
Au terme de ce voyage, il me semble nécessaire dans ce commentaire en mouvement de Grotstein, de reprendre « L’activité du rêver » de Bion. Grotstein nous montre très bien comment la rêverie, la fonction Alpha, la barrière de contact, la grille, la césure, toutes ces conceptions qu’il a déployées et que je n’ai pas toutes reprises, appartiennent aux « structures de support » qui sous-tendent l’activité onirique, cette « jumelle » qui rend possible l’activité de pensée. Dans son épilogue, Grotstein, définit la tâche de l’analyste selon Bion comme étant celle de rêver nos émotions et celles de nos patients. Il ajoute : « J’ai distillé le meilleur de Bion en termes d’activité onirique, d’activité de pensée et de devenir, avec pour horizon constant, les idées de Foi et de Vérité émotionnelles. » Quelle meilleure initiation à cette métathéorie que cette approche si remarquable ?
Béatrice Ithier, Psychanalyste, membre de la SPP.
Cosimo Schinaia, Figures de la pédophilie. La psychanalyse et le monde du pédophile, Paris, L’Harmattan, 2017, 372 pages.
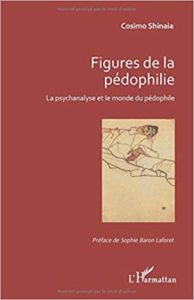
Cosimo Schinaia est psychanalyste, membre formateur de la Société Psychanalytique italienne (SPI). Également psychiatre, il fut médecin-chef directeur du Département de Santé Mentale ASL3 de Gênes, directeur de publication de la revue de psychiatrie La via del sale, rédacteur de la revue de culture psychanalytique Psiche, et auteur de nombreux livres et articles.
Pour cette deuxième édition d’un ouvrage paru en 2001, il s’est entouré de cinq collègues psychanalystes, psychiatres ou psychologues d’orientation psychanalytique, avec lesquels il a constitué un groupe de travail alternant tous les quinze jours des discussions d’un matériel clinique et des recherches culturelles sur le thème de la pédophilie . Ces dernières, très riches, constituent quatre des onze chapitres de ce gros volume, que l’on lira avec beaucoup d’intérêt : le discours mythologique et ses interrelations avec l’inconscient humain (en collaboration avec Clara Pitto) ; l’émergence dans les contes des fantasmes sexuels réciproques entre adultes et enfants (en collaboration avec Franca Pezzoni) ; les personnalités et comportements pédophiles dans le roman (en collaboration avec Paolo Peloso et Giuseppina Tabo) ; la pédophilie dans l’histoire depuis l’âge classique à nos jours, puis dans la pensée médicale et psychiatrique (ce dernier en collaboration avec Paolo Peloso).
Nous nous centrerons ici sur la clinique rapportée.
D’entrée de jeu, Cosimo Schninaia nous annonce que l’épineuse question de la pédophilie sera traitée « avec une attention scientifique rigoureuse et une sensibilité relationnelle respectueuse, sans se laisser envahir par un refus émotionnel défensif » (p. 18). Il s’agit de chercher à « comprendre en profondeur le monde interne de l’abuseur, qui il est réellement, ce qu’il veut, quels sentiments l’agitent, quelles émotions il peut ressentir ou ne pas ressentir, quelles sont les raisons de son comportement » (p. 41), enfin d’élaborer les interventions les plus adaptées à chaque situation clinique.
Car le terme « pédophilie » au singulier lui semble un terme « omnibus », regroupant en amalgame abusif des troubles appartenant à des tableaux psychopathologiques très différents (p. 45), plus ou moins proches selon les cas de la névrose, ou de la psychose, ou des états-limites. Il choisit donc de parler des pédophilies au pluriel, d’autant que les passages à l’acte peuvent survenir de manière sporadique chez certains, et récurrente chez d’autres. Mais il tient avant tout à établir une distinction à ses yeux fondamentale entre perversion et perversité.
La distinction « indispensable » entre perversion et perversité
Concernant la perversité, l’auteur s’appuie sur la description par Claude Balier des auteurs de comportements sexuels violents[1], très proches de la psychose, qui visent l’anéantissement d’un autre mal différencié pour se sauver d’angoisses de dissolution du moi, en un double processus de désobjectalisation et de désubjectivation : chez eux, on est confronté à un profond degré de destructuration psychique, qui se traduit par une absence de pensée réflexive et de symbolisation.
La perversion quant à elle est à comprendre tout autrement, comme une modalité défensive contre l’angoisse de castration et/ou l’angoisse de perte d’objet, où la violence est intégrée et limitée : les capacités de communication, de relation objectale et de représentation sont réduites mais partiellement conservées.
Les chapitres 9 et 10 tentent d’exemplifier cette distinction, en présentant deux cas artificiellement reconstitués à partir de données plurielles empruntées, pour préserver la confidentialité, ce qui explique peut-être leur caractère assez peu probant.
Bien plus convaincants sont les cas exposés dans le travail de groupe (chapitre 11, écrit en collaboration avec Luisella Peretti). Celui-ci permet tout d’abord de travailler les sentiments contre-transférentiels d’angoisse ou de répulsion, et de favoriser une ébauche de familiarité avec les auteurs d’abus par la prise de conscience que les sentiments des adultes envers les enfants sont toujours ambivalents et pleins de zones d’ombre chez tout un chacun.
Un premier cas, « paradigmatique » de perversité, présente une forte dimension paranoïde, et son thérapeute se sent rapidement incompris voire persécuté par le groupe comme par son patient. On assiste, plutôt qu’à un transfert, à « une sorte de transvasement évacuateur des vécus du patient dans le thérapeute », phénomène qui sature émotionnellement les membres du groupe, ce qui les empêche d’écouter le matériel et d’y réfléchir. Le thérapeute en arrive à quitter le groupe, lequel dans l’après-coup comprend que la difficulté à affronter n’est pas seulement le comportement du pédophile mais surtout la nature des troubles psychopathologiques à l’origine de ses conduites : en l’occurrence l’incapacité de penser liée à des angoisses intenses de désintégration et d’annihilation.
Un second cas de perversion, beaucoup moins désorganisé, présente un tout autre fonctionnement, caractérisé par une alternance qualifiée de « déroutante » entre deux polarités opposées : des moments où le discours laisse apparaître des représentations riches et animées, et d’autres moments où les représentations deviennent pauvres et répétitives. Ces deux polarités se retrouvaient dans le groupe : deux clans s’étaient formés. Le premier estimait que le patient cherchait à détourner le regard du thérapeute de l’événement traumatique en explorant tout le reste sur un mode complice (passé, émotions, zones de conflit). Le deuxième se prononçait en faveur d’un travail psychanalytique authentique avec les « bons éléments » du patient, qui en progressant permettrait d’atteindre la zone traumatique à laquelle celui-ci ne peut accéder d’ici-là. Les auteurs préconisent de conserver les deux hypothèses et, sans évoquer le concept de clivage du moi caractéristique selon Freud des perversions[2], proposent l’idée d’un développement disharmonieux résultant de traumatismes qui auraient arrêté le développement dans certaines aires relationnelles, alors que d’autres ont pu évoluer : « en lui coexistaient différents stades de développement » (p. 329). Ainsi, le groupe aide le thérapeute à faire face à l’expérience de perte de sens, et à porter sur son patient « un regard nouveau ».
Quels traumatismes infantiles chez les pédophiles ?
Chez Freud, l’abandon de la Neurotica dans sa lettre à Fliess du 21 septembre 1897 affaiblit la valeur et le sens jusque-là attribués par lui aux traumatismes sexuels réels subis pendant l’enfance au profit de l’existence des fantasmes de séduction, auxquels il adjoindra en 1910 l’importance des mécanismes d’identification à la mère chez les pédophiles dans son étude sur Léonard de Vinci[3]. Par la suite, il réfèrera la formation des perversions à l’angoisse de castration et non plus, comme en 1905, à une fixation aux étapes normalement traversées et surmontées par l’enfant « pervers polymorphe ».
Cosimo Schinaia rappelle fort opportunément une certaine vogue militante qui, dans les années 1980, a voulu défendre l’idée que tous les souvenirs d’abus sexuel évoqués en psychanalyse auraient une réalité historique, avant qu’on reconnaisse dans ces faux souvenirs l’influence de la suggestion.
Il souligne que la plupart des psychanalystes contemporains défendent l’idée que l’essentiel des traumatismes subis par les pédophiles sont bien davantage d’ordre narcissique que sexuel. Il cite de nombreux auteurs, tel Socarides (1988, 2004), pour qui il s’agit de frustrations libidinales précoces, l’union avec l’enfant représentant le désir d’incorporer le sein maternel et de compenser l’absence ou l’insuffisance de soins maternels réels : on note dans leur histoire des expériences de séparation prématurée ou d’abandon, et le manque de présence paternelle. Il cite également Arundale (1999), qui insiste sur l’idéalisation du soi : les humiliations et la relation interdite avec la mère sont effacées et triomphalement remplacées par l’enfant adoré qui recevra attention et amour à profusion. Ainsi, la sexualisation de l’enfant intervient pour masquer le vide avec du « faux plein », en une opération maniaque débusquée par Janine Chasseguet-Smirgel (1985). Il cite aussi Joyce McDougall (1990), qui estime que les perversions correspondent à une tentative d’auto-traitement de profondes blessures narcissiques.
Cosimo Schiania nous donne sa propre définition du traumatisme : « Le vrai traumatisme est celui dont on ne peut faire l‘expérience psychique et symbolique, du fait que le moi se trouve hors combat et en état d’impuissance. ». La thérapie doit donc tendre à « développer l’appareil à penser du patient ». Pour cela, il faut rechercher les microtraumatismes survenus lors des premiers soins maternels, en faisant l’expérience dans la relation thérapeutique de ce qui n’a pu être vécu lors de l’événement. Le thérapeute doit alors répondre à la demande de partage émotionnel, reconnaître les éléments de réalité et la légitimité des affects associés (sentiments d’injustice, de rage, de douloureuse impuissance), le tout nécessitant une auto-analyse soutenue impliquant souvent la référence à une écoute tiercéisée. Car la relation avec les pédophiles est parfois difficile à soutenir en raison des mouvements de méfiance et d’agressivité du patient lorsque le traitement est imposé, et lassante en raison de la répétition. Il faut alors se souvenir que pour Freud la pulsion de répétition est aussi un acte de transfert, et persister dans la continuité d’une écoute suffisamment attentive pour entendre leurs souffrances cachées.
En conclusion : Cet ouvrage agréable à lire et extrêmement documenté (bibliographie de 35 pages !) démystifie brillamment la représentation trop répandue des tendances pédophiles comme étrangères à l’humanité. Il montre par ailleurs, parmi les auteurs d’abus sexuels commis sur des enfants, l’extrême variété des organisations mentales sous-jacentes, malgré l’existence chez tous de traumatismes narcissiques plus ou moins difficiles à aborder et élaborer.
Denise Bouchet-Kervella, Psychanalyste, membre de la SPP.
[1] cf le livre de Claude Balier, Psychanalyse des comportements sexuels violents, Paris, Puf, 1996.
[2] cf les deux articles de Freud « Le fétichisme » (1927) et « Le clivage du moi dans les processus de défense » (1938).
[3] cf « Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci », OCF-P, X, 1993.
Michel Godefroy, Esthétique et psychiatrie, Paris, L’Harmattan, 2017, 203 pages.

Le terme d’esthétique est ambigu, et c’est cette ambiguïté qui fournit à Michel Godefroy la profondeur et la justesse de son propos. Il s’agit pour lui de voir comment l’aisthésis, la connaissance du monde par les sens, s’organise d’une esthétique, d’une philosophie naturelle du beau engendrant des mouvements conflictuels et des violences parfois fauteurs de troubles psychiques chez le sujet, en particulier lorsque celui-ci, submergé, ne parvient plus à les organiser.
Pour argumenter ce point de vue original, l’auteur s’appuie sur une solide érudition philosophique, psychiatrique et psychanalytique ainsi que sur une longue pratique de médecin psychiatre ouvert à la prise en compte de la psychanalyse. D’une certaine façon, il s’agit ainsi de souligner ce qui établit le lien entre les deux sens du terme grec d’aisthésis qui sert de point de départ à la réflexion. Aisthésis désigne en effet tout ensemble la saisie par les différents sens de la réalité extérieure au sujet mais également la compréhension, l’appréhension intellectuelle qu’il peut faire de cette même réalité. Ainsi se trouve souligné, pour peu que l’on s’en remette à la vie des mots, que l’une ne saurait aller sans l’autre.
En maints endroits l’ambiguïté de la notion d’esthétique permet ainsi à l’auteur de faire travailler et d’enrichir des conceptions classiques. Tantôt celles de Melter sur le conflit esthétique (lorsque l’enfant découvre simultanément les sources de satisfactions que lui fournissent la peau et les seins de sa mère, tandis que le regard de celle-ci fait signe vers une intériorité, une autonomie d’investissement et le confronte à ce qui lui échappe en elle d’un intérieur qu’il ne saurait directement atteindre) tantôt celles de Racamier, notamment dans la différence qu’il établit entre personnation et personnalisation. Toutefois, l’aspect le plus novateur de cet essai réside, de mon point de vue, dans l’analyse de ce qui a pu être nommé « syndrome de Stendhal ». Cette manifestation de la psyché offre en effet un éclairage singulier sur la liaison intime qu’entretiennent le contact avec le beau et l’affect d’inquiétante étrangeté. Après avoir rappelé à la faveur de ce syndrome que l’exaltation suscitée par le contact de la beauté n’est pas nécessairement fauteuse d’allégresse mais qu’elle peut au contraire être le point de départ d’un trouble dont les manifestations somatiques, lorsqu’elles s’avèrent, peuvent emprunter aux différents registres du malaise, l’auteur interroge en somme la question du sentiment du beau et celle de sa caractérisation qui ne saurait être uniquement rapportée à un gain de plaisir. Il rappelle à ce propos la description que Stendhal fournit de son premier contact avec Florence : « J’étais dans une sorte d’extase par l’idée d’être à Florence et le voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tableaux. Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire […] J’étais arrivé à ce point où se rencontrent les sensations célestes donnés par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croche, j’avais un battement de cœur ce que l’on appelle les nerfs à Berlin. La vie était épuisée chez moi, j’avais la crainte de sombrer » (Stendhal, Rome Naples et Florence, p. 206-207, Paris, Michel Lévy Éditeur, 1854). Cet ébranlement identitaire occasionné par la rencontre avec le beau est l’un des temps forts de la réflexion de l’auteur. Il montre notamment que l’interrogation qu’elle suscite retrouve pour partie le chemin des considérations meltzeriennes sur le conflit esthétique et ce qu’il envisage au départ des mouvements psychiques suscités par l’énigme que constitue pour le très jeune enfant l’émerveillement inquiet causé par le contact avec une mère dont l’intériorité lui échappe.
Ce livre riche et divers est donc une exploration remarquable de points de contacts insoupçonnés entre Esthétique et Psychiatrie.
Laurent Danon-Boileau, Psychanalyste, membre de la SPP

