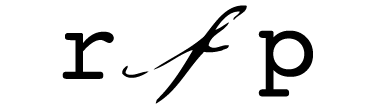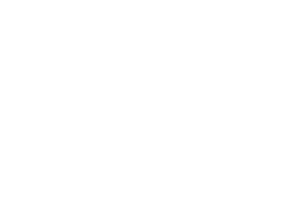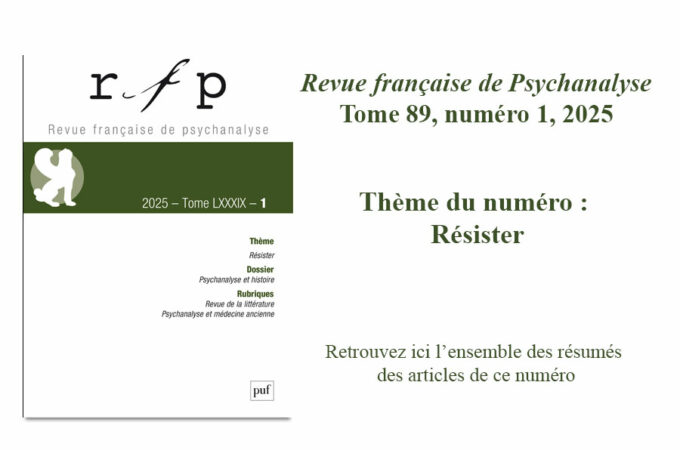
89-1 Résumés des articles
THÈME : RÉSISTER
Résistance en séance
Cécile Prudent, Benjamin Levy – Lycanthropie et résistance au soin. Le levier thérapeutique d’un travail sur le symbolique
RÉSUMÉ – À travers le récit de cas de Mélanie, une patiente résistante aux soins depuis de nombreuses années, nous étudions dans cet article les processus de changement envisageables dans la mélancolie. L’établissement d’un lien de confiance grâce à la poursuite sur le long terme d’entretiens thérapeutiques – bien que difficile au départ en raison du traitement ambivalent de l’objet dans la mélancolie – apparaît comme une issue. Nous montrons que la relation transférentielle avec le patient est dans l’analyse un outil permettant d’accéder à des processus de changement aux niveaux de la dynamique pulsionnelle, des identifications et des capacités de symbolisation. Chez Mélanie, l’idée de métamorphose en loup (lycanthropie) et l’activité onirique qui s’y rattache sont utilisées comme un levier thérapeutique ouvrant la voie à une transformation de l’économie psychique, jusqu’à inaugurer une ébauche de rapport structurant à l’interdit, au manque et au refoulement.
MOTS-CLÉS – mélancolie, lycanthropie, résistance, transfert, métamorphose, processus de changement.
Dinah Rosenberg – Les interventions ratées
RÉSUMÉ – Cet article interroge la résistance de l’analyste dans la cure à partir de l’exemple d’une situation clinique où cette résistance se manifeste par une double difficulté à garder le silence et à intervenir d’une façon précise et concise. Ce cas est interrogé en regard d’une revue de certaines interventions de Freud avec l’homme aux rats, telles qu’elles apparaissent non dans le cas publié, mais dans le journal de la cure. Cette difficulté de l’analyste est alors vue comme un arrimage à une théorie ou à une construction sous-jacente à l’intervention qui évite des orages transférentiels et fonctionne pour l’analyste à l’instar d’un rêve typique sans associations véritables. La capacité à rêver, interprétée comme une capacité à être seul en présence du patient, peut se retrouver à la faveur d’un moment d’humour hors séance pour l’analyste permettant l’advenue d’un surmoi analytique plus souple. La difficulté trouve un début d’interprétation possible dans ce qu’amène le silence qui avait été évité.
MOTS-CLÉS – résistance, rêve typique, contre-transfert, silence, Homme aux rats, intervention.
Travail de mémoire
Armelle Hours – Créer… Résister ? Réflexions encouragées par un tableau de Zoran Mušič
RÉSUMÉ – L’art peut-il assurer ce rôle crucial du côté d’une position de résistance face à la barbarie ? La résistance dans le champ de la création se dirige non seulement vers la restauration, la transformation, mais aussi la continuité. À l’appui d’un tableau de Z. Mušič, « Nous ne sommes pas les derniers T.8 », nous examinerons le(s) pouvoir(s) de l’œuvre. D’abord, nous nous pencherons sur l’histoire de cette toile. Cette œuvre se visite, à la fois comme un travail de création, comme un témoignage, et comme une alerte. Nous nous pencherons ensuite sur la possibilité qu’a l’œuvre de montrer ce qui ne peut se dire. Ensuite, nous tenterons de repérer les vertus de l’œuvre du côté de l’espace intersubjectif. L’artiste participe alors, non seulement à la créativité trouvée/retrouvée, au rétablissement de la continuité historique, mais aussi à la restauration du nouage entre les destins individuels et collectifs. Le travail de l’artiste équivaut ainsi à un travail de civilisation.
MOTS-CLÉS – trauma collectif, art, création, résistance, intersubjectivité, civilisation.
Yan Bylon – L’écriture de la pensée postcoloniale. Esquisse d’une réflexion sur le négatif entre-mères
RÉSUMÉ – L’auteur s’intéresse à l’écriture de la pensée postcoloniale en tant qu’elle met au travail un négatif dans l’affiliation culturelle. En appui sur une écriture d’analysant héritier de la colonisation esclavagiste reposant sur deux crimes contre l’humanité que sont le génocide des Amérindiens des Caraïbes et la traite des esclaves noirs déportés d’Afrique, il soulève trois enjeux : faire hériter les ancêtres, déloger les tabous du lien postcolonial et la Weltanschauung des descendants de la colonisation esclavagiste aux Antilles. Son écriture s’accompagne des écrits de penseurs caribéens tels que Hannibal Price, Paulette Nardal, Jean-Price Mars, Aimé Césaire ou encore Frantz Fanon, pour penser le conflit du colonisé en quête de subjectivation du drame colonial esclavagiste. L’auteur invite alors à penser la violence entre l’esclave et le maître, son enjeu de dénonciation vers l’énonciation par l’écriture pour conquérir la capacité d’aimer l’histoire des ancêtres sans sépulture.
MOTS-CLÉS – écriture, héritage, alliance inconsciente, esclavage, colonial.
L’entrée en résistance
Christophe Dejours – Pourquoi la psychanalyse serait-elle concernée par la résistance ?
RÉSUMÉ – La résistance est entendue ici comme une posture, voire une pratique consistant à refuser de collaborer à un régime anti-démocratique. Dans la clinique, c’est souvent à propos du travail que la question de la résistance surgit dans la cure : ambivalence vis-à-vis de la « souffrance éthique », lorsque le patient, sous la pression de la nouvelle domination managériale, se voit contraint d’apporter son concours à des pratiques que le sens moral réprouve. Le risque psychique est d’abord de compromettre les conditions éthiques de la sublimation et de mettre à mal toute l’économie psychosomatique. L’ambivalence entre résister ou se soumettre peut être perlaborée, à condition d’aller chercher dans la prime enfance les conditions qui ont été faites à l’enfant, ou bien d’entrer en conflit avec l’autre adulte qui le tolérait (noyau de l’autonomie), ou bien au contraire d’avoir dû capituler sous l’effet de la violence de l’adulte (« prédisposition » à la servitude volontaire).
MOTS-CLÉS – démocratie, résistance, travail, sublimation, souffrance éthique, névrose de guerre.
Christelle Lebon, Andrey Andrès et Fanny Maccariello-Garcia – La crainte de l’effondrement en psychiatrie : défenses et résistances
RÉSUMÉ – À partir d’une clinique de la formation en institution, les auteures questionnent l’état de la psychiatrie française. Démontrant que les professionnels souffrent d’un effondrement psychique collectif qui a déjà eu lieu, au sens winnicottien, sans avoir été éprouvé, elles soutiennent la nécessité d’accompagner un processus groupal de symbolisation au sein des dispositifs de formation. L’analyse des défenses, mais aussi des résistances à la psychanalyse dans ces espaces, leur permet de convoquer des modèles théoriques étayants (l’analyse transitionnelle, la position nostalgique-mélancolique et la subversion transitionnelle), tout en montrant l’appui nécessaire sur la groupalité des intervenants-analystes et leur capacité à retisser du lien au sein des institutions. La construction d’un cadre qui ne va plus de soi, dans une pratique de formation devenue clinique du traumatisme, est interrogée au même titre que le recours à l’histoire, l’art et la culture.
MOTS-CLÉS – psychiatrie, formation, acrasie, institution, traumatisme, analyse transitionnelle, résistance.
Wilfried Morice – Jusqu’ici, tout va bien (sur la psychanalyse en institution)
RÉSUMÉ – Se reportant à une expérience personnelle de rejet violent de la psychanalyse d’une institution et au constat général de la chute de sa représentation et de son influence dans les sphères soignantes et universitaires, les sources de ce déchaînement de destructivité sont recherchées. L’institution, au carrefour de l’individuel et du collectif, constitue un objet d’étude privilégié. Au regard du nombre appréciable d’analystes qui y exercent, il est plutôt peu investi par les auteurs. L’attachement à la méthode freudienne, promue et déployée dès L’interprétation du rêve, de travail contre les résistances et demeurant asservie à la dimension du sexuel infantile, accorde pourtant un dégagement vis-à-vis de certaines résistances, dont les analystes ne sont eux-mêmes pas préservés. « Faire travailler Freud », et particulièrement les apports du Malaise dans la culture, renouvelle l’observation d’un narcissisme dans sa dimension mortifère aux sources de cette dynamique destructive. Des modalités d’expression de la résistance dans, à, de, par la psychanalyse et les psychanalystes peuvent être ainsi décrites.
MOTS-CLÉS – institution, résistance, narcissisme, métapsychologie, malaise.
Yannick Milleur – Le complexe héroïque : une réponse de résistance aux situations désespérées en psychiatrie
RÉSUMÉ – Dans le contexte actuel de crise majeure de la psychiatrie, face au désespoir et à l’épuisement qui gagne les équipes, plusieurs formes de résistances inconscientes peuvent émerger, visant à sauvegarder le collectif, les individus ou encore les deux simultanément. Au sein du groupe soignant est ainsi mobilisé ce que l’auteur propose de nommer le complexe héroïque. Lorsqu’une situation de soin catastrophique devient une menace de négligence ou de maltraitance pour les patients, un ou plusieurs membres du groupe sont traversés par une impulsion de résistance et s’érigent de manière irrépressible et transitoire en place d’idéal, se faisant ainsi hérault du collectif, en proposant une ultime solution. L’auteur met en évidence plusieurs formes et devenirs du complexe héroïque, en examinant son intérêt clinique, ses conditions d’existence symboligènes, ses limites, ainsi que le but auquel il tend : la réinstauration d’un idéal et d’un surmoi protecteur, visant la refondation de la scène originaire du soin.
MOTS-CLÉS – résistance, héros, complexe héroïque, psychiatrie, crise, équipe
Dossier : Psychanalyse et Histoire
Carlo Ginzburg – Airs de famille et arbres généalogiques. Deux métaphores cognitives
RÉSUMÉ – Une étude de cas basée sur deux métaphores cognitives, étroitement liées à des images. La série de photographies superposées des portraits de membres d’une famille est une expérience réalisée par Francis Galton, évoquée par Sigmund Freud, et analysée par Ludwig Wittgenstein et Gregory Bateson. Le diagramme des arbres généalogiques, qui montre la relation généalogique entre une série de manuscrits d’une même œuvre, a été proposé par Jacob Bernays, l’oncle de Martha Bernays, l’épouse de Sigmund Freud. Les implications de ce diagramme (ainsi que, plus généralement, du travail de Bernays) n’ont pas échappé à l’attention de Freud.
MOTS-CLÉS – Galton, portraits composites, eugénisme, Bateson, Wittgenstein, J. Bernays, philologie, airs de famille, arbres généalogiques.
Alain Boureau – Irisations. Quelques teintes historiennes de la psychanalyse
RÉSUMÉ – L’instant de la parole comme matière, objet et levier de la psychanalyse, peut-il appartenir à la durée longue de l’histoire ? Pour exclure une continuité simple entre psychanalyse et histoire, on tente de relier l’activité analytique à une création au sens aussi bien esthétique que religieux : faire du neuf avec du vieux, rendre visible ou audible au monde ce qui était chaos et magma. On considére d’abord, chez Freud, le déploiement des traces du passé par l’analyse des artistes et de leurs névroses. Puis, on note qu’ainsi un autre mobile, la fascination pour le visible, convoquait l’histoire en pérennisant l’instant de l’écoute. Enfin, à partir de l’exemple de la pensée scolastique et en particulier celle de Nicole Oresme (XIVe siècle), on propose l’hypothèse de cycles historiques où l’homme explore l’impensé d’une parole qui excède de toutes parts la connaissance de la langue. Ce processus exclut la linéarité de l’influence et assemble les fragments d’une Histoire discontinue.
MOTS-CLÉS – sublimation et névrose, pensée scolastique, Nicole Oresme, Alexius Meinong, Histoire discontinue.
Blaise Dufal – Les liaisons de la carpe et du lapin. Esquisse métaphorique des rapports entre histoire et psychanalyse
RÉSUMÉ – Les rapports entre l’histoire et la psychanalyse dans le cas français sont à la fois ténus et complexes, objets de diverses évolutions et caractéristiques de quelques figures intellectuelles majeures. Pour renouveler le récit historiographique de ces entremêlements, l’usage de certains dispositifs narratifs de la psychanalyse permet de déplacer un peu le regard pour mieux décrire quelques moments importants de ces rapports entre deux disciplines qui s’attirent et se repoussent. Ce sont des relations contrariées depuis l’histoire-problème des Annales qui évacue la psychanalyse Avant-guerre, et le projet de la psychologie historique très influent chez les historiens pendant plusieurs décennies, puis des liens plus intenses avec l’histoire des mentalités et certaines trajectoires intellectuelles individuelles remarquables, jusqu’à la saisie des questions de mémoires contemporaines à l’aide des outils psychanalytiques.
MOTS-CLÉS – historiographie, psychologie historique, Annales, histoire des mentalités, mémoire.
Hervé Mazurel – Historiciser l’inconscient – Entretien
RÉSUMÉ – Si l’historicisation de la psychanalyse est chose désormais bien avancée, cet entretien explore la possibilité d’historiciser jusqu’à l’objet-princeps de la psychanalyse, à savoir l’inconscient lui-même. Car là gît peut-être la raison profonde du dialogue souvent plein de malentendus et encore trop souvent infructueux de l’histoire et de la psychanalyse.
MOTS-CLÉS – altérité, Inconscient, historicité, mémoire, affects.
Sophie de Mijolla-Mellor – Psychanalyse et Histoire
RÉSUMÉ – Construire son histoire est pour tout sujet une nécessité pour pouvoir se penser et s’auto-investir dans une réalité tant extérieure que psychique qui lui demeure pour une bonne part inconnue. On ne s’étonnera pas dès lors que l’appropriation d’un savoir sur soi-même, telle que la cure psychanalytique en soutient le processus, rencontre des interrogations qui sont propres à l’Histoire. Parler de « l’Histoire» et de la « Psychanalyse » conduirait à construire une approche épistémologique à partir d’une investigation psychanalytique centrée sur les conditions de production psychique de ces discours et sur la situation d’interlocution. En revanche, dans une perspective en interaction avec la précédente, l’interrogation sur la psychanalyse elle-même, comme méthode d’investigation issue d’une théorie de la cure et de la psyché, peut partir des emprunts de modèles que la psychanalyse fait à diverses régions de la rationalité, et notamment à l’Histoire, pour explorer l’usage et les limites de ces emprunts.
MOTS-CLÉS – archéologie, archives de la mémoire, auto-historicisation, modèle historique en psychanalyse, vérité.
Luiz Eduardo Prado De Oliveira – La psychanalyse entre histoire et biographie. Propositions méthodologiques
RÉSUMÉ – Cet article vise à mettre en lumière le surgissement progressif d’une méthode pour l’approche de l’histoire de la psychanalyse par les psychanalystes. Certains de ses paramètres mûrissent depuis longtemps ; d’autres sont récents. La relecture de quelques historiens majeurs de cette discipline est l’occasion d’attirer l’attention sur leurs contributions. L’histoire de la psychanalyse est liée à des traumatismes à répétition. Leur perlaboration permet la parution des premières histoires d’ensemble de la psychanalyse. L’entrée en scène de nouvelles autrices et de nouveaux auteurs, notamment en provenance d’Autriche, l’apport de nouvelles archives exigent la définition de méthodes pour l’établissement d’une histoire de la psychanalyse à la fois globale et basée sur des éléments objectifs.
MOTS-CLÉS – historiographie, biographie, intertextualité, contextualisation, périodisation.
Laurence Kahn – Le détail et l’incarnation
RÉSUMÉ – Le « tournant linguistique » et le relativisme qui découla du refus de n’accorder au fait d’autre existence que linguistique ont frappé d’une manière assez analogue les champs de la psychanalyse et de l’histoire. D’une part, en ce que la référence à la réalité, fruit d’une construction à partir d’éléments convergents, fut dès lors fortement suspectée. Et, d’autre part, en ce que, la subjectivité opérant justement sur le terrain du maniement du langage, la neutralité de l’historien comme celle du psychanalyste fut soupçonnée d’être sujette à distorsions. Rhétorique trompeuse, illusion référentielle et suggestion conduisirent à l’abandon de l’espoir d’accéder à un régime de vérité. Pourtant, si la mise à l’épreuve de la représentation en histoire impliquait d’éprouver les limites de l’inventivité, et si ces limites semblaient bien imputables au rôle du fantasme dans l’inventivité elle-même, le problème de savoir comment peut se « perlaborer » un fait historique demeurait intact. La fonction du transfert de l’historien sur son objet et le rôle de l’incarnation dans l’analyse du détail sont ici envisagés à propos de la Shoah.
MOTS-CLÉS – relativisme, négationnisme, réalité, transfert, incarnation, perlaboration.
Rubriques
Rafaela Alves – L’obésité et l’inscription du manque : une revue de la littérature
RÉSUMÉ – Dans cet article, nous entreprenons une analyse critique de la littérature consacrée à l’obésité en utilisant le prisme de la psychanalyse comme cadre théorique. Notre revue de la littérature englobe une période s’étendant des années 1970 à nos jours. Nous mettons particulièrement l’accent sur les travaux d’auteurs français et américains de renom. Les principaux thèmes abordés par ces auteurs gravitent autour de la compréhension des causes de l’obésité, des mécanismes opératoires sous-jacents, ainsi que de la perception d’un déficit de symbolisation émotionnelle au sein de cette population. De plus, l’obésité est envisagée comme un potentiel effet d’un trouble narcissique. Nous avons identifié que la question de la séparation d’avec l’Autre et la manifestation du manque de l’objet primaire constituent des points de convergence entre différentes perspectives théoriques.
MOTS-CLÉS – trouble narcissique, pensée opératoire, psychosomatique, hyperempathie, alexithymie, séparation
Cecilia Perczyk, Gabriel Lombardi, Céleste Labaronnie – Virginité et pathologies féminines : Freud face aux médecines hippocratiques
RÉSUMÉ – Dans « Le Tabou de la Virginité », Sigmund Freud rappelle qu’une valeur suprême est accordée à l’intégrité sexuelle des femmes, ce qui l’amène à affirmer que la défloration peut déclencher une réaction d’hostilité à l’égard des hommes, et même prendre des formes pathologiques, comme la frigidité, faisant de la vierge une figure dangereuse. La même notion de danger associée à la virginité est mise en évidence dans un texte de la médecine antique grecque : le traité hippocratique « Maladies des jeunes filles ». Le traité identifie une maladie spécifique pour les vierges dont la cause est la perpétuation de la virginité. Nous visons à identifier les prémisses sous-jacentes des deux écrits afin d’élucider les aspects opaques du texte de Freud. L’objectif de cette comparaison est de fournir des éléments de réflexion sur la représentation des femmes à partir d’une approche psychanalytique de la figure de la vierge.
MOTS-CLÉS – virginité, psychanalyse, médecine hippocratique, femme.